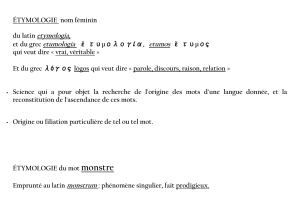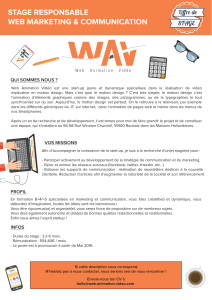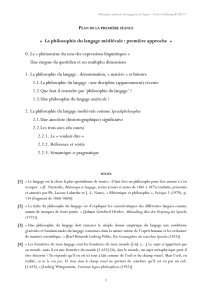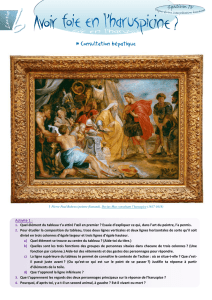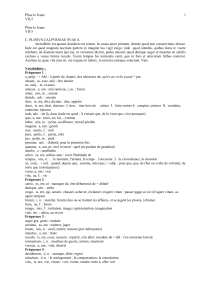1
Divergences d’Écoles et hérésies sur la grâce
suffisante et la grâce efficace
Abbé Bernard Lucien
2025
Table des matières
Table des matières ............................................................................................................. 1
Exposé janséniste sur la grâce suffisante et efficace ................................... 2
Position d’Arnauld ............................................................................................................................... 2
Autre forme de la thèse janséniste .............................................................................................. 3
Exposé moliniste ........................................................................................................... 4
Exposé selon l’Augustinianisme ............................................................................. 6
Exposé du système ............................................................................................................................. 6
Conception particulière des deux états de l’homme innocent et de l’homme déchu.................................... 6
La délectation victorieuse ................................................................................................................................... 7
Les deux autres thèses de l’Augustinianisme .................................................................................................. 8
Critique théologique de l’Augustinianisme .............................................................................. 8
Augustinianisme modéré ................................................................................................................. 9
Exposé thomiste classique ........................................................................................ 9
Généralités ............................................................................................................................................. 9
La grâce efficace ............................................................................................................................... 10
La grâce suffisante .......................................................................................................................... 11
Annexe : Comment le libre arbitre met-il obstacle à la grâce ? .................................. 12
1. Données brèves ........................................................................................................................................................ 12
2. Supplément sur la résistance à la grâce ................................................................................................................ 13
3. La connaissance du péché par Dieu ...................................................................................................................... 16

Thomisme – Augustinianisme – Molinisme – Jansénisme
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2
La grâce prochainement suffisante confère à l’homme le pouvoir « complet et tout
prêt » d’agir dans l’ordre surnaturel. La question disputée entre théologiens catholiques est alors
la suivante :
la volonté humaine élevée par cette grâce pose-t-elle de fait les opérations
surnaturelles en acte second sans autre secours, ou a-t-elle besoin de l’application d’une grâce
supplémentaire pour passer de la puissance à l’acte ?
Avant de présenter les deux principales positions catholiques (position moliniste et
position thomiste ; d’autres théories sont brièvement exposées dans le cours) nous expliquerons
la doctrine janséniste afin de mieux situer son erreur et sa différence avec les systèmes
catholiques.
Exposé janséniste sur la grâce
suffisante et efficace
Après la condamnation des « cinq propositions » [Innocent X, Const. Cum occasione
adressée à tous les fidèles, 31 mai 1653 ; D 1092 – D 1096, DS 2001 – DS 2007. Les
propositions 1, 2 et 4 nient en fait la grâce suffisante], les jansénistes les reconnurent en
général fausses « ut sic » sur le plan doctrinal, et cherchèrent à se recommander du thomisme.
Ils en vinrent donc à admettre la grâce suffisante, sous deux formes principales, toutes deux
insuffisantes.
Position d’Arnauld
• En 1651 (donc avant la condamnation des « cinq propositions »), Arnauld n’admet aucune
autre puissance pour le bien que la puissance purement passive et vide de la nature (capacité
obédientielle de recevoir la grâce), et aucune autre grâce que la grâce efficace qui n’apporte jamais la
puissance prochaine sans l’acte.
• En 1656 (après la condamnation) :
– Arnauld admet que si les justes manquent parfois de la grâce efficace, ils ont toujours, par le
secours d’une grâce intérieure, le pouvoir d’observer les commandements et de vaincre les tentations.
Il semble bien qu’ici Arnauld accepte à peu près la grâce suffisante telle qu’elle est comprise* par
Alvarez, o.p. et beaucoup de thomistes.
* C’est-à-dire : grâce actuelle qui complète la puissance opérative « in ratione potentiae et actus
primi ». En sorte qu’il ne manque à la puissance, pour opérer effectivement, que l’opération
même ou l’application effective à l’opération, effet propre de la grâce efficace.
• Donc Arnauld a réellement fait un grand pas vers l’orthodoxie. Malheureusement, il veut en
même temps maintenir sa proposition :
« Aux justes qui peuvent, avec la grâce suffisante, faire le bien et vaincre les
tentations, il manque parfois la grâce [efficace] sans laquelle on ne peut rien faire. »
• En outre, pour s’accorder avec les thomistes et l’orthodoxie, Arnauld aurait dû répondre à la
question suivante : pourquoi et comment les justes, qui ont la grâce suffisante, et qui possèdent la
grâce sanctifiante, sont-ils dépourvus de la grâce efficace ?

Thomisme – Augustinianisme – Molinisme – Jansénisme
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3
Arnauld, dans l’analyse de la chute de saint Pierre, insinue que c’est par une suspension, un
défaut de miséricorde du côté de Dieu par rapport à l’âme juste. Pour les thomistes, c’est parce que
l’âme juste, par sa faute, a dérogé aux conditions prérequises pour que la grâce efficace soit accordée.
Autre forme de la thèse janséniste
• Tous les justes, ayant l’amour de Dieu, ont le pouvoir suffisant de faire le bien, en général et
absolument parlant ; mais ils n’ont pas toujours le pouvoir suffisant relativement à tel commandement,
dans telles circonstances, face à telles tentations...
C’est à ce propos que l’on parle de « petite grâce » ; l’École augustinienne retiendra cette
notion, tout en s’efforçant de se démarquer de l’erreur janséniste.
• En réalité, c’est la négation de la suffisance de la grâce et de la liberté : si la grâce n’apporte
pas un pouvoir proportionné au devoir présent, on ne peut dire en vérité qu’elle suffit, qu’elle apporte
un pouvoir suffisant.
• En fait on retombe dans la première des cinq propositions condamnées de Jansénius :
"1. Aliqua Dei praecepta hominibus iustis volentibus et conantibus, secundum
praesentes quas habent vires, sunt impossibilia; deest quoque illis gratia, qua possibilia fiant."
Si l’on veut cerner l’erreur radicale de ces thèses, qui touche la liberté, il faut pousser
plus loin l’analyse.
– Arnauld accorde :
dans le cas d’une « petite grâce » [= faible charité], l’homme cède à la tentation, parce
qu’il n’a pas voulu ; s’il avait voulu, il aurait pu.
– On insiste :
il n’a pas voulu, parce qu’il n’a pas pu vouloir.
– Arnauld répond :
non, mais parce que son esprit était aveuglé par l’ignorance, ou sa volonté retenue par
la glu de quelque amour dépravé ; de cette affection, il n’y a pas d’autre cause que la volonté
défectueuse elle-même, cause première du péché.
→ C’est bien, mais à condition que la volonté soit en défaut dans et par son propre
libre choix, non si elle est en défaut par suite d’un état d’impuissance qui ne dépend pas
d’elle. Car la défectuosité de la volonté peut se concevoir de deux façons :
a) la volonté se porte librement, en vertu de son choix, à un acte défectueux plutôt
qu’à l’opposé qu’elle pouvait vouloir ;
b) la volonté comme puissance volitive est dans un état défectueux ne lui laissant pas
le pouvoir de préférer l’acte bon.
Autrement dit :
en (a) la volonté agit défectueusement « quia vult deficienter » ;
en (b) la volonté agit défectueusement « qui est deficienter ».
Bien comprendre
On peut admettre que la volonté va toujours vers ce qui l’attire le plus [la volition
actuelle porte sur ce qui est préféré] mais :
a) cette prédominance de l’attrait peut être dans l’objet présentement voulu comme
un effet de la volonté subjective qui entre deux biens la sollicitant, et vers lesquels elle pouvait
se porter, a décidé d’aller de préférence vers l’un ;
b) cette prédominance peut se trouver dans l’objet comme cause productrice,
adéquate, nécessitante du mouvement subjectif de la volonté.
En (a) la volonté est libre et responsable, en (b) non. Cf. De Malo q1 a3 cité par
Guillermin, RT 1902, 58.
(b) c’est la « délectation victorieuse » des Jansénistes.

Thomisme – Augustinianisme – Molinisme – Jansénisme
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4
N.B.
Cette divergence entre Thomistes et Jansénistes se retrouve pour la grâce efficace.
Jansénistes
La grâce est efficace parce qu’elle produit infailliblement dans la volonté la délectation
victorieuse à la suite de laquelle la volonté se détermine.
Thomistes
La prémotion physique meut infailliblement le libre arbitre à rendre lui-même, par son
choix préférentiel entre divers biens, son attrait prépondérant d’un côté plutôt que de l’autre. La
motion divine précède (« ratione et natura ») notre opération volontaire mais elle ne pose pas dans
notre volonté, antérieurement à notre volition, une inclination formelle prépondérante d’un
côté plutôt que de l’autre. Elle fait que la volonté veuille elle-même, librement, s’incliner dans un
sens plutôt que dans l’autre.
Exposé moliniste
Rappel : il s’agit là d’une doctrine libre dans l’Église.
1°) La pierre angulaire de l’édifice moliniste est une façon d’entendre les conditions requises
pour que l’homme soit libre dans l’exercice de sa faculté volitive.
• D’après Molina, Dieu n’a pas en son pouvoir d’influer intrinsèquement sur notre libre
arbitre, de manière à l’amener infailliblement à fixer son choix entre les divers partis auxquels il peut
indifféremment se déterminer. Selon Molina, une influence divine déterminante [ad unum] est
identiquement nécessitante.
• Soit :
par sa grâce intérieure Dieu peut éclairer notre intelligence sur les avantages de tel choix, il
peut inspirer à la volonté un goût, un attrait pour tel bien ; mais ces grâces ne sont pas par elles-
mêmes efficaces, capables de produire le résultat désiré par Dieu.
Dieu n’a aucun moyen d’exercer sur notre volonté une action efficace tout en respectant notre
libre arbitre.
• Bref :
la grâce divine est incompétente à apporter effectivement le vouloir et l’agir actuels.
• D’où :
ce n’est pas relativement à cette effective production du consentement, ou au pouvoir de la
produire, qu’il faut définir et distinguer grâce efficace et grâce suffisante.
2°) Donc, pour le Moliniste :
– La grâce efficace est celle qui obtient son effet parce que le libre arbitre donne en fait son
consentement ;
– la grâce suffisante est celle à laquelle le libre arbitre n’a pas donné son consentement [alors
qu’il pouvait] et a ainsi été privée de son effet.
Grâce efficace et grâce suffisante ne se différencient donc pas du côté de leur vertu
intrinsèque, mais par rapport à quelque chose d’extrinsèque : la détermination qu’il plaît au libre
arbitre de prendre, avec la coopération de la grâce.
N.B. :
Les congruistes admettent que la grâce congrue efficace doit être distinguée de la suffisante non congrue in
ratione beneficii : Dieu l’a conférée précisément pour qu’elle obtienne son effet ; mais elle n’obtient pas son effet en
vertu d’une activité intrinsèque particulière, mais seulement parce qu’il plaît au libre arbitre de s’accommoder de
cette grâce plutôt que de toute autre.

Thomisme – Augustinianisme – Molinisme – Jansénisme
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
5
3°) La grâce a alors pour fonction de faire que notre consentement soit élevé à l’ordre
surnaturel [puisqu’elle n’a aucunement pour fonction d’apporter le consentement]. Comment ?
On remarque que nos actes libres salutaires sont précédés de mouvements indélibérés de
l’intelligence et de la volonté (bonnes pensées, illustrations de l’esprit ; pieuses affections ou
inspirations de la volonté) : c’est en ces actes indélibérés d’ordre surnaturel que consiste formellement,
d’après les Molinistes, la grâce prévenante et excitante.
N.B. :
Tous les théologiens voient dans ces mouvments l’œuvre de la grâce. Mais les Thomistes les considèrent
comme des effets de la grâce qui est une motion surnaturelle reçue dans nos facultés et les actionnant ; tandis que
pour les Molinistes ils sont un élément constitutif, formellement, de la grâce excitante elle-même.
1
Ces mouvements indélibérés surnaturels méritent le nom de grâce suffisante, car ils apportent
à l’homme tout ce dont il a besoin, du côté de Dieu, pour se disposer à la grâce sanctifiante ou, s’il l’a,
pour agir de façon méritoire.
PRÉCISIONS :
Ces actes indélibérés sont, d’après Molina, le résultat de deux causes :
– d’une part, ils émanent dans leur individualité propre de l’intelligence et de la
volonté (avant toute délibération). Ces facultés dans telles circonstances (en présence par
exemple de tel sermon, de tel bon exemple) produisent nécessairement, par leur activité
spontanée et naturelle, sans besoin de motion divine, telle bonne pensée, tel bon désir etc.
– d’autre part Dieu, par l’influx général du concours simultané, produit dans ces actes
la formalité d’être ; et par l’influx particulier de sa grâce, il leur communique la formalité
surnaturelle (proportionnement à l’œuvre du salut). [Selon plusieurs auteurs, il n’est plus
besoin de ce dernier élément lorsque l’acte procède des vertus infuses].
4°) Note caractéristique :
Dans le cas où le libre arbitre consent au invitations et incitations de la grâce, celle-ci, de
prévenante et opérante, devient sans aucun changement adjuvante et coopérante.
Il n’y a, dans la production présente de l’acte salutaire, aucune intervention particulière de
Dieu non déjà réalisée ou épanouie quand le libre arbitre était à l’état potentiel.
5°) Éléments de critique théologique du Molinisme
S’il n’est pas pélagien, le Molinisme est pourtant loin de satisfaire « les instincts théologiques
de l’âme chrétienne » (Guillermin).
• Cette théorie est intrinsèquement liée à la science moyenne et, dans une certaine mesure, au
concours purement simultané. Or :
– La science moyenne, en rigueur, aboutit à deux impasses :
science sans objet assignable ;
fatalisme [déterminisme des circonstances].
– Le concours purement simultané :
s’accorde mal [ou pas du tout] avec la dépendance des causes secondes par rapport à la cause
première et avec la causalité universelle de Dieu, de l’avis même de saint Robert Bellarmin.
• Plus directement contre la grâce moliniste :
– Toute l’œuvre de notre salut est vraiment consommée, accomplie, dans le consentement du
libre arbitre [les actes indélibérés ne sont que préparatifs] : or Dieu n’y intervient pas. Tandis que
1
Voir par exemple Mazzella, De Gratia, disp. 1, art. 4, n. 136.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%