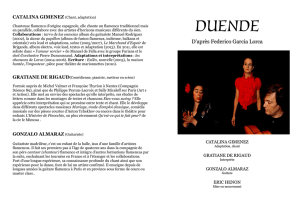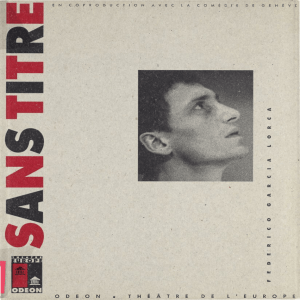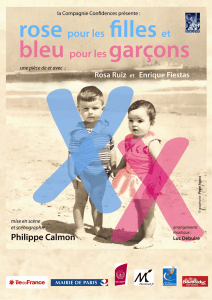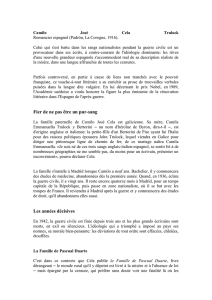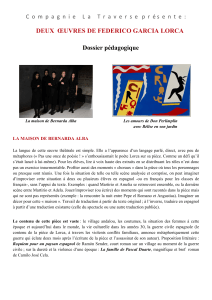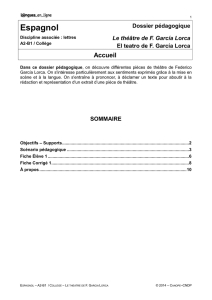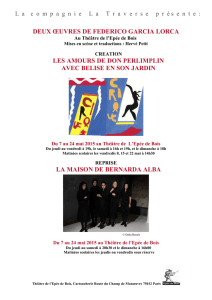1
LA CRISE DU LYRISME
Lorca et les poètes français de la Modernité
Nom : BONNEFOND
Prénom : Anna
UFR LLD Littérature, linguistique, didactique
Mémoire de Master 1 - Lettres Modernes,
Spécialité ou Parcours : Lettres, Langue et littérature française
Sous la direction de Monsieur Henry SCEPI.
Année universitaire 2018-2019

2
Table des matières
Table des matières……………………………………………………………………………...2
Introduction…………………………………………………………………………….............3
Partie 1
Le paysage, air post-romantique et paysage « état-d’âme » du détraquement……4
Le paysage urbain………………………………………………………………5
Les manifestions météorologiques de la mélancolie du poète…………………..9
Partie 2
Le chant de la solitude éternelle……………………………………………………..25
La solitude énonciative du poète………………………………………………26
Une polyphonie et une esthétique du mélange compensatoires………………..32
Partie 3
Le lyrisme de l’errance identitaire………………………………………………….38
«Yo soy una máscara eterna» – [Je suis un masque éternel]…………………………..39
Résister à la dégradation : le rire, la colère et la violence comme exutoires…………..44
Conclusion……………………………………………………………………………………54
Bibliographie………………………………………………………………………………….55

3
Introduction
« Nous, nés dans des jours de révolutions et d’orages, où toutes les croyances ont été
brisées… »
1
. Après une Seconde Révolution, foyer de tous les espoirs d’une jeunesse engagée,
et l’avènement de la Seconde République qui réforme la France en abolissant des lois
liberticides tout en instaurant des droits nouveaux, le coup d’état Napoléonien du 2 décembre
1851 marque le début de l’ère du désenchantement. Le poète ne peut désormais plus prétendre
à guider le peuple à travers un lyrisme qui pose le « je » comme une instance unie et universelle
alors même que la société voit triompher et s’instaurer, durablement, un matérialisme bourgeois
qui ne s’indigne plus face au pouvoir autoritaire. C’est dans ce contexte de modernité
industrielle et de bouleversement de la perception du temps et du paysage que s’inscrit le point
de départ de la crise du lyrisme et des valeurs poétiques : « Baudelaire [..] vit et illustre
exemplairement le douloureux passage d’un romantisme ouvert à toutes les tentations et
tentatives de dépasser les limites de l’art, à une modernité confrontée à la vacuité et à
l’inaccessibilité de cet horizon, qui fuit comme une transcendance à jamais vide et illusoire »
2
.
Héritier du déclin du rayonnement culturel espagnol du XIXe siècle tout en étant contemporain
de la montée des nationalismes et de la multiplication des crises politiques, économiques et
sociales qui amèneront à la Guerre civile de 1936-1939, Federico Garcia Lorca sera lui aussi
un poète du désenchantement. Notre objet d’étude portera sur le dialogue entre ce poète
espagnol et certains poètes de la Modernité française que sont Gérard de Nerval, Charles
Baudelaire, Paul Verlaine et enfin Jules Laforgue. Car, tous sont mue par le désir : cette
aspiration profonde de l’Homme vers un objet qui répondrait à une attente et à une frustration
dans le but de combler un sentiment de manque et d’incomplétude. Nous nous demanderons
donc en quoi l’expression lyrique permet de rendre compte d’une crise et d’une quête de
l’identité à la fois intime et historique. Nous étudierons comment le paysage état-d’âme post-
romantique se fait le lieu de l’expression du détraquement et du décentrement du « moi ». Nous
verrons ensuite que ce traitement de l’expérience du paysage amène les poètes à produire un
chant universel : celui de la solitude qui conditionne l’existence humaine condamnée au désir.
Puis nous étudierons enfin les instruments dont usent les poètes français et Lorca pour résister
face à la dislocation du moi.
1
De Nerval, Gérard, Aurélia, (Pléiade, tome 1, Lachenal & Ritter, 1985), 386.
2
Collot, Michel, Paysage et poésie du Romantisme à nos jours, (José Corti, Les Essais, 1953), 79.

4
Partie 1
-
Le paysage : Air post-romantique et paysage « état-d’âme »
du détraquement

5
« Dans ce monde d’apparences fugaces, illusoires, insaisissables, comment ne pas
chercher à déceler, au-delà des apparences, l’absolu ? Et par quel moyen, sinon l’expérience
intérieure ? »
3
. Quoi de mieux donc que l’expérience du paysage et sa traduction poétique pour
ancrer le moi dans une épaisseur ? Les poètes de cette fin de siècle, héritiers du Romantisme et
de la conception rousseauiste du paysage (qui abolie tout obstacle entre l’individu et la nature
en libérant l’expression des impressions, émotions et sensations) voient dans le paysage une
lunette privilégiée pour observer ce bouleversement généralisé.
Le paysage urbain
Le paysage le plus signifiant de l’air du désenchantement est définitivement le paysage
urbain et son esthétique de la défiguration. Federico García Lorca propose une écriture de ce
sentiment pénible du vertige de la modernité qui n’est pas sans rappeler le Spleen, aussi appelé,
mélancolie des villes. En témoigne, par exemple, sa dénonciation virulente de la défiguration
des villes de Castille, dans son premier recueil : « Villes ruinées par le progrès et mutilées par
la civilisation actuelle ! […] Villes mortes de Castille, au-dessus de tout plane le souffle d’ennui
et de peine immenses
4
». Il semble judicieux de rappeler un paradoxe très justement souligné
par le professeur et chercheur Ross Chambers dans son œuvre Mélancolie et Opposition
5
, le
modernisme poétique naît d’une forme de refus de la modernité historique. Aussi, Lorca semble
empreint de cette idée qui pullule dans la poésie de Charles Baudelaire : la figure du poète est
le symptôme d’une perte collective, un sujet dispersé qui se fait l’écho d’un décentrement
existentiel généralisé, reflet de ce fameux « mal du siècle ». Par conséquent, le lyrisme, dans ce
monde de bouleversement, ne peut être que défaillant. Dès lors, le paysage « état-d’âme » de la
seconde moitié du XIXe se fait le signe d’une vaporisation de l’être, d’un « je » lyrique et d’un
romantisme détraqués :
Les âmes romantiques que le siècle méprise, comme il vous méprise, vous si
romantiques et si démodées, vous [les villes] les consolez très doucement et elles
retrouvent leur tranquillité, et une lassitude bleue sous les lambris de vos maisons… les
âmes errent à travers vos ruelles […].
6
3
Décaudin, Michel. La Crise des valeurs symbolistes, Vingt ans de poésie française, 1895-1914,
(Champion Classiques, Série « Essais », Paris, 1960),19.
4
García Lorca, Federico, Impressions et paysages, (Gallimard, 1958), 23.
5
Chambers, Ross, Mélancolie et Opposition, Les débuts du modernisme en France, (José Corti, 1987),
114.
6
García Lorca, Federico, Impressions et paysages, (Gallimard, 1958), 23.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
1
/
57
100%