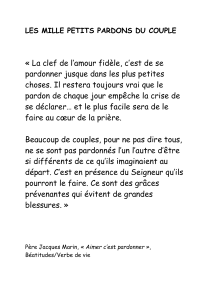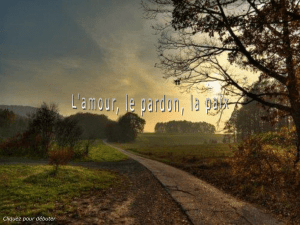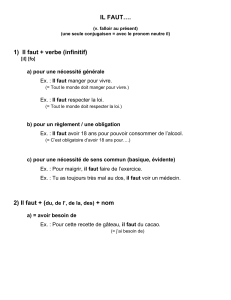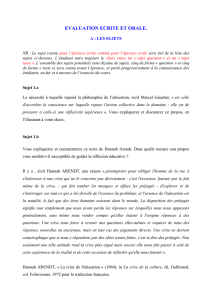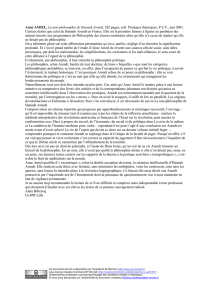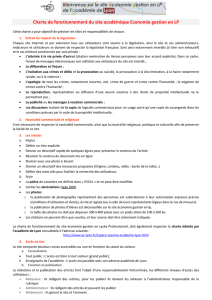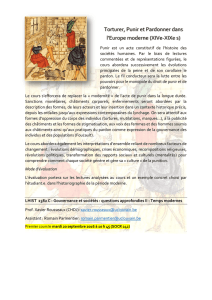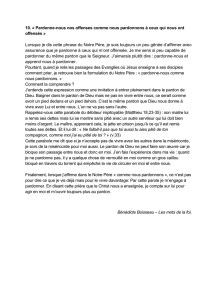Corinne Enaudeau
La rétribution
"En s'efforçant de prouver que tout est possible, les régimes totalitaires ont
découvert sans le savoir l'existence de crimes que les hommes ne peuvent ni punir ni
pardonner". Les massacres de populations avaient jusque-là confirmé que "tout est
permis", que la fin justifie les moyens. Mais l'extermination nazie est passée du "tout est
permis" au "tout est possible"
1
. Qu'elle n'ait aucune utilité économique ou politique,
qu'elle accapare toutes les forces et accélère ainsi la défaite militaire de l'Allemagne
prouve seulement qu'elle n'est pas un moyen, mais la fin elle-même. Fin si aberrante
qu'elle invalide nos catégories de pensée. "Nous essayons de comprendre des faits […]
qui dépassent tout simplement nos facultés de compréhension. Nous essayons de classer
dans la rubrique du crime ce qu'aucune catégorie de ce genre, selon nous, ne fut jamais
destinée à couvrir".
Les crimes impunissables autant qu'impardonnables sont d'abord pour Arendt des
faits qu'on peine à appeler des actes. Leurs agents ne s'en tiennent pas pour
responsables ni n'en perçoivent le mal. Comme privés de jugement, ils semblent
impossibles à juger. Juger quelqu'un exige de saisir comment lui-même a jugé de la
situation, il faut accomplir en pensée le délit avec lui, en saisir les mobiles passionnels et
rationnels. De ce point de vue, "le sadisme sexuel"
2
d'un tortionnaire comme Boger –
célèbre par sa terrible balançoire – semble moins opaque que la méticuleuse indifférence
de Eichmann. Quand l'homme est aussi normal que le crime est insensé, il faut pourtant
juger et punir sans comprendre et encore moins soigner. Il le faut parce qu'un crime
connu et resté impuni est un crime autorisé, qu'il n'est donc pas un crime au regard de la
1
Les Origines du totalitarisme, [noté OT], Gallimard, Quarto, 2002, p.811 ; p. 786 pour la citation suivante.
2
"Nonobstant la normalité clinique des accusés, le facteur humain principal à Auschwitz était le sadisme,
et le sadisme est fondamentalement sexuel", "Auschwitz en procès" [1966], in Responsabilité et jugement
[noté RJ], Payot, 2005, p.275.

2
loi, ni au regard de mœurs qui le prennent pour norme. Il faut punir quand bien même
la peine serait privée en ce cas, dit Arendt, de ses justifications habituelles, puisqu'il n'y
a pas à dissuader de récidive individuelle un criminel de masse, ni à éduquer quelqu'un
faisant de son crime l'objet de son zèle. La valeur rétributive de la peine, "seule raison
non utilitaire […] et donc quelque peu en désaccord avec la pensée juridique actuelle"
3
,
semble elle-même menacée quand l'ampleur du crime semble impossible à
contrebalancer. Pourtant "notre sens de la justice" ne tolère pas, dit Arendt, de laisser
impuni l'assassinat de milliers de gens, même si la peine n'entre dans aucun calcul
arithmétique pertinent ni aucun calcul d'utilité. Comme si le châtiment devenait alors
aussi catégorique que l'était l'impératif transgressé et levait toutes les conditions
("hypothèses" dirait Kant) sous lesquelles ce dernier prend ordinairement son sens.
De l'hypothétique au catégorique, du conditionnel à l'inconditionné, c'est la valeur
de la loi qui se joue dans la peine. Valeur empirique ou idéelle, utilitaire ou symbolique.
À ne pouvoir que rétribuer le crime (hors de toute proportion, qui plus est), la peine ne
prétend être un bien-fait ou un béné-fice pour personne, elle ne "fait de bien" qu'à la loi
elle-même, à la valeur qu'on lui reconnaît. La peine rappelle que la loi est la condition
inconditionnée du vivre ensemble. Non pas telle loi précise du droit positif que le délit
enfreint, mais la loi comme orbe des lois positives, ordre symbolique qui leur donne
sens, comme registre du sens lui-même. Que les lois puissent être dites "scélérates", que
le légitime puisse récuser le légal prouve seulement que la loi impose la visée d'un sens
échappant aux opportunités des circonstances. Le droit dit "naturel" n'est que cette visée
même, il n'est donné dans aucune "nature", il est la demande de l'impossible, qu'on ne
puisse pas ce qui ne doit pas se pouvoir et qui se fait pourtant si bien, "naturellement"
comme dirait Kertesz : jouer au jeu du "tout est possible", au jeu du sens à discrétion.
Qui n'est que le jeu de massacre du non-sens.
3
"Responsabilité personnelle et régime dictatorial" [1968], in RJ, p.57.

3
Pour la justice rétributive, la loi vaut – et c'est bien ce qu'on lui reproche – du seul
fait qu'elle est la loi. "Le crime est à lui seul, écrit Ricoeur, sa raison d'être puni" – ce que
veut dire "rétribution" –, à lui seul aussi la raison de faire souffrir, ce que veut dire
"peine". C'est le franchissement du punissable au pénible, de la loi comme forme de la
raison à l'individu comme être de chair qui fait pour Ricoeur
4
"l'inhumanité de la peine",
son "scandale". "Souffrance infligée légalement", la peine serait "le point aveugle de tout
le système judiciaire". "Scandale intellectuel", pierre d'achoppement sur laquelle la
raison trébuche, dit-il, parce que la rationalité du droit se paye d'un formalisme qui,
découplant droit et moralité, à l'exemple de Kant, lie inexorablement le droit à la
contrainte. Droit de contraindre et de faire souffrir, de "mesurer" la souffrance dans un
calcul arithmétique où le corps sensible est oublié. En dialectisant la conception
kantienne de la peine pour en faire un obstacle à l'obstacle qu'est le délit, un mal
surmontant le mal, Hegel en aurait exalté "la fine fleur empoisonnée". Si l'on veut en
finir, dit Ricoeur, avec cette légalité "pauvre" et inhumaine incitant l'individu à
transgresser la loi plus qu'à s'intégrer dans la communauté, on ne peut qu'admirer la
justice nouvelle dont la Commission Vérité et Réconciliation
5
aurait, mieux que toutes
les inflexions du droit pénal, ouvert la voie : justice sans violence qui s'exerce par la
seule parole, par l'échange de l'amnistie du coupable contre son aveu.
Que la procédure de "réconciliation" civile en Afrique du Sud ait été le fruit d'un
compromis politique entre l'exigence d'amnistie du Parti national et le refus par l'ANC
4
"Avant la justice non-violente, la justice violente", in "Vérité, réconciliation, réparation" [noté VRR], sous
la direction de B.Cassin, O.Cayla, et Ph.-J.Salazar, Le Genre humain, Seuil, novembre 2004, pp.159-171.
5
L'Assemblée constituante d'Afrique du Sud (composée de deux chambres élues en 1994) adopte en 1995
la loi n°34 relative à la promotion de l'unité nationale et de la réconciliation, qui institue la Commission
Vérité et Réconciliation [notée CVR]. Celle-ci a mission d'entendre les dépositions des perpetrators (auteurs
de graves violations des droits de l'homme commises pendant la période de l'apartheid) et d'apprécier en
retour s'il convient ou non (sous des conditions prédéfinies) de les amnistier. Le numéro du Genre humain,
cité dans la note précédente, est entièrement consacré aux enjeux de cette procédure.

4
d'une amnistie générale, c'est là un fait
6
. Que la justice rétributive doive y perdre ipso
facto sa valeur et la justice "restauratrice" servir de modèle
7
pour le règlement des
conflits à venir, c'est ce qu'aucun fait ne saurait justifier. Plus que la "Commission", c'est
l'admiration philosophique pour la justice restauratrice, le discrédit de la justice
rétributive et la caution de tout cela demandée à Arendt que nous voudrions discuter.
La "révolution intellectuelle" qu'on prête à cette expérience risque d'être plutôt une
régression où rien ne vient plus signifier, postuler et commander l'universalité du sens.
Abandonnant le droit de contraindre, la Commission Vérité et Réconciliation [CVR]
suspend l'amnistie individuelle des coupables (des seuls actes avoués, précise Barbara
Cassin) à l'aveu spontané de leurs crimes. Par l'amnistie, elle restaure la communauté en
y réintégrant le coupable. Par l'aveu, elle lie l'amnistie à "son juste pacte avec la vérité".
Cette nouvelle justice, ni distributive, ni rétributive, mais "reconstructrice" (restorative) et
"non-violente", trouverait enfin son vrai destinataire : non la victime (à venger) ni
l'accusé (à réhabiliter) ni la loi (à honorer), mais "le lien organique qui fait tenir ensemble
une communauté humaine"
8
(à restaurer).
Rétribuer la souffrance infligée à la victime d'une souffrance équivalente pour le
coupable afin de revenir au zéro de l'équilibre, c'est ce que demanderait la fameuse "loi
du talion" : "œil pour œil, dent pour dent" (nous y reviendrons). Loi méchante des
représailles, de la vengeance rationalisée selon Ricoeur, dont la loi d'amour et son
pardon ou la loi de réconciliation et son amnistie nous éviteraient les inutiles sévices.
6
Xavier Philippe, "Commission Vérité et Réconciliation et droit constitutionnel, VRR, p.225
7
Erik Doxtader, "La réconciliation avant la réconciliation", VRR, p.256
8
Paul Ricoeur, article cité, VRR, p.170.

5
Des "crimes qu'on ne peut ni punir ni pardonner", il est bien vrai qu'on n'a plus
qu'à les venger
9
. Les crimes nazis ne seraient justiciables que par une vengeance directe
ou légalement médiatisée. Arendt a beau s'en défendre, la conclusion de l'épilogue de
son Eichmann accrédite l'hypothèse. Que le crime d'Eichmann défie les présupposés du
droit moderne (l'utilité et/ou la jouissance du délit) ne l'empêche pas d'être un crime.
Qu'il invalide les justifications ordinaires de la peine n'interdit en rien de le punir. Car
"un grand crime – dit Arendt en citant le journaliste israélien Yosal Rogat – est une
offense contre la nature, de sorte que la terre elle-même crie vengeance [je souligne] ; que le
mal viole l'harmonie naturelle que seul le châtiment peut rétablir ; qu'une collectivité
lésée a le devoir à l'égard de l'ordre moral de châtier le criminel"
10
. Argument d'autant
plus étrange qu'il mêle la justice cosmique de la Grèce archaïque, le droit "naturel"
tourmentant l'Occident chrétien (et laïque à sa suite) et la juridiction positive de la
collectivité lésée, c'est-à-dire d'Israël. Confusion des registres, dira-t-on, dont "la terre"
est pourtant la clef. Le verdict circonstancié qu'Arendt contre-propose à celui que les
juges ont lu à Eichmann se clôt en effet par ces lignes :
"Et puisque vous avez soutenu et exécuté une politique qui consistait à refuser le partage
de la terre avec le peuple juif et les peuples d'un certain nombre d'autres nations – comme
si vous et vos supérieurs aviez le droit de décider qui doit et ne doit pas habiter le monde –
nous estimons qu'on ne peut attendre de personne, c'est-à-dire d'aucun membre de
l'espèce humaine qu'il veuille partager la terre avec vous. C'est pour cette raison, et pour
cette raison seule, que vous devez être pendu" [je souligne]
11
.
Sans analyser ici "le souci du monde" où s'articule la pensée d'Arendt, disons que
la "terre" criant vengeance n'est pas le cosmos auquel un destin jaloux fait expier ses
déséquilibres, mais le "monde", ce réseau immatériel de relations que les hommes tissent
entre eux dans le seul lieu qui leur soit donné en partage à tous, la terre à habiter. C'est
9
Ni non plus les amnistier, comme on voudrait que la formule l'autorise, cf. Barbara Cassin, "Amnistie et
pardon", VRR, p.39. L'étendue d'un article interdit de traiter ici cette option de la vengeance, telle qu'elle
est argumentée, par exemple, par Jean Améry dans Par-delà le crime et le châtiment, Actes Sud, 1977.
10
Eichmann à Jérusalem [noté EJ], même volume que OT, Gallimard, Quarto, 2002, p.1285.
11
Ibid, p.1287.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
1
/
21
100%