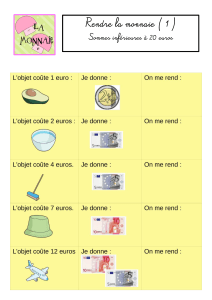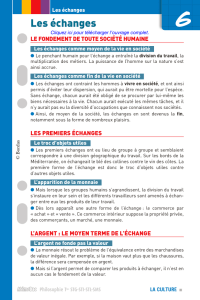Analyse des politiques agricoles : Tonure, Traite, Paysanne, Entreprise
Telechargé par
Khadime Rassoul Sene

ANALYSE ET EVALUATION DES POLITIQUEs AGRICOLE
Chapitre 2 : L’AGRICULTURE DE TONURE
Elle désigne un type d’agriculture basé sur une relation entre les propriétaires fonciers et l’exploitation. Le
propriétaire foncier peut être selon les cas un seigneur, un propriétaire féodale, un aristocrate foncier et
l’exploitant peut être un métayer ou un fermier.
Les fonctionnements de l’agriculture de tonure :
- l’économie de sécurité: la terre appartient à ceux qui assurent la défense du territoire et le versement de la
rente permet la prise en charge financier de la guerre. L’exploitant est totalement dépendant du propriétaire
de la terre cette dernière vie de la perception d’une rente et il n’est que très indirectement concernés par la
production agricole.
- l’économie de prélèvement : elle ne repose pas sur une grande différenciation entre le propriétaire qui tire
sa subsistance de la location de la terre et l’exploitant qui assure sa vie grâce au champ qu’il loue.
- l’économie d’association : elle résulte de l’association du propriétaire foncier au maintien ou
l’accroissement de la productivité du sol (apport fertilisant de capitaux).
Le rôle de l’exploitant étant d’assurer les travaux culturaux ce qui met à l’abri le propriétaire foncier des
risques climatiques dans le cas de fermage car il reçoit une quantité fixe de la récolte de l’exploitant. Par
contre dans un système de métayage ou le métayeur reçoit un pourcentage de la production, le sort du
propriétaire est lié à celui de l’exploitant.
CHAPITRE 3 : L’AGRICULTURE DE TRAITE
Elle définit les rapports entre agriculteur et commerçant appelé traitant. Le traitant est un commerçant qui
achète en gros et vend en détails. Mais c’est aussi un banquier qui accorde des avancements aux producteurs
pendant la période de soudure. C’est enfin un transporteur qui assure la collecte des produits.
L’économie de traite est l’intermédiaire entre l’agriculture de subsistance et l’agriculture d’échange intégré
dans les circuits de commercialisation caractéristique des pays en voie de développement.
Le fonctionnement se repose sur deux acteurs principales : le cultivateur et le traitant
- Le producteur livre des produits au traitant dans une période ou l’offre est abondante et le producteur rachète
des produits aux traitants dans une période de soudure (au prix plus élevé). La différence profite du traitant à
cause du risque et à cause du stockage. L’activité du traitant débouche en général sur des sociétés de
transaction d’import /export.
- L’économie de traite se situe dans la perspective de relations extérieures. Elle explique la mauvaise insertion
d’une agriculture de subsistance dans une économie d’échange. Cette insertion parait avorté sinon insuffisante
puisque la pratique de l’échange ne conduit pas le producteur à modifier son système de production.

CHAPITRE 4 : AGRICULTURE PAYSANNE
Elle désigne des ensembles d’économie agricole dans lesquels l’agriculture repose sur la famille au sens
occidental du terme.
REMARQUE 1 : A la différence de l’agriculture de subsistance L’exploitant agricole repose sur une famille
plus rigide. Elle produit pour le marché.
REMARQUE 2 : par comparaison à l’agriculture de tonure le paysan est ici tout à la fois c’est-à-dire
propriétaire exploitant, chef de carré qui participe activement à la mise en valeur de son exploitation.
Pour le fonctionnement : il est fondé sur une multitude d’exploitation de taille réduite qui livre des
produits à l’économie nationale sans requérir des facteurs de production.
- l’exploitation paysanne est autonome pour l’acquisition de ces facteurs de productions. Elle utilise
essentiellement la main d’œuvre familiale et assure son auto-approvisionnement pour les autres ressources
productive (fumiers, fourrage, matériels agricole).
- l’exploitation paysanne vise dans son fonctionnement la subsistance complète de sa famille et livre en même
temps son produit sur le marché.
- le fonctionnement de l’agriculture paysanne peut subir des modifications pour répondre aux besoins du
marché par une transformation de son système de production. En ce sens elle à une forte capacité d’adaptation
pour faire face aux exigences de la croissance. Exemple : l’augmentation considérable de la production
agricole en Europe au 19e siècle est le fait d’une agriculture paysanne.
- l’exploitation à néanmoins une grande capacité de résistance à la crise et dépression conjoncturel à cause de
sa relative autonomie vis-à-vis de l’économie : sécrétion interne de facteur de production et livraison sur le
marché d’un simple sous-produit.
- face à une baisse des prix sur le marché des exploitations paysannes plutôt qu’une limitation de l’offre
agricole auront tendance à augmenter leurs produits pour maintenir leurs revenus. Ces phénomènes peuvent
s’expliquer par l’existence d’une multitude de limitation de l’offre.
L’installation : bien que l’agriculture paysanne soit propre à l’Europe et à son histoire, de nombreux
pays ou l’agriculture est propice à la croissance on cherchait à favoriser l’installation d’une agriculture
paysanne dans le but de permettre le financement de la croissance.
L’évolution : au fur et à mesure que la demande augmente le paysan peut être enclin à augmenter sa
production et une partie de son revenu additionnel peut être consacré à l’achat de facture de production
et de ressource productive (engrais, matériels). L’agriculture paysanne en conséquent favorise son
propre démantèlement et l’apparition d’un autre type de système d’agriculture : c’est l’agriculture de
d’entreprise
CHAPITRE 4 : ECONOMIE D’ENTREPRISE
Elle définit l’ensemble d’économie agricole ou l’unité de production devient un véritable levier de calcul
économique.
On distingue généralement deux formes d’agriculture d’entreprise : l’agriculture de plantation et l’agriculture
de conversion

1) L’agriculture de plantation : une agriculture de superposition
Elle résulte de la superposition de l’agriculture de plantation à une agriculture de subsistance.le terme
d’économie de plantation fait allusion à une agriculture ou l’exploitation agricole abrite des cultures arbustive.
En Afrique par exemple le terme caractérise très souvent l’organisation des exploitations de transition
(caractérise par la coexistence entre la culture de tubercule et culture arbustive).
a) La plantation moderne
Dans une agriculture d’entreprise la plantation moderne est caractérisé par :
- la grande taille de l’exploitation qui peut atteindre dans certains des milliers d’hectares
- la pratique de la monoproduction, la mécanisation des cultures, la sélection des espèces, l’obtention des
meilleurs rendements et l’utilisation d’engrais.
- l’emploi de salarié agricole qui fait de l’exploitation d’une entité en partie extérieur de l’espace économique
national dont la production est orienté vers l’extérieur.
Avantage et inconvénient de l’agriculture de plantation
-les avantages
Favoriser de nouvelle technique de production
L’emploi en milieu rural
Les flux de devise pour financer l’économie national grâce aux produits exporté
-les inconvénients
Rapatriement des bénéfices à l’extérieur
Concurrence vis-à-vis des cultures vivrières
Exploitations des indigènes (la main d’œuvre local)
Exploitation abusive des terres
Apres les indépendances se sont les entreprises d’Etat qui ont pris le relais des grandes concessions de
plantation (SODEPALM en côte d’ivoire)
2) Economie d’entreprise de conversion
Elle est le résultat de la conversion des exploitations de type paysanne qui se trouve dépendant de l’extérieur
pour l’acquisition des facteurs de production. Le paysan devient un entrepreneur qui se livre au calcul
économique en procédant à une comparaison des couts de facteur de production et de la valeur ajouté des
produits.
a) Les caractéristiques de l’entreprise agricole
- l’exploitation devient capitalistique et la culture remplace la culture attelée.
- les couts de production s’évaluent en terme monétaire, l’exploitation agricole reste sensible de l’évolution
des couts de facteur de production.
- la terre devient un facteur de production comme les autres et le recherche d’une taille optimale de
l’exploitation vise la rentabilisation du facteur capital et travail.
- la recherche et la spécialisation avec la recomposition des exploitations traditionnelles en atelier de
production vers les relations contractuelles. Il s’agit d’atténuer l’incertitude en ce qui concerne la situation
des marches et les problèmes des débouchés. L’entreprise entretient des accords et contrat néanmoins
l’intégration de l’entreprise dans les contrats limite l’autonomie de celle-ci qui devient le maillon d’une
longue chaine.

REMARQUE :
- Le contrat est négocié chaque année et l’acheteur détermine le type de variétés à déterminer
- Si la qualité du produit n’est pas celle attendu l’acheteur peut refuser la marchandise
- Le contrat prévoit le type d’engrais à utiliser et même d’intrant
- Si le rendement optimal n’est pas atteint l’acheteur peut refuser le renouvellement du contrat. Tout
ceci dans le cas d’une économie de chaine bien organisé car comme dans les Niayes les paysans ne
respecte pas souvent les contrats.
CHAPITRE 6 : L’AGRICULTURE EN TEMPS PARTIEL
Elle correspond à une situation ou l’activité de production de l’individu est partagée entre l’agriculture et un
autre métier qui lui procure des revenus. L’individu peut être à la fois fonctionnaire et exploitant, médecin et
exploitant, commerçant et exploitant et ingénieur et agro-exploitant.
REMARQUE : les critères de définition d’une exploitation en temps partiel varie selon les prix et également
en fonction du temps de travail et du revenu.
- Aux USA l’exploitation est à temps partiel quand l’exploitant travail 100 jours à l’extérieur.
- En GRANDE BRETAGNE c’est en temps partiel lorsqu’il travaille 2200 heures moins de à l’extérieur
- En AFRIQUE il n’y a de critère particulier contrevenu de cette agriculture en temps partiel qui peut
être développer généralement s’est exercé par les commerçants et les anciens fonctionnaires de l’ETAT
3) Les différentes formes d’agriculture en temps partiel
a) Agriculture à temps partiel au sens stricte
C’est la première forme d’agriculture à temps partiel. L’ouvrier salarié peut à la fois exercer son métier et
mettre en valeur son lopin de terre. Cette forme d’agriculture en temps partiel résulte du développement des
activités non agricole en milieu rural.
b) L’agriculture à temps partiel comme activité de plaisance
Ici l’activité agricole est considérée comme une fonction secondaire qui permet à l’individu d’échapper
momentanément aux contraignants de son travail habituel. L’agriculture en temps partiel n’est une activité
rémunératrice mais une distraction qui peut s’inscrire dans le cadre d’un petit jardin familial urbain ou péri
urbain.
c) L’agriculture à temps partiel successeur
Elle constitue le prolongement d’une activité professionnel. Le retraité qui devient agriculteur trouve aussi
une occupation et dans une exploitation à faible dimension. IL peut devenir un producteur efficace à cause de
son expérience acquise et de sa disponibilité.
CHAPITRE 7 : AGRICULTURE COLLECTIVE
Elle désigne les systèmes économiques ou l’exploitation agricole est caractérise par 4 éléments au moins :
-L’absence de propriété privé du capital financier
- l’exécution communautaire des travaux
-L’existence d’un système d’encadrement des travaux
-L’existence d’un système d’encadrement, de vulgarisation et d’approvisionnement

Bien qu’elle obéisse à la logique que l’agriculture d’entreprise (intensive).L’agriculture collective n’est pas
propre au système socialiste. Elle peut cependant inventer plusieurs formes
1) Les différents d’agriculture collective
A) L’exploitation agricole intégrée dans les structures collectives
L’unité de production est ici très étroitement dépendant des structures d’encadrement et vulgarisation. Par
exemple au Sénégal avant la nouvelle politique agricole(NPA) en 1984 très souvent l’agriculteur était obligé
de vendre ces produits à la coopérative agricole.
B) L’exploitation agricole et collective mais les unités de production son autonome
Ces phénomènes désigne les coopératives de production tels que son pratiqué en URSS le capital foncier
appartient à la communauté et les produits vendus à la coopérative.
C) L’exploitation agricole et collective au niveau de la production et de la consommation
Le KIBBUPZ est fondé sur un travail collectif et un mode de vie collective. Il est dirigé par une assemblée
qui prend les décisions en matière de production et de la consommation chaque membre de la communauté.
D) L’exploitation agricole est une ferme d’Etat
Elle est propre au socialiste, la terre appartient à l’Etat. La création d’exploitation de grande taille répond au
besoin et au double souci de l’Etat socialiste :
- De rentabiliser les exploitations agricoles par l’introduction de la mécanisation dans les exploitations
de grande dimension
- De faciliter leur intégration dans le processus de planification à travers las programmes de planification
des services de l’Etat. Le pouvoir central pourra ainsi agir directement sur l’activité de production.
DEUXIEME PARTIE
CHAPITRE 1 : théorie de la production
I) Economie national classique
Individualisme des agents économique : l’individu est un être rationnel il est le seul capable de juger et décider
ce qui est bon pour lui. L’interventionnisme de l’Etat même à but louable et donc pervers dans ces
concurrences chaque individu poursuit son intérêt particulier (utilitarisme) par la maximisation des
satisfactions et la minimisation des efforts (hédonisme). Son postulat smithien a été précisé par GEREMI
BENTHAN avec la plus grande netteté.
- affirmation de la liberté économique
Dérivé de l’ordre naturel, le model de l’omoéconomiquse justifie en retour le libéralisme économique. La
propriété privée des moyens de production est une garantie de la liberté. Le marché constitue le régulateur le
plus efficace de l’activité économique
- Socialisation par le marché
La recherche de l’intérêt individuel permet de réaliser l’intérêt général car il existe une main invisible (le
marché) qui guide les passions individuelles vers le bien de tous : « ce n’est pas de la bienveillance du boucher,
du boulanger ou du marchand de bière que nous attendons notre diner mais bien du soin qu’il apporte à leurs
intérêts » ADAM SMITH recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations 1776. L’harmonisation
des intérêts étant naturelle il n’y a dès lors plus aucune raison pour qu’un pouvoir public (l’Etat) fasse passer
l’intérêt général au-dessous de la somme des intérêts privés.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%