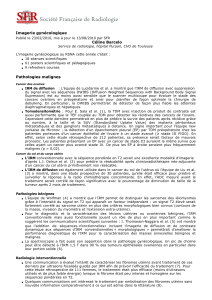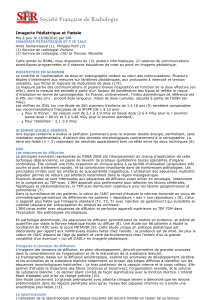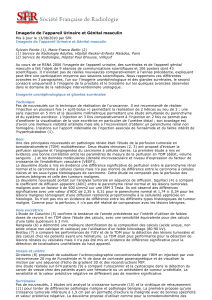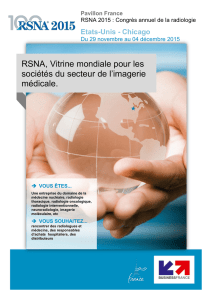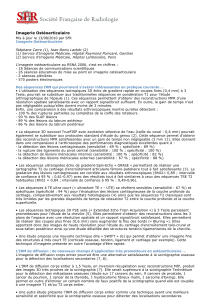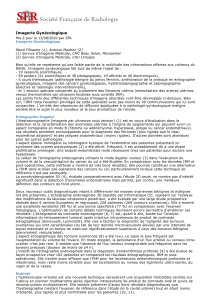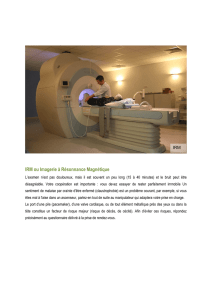Imagerie Ostéo-articulaire : Revue des Applications Cliniques
Telechargé par
Agbayi 53

J Radiol 2006;87:867-72
© Éditions Françaises de Radiologie, Paris, 2006
état de l’art en imagerie
applications cliniques
Imagerie Ostéo-articulaire
M Morel (1), A Marie (2), A Sobotka (3) et C Mutschler (3)
ette année, 22 séances de commu-
nication scientifique, 133 posters à
visée éducative et 40 posters scien-
tifiques ont porté sur l’imagerie Ostéo-
articulaire.
Les nouvelles séquences en IRM ainsi que
l’échographie dynamique et interven-
tionnelle font partie des thèmes impor-
tants présentés. La TDM connaît un
regain de popularité avec l’avènement des
multidétecteurs. Enfin, certaines présen-
tations sur des thèmes originaux ont rete-
nu notre attention.
IRM
IRM 3T
L’apport des hauts champs a été étudié
sur de multiples articulations. Des posters
éducatifs ont détaillé l’anatomie fine des
ligaments et nerfs du coude (1), du poi-
gnet : complexe TFCC, ligaments intrin-
sèques et extrinsèques dorsaux et palmaires
(la fréquence de visualisation et la sémio-
logie lésionnelle de ces ligaments extrin-
sèques ne sont pas présentées) (2) et enfin
de la cheville (3). Les atlas iconographi-
ques présentés témoignent du gain en
résolution et de l’augmentation du rap-
port signal/bruit. L’étude de structures
obliques telles que le ligament calcanéo-
fibulaire et la syndesmose antérieure
bénéficient des séquences 3D DP FSE
isotropiques (4). La distinction liquide/
cartilage est améliorée par rapport au 2D
DP TSE. Par contre, le 2D DP TSE reste
supérieur en terme de distinction muscle/
graisse, pour l’étude du segment périmal-
léolaire du tendon court fibulaire.
L’analyse distincte des cartilages tibial et
talaire à la cheville peut bénéficier d’une
distraction articulaire, réalisée à l’aide d’un
dispositif simple externe exerçant une trac-
tion distale sur le pied et évite ainsi une in-
jection intra articulaire (5). À l’épaule (6),
l’IRM 3T (confrontée aux résultats de
l’arthroscopie) détecte avec de bonnes sensi-
bilité et spécificité les ruptures transfixiantes
et non transfixiantes du supra-épineux,
mais il reste à prouver la réelle supériorité
par rapport à l’IRM 1,5T car il semble que
la qualification partielle ou complète des
petites ruptures reste difficile.
IRM bas champs
Une communication (7) souligne la néces-
sité de doubler la dose de gadolinium IV
(0,2 mmol/kg) dans l’étude des synovites
des patients atteints de polyarthrite rhuma-
toïde pour contrebalancer la baisse du rap-
port signal/bruit associée à un faible champ
magnétique (ici 0,2T), et ne pas sous
évaluer le score de synovite (OMERACT-
RAMRIS). Par ailleurs, le calcul du rehaus-
sement relatif de la synoviale par rapport à
l’os peut servir d’outil fiable d’évaluation
de la réponse au traitement par Infliximab
(étude réalisée en simple dose de gadoli-
nium avec une IRM 0,3T) (8).
Antennes microscopiques
Les antennes de surface dites microscopi-
ques sont utiles pour l’étude des doigts en
pathologie rhumatismale et traumatique.
Ainsi, une antenne de 47 mm placée sur
les articulations douloureuses peut détecter
un épaississement irrégulier et nodulaire
de la synoviale et des érosions osseuses au
niveau des MCP et IPP des doigts de la
main de manière précoce au cours de la
PR (Spécificité : 92,3 %, avec cependant
une faible sensibilité : 30 %) (9).
Une antenne dédiée aux doigts est inté-
ressante pour l’évaluation des ligaments
collatéraux des MCP du pouce et des
autres rayons en particulier du ligament
collatéral radial du 5
e
rayon, sous réserve
de n’étudier qu’une seule articulation à la
fois. Les alternatives en cas de traumatis-
mes multi digitaux sont l’antenne poignet
(excellente résolution pour la 1ère MCP,
moindre aux autres rayons) ou l’antenne
coude. Ce poster didactique rappelle la
nécessité de placer l’articulation explorée
au milieu de la table pour limiter les inho-
mogénéités de champ, et l’importance du
confort du patient pour réduire les arté-
facts cinétiques. Les IRM sont réalisées
soit en décubitus latéral du côté examiné
avec la main le long du corps, soit en dé-
cubitus dorsal la main le long du corps ex-
centré dans l’anneau, soit dans la position
dite de « Superman » en décubitus ven-
tral main placée en avant (10).
L’IRM montre les lésions de Steiner avec
un fragment rétracté, déplacé superficiel-
lement par rapport à l’aponévrose de l’ad-
ducteur du pouce réalisant une masse
arrondie sur le versant médial de la portion
distale du 1
er
métacarpien, et recherche une
lésion associée de la plaque palmaire (11).
Les pièges à connaître en IRM haute réso-
lution des doigts (12) sont l’artéfact de
l’angle magique du tendon du long flé-
chisseur du pouce pour les séquences à
TE court (T1, DP, EG), la présence phy-
siologique de petites quantités de liquide
dans la gaine des tendons extenseurs, et
l’hétérogénéité de signal du tendon du
long abducteur du pouce.
À l’épaule, l’IRM haute résolution à l’aide
d’une antenne microscopique de surface
(47 mm) placée sur la face antéro-latérale
et centrée sur le relief antérieur de la gran-
de tubérosité permet une analyse très fine
de la portion distale du supraépineux, des
portions hautes des sous-scapulaire et in-
fraépineux et de l’intervalle des rotateurs.
Les auteurs montrent à l’aide de corréla-
tions histologiques en IRM haute résolu-
tion de coiffe, que 5 couches successives
peuvent être visualisées. La 1
re
couche super-
ficielle est composée de fibres du ligament
coraco-acromial, la 2
e
couche correspond
à un paquet compact et épais de fibres ten-
dineuses groupées en large faisceau depuis
le corps musculaire jusqu’aux tubérosités
pour le supra spinatus et l’infra spinatus.
La 3
e
couche est composée de petits fais-
ceaux tendineux nettement inférieurs en
taille à ceux de la 2
e
couche. Les faisceaux
tendineux de cette couche se croisent à un
angle de 45
°
. La 4
e
couche est composée de
tissus conjonctifs qui contiennent de larges
bandes de fibre de collagène. Ces bandes
sont situées à la face externe de la capsule
et fusionnent avec le ligament coraco-
huméral à la partie antérieure du supra
spinatus. Enfin la 5
e
couche est la capsu-
le articulaire.
La 2
e
couche est en hyposignal sur les
IRM et la 3
e
couche est en signal plus
intense, cependant inférieur à celui du
cartilage. Les couches 4 et 5 sont généra-
lement non individualisables en regard
C
(1) Service de Radiologie Ostéo-Articulaire du Pr Anne
Cotten, Hôpital R. Salengro, Lille. (2) Service de Radio-
logie du Pr Barral, Hôpital de Bellevue, Saint-Étienne.
(3) Service de Radiologie de Pr Frija, Hôpital Européen
G. Pompidou, Paris.
Correspondance : M Morel

J Radiol 2006;87
868
Imagerie Ostéo-articulaire
M Morel et al.
du supra spinatus. Elles sont mieux diffé-
renciées à hauteur de l’intervalle des rota-
teurs. Proximalement, les fibres tendineuses
sont cernées des fibres musculaires, ceci à
peu près à l’aplomb de la tête humérale, et
à ce niveau les couches 3 et 4 ne sont pas
visibles. Au niveau de l’intervalle des ro-
tateurs les ligaments coraco-huméral
(faisceau antérieur et postérieur) et gléno-
huméral supérieur sont parfaitement visi-
bles sur les coupes sagittales et axiales.
Ensuite 3 exemples sont présentés :
• Un exemple de rupture partielle non
visible sur l’IRM standard mais de qualité
mauvaise. L’IRM de haute résolution
montre une fissuration de très petite taille
de la face profonde de la portion distale et
postérieure du supra épineux, confirmée
en arthroscopie.
• Une fissuration transfixiante non visible
sur l’IRM standard, devinée sur l’IRM en
haute résolution par la présence d’un cliva-
ge des supra et infra épineux la faisant sus-
pecter. La rupture transfixiante ainsi que les
2 clivages est confirmée par l’arthro-IRM.
• Un exemple de rupture de l’intervalle
des rotateurs suspectée sur l’IRM classi-
que, confirmée par l’IRM en haute réso-
lution et l’arthro-MR (13).
Produits de contraste
Deux études évaluent les produits de
contraste ferreux superparamagnéti-
ques. Le ferucarbotran (Resovist
®
) en
IRM corps entier (séquences T2 et STIR,
réalisées à 60 min de l’injection) aug-
menterait la détectabilité des lésions
dans la pathologie osseuse métastatique
et myélomateuse (14) mais semble-t-il
sans augmenter la spécificité (en parti-
culier non discriminant en l’absence de
T1 pour les angiomes vertébraux). Une
étude animale va dans le même sens (tu-
meur versus inflammation (15).
IRM dynamique après injection
de gadolinium
L’étude dynamique du rehaussement des
tumeurs musculo-squelettiques (DCE-
MRI)
semble présenter un certain intérêt
(16). Si la mesure de la perfusion tumorale ne
fait pas la preuve de sa capacité à différencier
spécifiquement les tumeurs bénignes et ma-
lignes, elle permet par contre d’évaluer la
réponse au traitement (diminution de la per-
fusion : nécrose tumorale > 90 %).
L’IRM dynamique par mesure de la vites-
se de réhaussement maximal permet de
distinguer les malformations vasculaires
à flux lent d’une part et les malformations
vasculaires à flux rapides et les hémangio-
mes d’autre part qui ne sont pas différen-
ciables entre eux (17).
IRM de diffusion
L’imagerie de diffusion (antenne corps en-
tier à 1,5T) pour la détection des métastases
osseuses de cancer de la prostate (18) serait
supérieure à la scintigraphie au technétium
(DWI : Sensibilité : 97,9 %, Spécificité :
97,9 % versus scintigraphie : Sensibilité :
84,2 %, Spécificité : 63,9 %). Les mêmes
auteurs rapportent également l’intérêt de
la cartographie de diffusion dans l’évalua-
tion post hormonothérapie des cancers de
prostate (diminution significative de l’ADC
à 1 et 3 mois correspondant à une réponse
au traitement alors que les lésions ne sont
pas modifiées en T1) (19).
Pour les tumeurs osseuses malignes du ge-
nou (20), l’ADC de la tumeur viable est si-
gnificativement plus élevé que celui du
muscle et la moelle osseuse normaux, mais
inférieur à celui de l’œdème et de la nécrose
tissulaire, ce qui permettrait en préopéra-
toire de mieux apprécier l’extension préci-
se (y compris en intra osseux : 21) de la
tumeur viable, et de déterminer le volume
de nécrose tumorale après chimiothérapie.
IRM de perfusion
Avec l’imagerie de perfusion, les courbes
intensité/temps des lésions osseuses verté-
brales métastatiques ont une forme en
« V », bien distincte du tracé des lésions
bénignes dessinant un « Z » allongé (22).
Séquences particulières
La séquence IDEAL-FSE (Iterative De-
composition of water and fat with Echo
Asymetry and Least squares estimation)
est présentée en comparaison avec une sé-
quence conventionnelle FS-FSE au niveau
de la cheville (23). Elle permet une excel-
lente séparation de la graisse et de l’eau.
L’amélioration de la qualité de l’image est
plus sensible là où la graisse est habituelle-
ment mal saturée (périmalléolaire, tibia
distal, calcanéus, autour de matériels mé-
talliques). Cette séquence améliorerait la
détection des lésions après injection de
gadolinium. Le coût en terme de durée de
séquence (5,30 mn au lieu de 3,46 mn) pour-
rait être contre-balancé par la suppression
de la séquence coronale pondérée T1.
La séquence B-TFE (Balanced Turbo-
Field Echo (1,5T)), sans injection, per-
mettrait de visualiser un épaississement
synovial au genou avec autant de préci-
sion et moins d’artéfacts qu’une séquence
T1 après injection de gadolinium (24).
Arthro-IRM
À l’épaule, l’arthro-IRM évaluée en
confrontation à l’arthroscopie chez
220 patient
s a une bonne sensibilité pour le
diagnostic des ruptures transfixiantes du
subscapulaire (88 %), du long biceps (63 %)
et des tendons supra et infra épineux
(97 %) ; mais on est surpris par la très faible
sensibilité pour le diagnostic des ruptures
partielles du sub scapulaire (35 %), du bi-
ceps (20 %), et les ruptures partielles des ver-
sants articulaire (30 %) ou bursal (50 %) des
supra et infra épineux (semblant équivalen-
tes à l’IRM simple) (25).
Une étude a montré qu’il existait une corré-
lation entre l’extension antéro-postérieure
(largeur) des ruptures de coiffe et le degré
de rétraction tendineuse. D’autre part en
cas de clivage du moignon tendineux le
rapport largeur/rétraction serait supé-
rieur (1,2/1) contre (1/1,1) pour les tendons
non clivés. Enfin les auteurs rappellent
qu’il ne faut pas se contenter de mesurer
la rétraction des fibres bursales en cas de
clivage du moignon, car cela conduit très
souvent à sous estimer l’atteinte car la ré-
traction des fibres articulaires est souvent
plus étendue (26).
En cas d’instabilité résiduelle postchirurgi-
cale d’épaule l’arthro-IRM permet de détec-
ter de manière fiable les lésions labrales
(précision diagnostique de 94,2 %), les SLA
P
(93,3 %), les lésions de la coiffe des rotateurs
(85 %), du biceps (95,8 %), les lésions de Hill
Sachs (93,3 %), mais avec de façon moins
précise les lésions cartilagineuses (27).
En cas de protocole comparant dans le
même temps arthro-TDM et arthro-IRM
d’épaule, le mélange adéquat proposé est
le suivant : 25 % d’iode et concentration
de gadolinium de 1,25 mmol/L (28).
Une communication porte sur l’intérêt de
réaliser, en arthro-IRM, des coupes axiales et
frontales en double obliquité inclinée dans
l’axe de la glène et perpendiculaire au la-
brum postérieur. Ces plans de coupe amélio-
reraient de façon significative la sensibilité
de détection des lésions labrales postérieures
(92 % versus 42 % pour l’arthro-IRM
conventionnelle — chiffre étonnamment
bas —). Les lésions du ligament gléno-hu-
méral inférieur et les lésions intracapsulaires
du chef long du biceps sont également
mieux vues. Les autres lésions labrales et
ruptures de coiffe seraient aussi bien visibles
qu’en coupes conventionnelles (29).

J Radiol 2006;87
M Morel et al.
Imagerie Ostéo-articulaire
869
L’équipe de Charlottesville propose de
dénommer les lésions focales du cartilage
glénoïdien postérieur et inférieur entre
7 h et 9 h « glad lesions » postérieures,
par analogie avec les lésions du cartilage
antéro inférieur de la glène scapulaire. El-
les peuvent être associées avec des lésions
labrales et capsulaires postérieures, des
corps étrangers intra articulaires, une
contusion de la tête humérale. Elles sur-
viennent après impaction et compression
de la tête humérale contre la glène lors
d’un mouvement de rotation interne (30).
TDM
TDM multidétecteurs (MD)
Le scanner, avec l’avènement des multi-
détecteurs (coupes plus fines et meilleurs
filtres de reconstruction), fait un retour en
force en offrant une alternative de qualité
en imagerie 3D particulièrement utile
pour l’évaluation pré et post chirurgicale
en orthopédie (ostéosynthèses et arthro-
plasties) (31, 32). La TDM MD low-dose
pourrait également remplacer les radio-
graphies standard pour l’analyse de cer-
tains sites où elles sont connues pour être
peu sensibles comme le rachis thoracique
(tassements ostéoporotiques (33) et pour
le myélome (34)). La TDM low-dose
(réduction calculée par un algorithme
informatique de 50 %) aurait la même
sensibilité pour le diagnostic de débord
discal focal au rachis lombaire (35).
Les reconstructions axiales MPR (TDM
64 barrettes) détectent avec une meilleure
sensibilité les appositions périostées que
les images axiales directes et les radiogra-
phies. Il en est de même pour le remplace-
ment médullaire, les lésions ostéolytiques
de petite taille, les séquestres, l’ostéosclé-
rose, et l’atteinte articulaire dans le bilan
des lésions des os longs (36).
Arthro-TDM
Une équipe française conseille de réaliser
les arthro-TDM d’épaule à la fois en rota-
tion neutre et de façon systématique en
ABER (Abduction Rotation Externe)
afin d’améliorer la détection et la classifi-
cation de la composante horizontale et
des ruptures partielles de coiffe (37).
Interventionnel sous guidage
TDM
Différents gestes à visée thérapeutique
peuvent être réalisés en salle de TDM (à
noter qu’elles n’ont pas reçu l’aval de la
FDA). Il s’agit de l’arthrodèse postérieure
percutanée (vis transarticulaires), après
ostéosynthèse antérieure classique chirur-
gicale (38), de la nucléotomie lombaire
percutanée, présentée comme une techni-
que efficace et sûre à condition de respec-
ter les indications (sciatique lombaire sur
conflit disco radiculaire par hernie discale
confirmée en IRM, résistante au traite-
ment médical, le disque gardant une hau-
teur et une hydratation satisfaisantes) et
contre-indications (39). La nucléotomie
par vaporisation laser sous guidage TDM
est une alternative (aval de la FDA) (40).
La vertébroplastie reste au premier plan de
l’interventionnel osseux sous TDM. Elle est
préconisée à visée antalgique en association à
l’ostéosynthèse chirurgicale des rachis trau-
matiques (41). Enfin il faut signaler un logi-
ciel de simulation pour l’interventionnel
rachidien présenté par l’équipe de Besançon.
Échographie
Échographie statique
Plusieurs communications et posters élec-
troniques didactiques ont porté sur les
conflits nerveux identifiables le long des
trajets des nerfs périphériques (nerf mé-
dian et canal carpien : 42, syndrome du
tunnel ulnaire : 43). La sémiologie ultra-
sonore est une augmentation de taille du
nerf, la perte de son échostructure follicu-
laire habituelle remplacée par un aspect
hypoéchogène global. Parfois la cause du
conflit et une amyotrophie graisseuse hy-
peréchogène des muscles innervés par le
nerf en souffrance peuvent être reconnus.
Le nerf radial (syndromes de Frohse et de
Wartenberg) (44), le nerf ulnaire (45), les
nerfs périphériques au membre inférieur
(46) et les conflits nerveux de l’épaule (47)
ont fait l’objet d’une étude écho anatomi-
que précise images à l’appui ! Cette dernière
étude rappelle qu’il faut penser à un conflit
du nerf axillaire dans l’espace quadrilatère
en cas d’amyotrophie sélective du deltoïde
(faisceaux postérieurs) et du teres minor, et
à un conflit du nerf accessoire dans le trian-
gle cervical latéral devant une atrophie iso-
lée du trapèze notamment après biopsie
ganglionnaire cervicale.
L’échographie avec recours au Doppler
énergie détecte avec une sensibilité éga-
le à l’IRM, mais nettement supérieure à la
radiographie standard les érosions et sy-
novites subcliniques (48) chez les patients
atteints de PR débutante. La sémiologie
ultrasonore de la PR précoce est illustrée
en poster (49).
L’échographie de contraste (SonoVue
®
)
permet, en étudiant la vascularisation sy-
noviale, d’évaluer l’efficacité thérapeuti-
que des injections intra articulaires de
corticoïdes au cours de la PR (diminution
significative du rehaussement sur la cour-
be intensité/temps) (50).
Échographie dynamique
L’étude dynamique en temps réel est un
des atouts de l’échographie. L’échogra-
phie dynamique de la hanche à ressaut
antérieur démontre bien en séquences vi-
déo le ressaut créé par le retour brutal du
tendon ilio-psoas contre l’éminence ilio-
pectinée et la libération latérale soudaine
du corps musculaire du chef médial de
l’ilio-psoas. On retiendra le caractère péda-
gogique des posters électroniques portant
sur l’échographie musculo squelettique
dynamique [à consulter si possible sur le
site du RSNA] (51, 52).
Interventionnel sous guidage
échographique
Les avantages du guidage échographique
sont l’absence d’irradiation, la visualisation
en temps réel de la progression de l’aiguille
et des structures vasculaires ou autres
structures à risque au voisinage de la zone
de traitement. Sont ainsi proposées, vidéos
à l’appui, des interventions innovantes tel-
les que la fasciotomie plantaire écho gui-
dée (micro perforations à l’aide d’une
aiguille de 18G et infiltration cortison-
née) dans les fasciites plantaires récalci-
trantes (53), la « ténotomie percutanée »
échoguidée du tendon extenseur commun
en cas d’épicondylite latérale rebelle (54).
Des injections écho guidées d’anesthési-
ques locaux et/ou de corticoïdes sont pra-
tiquées en pathologie neuromusculaire
(ganglion stellaire, plexus brachial distal,
syndrome du piriforme…), y compris, et
avec un peu plus de difficulté est-il précisé,
au niveau des articulaires postérieures (55).
L’intérêt de l’échographie dans l’exploration
des PTH douloureuses, avec ponction
échoguidée de collections périprothéti-
ques, est confirmé par une équipe de
Détroit (aucun faux négatif pour le
diagnostic d’infection) (56).
Les biopsies synoviales d’articulations pé-
riphériques écho guidées ont un taux de
succès plus élevé (94 % en moyenne, maxi-
mum 100 % à l’épaule et à la cheville) que
celles réalisées sous scopie (57).

J Radiol 2006;87
870
Imagerie Ostéo-articulaire
M Morel et al.
Ménisques
Les lésions méniscales (internes et exter-
nes confondues) occultes en IRM et dé-
couvertes en arthroscopie ne sont pas rares :
(44/486) IRM chez 28 patients. Plus de la
moitié de ces patients (57 %) avaient une
rupture du LCA (58).
Des signes indirects de lésion méniscale
ont été étudiés et confrontés à la présence
d’une lésion méniscale en arthroscopie
(33 patients de 32 ans en moyenne) et rete-
nus comme ayant une grande spécificité et
VVP de lésion méniscale, que celle-ci soit
visible ou non en IRM. Ces signes sont : lé-
sion cartilagineuse focale au contact du
ménisque (Sp1.0/vvp1.0), subluxation mé-
niscale > à 3 mm (0,96/0,94), kyste para-
méniscal (1,0/1,0), œdème sous-chondral
au contact du ménisque (0,96/0,96) et œdè-
me linéaire sous-chondral (0,96/0,90) (59).
Plusieurs communications se sont inté-
ressées à l’insertion tibiale des ménisques,
en particulier l’insertion tibiale postérieu-
re du ménisque interne dont la rupture
complète peut être diagnostiquée en IRM
(60, 61) sous réserve de retrouver cette lé-
sion sur tous les plans de coupes. Une étu-
de s’est plus particulièrement intéressée
à la subluxation du ménisque interne
(> à 3 mm par rapport au rebord tibial)
comme signe indirect isolé de rupture de
l’insertion tibiale postérieure du ménis-
que interne. Ce signe a été retrouvé sur
42/300 IRM (42 patients) et corrélé aux
données arthroscopiques. Neuf des 42 pa-
tients n’avaient aucune lésion méniscale
en arthroscopie. Tous étaient âgés de plus
de 50 ans (62). Ces données sont concor-
dantes avec les résultats d’une autre étude
présentée en 2004 qui retrouvait sur 783
IRM 9,7 % de subluxation méniscale
dont 53,9 % en relation avec des remanie-
ments dégénératifs modérés à sévères du
compartiment médial et dans 40,8 % des
cas associée à une rupture radiaire complète
(RSNA 2004 SSG23-03 p461).
Enfin sur une série française de 952 genoux
explorés en arthro-TDM (192) et IRM
(760), 89 ruptures de l’insertion tibiale pos-
térieure du ménisque interne ont été retrou-
vées (corrélation arthroscopique = 8). Ces
lésions ne seraient donc pas si rares. Elles se-
raient fréquemment associées à des lésions
focales du cartilage du tiers postéro-interne
du condyle fémoral médial retrouvées chez
57/89 (64 %) patients contre 72/815 (9 %) des
patients n’ayant pas ce type de lésion ménis-
cale (63-66)
(fig. 1)
.
Mais aussi…
On citera ici quelques études ayant retenu
notre attention :
Échographie et 3D
Une étude étonnante qui valide l’outil ultra-
sonore couplé à un système de navigation
3D pour la mesure en pré et postopératoire
de l’antéversion fémorale. La fiabilité serait
identique à la méthode TDM de référence
mais l’outil semble complexe et la relecture
par le clinicien impossible (67).
IRM
Les signes distinctifs de l’arthrite de Ly-
me au genou, en comparaison à la PR,
sont la présence d’adénomégalies en fosse
poplitée, la prolifération synoviale pré-
pondérante dans les secteurs postérolaté-
raux, et la faible atteinte cartilagineuse
fémoro patellaire (68).
L’hypertrophie de la synoviale en iso ou hy-
posignal T2 par rapport au liquide articulaire
et la présence de foyers de bas signal (maté-
riel caséeux, débris, corps étrangers)
dans le
liquide synovial doivent faire évoquer le dia-
gnostic de tuberculose du genou
(69).
Plusieurs posters ont décrits les aspects
IRM des lésions cutanées et sous cutanées :
on retiendra en situation cutanée le der-
mato fibrosarcome protuberans (masse
nodulaire de signal aspécifique et se re-
haussant discrètement), et en situation
souscutanée la prépondérance de l’histio-
cytome fibreux malin (70, 71).
Sclérodermie
Très beau poster (primé) de l’équipe de
Lille illustrant les atteintes cutanées et en
imagerie (radiographies, échographie et
IRM) au cours de la sclérodermie. Pour
les amateurs, le sujet est en ligne sur le site
osartim.chru-lille.fr.
L’articulation tibio fibulaire
proximale : l’oubliée du genou
L’atteinte de l’articulation tibio fibulaire
proximale serait méconnue et sous-estimée
dans les gonalgies latérales… Ouvrez l’œil
en IRM (72).
Les biphosphonates
Une cause rare et bénigne d’ostéonécrose
spontanée de la mandibule (73).
Évaluation postopératoire
avec matériel en TDM et IRM :
comment minimiser
les artéfacts ?
En TDM, l’augmentation du nombre de
détecteur limiterait les artéfacts : à 64 bar-
rettes (arthroplasties de hanches et ge-
noux : 74, 75), ou à 16 barrettes versus 4
(vis pédiculaires : 76). Les filtres de re-
construction très durs peuvent améliorer
la visualisation de l’implant métallique
lui-même mais une couronne noire appa-
raît à son contact et gène la visualisation
des tissus adjacents. Les filtres mous sont
préférables pour voir au mieux les tissus
au contact. Les filtres durs sont un compro-
mis. Augmenter les Kv à 140 diminuerait
les artéfacts de durcissement. L’augmen-
tation des mAs aurait peu d’effet. Il est
préférable d’utiliser une collimation fine
(coupes inférieures au millimètre et che-
vauchement de 50 %). En général les re-
formations MPR sont meilleures que les
reconstructions directes à partir des row-
data. Augmenter l’épaisseur du reforma-
tage (1,5 au lieu de 1 mm) permet égalemen
t
de réduire les artéfacts. Il faut penser à uti-
liser une fenêtre adaptée : 14 000 w, 700 c
pour voir le matériel (75, 77).
En IRM les artéfacts sont moindre avec un
matériel en titane qu’en acier. L’axe de la
prothèse doit être de préférence orienté pa-
rallèlement au champ magnétique. Il faut
Fig. 1 : IRM de genou coupe frontale (DP
fat sat) passant par la corne posté-
rieure du ménisque médial, mon-
trant la rupture de l’insertion tibiale
postérieure du ménisque médial
(flèche) et l’altération du cartilage
condylien en regard (flèche dou-
ble). Courtoisie Dr Pessis, Paris.
Fig. 1: Coronal fat-suppressed proton
density MR image through the
posterior horn of the medial
meniscus showing tear of the
posterior tibial insertion (arrow)
and abnormality the adjacent
femoral cartilage (double arrow).

J Radiol 2006;87
M Morel et al.
Imagerie Ostéo-articulaire
871
orienter le codage de la fréquence dans le
sens de l’axe de la prothèse, augmenter la
bande passante à 62,5 KHz, préférer le fast
spin écho (FSE) et le STIR à la Fat Sat. En-
fin il faut diminuer la taille du Voxel et
augmenter le nombre de pixels dans le sens
du codage de la fréquence (75, 78).
Références
1. Boles CA, D’Alessio TL, Wile GE, El-
Khoury GY. High Resolution 3.0T MR
Elbow: A Fresh Look at Anatomy. RS-
NA 2005;1218BP-e:782.
2. Boles CA, Lee J, El-Khoury GY. High Re-
solution 3.0T MR Wrist: Anatomy on Rou-
tine Images. RSNA 2005;1218BP-e:781.
3. Lee KS, Craig JG, van Holsbeeck MT.
3 Tesla MR Imaging of the Ankle Using
a Surface Coil: Normal Anatomy and
Selected Abnormal Cases. RSNA 2005;
2341CE-e:790.
4. Yao L, Pitts JT, Thomasson D. Compre-
hensive MRI of the Ankle at 3.0 Tesla: Iso-
tropic 3D Proton Density-weighted Fast
Spin Echo. RSNA 2005;SSE20-01:310.
5. Thedens D, Stolpen AH, Baer TE, Saltz-
man CL, Brown TD, El-Khoury GY.
Improved Visualization of Ankle Car-
tilage with Three-dimensional MRI at
3 Tesla Using Noninvasive Distraction.
RSNA 2005;SSA21-06:221.
6. Magee T, Shapiro MD, Williams DS,
Ramnath RR. Sensitivity and Specificity
in Detection of Supraspinatus Tendon
Tears with 3.0 Tesla MR Imaging of the
Shoulder. RSNA 2005;SSC19-05:274.
7. Eshed I, Althoff CE, Scheel AK, Bac-
khaus M, Hamm KA. Low-Field MRI
for Assessing Synovitis in Patients with
Rheumatoid Arthritis: Impact of Gd-
DTPA Dose on Synovitis Scoring? RS-
NA 2005;SSA22-04:223.
8. Kamishima T. Effect of Treatment with
Infliximab on Patients with Rheumatoid
Arthritis Evaluated by Contrast-enhanced
MR Imaging. RSNA 2005;SSA22-05:223.
9. Suga T, Watanabe Y, Amoh Y, Saegusa J,
Nagayama M, Okumura A. Early Dia-
gnosis of Rheumatoid Arthritis with Mi-
croscopic MR Imaging of the Fingers.
RSNA 2005;SSA22-02:222.
10. Cerezal LF, Abascal F, del Pinal F, Can-
ga A. MR imaging of athletic injuries of
the wrist and hand. RSNA 2005;1213BP-
e:781.
11. Peterson JJ, Kransdorf MJ, Bancroft LW,
Berquist TH, Murray P, Ruzek KA.
Evaluation of collateral ligament injuries
of the mcp joints with magnetic resonance
imaging and magnetic resonance arthro-
graphy. RSNA 2005;1212BP-e:781.
12. Fujii M, Iwama Y, Kawamitsu H,
Ohno Y, Kaji Y, Sugimura K. High-
resolution MR imaging of the finger trau-
ma with a microscopic coil. RSNA 2005:
1210BP-e:781.
13. Hitachi S, Majima K, Tabata S, Sato A,
Higano S, Takahashi S. The impact of hi-
gh-resolution MR imaging of the rotator
cuff with a microscopic coil: correlation
with histopathologic and arthroscopic
findings. RSNA 2005;1254BP-e:785.
14. Johnston CJ, Ford SM, Duke DM, Eusta-
ce SJ. Whole body MRI in the evaluation
of marrow disease employing intra-
venous super paramagnetic iron oxide
agent: comparison of T2-weighted and
STIR TSE sequences. RSNA 2005;SSM22-
03:486.
15. Tsuda N, Tsuji T, Kato N, Fukuda Y,
Ando K, Ishikura R. Differential uptake
of superparamagnetic iron oxide between
tumor and inflammation in rabbit bone
marrow. RSNA 2005;LPH08-04-p:662.
16. Sugawara Y, Kajihara M, Kikuchi K, Miki
H, Mochizuki T, Murase K. Tumor blood
flow measurement by dynamic contrast-en-
hanced MRI in musculoskeletal tumors:
comparison with Thallium-201 scintigra-
phy. RSNA 2005;LPH08-02-p:661.
17. Ohgiya Y, Hashimoto T, Gokan T, Oka M,
Ekholm S, Westesson PA. Peripheral
vascular malformations and hemangio-
mas: value of dynamic MR imaging for
diagnosis. RSNA 2005;LPH08-05-p:662.
18. Wang X, Dou Y, Xu Y, Jiang X. Diffu-
sion-weighted whole body imaging in the
evaluation of bone metastasis of prostate
cancer: comparison with bone scintigra-
phy. RSNA 2005;LPH08-03-p:662.
19. Wang X, He J, Li F, Xu Y, Jiang X. Eva-
luation of enbocrine therapy on bone me-
tastasis of prostate cancer with MRI and
DWI. RSNA 2005;SSA21-07:221.
20. Ma L, Meng Q. The Value of Apparent
diffusion coefficients (ADCs) in the dia-
gnosis of malignant bone neoplasms. RS-
NA 2005;SSE19-01:309.
21. Ma L, Meng Q, Jiang B, Chen Y. Accuracy
of ADC maps derived from the SSEPI-
DWI for estimating the intramedullary
extent of malignant bone neoplasms. RS-
NA 2005;SSE19-02:309.
22. Wang S, Fang M, Sun M, Zhang L. Eva-
luation of MR perfusion-weighted ima-
ging in vertebral disease. RSNA 2005;
LPH08-01-p:661.
23. Gold GE, Fuller SE, Shimakawa A,
Yu H, Johnson JW, Beaulieu CF. MR
imaging of the ankle: comparison of FS-
FSE with IDEAL-FSE. RSNA 2005;
SSE20-04:311.
24. Fukuda Y, Ishikura R, Ando K, Aoya-
ma N, Nakao N. Balanced turbo field
echo (B-TFE) for evaluation of synovial
thickening in the knee joint. RSNA 2005;
LPR05-03-p:665.
25. Hong HP, Chung HW, Choi S, Yoon YC,
Park JY, Lee MH. Diagnostic value of
MR arthrography for evaluation of rota-
tor cuffs and biceps tendons. RSNA
2005;SSC19-07:274.
26. Venkatesan AM, Fritz B, Kassarjian A,
Palmer WE. Correlation between the size
of rotator cuff tear and the degree of ten-
don retraction. RSNA 2005;SSC19-04:274.
27. Probyn LJ, White LM, Salonen DC,
Tomlinson G, Boynton E, Powell T. Di-
rect MR arthrographic assessment of
recurrent symptoms post shoulder insta-
bility repair: correlation with second look
surgical evaluation (in 40 patients). RS-
NA 2005;SSC19-01:273.
28. Choi J, Kang HS, Hong SH, Jun WS,
Moon SG, Choi J. Optimization of the
mixture ratio of iodinated contrast and
gadolinium for simultaneous direct MR
and CT arthrography. RSNA 2005;SSA21-
05:221.
29. Sasaki T, Yodono H, Shinohara A, Matsuo
K, Ishibashi Y, Sato H. MR arthrography of
shoulders: double versus conventional MR
imaging. RSNA 2005;SSC19-02: 273.
30. Anderson MW, Barr MS, Gaskin C, Al-
ford BA. Posterior GLAD lesions of the
shoulder. RSNA 2005;SSC19-03:273.
31. Dijkshoom ML, Van Dijke C, Ginai AZ,
Bessems JH, Krestin GP. Metal implants:
a CT radiographer’s worst nightmare!
which materials to use and how to optimize
scan protocols. RSNA 2005;1260BP-e:785.
32. Kim H, Shin MJ, Kim SM, Lee SH,
Hong HJ. The role of MDCT in the eva-
luation of postoperative findings in long
bone fracture. RSNA 2005;1261BP-e:785.
33. Safdar NM, Nguyen K, Siddiqui KM,
Mulligan ME, Moffitt R, Filigenzi J.
Comparison of ultra low-dose computed
tomography and digital radiography for
the detection of thoracic spine fractures.
RSNA 2005;LPB07-09-p:659.
34. Fanucci E, Schillaci O, Nisini A, Di Cos-
tanzo G, Leporace M, Simonetti G. Conven-
tional radiography, 64-row detector MSC
T,
MRI, and PET/CT in staging of multiple
myeloma. RSNA 2005;1227BP-e:783.
35. Bohy P, De Maertelaer V, Tack DM,
Roquigny A, Keyzer C, Genevois PA.
Comparison of standard-dose and simu-
lated low-dose MDCT in patients suspec-
ted of lumbar disc herniation. RSNA
2005; SSG22-02:362.
36. Haisong C, Cheng L, Chen Q, Wang D,
Zhen J, He J. The value of multi-direc-
tion adjusted MPR using 64-slice CT in
diagnosing long bone diseases. RSNA
2005;LPB07-01-p:658.
37. Silbermann-Hoffman O, Feydy A, Mau-
lat I, Clarencon F, Drapé JL, Schouman-
Claeys E. Shoulder CT arthrography in
ABER position in rotator cuff tear. RS-
NA 2005;SSC19-09:275.
 6
6
1
/
6
100%