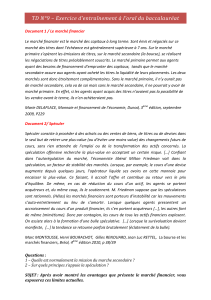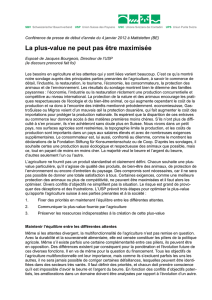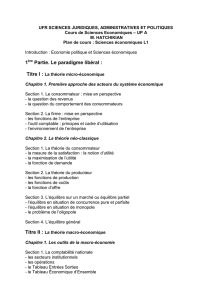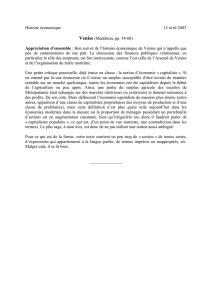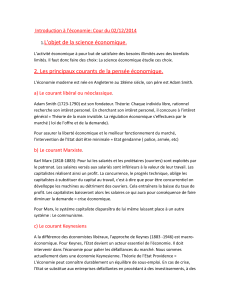L'accumulation du capital
Otto Bauer
Dans Cahiers d'économie PolitiqueCahiers d'économie Politique 2006/2 (n° 51)2006/2 (n° 51), pages 287 à 309
Éditions L'HarmattanL'Harmattan
ISSN 0154-8344
ISBN 2296026575
DOI 10.3917/cep.051.0287
Distribution électronique Cairn.info pour L'Harmattan.Distribution électronique Cairn.info pour L'Harmattan.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le
cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque
forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est
précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.
Article disponible en ligne à l’adresseArticle disponible en ligne à l’adresse
https://www.cairn.info/revue-cahiers-d-economie-politique-1-2006-2-page-287.htm
Découvrir le sommaire de ce numéro, suivre la revue par email, s’abonner...
Flashez ce QR Code pour accéder à la page de ce numéro sur Cairn.info.
© L'Harmattan | Téléchargé le 07/01/2024 sur www.cairn.info via Université de Picardie (IP: 194.57.107.113)
© L'Harmattan | Téléchargé le 07/01/2024 sur www.cairn.info via Université de Picardie (IP: 194.57.107.113)

Cahiers d'économie politique, n° 51, L'Harmattan, 2006
L'ACCUMULATION DU CAPITAL
Traduction de Otto BAUER (Vienne)
Accumulation et pouvoir de consommation
Chaque année, les capitalistes transforment une partie de la plus-value produite
en capital. Ils consacrent une partie de la plus-value à étendre les anciennes exploi-
tations et à en bâtir de nouvelles ; également, à accroître leur appareil de production
et l'armée ouvrière sous leur commandement. Marx appelle cette transformation
d'une partie de la plus-value en capital, l'accumulation du capital. Plus le dévelop-
pement capitaliste se poursuit, plus la part de la plus value consommée par les capi-
talistes s'amoindrit, et plus grande devient celle qu'ils ont accumulée. Le taux
d'accumulation, c'est-à-dire le rapport de la part de la plus-value accumulée sur la
plus-value totale, grimpe.
Tandis que l'accumulation du capital progresse de manière illimitée, l'appareil
productif de la société est allongé, la masse de biens qui a été produite dans les en-
treprises des capitalistes grossit de façon colossale, des limites étroites sont posées à
la capacité de consommation de la société capitaliste. Le pouvoir d'achat de la
classe laborieuse augmente plus lentement que le capital ; car avec le développe-
ment des forces productives la valeur de la force de travail chute, la part de la classe
laborieuse dans la valeur du produit social diminue. Mais de la même façon, le pou-
voir d'achat de la classe capitaliste croît moins vite que le capital. Les capitalistes
peuvent consommer d'autant moins qu'ils accumulent davantage. C'est pourquoi le
pouvoir de consommation de la société capitaliste reste encore et toujours en retrait
par rapport aux forces productives dont l'expansion est infinie. Cette contradiction
interne du mode de production capitaliste conduit à la baisse du taux de profit. Il
devient apparent dans les crises dévastatrices, lors desquelles les masses de biens
déversées sur le marché par un appareil de production élargi, cherchent vainement
des acheteurs.
L'explication des crises en termes de disproportion entre accumulation du capi-
tal et pouvoir de consommation de la société a été développée en premier lieu par
Sismondi, suivi par Malthus, Chalmers et Rodbertus. Pour Sismondi, elle constitue
un élément essentiel de sa critique du capitalisme ; pour Malthus et Chalmers, une
hypothèse préalable à leur démonstration, selon laquelle la société capitaliste a be-
© L'Harmattan | Téléchargé le 07/01/2024 sur www.cairn.info via Université de Picardie (IP: 194.57.107.113)
© L'Harmattan | Téléchargé le 07/01/2024 sur www.cairn.info via Université de Picardie (IP: 194.57.107.113)

Otto Bauer
288
soin d'une "tierce personne" pour être capable de vendre une fois pour toutes ses
marchandises – une tierce personne qui consomme sans produire.
L'explication de la baisse du taux de profit en termes de disproportion entre ac-
cumulation du capital et croissance de la force de travail a été apportée tout d'abord
par le Pamphlet de 1821, par Hodgskin, et par Ramsey.
Les défenseurs du capitalisme ont attaqué cette théorie. Ils dénient la possibili-
té d'une surproduction générale. Avec la croissance des marchandises augmenterait
également le pouvoir d'achat des producteurs. Les crises ne pourraient survenir
qu'en raison d'une disproportion entre les secteurs de production, et non en raison
d'une surproduction générale. Et à cela, le fait que le travailleur doit partager la va-
leur de sa production avec le capitaliste n'y change rien. Car moins les travailleurs
peuvent consommer, plus grand est le pouvoir d'achat des capitalistes : le volume
total de la demande de biens reste inchangé, que la part des travailleurs à la valeur
du produit augmente ou diminue. C'est exactement la même chose pour l'accumula-
tion du capital. Si elle s'accroît, proportionnellement moins de biens de consomma-
tion sont alors achetés, mais d'autant plus de moyens de production. C'est ce qu'ont
avancé Ricardo, Mac Culloch, Say.
Tout comme les crises, la baisse du taux de profit ne trouverait pas plus d'ex-
plication dans la suraccumulation. La baisse du taux de profit s'expliquerait seule-
ment par le fait que les difficultés croissantes à fournir les moyens de subsistance
élèvent la valeur de la force de travail et font chuter le taux de plus-value. La baisse
du taux de profit est alors attribuée à d'inévitables lois naturelles : à la surpopulation
et à la chute du taux de mortalité, arguments avancés spécialement par Ricardo et
John Stuart Mill.
Marx a définitivement rejeté ces objections émanant de l'école Ricardo - Say,
mais en même temps il a aussi proposé une version tout à fait nouvelle de l'ensei-
gnement de Sismondi relatif à la contradiction interne de l'accumulation capitaliste.
Il a divisé la production capitaliste en deux parties : la production de moyens de
production et la production de biens de consommation. Il a démontré que la repro-
duction du capital ne pouvait alors se produire sans heurts que s'il existe des rela-
tions quantitatives déterminées entre les deux branches de production. Or, dans la
société capitaliste cette harmonie ne peut pas être établie, excepté comme le "résul-
tat du processus de dissolution des dissensions existantes". Ainsi, les crises n'appa-
raissent pas comme des phénomènes accidentels provoqués par des disproportions
fortuites dans la production, mais comme des phases inévitables de la reproduction
du capital, car ce n'est que moyennant ces crises que s'établissent les nécessaires
rapports de grandeurs entre les deux secteurs de la production sociale. Cependant, la
baisse du taux de profit s'accomplit même lorsqu'il y a une proportionnalité totale
de la production, non pas sous l'effet d'une loi naturelle inéluctable, mais comme la
© L'Harmattan | Téléchargé le 07/01/2024 sur www.cairn.info via Université de Picardie (IP: 194.57.107.113)
© L'Harmattan | Téléchargé le 07/01/2024 sur www.cairn.info via Université de Picardie (IP: 194.57.107.113)

L'accumulation du capital
289
conséquence de ce que le capital croît plus vite que la force de travail qu'il met en
mouvement et qui, seule, produit la plus-value.
Les schémas du second volume du Capital, dans lequel Marx a présenté les
conditions d'équilibre entre les deux branches de la production, ont par la suite très
fortement influencé la littérature économique russe. Celle-ci s'est posée la question
de savoir, si le capitalisme était, pour la Russie également, une "nécessité transi-
toire" ; si, comme le soutenaient les Zapadniki ("Occidentalistes"), la Russie devait
aussi adopter les institutions économiques, sociales et politiques de l'Europe de
l'Ouest et centrale ou si, comme le pensaient les Slavophiles, elle devait conserver
son caractère et son originalité nationale ; exprimé en termes socialistes : si, en Rus-
sie aussi, la concentration du capital, la prolétarisation des masses, la lutte de clas-
ses entre la bourgeoisie et le prolétariat constituaient les conditions préalables du
socialisme, comme les sociaux-démocrates l'enseignaient ou bien si la Russie, sans
avoir à emprunter la voie du capitalisme, pouvait construire une communauté socia-
liste sur la base du mir, la communauté villageoise de paysans, comme les Narodni-
ki ("populistes") et leurs successeurs, les socialistes révolutionnaires, le suggéraient.
Dans le cadre de ce débat, la question s'est donc posée de savoir si le capitalisme
pourrait absolument s'établir en dehors de l'aire de l'Europe centrale et de l'Ouest ;
si le développement d'une production capitaliste à l'Est ne devrait pas avorter, en
raison de l'impossibilité de vendre les marchandises produites par l'appareil produc-
tif élargi. Dans le combat contre les Narodniki les marxistes ont montré, en s'ap-
puyant sur les schémas de Marx, que le capitalisme pouvait s'étendre de plus en plus
et l'appareil productif être démesurément multiplié sans qu'il manque aux capitalis-
tes le marché pour leurs produits, et que, alors, l'équilibre entre la production de
moyens de production et la production de biens de consommation est continuelle-
ment renouvelé par les mécanismes capitalistes.
Le conflit entre les Narodniki et les marxistes en Russie a été tranché par l'his-
toire. Mais à présent, Rosa Luxemburg soulève de nouveau la thèse de l'épuisement
du capitalisme, certes dans des perspectives très différentes. Son livre L'accumula-
tion du capital : une contribution à l'analyse économique du capitalisme (Berlin,
Vorwärts, 1913), offre une nouvelle version du problème qui est récurrent depuis
Sismondi.
Supposons dans un premier temps une reproduction simple : la totalité de la
plus-value est consommée et aucune part n'est accumulée. Dans ce cas, selon Marx,
la production totale peut être présentée comme suit :
I. Industries des moyens de production :
Capital constant (c) + Capital variable (v) + Plus-value (m)
II. Industries des biens de consommation :
Capital constant (c1) + Capital variable (v1) + Plus-value (m1)
© L'Harmattan | Téléchargé le 07/01/2024 sur www.cairn.info via Université de Picardie (IP: 194.57.107.113)
© L'Harmattan | Téléchargé le 07/01/2024 sur www.cairn.info via Université de Picardie (IP: 194.57.107.113)

Otto Bauer
290
Les industries de moyens de production doivent acheter des biens de subsis-
tance aux industries de biens de consommation : 1) pour nourrir leurs travailleurs à
concurrence de v, 2) pour la consommation de leurs capitalistes à concurrence de
m ; donc, pour une somme totale de v + m. D'un autre côté les industries de biens
de consommation doivent acheter des moyens de production aux industries qui les
fabriquent à concurrence de c1, afin de renouveler leur capital constant. L'échange
entre ces deux secteurs se produit sans encombre tant que c1 = v + m. Telle est la
condition d'équilibre dans le cas d'une reproduction simple.
Il en va tout autrement dans le cas de la reproduction élargie. Ici la production
totale se présente de la manière suivante :
I. Industries des moyens de production :
Capital constant (c) + Capital variable (v) + part consommée de la plus-value (k)
+ part accumulée de la plus-value (a)
II. Industries des biens de consommation :
Capital constant (c1) + Capital variable (v1) + part consommée de la plus-value (k1)
+ part accumulée de la plus-value (a1)
C'est ici qu'apparaissent les difficultés. Les industries des moyens de produc-
tion achètent des biens de subsistance à concurrence de v + k et, pour ce même
montant, les industries de biens de consommation leur achètent des moyens de pro-
duction pour renouveler leur capital constant. Mais que se passe-t-il avec a et a1 ?
Avant tout, a est réalisé, dans les moyens de production ; qui peut l'acheter ? a1 est
incorporé dans les biens de consommation ; où doit-il être écoulé ? C'est ici à pré-
sent que Rosa Luxemburg a recours à la vieille hypothèse de la "tierce personne".
Elle pense que la part de la plus-value devant être accumulée ne pourrait absolu-
ment pas se réaliser, si la production capitaliste n'était pas en mesure d'écouler le
surplus de valeur en dehors de sa propre sphère : auprès de petits-bourgeois aux
méthodes de production non capitalistes et auprès de petits paysans. Cela explique
la pression du capital pour l'extension de ses marchés. De là vient aussi la tendance
à dévaster l'économie naturelle, à convertir partout la production simple de mar-
chandises en production capitaliste, à faire de la terre entière un territoire marchand
pour l'industrie capitaliste –donc, l'impérialisme ! Cependant, dès l'instant où le ter-
ritoire marchand n'est plus extensible, le capitalisme n'est plus capable d'écouler une
grande partie de ses marchandises. Il étouffe sous l'opulence qu'il a lui-même en-
gendrée. Sa dernière heure approche… Telle est l'idée fondamentale au centre de
l'œuvre de la camarade Luxemburg. Savoir si cette thèse est correcte, voilà ce que
nous devons maintenant examiner.
Accumulation et croissance de la population
Toute société, dont la population augmente, doit étendre sa capacité de produc-
tion chaque année. Cette nécessité se présentera aussi bien pour la société socialiste
du futur que pour la société capitaliste du présent, comme cela était le cas pour une
© L'Harmattan | Téléchargé le 07/01/2024 sur www.cairn.info via Université de Picardie (IP: 194.57.107.113)
© L'Harmattan | Téléchargé le 07/01/2024 sur www.cairn.info via Université de Picardie (IP: 194.57.107.113)
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%