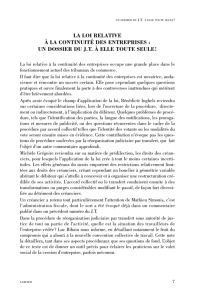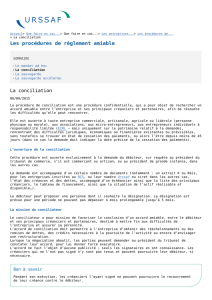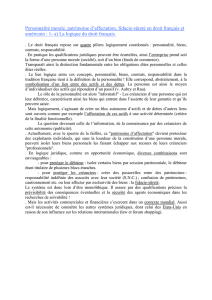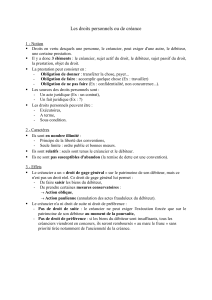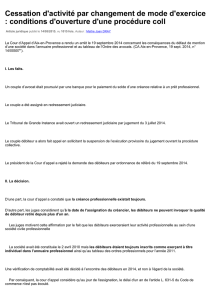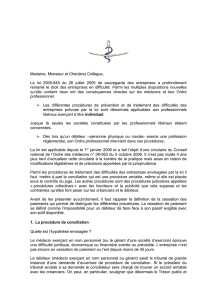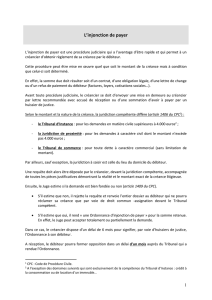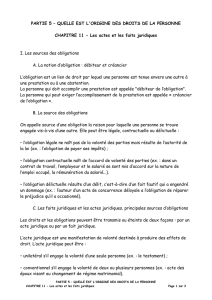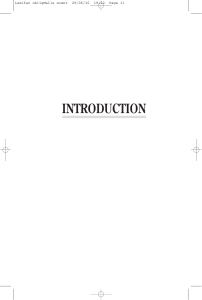Procédures Collectives d'Apurement du Passif des Entreprises
Telechargé par
yanicefdl19

1
PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF DES ENTREPRISES
Table des matières
INTRODUCTION ..................................................................................................................................... 3
SECTION 1 : LA NOTION ET LA NATURE JURIDIQUE DE L’ENTREPRISE ............ 3
SECTION 2 : LA NOTION DE DIFFICULTES D’UNE ENTREPRISE. ......................... 5
PARTIE I : LES PROCEDURES PREVENTIVES DE LA CESSATION DES
PAIEMENTS ...................................................................................................................... 7
CHAPITRE 1 : LA CONCILIATION .................................................................................................... 7
CHAPITRE II : LE REGLEMENT PREVENTIF ............................................................................ 10
SECTION 1 : LA SAISINE DE LA JURIDICTION COMPETENTE ............................. 10
A- L’organisation de la saisine. .......................................................................... 10
B- La détermination de la juridiction compétente. .............................................. 11
SECTION 2 : LA DECISION DU PR DE LA JURIDICTION COMPÉTENTE.............. 11
PARAGRAPHE 1 : La suspension des poursuites individuelles ............................. 11
PARAGRAPHE 2 : La désignation de l’expert. ....................................................... 12
SECTION 3 : La décision de la juridiction compétente .............................................. 13
PARAGRAPHE 1 : La confirmation du règlement préventif. ................................... 13
PARAGRAPHE 2 : L’homologation du concordat préventif .................................... 14
CHAPITRE 2 : LES EFFETS DU REGLEMENT PREVENTIF ................................................ 15
SECTION 1 : Les organes du règlement préventif ..................................................... 15
Section 2 : Le suivi du règlement préventif ................................................................ 16
Paragraphe 1 : Les obligations des parties ............................................................. 16
Paragraphe 2 : La remise en cause du concordat préventif ................................... 17
PARTIE 2 : LES PROCEDURES CONSECUTIVES A LA CESSATION DES
PAIEMENTS ................................................................................................................... 20
CHAPITRE 1 : L’OUVERTURE DES PROCEDURES. ............................................................. 20
SECTION 1 : Conditions de fond. .............................................................................. 20
PARAGRAPHE 1 : Conditions de fond liées à la situation juridique de l’entreprise 21
SECTION 2 : Les conditions de forme de l’ouverture des procédures .................... 24
Paragraphe 1 : la saisine de la juridiction compétente ............................................ 24
CHAPITRE 2 : LES EFFETS DE LA DECISION D’OUVERTURE......................................... 27
SECTION 1: Les effets à l’égard du débiteur ............................................................. 27

2
Paragraphe 1 : la restriction des droits du débiteur ................................................ 27
Paragraphe 2 : la remise en cause des actes antérieurs à la décision d’ouverture. 29
Paragraphe 3 : La continuation de l’activité du débiteur. ........................................ 31
SECTION 2 : Les effets à l’égard des créanciers ................................................... 36
Paragraphe 1 : la production et la vérification de créance ......................................... 36
Paragraphe 2 : la constitution de la masse ................................................................ 38
CHAPITRE 3 : LES SOLUTIONS DES PROCEDURES ........................................................... 39
SECTION 1 : Les solutions du redressement judiciaire ............................................. 39
Paragraphe 1 : la formation du concordat de redressement ................................... 39
Paragraphe 2 : la clôture pour extinction du passif. ................................................ 41
SECTION 2: Les solutions de la liquidation des biens ............................................... 42
Paragraphe 1 : La déclaration de l’union ................................................................ 42
Paragraphe 2 : la clôture pour insuffisance d’actif .................................................. 43
Paragraphe 2 : La clôture pour insuffisance d’actif ................................................. 43

3
INTRODUCTION
Les procédures collectives d’apurement du passif se définissent comme des mécanismes
juridiques et judiciaires qui ont pour finalité de payer les créanciers d’une entreprise. Il
s’agit d’un ensemble de principes et de règles juridiques permettant de régler les
difficultés financières et économiques que traversent les entreprises dans l’exercice de
leur activité, au cours d’un procès.
Ces procédures sont dites collectives en ce sens qu’elles conduisent à regrouper les
créanciers de l’entreprise en une entité appelée « masse des créanciers ». Elle vise à
satisfaire par un seul et même procès les intérêts de l’ensemble des créanciers que les
difficultés de l’entreprise débitrice remettent en cause.
Il est donc nécessaire de définir la notion et la nature juridique de l’entreprise, d’une part
et la notion de difficulté de l’entreprise, d’autre part.
SECTION 1 : LA NOTION ET LA NATURE JURIDIQUE DE L’ENTREPRISE
L’entreprise peut se définir de deux manières :
1ere définition l’entreprise est une activité : cela veut dire qu’elle consiste en une série
d’actes identiques répétée dans le temps. Cette définition est celle de l’entreprise
commerciale.
L’activité de l’entreprise est donc la répétition des actes de commerce telle que prévue
par la règlementation résultant des Actes Uniformes de l’OHADA et notamment de l’acte
uniforme relatif au droit commercial général. L’acte de commerce le plus courant est
l’achat pour revendre. Il y aura donc entreprise dès lors qu’il y a exercice d’actes de
commerce de façon professionnel.
2eme définition l’entreprise est une organisation : l’entreprise est la réunion d’un ensemble
de moyens matériel, financier et humain en vue de produire un bien à mettre à la
disposition des consommateurs. L’entreprise apparait comme un intermédiaire entre les
producteurs de bien et les consommateurs de ces biens. Il peut se faire aussi que
l’entreprise produise directement les biens destinés à la consommation. Cette définition
montre que l’entreprise a aussi un aspect physique, tangible. On la qualifie alors
d’organisation ou de système.
Ces deux définitions se rejoignent et elles font apparaitre l’idée fondamentale sur laquelle
repose la notion d’entreprise. L’entreprise est constituée dans un but de spéculation. La
recherche du profit et la circulation des richesses permettent de qualifier l’entreprise.
C’est la raison pour laquelle on parle d’opérateur économique pour identifier l’entreprise.
L’entreprise peut appartenir à un seul individu. C’est l’entreprise individuelle, qu’on
appelle aussi commerçant ou entreprenant. L’entreprise peut aussi appartenir à plusieurs
personnes, c’est l’entreprise collective qu’on appelle aussi société.
La différence entre l’entreprise individuelle et l’entreprise collective est que la seconde
est une entité juridique distincte de celle de ses propriétaires. On dit alors que l’entreprise
sociétaire est dotée de la personnalité juridique ou de la personnalité morale.

4
Les actes uniformes de l’OHADA permettent qu’un individu exerce tout seul son activité
sous la forme d’une entreprise sociétaire dotée de la personnalité juridique, il s’agit de
l’entreprise sociétaire unipersonnelle. On en déduit que l’entreprise sociétaire, qu’elle soit
collective ou unipersonnelle ne se confond pas avec les personnes qui en sont les
propriétaires. Mais quelle que soit la forme qu’elle prend, la détermination de la nature
juridique de la personnalité de l’entreprise pose problème. Deux conceptions de cette
nature juridique sont possibles :
1ere conception : la théorie de la fiction juridique.
Même si elle a une apparence aux yeux des tiers, l’entreprise n’existe pas. La
personnalité juridique de l’entreprise ne peut pas résulter des biens qui la composent ni
des personnes physiques qui la dirigent. En conséquence, l’entreprise ne peut agir que
par représentation. L’entreprise est toujours représentée par une personne physique.
Cela pose le problème de la détermination de la volonté de l’entreprise.
En effet, on peut se demander si les actes posés par les représentants de l’entreprise le
sont dans leur intérêt personnel ou dans celui de l’entreprise et par conséquent si
l’entreprise est responsable de ces actes.
Par ailleurs, la personnalité juridique des personnes physiques a une vocation générale ;
la volonté des personnes physiques n’a pas de limite. Au contraire, la personnalité
juridique de l’entreprise est limitée. Elle est soumise au principe de la spécialité, ce qui
veut dire que l’entreprise ne peut accomplir que les activités pour lesquelles elle a été
créée. C’est ce qu’on appelle le respect de l’objet social.
2e conception : la théorie de la réalité juridique.
Comme les personnes physiques, la personne morale est un être qui est pourvu d’une
expression pour la défense d’intérêts licites et donc juridiquement protégés. Cette
conception ne fait aucune différence entre la personnalité juridique des personnes
physiques et celle des personnes morales.
En effet, la personnalité juridique provient d’une formalité qu’on appelle déclaration ou
immatriculation. C’est l’accomplissement de cette formalité qui constitue le point de
départ de la personnalité juridique. La personnalité juridique des personnes physiques et
celle des personnes morales est soumise au même principe de la déclaration ou de
l’immatriculation.
Cette conception est importante parce que l’entreprise peut s’engager personnellement,
indépendamment des personnes physiques qui la composent.
En définitive, même si la personnalité juridique de l’entreprise est limitée par les principes
de la représentation et de la spécialité, l’entreprise a une volonté propre qui permet
d’envisager la question des difficultés qu’elle rencontre dans les actes qu’elle pose et par
rapport aux évènements qui peuvent affecter sa vie.

5
SECTION 2 : LA NOTION DE DIFFICULTES D’UNE ENTREPRISE.
Par difficulté d’une entreprise, il faut entendre des signaux et des indices qu’il faut pouvoir
détecter. La détection de ces signaux et indices permet d’envisager l’examen de la
situation de l’entreprise et le traitement de difficultés afin de prévenir des pathologies plus
graves. Les difficultés de l’entreprise sont de tous ordres mais elles ont la particularité,
en raison du principe de la représentation, d’être liée à la gestion et au comportement
des personnes physiques responsables de la prise de décision à l’intérieur même de
l’entreprise.
A ce titre, les exemples sont nombreux :
- absence ou mauvaise tenue d’une comptabilité entrainant un manque de lisibilité
et de visibilité de l’activité de l’entreprise ;
- méconnaissance des échéances qui de ce fait ne peuvent pas être honorées ;
- personnel pléthorique et inadapté parce que recruté avec complaisance ;
- rémunération et avantages salariaux excessifs empêchant d’affecter les
ressources de l’entreprise au renouvellement de l’outil de travail et de production ;
- confusion du patrimoine de l’entreprise avec celui des dirigeants sociaux du fait de
la représentation de l’entreprise ;
- incapacité ou incompétence des dirigeants sociaux emmenant à prendre des
décisions inappropriées eu égard à la situation de l’entreprise ;
- insuffisance de fonds propres en raison d’une mauvaise appréciation des besoins
de l’entreprise ;
- mauvais fonctionnement des organes sociaux d’administration, de décision ou de
contrôle empêchant la vie normale de l’entreprise.
La plupart de ces difficultés ou dérèglements peuvent être traités au plan interne.
Ainsi, les associés ou les actionnaires ont un rôle à jouer dans la prévention des difficultés
de l’entreprise. Ils ont la faculté suivant les circonstances, de mettre en œuvre la
procédure d’alerte prévue par l’Acte Uniforme de l’OHADA sur les Sociétés
Commerciales et le Groupement d’Intérêt Economique.
Cet acte prévoit que l’associé ou l’actionnaire peut deux fois par exercice, adresser par
écrit, des questions au gérant ou au principal dirigeant de la société sur des faits qui
pourraient compromettre la continuité de l’affaire. Et la réponse, qui doit intervenir dans
un délai d’un mois, et est adressée à l’auteur de la question et aux Commissaires aux
Comptes. Pour les Commissaires aux Comptes, l’acte prévoit que le déclenchement de
l’alerte est une obligation. Ils doivent la donner dès que se révèle tout fait de nature à
compromettre l’exploitation de l’entreprise. Ces interventions sont importantes mais elles
sont limitées. Elles n’obligent pas les dirigeants à traiter les difficultés annoncées, elles
ne peuvent qu’aboutir à une saisine des tribunaux afin de régler définitivement les
difficultés détectées.
Les difficultés peuvent être aussi traitées pour certaines sociétés dans le cadre
professionnel. Les réformes intervenues dans le domaine bancaire et dans celui des
assurances ont eu pour effet d’instituer des autorités régionales ou communautaires de
régulation et de contrôle professionnel. Il s’agit, par exemple, des commissions bancaires
instituées au sein des banques centrales chargées entre autre de prévenir et de corriger
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
1
/
43
100%