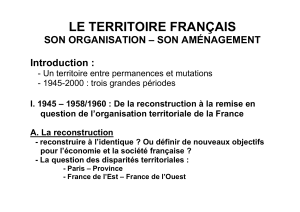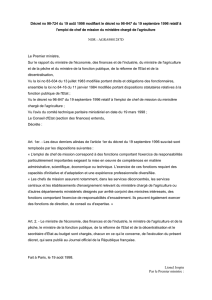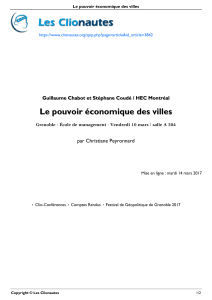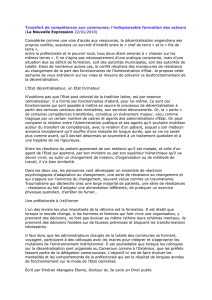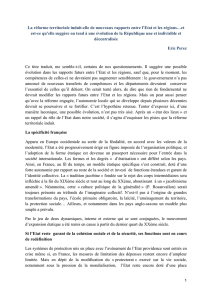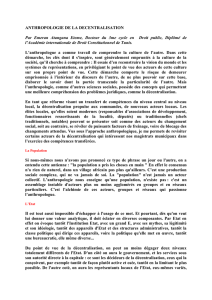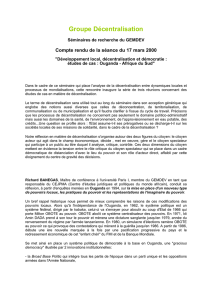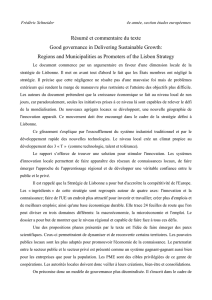DIENG CONSULTING
Courriel : diengconsulting@yahoo.fr Web: www.diengconsulting.com
EXEMPLE DE SUJET TRAITE
Sujet : Décentralisation sénégalaise: bilan et perspectives.
Depuis son accession à la souveraineté internationale, le Sénégal a toujours mené une
politique de décentralisation prudente et progressive pour un rapprochement entre
administration et administré.
Déjà, l'année 1972 marque l'entrée en vigueur de la loi 72-25 du 19 avril 1972 portant
création de la communauté rurale. 1996 voit l'érection de la région en collectivité locale,
l'allégement de la tutelle et le transfert de compétences. Le chemin balisée, on passe en mars
2013 à une nouvelle réforme dénommée acte III de la décentralisation.
Après plus d'une cinquantaine d'années d'initiatives, il urge de faire une évaluation de ces
politiques d’où l'actualité de la question décentralisation : bilan et perspectives ».
La décentralisation Elle peut être définie comme un système d'organisation
administrative qui reconnait une existence juridique à des collectivités secondaires qui sont
dotées de la personnalité morale et qui sont appelées à gérer leurs propres affaires par
l'intermédiaires d'organes issues d'elles-mêmes.
Le bilan constitue l'évaluation alors que les perspectives désignent les attentes.
L'étude de cette question serait impertinente si l'on faisait fi de l'organisation de
l'administration décentralisée du Sénégal, où elle est plus que jamais d'actualité.
Sur le plan pratique, ce sujet est d'une importance particulière. En effet, renseigne sur le
niveau d'implication des populations locales dans la gestion des affaires les concernant.
Dès lors, il serait important de s'interroger sur l'évaluation de la décentralisation
sénégalaise.
A L'analyse, il s'avère que l'existence de forces et faiblesses enseigne la pertinence de la
décentralisation sénégalaise tandis que les pôles régionaux développement et le renforcement
de la capacité matérielle et financière des collectivités territoriales renseignent sur les attentes.

De telles considérations justifient que l'on montre d'une part dresser le bilan avant
d'étaler d'autre part les perspectives de la décentralisation.
I. Décentralisation : un-bilan mitigé
De 1972 à nos jours, le Sénégal a toujours mis en place des initiatives en vue d'améliorer
sa politique de décentralisation. Cela est dû au fait que toute politique présente des avantages
mais aussi des insuffisances.
A. Les forces de la décentralisation
Cette nouvelle étape de la politique de décentralisation, a permis d'engranger des avancées
administratives et institutionnelles indéniables telles que :
- la libre administration des collectivités est devenue un principe constitutionnel et le transfert
de compétences et de ressources, ainsi que le développement de la solidarité et de la
subsidiarité, sont une réalité ;
- les organes des Collectivités locales constituent des instances reconnues et appropriées pour
la prise en charge de l'ensemble des initiatives de développement local ;
- la participation des populations à l'identification, à la programmation et à la réalisation des
actions de développement local, à travers les collectivités locales, en partenariat avec les
organisations communautaires de base, est consacrée ;
- les Collectivités locales constituent des cadres appropriés pour la mise en œuvre des
stratégies et politiques définies par l'Etat ;
- le contrôle de légalité supplante le contrôle de tutelle;
- la mise en place de mécanismes d'appuis techniques est effective avec la valorisation de la
convention type, de l'agence régionale de développement et des structures locales de la
direction d'appui au développement local ;
- la mise en place de mécanismes financiers à travers la fiscalité locale et les transferts
financiers de l'état (la compensation) est effective ;
- la mise en place de projets et programmes d'appui à la décentralisation et au développement
des collectivités locales est promue.
B. Los faiblesses de la décentralisation

Cependant, la pratique de cette politique de décentralisation au Sénégal, en particulier, entre
1972 et 2012, se heurte encore à beaucoup de limites :
➤ les faiblesses objectives du cadre organisationnel et fonctionnel de la décentralisation pour
la promotion d'un développement territorial ;
➤ le manque de viabilité des territoires et de valorisation des potentialités de développement
des territoires;
➤ la faiblesse de la politique d'aménagement du territoire limitée par une architecture
territoriale rigide :
➤ la faiblesse de la gouvernance territoriale accentuée par une multiplicité d'acteurs avec des
logiques et des préoccupations parfois différentes :
➤ l'incohérence et l'inefficience des mécanismes de financement de développement
territorial :
➤ la faiblesse de la coproduction des acteurs du développement territorial qui induit
fortement l'inefficacité des interventions.
La faiblesse des politiques et stratégies de développement appliquées jusque-là , induit la
nécessité d'initier des alternatives susceptibles de corriger les déficiences et produire
simultanément des progrès significatifs à l'échelle nationale et un développement local
harmonieux
II. Perspectives de la décentralisation : la phase deux l'acte III de la décentralisation
L'acte III de la décentralisation, de par son contenu mais également et présente des
perspectives favorables au développement local.
Les pôles régionaux de développement
Il s'agira ici de construire une cohérence territoriale par une réorganisation de l'espace et
l'émergence de pôles de développement.
La promotion de tels territoires de convergence économique, axés sur des entités
économiquement viables peut contribuer à l'émergence d'un maillage et d’un développement
polycentré de l'espace communautaire.

La Commission sur la Cohérence territoriale a proposé un regroupement des régions du
Sénégal en 6 pôles territoires.
1. Pole-territoire Casamance : Il fusionnera les régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Il
s’étend sur 28350km2, pour une population de 1551600 habitants en 2012.
2. Pôle-Territoire Diourbel-Louga : fusionnera les territoires de Diourbel et Douga, pour
une superficie 29616km2 pour 2 377 994 habitants en 2012.
3. Pôle-Territorial Fleuve : comprend les anciennes régions de Saint-Louis et Matam. Sa
superficie est de 48 503 km² pour 1 562 530 habitants en 2012.
4. Pôle-Territoire Sine Saloum : couvre les anciennes régions de Kanlack, Fatick et
Kaffrine, sur une superficie de 23545km² pour 2 005 577 habitants en 2012.
5. Pôle Territoire Sénégal Oriental : couvre les anciennes régions de Tambacounda et de
Kédougou, et couvre une superficie de 59602 km2 pour 817527 habitants en 2012.
6. Pôle-Territoire Dakar-Thiès : La région Dakar-Thiès» recompose les deux régions du
même nom. La Plateforme technique et industrielle de Diamniadio, le nouvel aéroport de
Ndiasse, la construction de l'autoroute à péage vont renforcer les régions et faire de Dakar un
véritable hub urbain.
Thiès renferme d'énormes potentiels industriels, du tourisme urbain, des industries artisanales,
du cuir, du textile.
A. le renforcement de la capacité matérielle et financière des collectivités territoriales
La pratique actuelle de la décentralisation a permis de déceler un certain nombre
d'insuffisances ayant occasionné des critiques d'experts et même d'élus locaux. Ces derniers
ont dénoncé un manque de cohérence entre la volonté d'autonomiser les Collectivités locales
par le transfert de compétences et l'octroi des moyens pour la réalisation des objectifs qui leur
sont assignés. En effet, le transfert de compétences avec la loi 96-07 du 22 Mars 1996 n'a pas
été suivi d'accompagnement de moyens à la hauteur des missions assignées aux Collectivités
Locales. C'est pourquoi certaines de leurs missions n'ont jusque-là pas été bien remplies aussi
bien au plan économique, culturel et de la santé
Les difficultés financières persistantes des collectivités locales, et qui seraient consécutives à
l'inadaptation des ressources et mécanismes financiers mis en place par l'Etat, au regard de
l'amplitude des compétences transférées, doivent trouvées des solutions adaptées; ainsi, il
s'agira de procéder à la révision des mécanismes de transfert des fonds, du mode de répartition

des ressources Etat/Collectivités territoriales, des mécanismes de péréquation, du cadre
juridique pour l'emprunt des Collectivités territoriales; également, il faudra réfléchir sur les
mécanismes de financement des projets de territoire contractualisés, les Collectivités
territoriales comme actrices des services financiers décentralisés, les mécanismes de
financement articulés au partenariat public privé, et aux coopérations décentralisée et
transfrontalière, et d'autres mécanismes de financements nationaux et internationaux
innovants du développement durable; comme tout aussi, la question de la décentralisation de
la fiscalité locale devra être posée.
1
/
5
100%