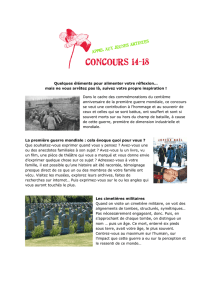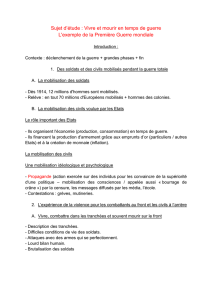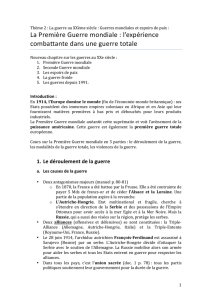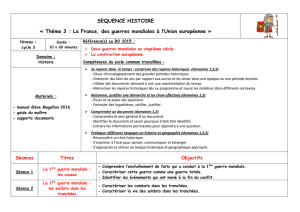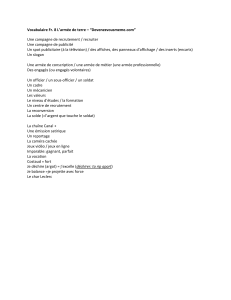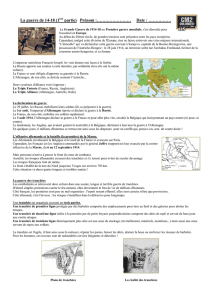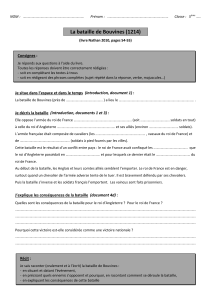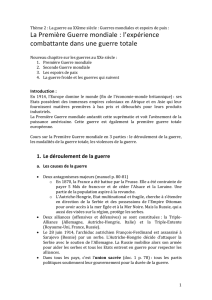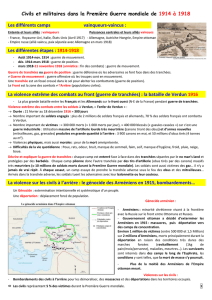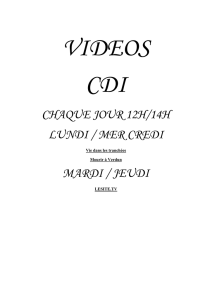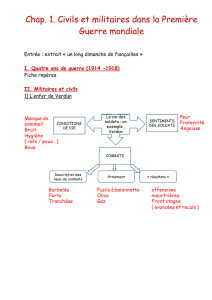La guerre au XIX° et au XX° siècle

1
La guerre au XIX° et au XX° siècle
Introduction.
Les hommes ont toujours entretenu un rapport ambivalent à la guerre : elle a toujours
été redoutée mais elle a aussi toujours nourri notre imaginaire. Quel petit garçon n’a pas joué
aux soldats de plomb ou à la guerre ? Les trois Français les plus populaires, en France et dans
le monde ne sont-ils pas : Napoléon Bonaparte, Jeanne d’Arc et Charles de Gaulle, trois
« hommes » de guerre ? La guerre a toujours accompagné voire façonné notre histoire :
pendant longtemps l’étude de celle-ci ne s’est-elle pas résumée à ce que Fernand Braudel et
les historiens de l’école des Annales ont appelé l’histoire-bataille ?
On a cependant assisté dans le monde occidental à une rupture dans la perception de la
guerre depuis le XX° siècle et notamment depuis 1914. En raison de l’ampleur des pertes, les
poilus sont revenus généralement pacifistes d’une guerre à laquelle ils avaient très
majoritairement consenti : « plus jamais ça », la « der des der » sont autant d’expressions nées
dans la boue et le sang des tranchées. L’expérience de 1939/45 ou celle de la Guerre Froide
ont cependant montré que malgré la SDN puis l’ONU, le monde restait régi par les rapports
de force et que le vieil adage des Romains si vis pacem para bellum, restait d’actualité.
L’historien anglais Liddell Hart écrivait pour sa part si tu veux la paix il faut apprendre à
connaître la guerre : les Français ont connu en 1940 la plus grave défaite de leur histoire faute
d’avoir compris les règles de la guerre moderne, notamment l’emploi combiné des chars et
des avions pour réaliser des percées en profondeur, condition de la guerre de mouvement. La
capacité à conjurer la guerre ou à en sortir vainqueur repose sur ce que Boris cyrulnik appelle
la résilience, des nations à surmonter les épreuves. Cette capacité repose sur la connaissance
du passé, sur la volonté de défense et aussi sur un effort financier.
Nous verrons d’abord que guerre et paix ont toujours été intimement liées, la guerre
ayant souvent servi à imposer ou préserver la paix tandis que la dignité des citoyens a
longtemps été liée au service des armes. On s’intéressera ensuite à l’évolution de l’art de la
guerre en fonction des mutations techniques (armes blanches, puis armes à feu, puis armes
atomiques et missiles…) mais aussi de l’organisation des sociétés : armées de citoyens en
armes, armées de métier ont alterné au cours de l’histoire. Enfin nous montrerons que la
perception de la guerre par les hommes a elle aussi évolué : la guerre a longtemps été à la fois
désirée et redoutée ; désirée car liée à un imaginaire héroïque et crainte car apportant la mort
et la destruction. Cependant à partir du XX° siècle, la « guerre juste » se limite à la guerre
défensive tandis que depuis trois ou quatre décennies elle tend à devenir illégitime en soi pour
une partie de l’opinion, du moins dans le monde occidental.
I) Guerre et paix
A) De l’Antiquité aux temps modernes : la guerre au centre de la vie.
1) La guerre chez les Grecs et les Romains est au centre de la vie de la
Cité : le citoyen est un soldat, c’est l’impôt du sang qui fonde les droits civiques. C’est ainsi
qu’à Athènes, les 4 classes censitaires correspondent à des fonctions différentes durant la
guerre. Les plus riches (pentacosiomédimnes) arment à leurs frais les trières, les Hippéis
servent dans la cavalerie, ceux de la troisième classe sont les Hoplites et les derniers, les
Zeugites servent de marins dans la flotte. Il en va de même à Rome au temps de la
république : avant l’expansion romaine, l’armée devient permanente et professionnelle, mais
les légionnaires qui s’engagent pour 20 ans sont toujours des citoyens romains, quant aux

2
officiers supérieurs ce sont des membres de la classe sénatoriale qui, au cours du cursus
honorum exercent alternativement des fonctions civiles ou militaires. La vie de la Cité antique
c’est le plus souvent la guerre. S’y préparer est la tâche des hommes libres, des citoyens (à
Athènes lors de l’éphébie). La politique et la guerre ne se distinguent pas, celle-ci, comme le
dira Clausewitz plus tard n’est que la continuation de la politique par d’autres moyens : le
magistrat est autant chef de guerre que chef politique.
C’est cette conception civique de l’armée que redécouvriront les hommes
des Lumières et notamment les républicains français ou américains avec les Soldats de l’An II
lors de la levée en masse de 1793 ou les minutemen de la guerre d’indépendance en 1776. La
conscription universelle instaurée par la III° République en remplacement du service par
tirage au sort s’inscrit dans la même logique : le citoyen est d’abord un homme prêt à mourir
pour la Patrie.
2) Au Moyen-Âge, avec la fin de la cité antique et les « invasions
barbares », la guerre cesse d’être l’affaire des citoyens de cités qui d’ailleurs n’existent plus
pour devenir une affaire de guerriers qui se transforment au fil des siècles en aristocratie
militaire. Au Moyen-Âge, la guerre devient l’apanage d’une élite sociale, d’une caste, celle
des chevaliers (bellatores). Comme l’écrivait vers l’an mil l’évêque Adalbéron de Laon : « les
uns prient, les autres combattent, les autres enfin travaillent ». C’est dans le cadre d’un contrat
entre seigneurs et paysans que s’effectue cette dissociation entre travailleurs et milites : les
seigneurs assurent une fonction politique (justice, police, défense) que l’Etat n’assure plus,
puisqu’il a disparu. L’Eglise donne son onction à cet ordre féodal. Pour les hommes de Dieu,
la providence veut que les chevaliers protègent les clercs et les paysans. Cette vision
chrétienne se superpose à la vision guerrière issue des sociétés germaniques : être un guerrier
est donc un état, renvoie à l’appartenance à un ordre. Le chevalier se distingue donc par le
sang mais aussi par une éthique (chevaleresque) faite de courage, d’honneur et de générosité
(prouesse, fidélité, largesse) : il doit être un preux comme le comte Roland à Roncevaux. Pour
autant la conception antique du citoyen soldat survit dans les cités, les villes libres qui doivent
leur franchise à leurs milices bourgeoises : le bourgeois/citoyen se doit d’être aussi un soldat.
Exclu du service des armes, les paysans parfois se mettent à faire la guerre mais c’est une
guerre civile ou sociale telle la jacquerie de 1358 en Île de France, due justement à la présence
de troupes de chevaliers qui vivaient sur le pays.
3 ) Vers l’armée de métier aux Temps Modernes. A la fin du Moyen-Âge
et aux Temps Modernes, la guerre devient peu à peu un métier pour lequel on est « soldé » : le
chevalier laisse la place au « soldat ». L’ost féodale, et ses preux, Du Guesclin ou Bayard
s’effacent devant les condottieri et leurs mercenaires, reîtres ou lansquenets. De nombreux
soldats sont désormais de condition vile ou recrutés chez des populations au tempérament
belliqueux tels les Suisses qui louent leurs services aux armées pontificales lors de la bataille
de Marignan. En effet, l’affirmation de l’Etat moderne amène les princes à vouloir se doter
d’armées permanentes : la figure du condottiere se substitue à celle du chevalier
accomplissant l’ost (40 jours) et les grandes compagnies remplacent les armées de chevaliers.
La Guerre de Trente Ans (1618-1648) qui dépeupla une partie de l’Allemagne et les gravures
de Jacques Callot ont pour longtemps fixé dans l’imaginaire européen l’effroi qu’inspiraient
ces armées de soudards, terreur des paysans qui pillaient, violaient et massacraient sur leur
passage à l’image des groupes armées qui dévastent aujourd’hui l’Afrique des Grands Lacs…
Beaucoup de ces soldats de fortune restent cependant de petits nobles (les
reîtres allemands). Les cadres sont souvent eux-mêmes issus de la noblesse dont ils
perpétuent la fonction militaire médiévale et les chefs de ces armées, les condottieri
deviennent généralement des princes, à l’image des Montefeltre devenus ducs d’Urbino après
avoir combattu pour le Pape. Cependant la noblesse se détache de plus en plus de sa fonction
militaire pour devenir aussi une noblesse d’Etat en raison de la montée en puissance de la

3
noblesse de robe : les « officiers royaux » (au sens de fonctionnaires). Le soldat de son côté
devient un type social à part et l’on assiste à l’apparition d’une société militaire distincte de
la société civile.
Parmi les condottieri restés fameux, il y a bien sûr les chefs de guerre du
XV° siècle italien : Malatesta à Rimini, les Sforza devenus duc de Milan, et aussi les généraux
de la Guerre de Trente Ans. Si l’on met de côté Gustave Adolphe, le roi de Suède, ceux-ci
étaient généralement de véritables entrepreneurs de guerre qui louaient leurs services au plus
offrant et passaient d’un camp à l’autre. C’était le cas de Tilly ou de Wallenstein : Jean
t’Serclaes comte de Tilly commandait l’armée de la ligue catholique au service de l’Empereur
et vainquit les Tchèques à la Montagne Blanche en 1618. Albrecht Wenzel Eusebius von
Wallenstein, catholique d’origine tchèque, combattit également pour l’Empereur. L’un et
l’autre menaient la guerre comme on conduit une entreprise. Liés à des banquiers qui leur
avançaient les fonds et à des fournisseurs qui assuraient la logistique, ils dirigeaient de
véritables armées privées qu’ils recrutaient eux-mêmes. En mer, c’était également le cas des
corsaires : Francis Drake ou Walter Raleigh en Angleterre sous Elisabeth I° ou Jean Bart sous
Louis XIV.
Voici l’exemple du Capitan Alonso de Contreras (document 1) dont les
mémoires ont été éditées en 1900 par Don Manuel Serrano y Sanz. Alonso de Contreras a
écrit ses mémoires vers 1633. Celles-ci couvrent les années 1595-1633 : il a donc servi au
temps de Philippe III et de Philippe IV d’Espagne. Né dans une famille modeste, orphelin de
père, il s’engage comme enfant soldat à 14 ans alors que sa mère l’avait placé en
apprentissage chez un orfèvre. Il devient enfant de troupe dans l’armée du cardinal Albert, qui
part prendre son poste de vice-roi des Pays-Bas. Marmiton puis jeune soldat, il déserte et
rejoint Naples où il s’engage comme matelot sur des navires corsaires qui combattent les
Turcs et les Barbaresques en Méditerranée. Il devient bientôt un capitaine corsaire réputé, puis
l’un des capitaines des galères de course de l’ordre des chevaliers de Malte, dont il devient
frère servant puis chevalier, bien qu’il soit noble de naissance. Il sert aussi comme capitaine
pour le roi d’Espagne notamment lors d’une expédition aux Indes occidentales où il combat le
corsaire anglais Walter Raleigh. Revenu en Europe il est gouverneur de Lampedusa et
Pantelleria, deux îles appartenant aux Chevaliers de Malte puis sert dans le royaume de
Naples au service de son vice-roi espagnol, le comte de Monterrey. Ses mémoires rédigées
dans un style simple et précis représentent un témoignage exceptionnel sur la guerre au début
du XVII° siècle : comme l’écrit Jean Dutourd « il surgit de cette succession d’épisodes un des
tableaux les plus saisissants du XVII° siècle. D’un bout à l’autre du livre, le lecteur a
l’impression de ses promener dans une gravure de Callot. Il y a des habits déchirés, des
feutres à plume, des forêts de hallebardes, des gueules patibulaires, des miquelets (soldats de
la garde des gouverneurs espagnols) avec l’arquebuse sur l’épaule, des pendus qui se
balancent aux arbres, des maisons qui brûlent. La guerre de Trente Ans est partout.». Extrait
(document 1)
B) Pax romana et Paix de Dieu : la dynamique de pacification
Si les hommes de l’Antiquité aux Temps Modernes ont adoré la guerre, ils
l’ont aussi redoutée et ont aussi aspiré à la paix. La Paix romaine d’Auguste à Marc Aurèle ou
les assemblées de la paix de Dieu vers l’An mil témoignent de la volonté de l’Etat (à Rome)
ou de l’Eglise catholique (universelle) de pacifier les mœurs.
1) La Paix romaine. Après 50 années de guerre civile, le triomphe d’Octave
sur Marc Antoine et Cléopâtre à Actium en 31 av. J.-C. lui permet de rétablir la paix : la Pax
deorum d’Auguste ouvre deux siècles de « pax romana » (d’Auguste à Marc Aurèle) qui
coïncident avec l’apogée de la civilisation romaine et avec l’extension maximale de l’empire.

4
C’est cette restauration de la paix autant que sa victoire à la guerre qui légitime la divinisation
d’Auguste (divus filii) : Auguste est à la fois celui restaure la concorde, qui fait fermer les
portes du temple de Janus, il est aussi celui qui célèbre avec faste ses triomphes (13,14 et 15
août 29 av. J.-C.). Il est donc imperator, c’est-à-dire le général victorieux auquel le Sénat
décerne un triomphe : le droit de pénétrer dans l’enceinte sacrée de Rome (pomerium) en
arme, avec ses troupes et son butin, ses captifs : homme de guerre et pacificateur à la fois. La
guerre sert donc à imposer la paix comme l’écrit Virgile : « souviens toi Romain que tu es
fait pour commander aux peuples. Imposer les règles de la paix, pardonner aux vaincus et
châtier les superbes, ce sont là tes beaux-arts » (Tu regere imperio romane, memento.
Pacisque imponere morem, parcere subjectis et debellare superbos , hae tibi artes erunt).
Cette paix est aussi une paix armée : la guerre est repoussée au limes, mais les légions veillent
toujours sur Rome en poursuivant des opérations militaires aux confins de l’Empire…
2) La paix de Dieu et le rôle pacificateur de l’Eglise. Au Moyen-Âge,
l’idéal chevaleresque de la guerre entre aussi en contradiction avec l’idéal chrétien de non
violence (tu ne tueras point), d’autant que les guerres féodales (la faide) menacent parfois les
grands domaines ecclésiastiques, ceux des monastères. D’où les serments de paix étudiés par
Dominique Barthélémy dans L’An mil et la paix de Dieu (Fayard, 1999) et le mouvement de
la paix de Dieu qui interdit la guerre du vendredi au dimanche et demande aux chevaliers de
protéger les biens de l’Eglise, les hommes de Dieu ainsi que la veuve et l’orphelin. Le
mouvement de la paix de Dieu a incontestablement pacifié la société féodale mais a aussi
contribué à rejeter le guerre au-delà de la Chrétienté et a nourri l’esprit de croisade qui se
développe avec l’appel de Clermont d’Urbain II (1095) et la première croisade (1099). Mais à
la guerre privée se substitue, avec la formation des Etats, les guerres entre rois. Par exemple,
les guerres entre la monarchie française et les rois d’Angleterre : guerres entre Philippe
Auguste et Jean Sans Terre puis Richard Cœur de Lion, guerre de Cent ans de 1337 à 1453…
Celles-ci s’avèrent bientôt plus dévastatrices que les guerres féodales car elles reposent sur la
mobilisation d’armées de professionnels de la guerre (les « grandes compagnies » du XIV°
siècle français) qui vivent sur le pays dès qu’elles sont « débandées ». Facteur de guerre à ses
débuts, l’Etat moderne va cependant progressivement se faire pacificateur
3) L’Etat pacificateur. Avec la renaissance de l’Etat, au XV° et XVI°
siècle, c’est de plus en plus le roi qui garantit la paix. Ainsi au terme de trente ans de guerres
de religion, c’est l’édit de tolérance de Nantes (1598) du « bon roi Henri IV » qui instaure la
paix religieuse entre catholiques et huguenots. Un demi siècle plus tard, Richelieu démantèle
les châteaux forts. Après la Fronde, Louis XIV, roi de guerre par excellence (37 années de
guerre sur 44 années de règne personnel !), pacifie l’intérieur du royaume. La guerre est alors
rejetée aux frontières, au-delà de la « ceinture de fer » des forteresses royales construites par
Vauban. Certes, pendant les deux tiers du règne de Louis XIV la France est en guerre, mais,
hormis quelques brèves périodes d’invasion à la fin du règne (victoire de Villars à Denain,
1712), la guerre a lieu à l’extérieur ou aux frontières du royaume. Roi de guerre en Europe,
Louis XIV est paradoxalement celui qui fait respecter l’ordre intérieur et assure la paix civile
dans le royaume… Les conséquences des guerres sont essentiellement économiques et
démographiques : les prélèvements fiscaux combinés aux aléas climatiques (Grand Hiver
1709) aboutissent à une catastrophe démographique. La France perd 2 millions d’habitants
sur 20 entre le début des années1690 et 1715. Néanmoins durant tout le XVIII° siècle, l’Etat
assure la paix intérieure : la guerre est une affaire lointaine, elle se déroule sur mer ou aux
frontières (Guerre de Sept Ans). Durant la Révolution, la guerre civile réapparaît notamment
durant la terreur : Vendée, chouannerie, soulèvement fédéraliste… C’est justement parce qu’il
a restauré la paix civile (notamment par le Concordat, mais aussi en créant la gendarmerie
nationale) que Bonaparte est resté aussi populaire. La légende napoléonienne se nourrit aussi
bien sûr de l’épopée militaire popularisée par les vieux grognards dont on trouve la trace dans

5
la littérature du XIX° ainsi dans Le médecin de campagne de Balzac, le grognard Goguelat
raconte aux paysans de son village du Dauphiné, à la veillée, « le Napoléon du peuple »
autrement dit la légende napoléonienne et l’épopée de la Grande Armée (document n°3). Mais
la popularité de l’empereur chez les paysans vient aussi du souvenir du retour des cloches
confisquées par la Convention et de la fin des « chauffeurs » traqués par la maréchaussée :
l’ordre et la gloire ont fait oublier « l’ogre corse » qui prenait les hommes pour les faire tuer à
la guerre (1 million de morts en 23 ans de guerres incessantes de 1792 à 1815).
Au fond, avec la mise en place de l’Etat moderne, la guerre a été projetée
hors du territoire tandis que l’Etat s’est arrogé le monopole de la violence. L’Etat a apporté la
paix intérieure et a fait de la guerre la continuation de la diplomatie par d’autres moyens, une
affaire de politique extérieure. A l’intérieur de ces sociétés pacifiées, la guerre est devenue
l’affaire de la société militaire, l’affaire d’une institution, l’armée. Celle-ci est composée d’un
encadrement qui s’est peu à peu professionnalisé tandis que les hommes du rang, l’infanterie
de ligne, sont des sujets mobilisés. La milice et l’inscription maritime, première étape vers
l’instauration du service militaire sont mises en place sous Louis XIV. Le siècle des Lumières
et la période révolutionnaire accentuent cette évolution : l’armée devient « nationale » avec la
levée en masse des soldats de l’an II et l’institution de la conscription. Les chevaliers ou les
aventuriers, les Bayard et les Contreras ont laissé la place à des experts, les officiers, formés
dans des académies (Saint-Cyr, Ecole navale), tandis que les reîtres, lansquenets et autres
suisses ont été remplacés par les conscrits. Avec la professionnalisation de l’encadrement et
les progrès de la logistique, les troupes ne vivent plus guère sur le pays même en cas de
guerre, tandis que des règles sont adoptées concernant le traitement des prisonniers, le respect
des civils : lors des guerres du XIX° siècle, les exactions contre les civils sont assez rares, du
moins elles semblent être l’apanage d’une humanité en retard, non civilisée, à l’image des
« horreurs bulgares » commises par les Bachi-bouzouks ottomans contre les chrétiens…ou
alors elles sont le fait des armées coloniales qui se lancent à la conquête de l’Afrique ou de
l’Asie : c’est le cas des « enfumades » de Bugeaud lors de la conquête de l’Algérie.
Avec le triomphe des Lumières, au XIX° siècle les règles de la guerre sont
codifiées. C’est ainsi que l’on assiste à l’apparition de la Croix-Rouge, fondée par le suisse
Henri Dunant au lendemain de la bataille de Solférino (juin 1859) qui laissa sur le champ de
bataille 38 000 morts et blessés. Dunant avait assisté un peu par hasard à cette bataille entre
les Français et les Autrichiens (il était venu plaider auprès de Napoléon III la cause de ses
établissements en Algérie). Effaré par l’ampleur des souffrances, il organise l’aide aux blessés
et consacrera sa vie à la mise en place de la première organisation humanitaire, la Croix
Rouge. C’est aussi Henri Dunant qui est à l’origine de la Convention de Genève en 1864, ce
qui lui vaudra d’être le premier lauréat du prix Nobel de la paix, lors de la création du prix en
1901. L’idée, chère au XIX° siècle positiviste, que la guerre est en voie d’humanisation dans
un Occident qui croit au progrès est cependant démentie par la tragédie de 1914-18 et plus
encore par la seconde guerre mondiale.
Avec la convention de Genève, la fondation de la Croix Rouge ou encore le
prix Nobel de la Paix on assiste donc à l’apparition d’une dynamique partiellement
contradictoire. La première dynamique consiste à humaniser la guerre en permettant de porter
assistance aux blessés ou respectant les prisonniers, il s’agit au fond de la naissance des
organisations humanitaires; l’autre dynamique est le pacifisme, c’est-à-dire la volonté
d’interdire la guerre. En raison de l’ampleur des pertes de la Grande guerre, le pacifisme
connaît un élan spectaculaire au lendemain de la première guerre mondiale.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
1
/
18
100%