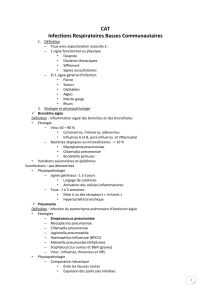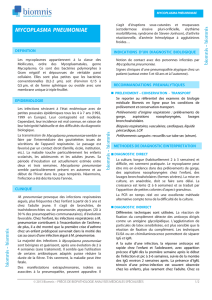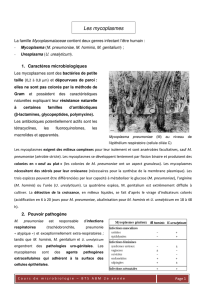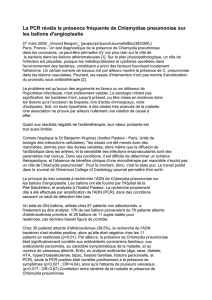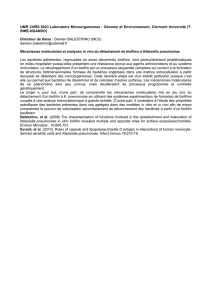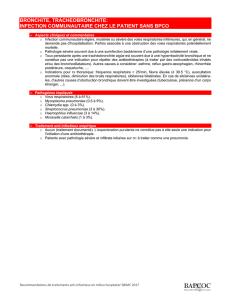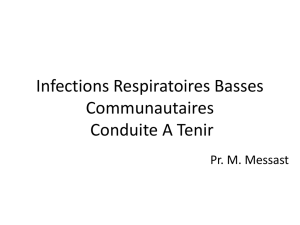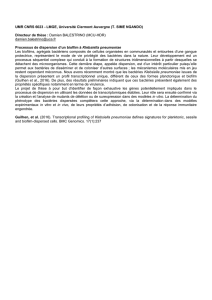Infections à Mycoplasma pneumoniae : Épidémiologie, Diagnostic et Traitement
Telechargé par
lazzazmedanes

Infections à Mycoplasma pneumoniae
F. Roblot, A. Bourgoin, C. Godet
Les mycoplasmes sont des organismes ubiquitaires, responsables d’infections communautaires. Les
infections à Mycoplasma pneumoniae concernent le plus souvent les enfants et les adultes jeunes et
peuvent sévir sous forme d’épidémies. Les infections respiratoires restent les plus fréquentes, mais tous les
organes peuvent être atteints et les techniques de diagnostic récentes ont permis d’imputer des signes
cliniques variés à ce germe. La culture du germe est difficile et le diagnostic biologique repose toujours sur
la sérologie en routine. Cependant, les nouvelles techniques de biologie moléculaire telles que
l’amplification génique sont utilisées, en particulier chez les patients immunodéprimés, et devraient
faciliter la surveillance épidémiologique. Les macrolides et les cyclines gardent une bonne activité et
restent le traitement de première intention de ces infections. Néanmoins, la résistance fréquente des
souches de pneumocoque leur a fait préférer la télithromycine pour le traitement de première intention
des infections respiratoires communautaires, y compris celles présumées à Mycoplasma pneumoniae.
Les nouvelles fluoroquinolones ont une efficacité comparable aux plus anciennes. Le pronostic est en règle
générale favorable.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
Mots clés : M. pneumoniae ; Pneumopathie atypique ; Pneumonie ; Macrolides ; Cyclines
Plan
¶Introduction 1
¶Épidémiologie 1
Transmission 1
Épidémies de collectivités 2
Impact dans la population 2
Implication dans les infections respiratoires basses 2
Infections mixtes 2
Modalités épidémiologiques 2
¶Manifestations cliniques 2
Manifestations respiratoires 2
Manifestations extrarespiratoires 3
¶Diagnostic bactériologique 4
Diagnostic direct 4
Diagnostic indirect : sérologie 7
¶Traitement des infections à Mycoplasma pneumoniae 7
Antibiotiques actifs vis-à-vis de M. pneumoniae 7
Traitements non antibiotiques 8
¶Conclusion 8
■Introduction
Les mycoplasmes sont des germes ubiquitaires, pathogènes ou
commensaux. Ils appartiennent à la classe des mollicutes
(« peau molle », appellation liée à l’absence de paroi propre, et
à la famille des Mycoplasmataceae). Il existe deux genres respon-
sables d’infections humaines : Mycoplasma et Ureaplasma.Il
s’agit des plus petits organismes vivants capables de réplication
autonome.
Après son isolement par Eaton en 1944, Mycoplasma pneu-
moniae (M. pneumoniae) a été reconnu comme agent respon-
sable d’infection chez l’homme, au début des années 1960.
Aujourd’hui, il est principalement impliqué dans les infections
respiratoires communautaires hautes et basses de l’enfant et de
l’adulte. De nombreuses autres manifestations cliniques lui sont
imputées.
■Épidémiologie
Transmission
M. pneumoniae se transmet horizontalement d’homme à
homme à partir d’une personne infectée chez qui la bactérie est
présente dans tout le tractus respiratoire supérieur ainsi que
dans les crachats. La diffusion des micro-organismes s’effectue
par contact direct ou par l’intermédiaire d’aérosols produits lors
de la toux. Leur transmission requiert des contacts rapprochés
en raison de la taille relativement importante des gouttelettes
infectantes. Le confinement favorise ainsi la propagation de
l’infection, occasionnant des épidémies à l’intérieur d’une
même famille et au sein de différentes collectivités. Certains
sujets asymptomatiques porteurs de la bactérie, en particulier les
enfants, pourraient constituer un réservoir pour la transmission
de la maladie
[1]
. Le portage asymptomatique de M. pneumoniae
est suggéré par la détection de la bactérie ou de son acide
désoxyribonucléique (ADN) dans la gorge chez 2,2 à 4,6 % de
sujets exempts de symptomatologie et jusqu’à 13,5 % en
période épidémique
[2]
. Néanmoins, M. pneumoniae n’appartient
pas à la flore commensale des voies aériennes supérieures.
Le temps d’incubation de la maladie est de1à4semaines,
mais peut être réduit à 4 jours lors d’une diffusion plus massive
au sein de groupes rassemblant un grand nombre d’individus
[3]
.
¶8-039-V-15
1Maladies infectieuses

À l’intérieur d’une même famille, le taux de transmission
varie selon les études. Hors période épidémique, l’ADN de M.
pneumoniae a été détecté chez 15 % des sujets contacts de cas
index et préférentiellement chez les enfants de moins de
15 ans
[1]
. En revanche, en période épidémique, la contamina-
tion s’étend parfois à toute la famille
[4]
.
Épidémies de collectivités
De nombreuses épidémies sont décrites au sein d’institutions
fermées ou semi-fermées : camps militaires
[5]
, institutions pour
personnes dépendantes
[6]
, colonies de vacances
[7]
, communau-
tés religieuses
[8]
, écoles
[9]
et petits villages
[4]
. Les taux d’attaque
peuvent être très élevés, et s’échelonnent en moyenne de 25 à
71 %
[3, 8, 10]
. Le rôle des soignants en tant que vecteur principal
de l’infection pourrait être important
[11]
.
Impact dans la population
Le pourcentage d’infections respiratoires aiguës attribuables à
M. pneumoniae varie de1à50%enfonction de la population
étudiée (enfants/adultes, médecine ambulatoire/hospitalière,
infections hautes/basses) et de la technique de diagnostic
utilisée (sérologie/polymerase chain reaction [PCR])
[12-14]
. Ce taux
est certainement sous-estimé en raison de la fréquence des
formes pauci- ou asymptomatiques et des infections mixtes
pour lesquelles le diagnostic peut faire défaut
[1]
. Les données
récentes de la littérature révèlent que les infections respiratoires
chez les enfants de moins de 5 ans sont beaucoup plus couran-
tes que ce qui était admis jusqu’à présent
[15]
.
Au cours des épidémies, la proportion de sujets infectés peut
atteindre plus de 10 fois celle des périodes interépidémiques
[16]
,
les enfants sont les plus touchés, mais, en dessous de 6 mois,
ils semblent en partie protégés par les anticorps maternels
[16,
17]
. En dehors des périodes épidémiques, le taux d’infections est
semblable dans toutes les tranches d’âge chez les sujets non
hospitalisés
[1]
tandis que chez les sujets hospitalisés, les
personnes âgées de5à15ansetde30à45anssemblent plus
fréquemment touchées
[17, 18]
.
Il n’y a pas de différence du taux d’incidence par sexe
[3, 19]
.
En France, 40 % des adultes et 27 % des enfants sont porteurs
d’immunoglobulines G (IgG) spécifiques
[17]
.
Implication dans les infections respiratoires
basses
Bien que S. pneumoniae reste le plus souvent la première cause
des pneumopathies communautaires, le rôle des pathogènes
atypiques (M. pneumoniae, C. pneumoniae et Legionella sp.) paraît
de plus en plus important
[15, 20, 21]
. Cette émergence s’explique
en partie par l’amélioration des moyens diagnostiques. M.
pneumoniae est responsable de 5 à plus de 50 % des cas de
pneumopathies, selon la population et la méthode diagnostique
envisagées
[14, 22, 23]
.M. pneumoniae et C. pneumoniae sont plus
fréquemment en cause chez l’enfant de plus de 5 ans
[23-25]
,
bien que plusieurs études rapportent le rôle non négligeable de
M. pneumoniae dans les pneumopathies communautaires chez
l’enfant de moins de 5 ans
[18, 26]
. Généralement, l’incidence des
pneumopathies à M. pneumoniae augmente avec l’âge et dépasse
10 pour 1 000 enfants par an chez les plus de 10 ans
[27, 28]
.
Chez les adolescents, M. pneumoniae serait responsable de 40 à
60 % des pneumopathies communautaires
[29]
. Chez l’adulte, M.
pneumoniae est également observé, mais avec une prévalence
habituellement beaucoup plus faible lorsqu’on atteint le grand
âge
[30]
.
Infections mixtes
Les infections mixtes ne sont pas rares puisque certaines études
rapportent jusqu’à 64 % de co-infections, avec le plus souvent, S.
pneumoniae
,C. pneumoniae ou Legionella sp.
[31]
.M. pneumoniae
est aussi régulièrement associé aux rhinovirus, au virus respira-
toire syncitial (VRS), aux entérovirus ou à d’autres virus
[1, 12, 32]
.
Modalités épidémiologiques
Les études épidémiologiques portant sur de longues périodes
suggèrent une propagation des infections à M. pneumoniae sur
un mode endémique avec des poussées épidémiques survenant
tous les3à8ans, essentiellement en été ou en automne
[17, 33]
.
La mise en place d’un système de surveillance des infections à
M. pneumoniae serait particulièrement utile aux cliniciens.
■Manifestations cliniques
Les manifestations respiratoires sont les plus fréquentes et en
règle inaugurales puisque la transmission se fait par voie
respiratoire. Cependant la plupart des organes peuvent être
atteints et les manifestations cliniques extrarespiratoires sont
fréquentes et variées (Tableau 1).
Manifestations respiratoires
Infection des voies respiratoires supérieures
Dans la majorité des cas, l’infection se limite aux voies
aériennes supérieures. Après2à3semaines d’incubation
apparaissent une fièvre, des céphalées, une sensation de malaise
et une toux sèche. La toux augmente en intensité pendant 1 à
2 jours. Le début progressif des symptômes s’oppose au début
souvent brusque de la grippe et des infections à Adenovirus.
Dans5à10%descas, l’évolution se fait vers une bronchite ou
une pneumopathie
[3]
.
Asthme, bronchite et exacerbation
de bronchopathie chronique obstructive
M. pneumoniae pourrait être responsable de2à3%des
bronchites aiguës. En revanche, son rôle au cours des exacerba-
tions de bronchite chronique reste controversé. C. pneumoniae
et M. pneumoniae pourraient être responsables de6à15%des
exacerbations de bronchite chronique
[34]
. Toutefois, des
données plus récentes suggèrent que leur rôle est limité dans ce
contexte
[35]
.
Le rôle des infections par des bactéries atypiques telles que M.
pneumoniae dans la pathogénie de l’asthme a été évoqué depuis
Tableau 1.
Principales manifestations cliniques au cours des infections à M.
pneumoniae.
Manifestations respiratoires Infection des voies aériennes
supérieures, bronchite aiguë,
exacerbation de bronchite
chronique, exacerbation d’asthme,
pneumopathie atypique
Manifestations cutanées Érythème polymorphe, syndrome
de Stevens-Johnson, ectodermose
pluriorificielle, vascularite
Manifestations neurologiques Encéphalite, méningite, syndrome
de Guillain-Barré,
polyradiculonévrite
Manifestations cardiaques Péricardite, myocardite
Manifestations hématologiques Anémie hémolytique,
thrombopénie, neutropénie,
syndrome d’activation
macrophagique, anticorps
antiphospholipides
Autres manifestations Arthrite, hépatite, pancréatite,
insuffisance rénale,
rhabdomyolyse, conjonctivite,
uvéite, papillite
8-039-V-15
¶
Infections à Mycoplasma pneumoniae
2Maladies infectieuses

plusieurs années chez l’adulte et l’enfant. Actuellement, ce rôle
reste controversé
[36]
. Certaines études suggèrent que les
infections respiratoires basses à M. pneumoniae contribuent à
l’exacerbation de l’asthme de l’enfant
[37-41]
. Pour certains, la
première crise d’asthme sévère survenant chez un enfant
prédisposé se produit dans la moitié des cas au cours d’une
infection à M. pneumoniae
[41]
. Chez l’adulte, des données
récentes suggèrent le rôle de M. pneumoniae au cours des
exacerbations aiguës de l’asthme
[42, 43]
. Une étude de type cas/
témoins a montré que 18 % des patients avec un asthme en
exacerbation avaient une infection à M. pneumoniae prouvée par
la sérologie contre 3 % dans le groupe témoin
[42]
.
Pneumopathie atypique
M. pneumoniae est le principal agent responsable des pneu-
mopathies communautaires de l’adulte jeune. Les pneumopa-
thies atypiques représentent 15 % des pneumopathies
communautaires
[44]
. Le terme de pneumopathie atypique
primitive a été créé pour décrire les pneumopathies dues en
particulier à M. pneumoniae. Le début est progressif, marqué par
une fièvre modérée (< 39 °C), associée à une pharyngite, une
toux sèche et quinteuse. Il existe un syndrome pseudogrippal
associant des myalgies et des arthralgies. À l’auscultation, il
existe des râles crépitants qui peuvent être localisés. Des
manifestations extrarespiratoires variées peuvent être associées.
L’évolution est le plus souvent favorable.
Des formes sévères ont cependant été rapportées telles que
des empyèmes, rares chez l’enfant et exceptionnels chez
l’adulte
[45]
, ou des syndromes de détresse respiratoire qui
peuvent survenir chez l’adulte
[46-50]
et plus rarement chez
l’enfant
[51]
. L’observation d’un patient de 55 ans ayant présenté
une pneumopathie nécrosante due à M. pneumoniae et qui a dû
bénéficier d’une transplantation pulmonaire est rapportée
[52]
.
Au plan histologique, les pneumopathies atypiques sont
d’abord des atteintes des bronchioles avant de s’étendre dans le
parenchyme pulmonaire. L’atteinte bronchiolaire due à M.
pneumoniae est souvent diffuse. Aux anomalies histologiques des
pneumopathies à M. pneumoniae correspondent quelques
caractéristiques radiologiques : bon nombre d’entre elles ne
dépassent pas le stade de l’atteinte bronchiolaire, se traduisant
alors par une image réticulée de type viral
[53]
. Lorsqu’il existe
un syndrome de condensation alvéolaire, celui-ci siège le plus
souvent dans les lobes inférieurs (Fig. 1) ou est plus rarement
diffus de type bronchopneumonique.
Les aspects tomodensitométriques assez caractéristiques sont,
la plupart du temps, des nodules centrolobulaires associés à des
images d’arbres en bourgeons
[54]
. Des épaississements des parois
bronchiques, des foyers aériens ou des images en verre dépoli
avec une distribution lobulaire sont aussi associés. Les adénopa-
thies médiastino-hilaires sont exceptionnelles. Des signes
d’épanchement pleural ou péricardique peuvent s’observer
(20 %). Malgré la bénignité habituelle de cette pneumopathie
sous traitement antibiotique adapté, certaines publications font
état de bronchiolites sévères
[55, 56]
.
Manifestations extrarespiratoires
Manifestations cutanées
L’incidence des exanthèmes au cours de l’infection à M.
pneumoniae reste indéterminée
[57]
. Foy et al. notent 17 %
d’éruptions chez 319 enfants atteints de pneumopathies à M.
pneumoniae
[58]
. Il peut s’agir d’un exanthème maculopapuleux,
vésiculeux, bulleux, pétéchial, ou urticairien
[59-61]
.
L’érythème polymorphe est la forme la plus classique. Les
lésions cutanées surviennent brutalement et siègent de façon
élective sur les extrémités. Elles peuvent s’étendre sur les faces
d’extension des membres (avant-bras, jambes, genoux). Le
visage, le décolleté ainsi que le tronc, peuvent être touchés. Sur
les membres, les lésions sont souvent symétriques. La lésion
typique adopte la morphologie d’une lésion en cible ou en
cocarde : papule œdémateuse comportant une zone périphéri-
que rouge sombre, parfois microvésiculeuse, zone moyenne
moins foncée, et centre rouge sombre, parfois purpurique ou
décollé, constituant une bulle. Le plus souvent, on observe des
lésions papulovésiculeuses parfois associées à des lésions
bulleuses. Les lésions sont rarement prurigineuses, mais l’érup-
tion est plutôt sensible avec sensation de cuisson. Les lésions
muqueuses associées sont vésiculobulleuses et laissent place
rapidement à des érosions douloureuses. Les lèvres présentent
des érosions, se recouvrant sur leur versant cutané de croûtes
épaisses hémorragiques, la langue, la face interne des joues et le
palais sont le siège d’érosions polycycliques qui se recouvrent
d’un enduit jaunâtre fibrinoleucocytaire. La muqueuse génitale
peut être le siège de lésions érosives. L’atteinte oculaire peut
associer une conjonctivite bilatérale, des hémorragies sous-
conjonctivales, voire des ulcérations conjonctivales ou même
cornéennes. Il existe des formes d’intensité variable.
La forme la plus sévère est le syndrome de Stevens-Johnson,
qui est observé dans 7 % des cas d’infections dues à M. pneu-
moniae
[62]
. L’exanthème est généralisé, les signes généraux sont
importants et l’atteinte muqueuse est diffuse. M. pneumoniae est
la première cause de syndrome de Stevens-Johnson chez
l’enfant
[62]
. La frontière entre érythème polymorphe et syn-
drome de Stevens-Johnson reste discutée et certains auteurs
considèrent actuellement qu’il s’agit de deux entités différentes.
L’ectodermose pluriorificielle associe des signes cutanés
habituellement discrets, voire absents, à localisation périorifi-
cielle et une atteinte muqueuse profuse et multifocale atteignant
les muqueuses buccale, génitale et conjonctivale. Les signes
généraux sont d’intensité variable.
Un cas de vascularite cutanée due à M. pneumoniae a été
rapporté chez un jeune patient de 16 ans, en dehors de toute
manifestation respiratoire
[63]
.
Manifestations neurologiques
La prévalence des manifestations neurologiques au cours de
l’infection à M. pneumoniae est de 5 à 10 %
[64]
et 1 à 10 % des
infections à M. pneumoniae requérant une hospitalisation
s’accompagnent de manifestations neurologiques
[65]
. Elles
Figure 1. Radiographie pulmonaire de face chez une femme de 44 ans
atteinte de pneumopathie (collection personnelle).
Infections à Mycoplasma pneumoniae
¶
8-039-V-15
3Maladies infectieuses

peuvent survenir quel que soit l’âge avec une prédominance
chez les patients jeunes. Les signes respiratoires associés sont
inconstants. Le plus souvent, ils précèdent les manifestations
neurologiques et le délai entre les manifestations respiratoires et
l’apparition des signes neurologiques est de 9,6 jours
[65]
.
Ces manifestations neurologiques sont variées. Les encépha-
lites diffuses ou focales et méningoencéphalites sont les plus
fréquentes
[66-72]
. L’expression peut être précoce, suggérant une
invasion du système nerveux central ou différée, évoquant
plutôt un mécanisme dysimmunitaire. L’expression clinique est
variable, il peut s’agir d’un trouble du comportement ou de
convulsion, mais également de coma, plus fréquent chez
l’adulte
[69]
. Une ataxie peut être associée, signant l’atteinte
cérébelleuse, de même que des signes déficitaires.
Les autres manifestations rapportées sont des méningites
aseptiques
[73]
, des myélites transverses
[74-76]
, des accidents
vasculaires cérébraux
[77]
, des polyradiculonévrites et des
syndromes de Guillain-Barré
[78, 79]
. Une infection à M. pneumo-
niae pourrait être associée à la survenue d’un syndrome de
Guillain-Barré dans 5 % des cas
[78]
. Les signes neurologiques
sont le plus souvent réversibles, néanmoins, un tiers des
malades conservent des séquelles
[80]
. La pathogénie de ces
manifestations peut être soit une invasion directe du système
nerveux central
[81-83]
, soit un mécanisme immunitaire
[84]
et/ou
une vascularite et/ou un état d’hypercoagulabilité responsable
de phénomènes thromboemboliques
[69]
. La production d’une
neurotoxine par M. pneumoniae a été évoquée, mais jamais
démontrée.
Le traitement de ces manifestations neurologiques n’est pas
codifié. L’antibiothérapie est systématique, les corticoïdes sont
associés dans l’hypothèse d’un mécanisme immunoallergique.
Les veinoglobulines sont proposées et utilisées pour la prise en
charge du syndrome de Guillain-Barré ou des encéphalites
[85,
86]
. Leur utilisation plaide en faveur du mécanisme dysimmuni-
taire de ces manifestations.
Manifestations cardiaques
Leur fréquence, de 1 à 8,5 % chez l’adulte
[87]
, serait beau-
coup plus faible chez l’enfant
[57]
. Il peut s’agir de péricar-
dite
[88]
, avec parfois tamponnade
[89]
, de myocardite ou de
myopéricardite
[57]
. L’expression peut être clinique et se traduire
par un tableau d’insuffisance cardiaque ou un trouble du
rythme ou électrocardiographique. L’échographie permet de
mieux détecter ces lésions. La pathogénie reste à préciser. M.
pneumoniae a été isolé dans le liquide d’épanchement péricardi-
que et dans le tissu péricardique, ce qui plaide en faveur du rôle
direct du germe au cours des péricardites. En revanche, M.
pneumoniae n’a jamais été isolé dans le myocarde
[57]
.
Manifestations hématologiques
La plus classique est l’anémie hémolytique aiguë liée à la
présence d’agglutinines froides. Il s’agit d’IgM anti-I, distinctes
des anticorps anti-M. pneumoniae. Ces agglutinines froides
traduisent l’auto-immunisation contre les hématies altérées par
l’hémolysine du germe. Pour Murray et al.
[87]
,80%des
patients infectés par M. pneumoniae ont un test de Coombs
positif. L’hémolyse peut être sévère.
Plus rarement ont été rapportées des thrombopénies ou des
neutropénies sévères
[90-92]
et des syndromes d’activation
macrophagique
[93, 94]
.
Manifestations ostéoarticulaires
Les manifestations articulaires sont rares
[95]
. Des cas d’arth-
rites réactionnelles ont été signalés au cours d’infections par M.
pneumoniae
[96]
. Dans un cas, l’évolution s’est faite vers une
spondylarthrite ankylosante juvénile. Le rôle de M. pneumoniae
comme cofacteur au cours de la polyarthrite rhumatoïde a été
suggéré
[97]
. Un cas de RS3PO a été décrit
[98]
.
Manifestations digestives
Les manifestations hépatiques sont classiques en particulier
chez l’enfant et souvent limitées à un décalage des transamina-
ses
[99]
. Deux cas d’hépatite aiguë ont été récemment décrits
chez des adultes, sans atteinte pulmonaire associée
[100]
.
En dehors des hépatites ont été rapportés des cas de pancréa-
tite
[101, 102]
ou de gastroentéropathie exsudative chez un enfant
de 3 ans
[103]
.
Autres manifestations
Les techniques de biologie moléculaires ont montré que M.
pneumoniae pouvait être responsable d’infections chez les
patients immunodéprimés en particulier chez les patients
infectés par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH)
[104]
.
Des cas d’insuffisance rénale au cours d’une infection à M.
pneumoniae ont été rapportés
[105-107]
. Le mécanisme est une
glomérulonéphrite. Une néphropathie à IgA a également été
décrite
[107]
.
Une rhabdomyolyse peut être observée. Elle peut être associée
à une pneumopathie
[108]
, voire à un syndrome de détresse
respiratoire
[46]
ou plus rarement être isolée
[109]
.
La présence d’anticorps antiphospholipides a été signalée au
cours d’infections dues à M. pneumoniae
[110]
;
Des manifestations ophtalmologiques sont également décri-
tes, il s’agit de conjonctivites, uvéites ou papillites
[111, 112]
.
Enfin, la responsabilité de M. pneumoniae a été évoquée
au cours du syndrome de fatigue chronique ou des
fibromyalgies
[113]
.
■Diagnostic bactériologique
(Tableau 2)
Diagnostic direct
La recherche de M. pneumoniae dans un prélèvement peut se
faire par l’isolement de la bactérie en culture ou, plus rapide-
ment, par la détection d’une partie de son génome. Cependant,
en raison de la difficulté et de la lenteur de la culture la mise
en évidence de ce micro-organisme est encore de nos jours
difficilement accessible aux laboratoires n’utilisant pas couram-
ment les outils moléculaires
[114, 115]
.
Prélèvements
Du fait des propriétés d’adhésion cellulaire de M. pneumoniae,
le prélèvement constitue une étape essentielle dans la démarche
diagnostique. Il doit être riche en cellules.
Types d’échantillons
Lors d’une atteinte pulmonaire, l’aspiration de sécrétions
trachéales, de liquide de lavage bronchoalvéolaire (LBA) ou le
brossage endobronchique sont à privilégier. Néanmoins, la
recherche de la bactérie peut se faire à partir de sites plus
facilement accessibles, notamment chez l’enfant, grâce à un
simple écouvillonnage de gorge ou une aspiration nasopharyn-
gée. Ces prélèvements sont susceptibles de contenir parfois des
inhibiteurs des réactions d’amplification génique
[13, 116]
, ils
restent cependant les prélèvements de référence. Chez l’adulte,
lorsque l’expectoration peut être recueillie, les techniques
d’amplification génique donnent des résultats acceptables (PCR
multiplex), voire supérieurs à ceux obtenus à partir d’écou-
villonnages de gorge ou d’aspirations nasopharyngées (PCR
monoplex)
[23, 117, 118]
.
Le diagnostic moléculaire peut être établi à partir du liquide
céphalorachidien ou de tout liquide de ponction (synovial,
pleural ou péricardique).
8-039-V-15
¶
Infections à Mycoplasma pneumoniae
4Maladies infectieuses

Le prélèvement de lésions cutanées est envisageable, en
particulier lorsque l’exanthème est de type vésiculaire ou
bulleux bien que la bactérie n’y soit que très rarement
présente
[119]
.
Transport et conservation
Les mycoplasmes sont extrêmement sensibles aux conditions
environnementales, en particulier à la chaleur et la dessiccation.
Tout prélèvement fait à l’écouvillon doit être placé directement
dans le milieu de culture ou dans un milieu de transport type
2SP (saccharose/phosphate de potassium) sans antibiotique et
additionné de5%desérum de veau fœtal. Les produits liquides
ne nécessitent pas de milieu de transport s’ils sont traités dans
l’heure qui suit leur recueil. Il est préférable d’analyser les
produits pathologiques le plus rapidement possible, néanmoins,
ils peuvent être conservés en milieu de transport pendant
48 heuresà4°Cet,passé ce délai, doivent être congelés à –
70 °C. Les échantillons, qui sont exclusivement soumis à des
techniques non culturales, ne requièrent pas de milieu de
transport spécifique et peuvent être conservés selon les mêmes
conditions de température. Toutefois, la congélation doit être
immédiate si l’on opte pour une technique de détection de
l’acide ribonucléique (ARN)
[120]
.
Culture
La petite taille (1 à 2 mm sur 0,1 à 0,2 mm) de M. pneumo-
niae, l’absence de paroi (empêchant la coloration de Gram) et
le polymorphisme important qui en résulte sont autant d’élé-
ments qui rendent l’examen microscopique direct irréalisable.
La mise en évidence de la bactérie au moyen de la culture est
compliquée par des exigences nutritionnelles complexes. Cette
culture est fastidieuse, longue et d’un rendement relativement
faible. Sa spécificité est de 100 % à condition qu’elle soit
complétée par l’identification de l’espèce isolée. En l’absence de
standardisation des différentes étapes, sa sensibilité varie et ne
dépasse pas 68 %, que l’on compare cette méthode à la
PCR
[121]
ou à la sérologie
[122]
. Pour toutes ces raisons, la
culture est peu utilisée en routine. Les techniques de biologie
moléculaire sont plus sensibles et plus rapides.
Milieux de culture
Malgré leur mode de vie parasitaire, les mycoplasmes sont
capables de croître en milieu acellulaire. Les milieux de culture
liquides sont composés d’un bouillon de base enrichi en sérum
de poulain ou de veau fœtal (20 %) et extrait de levure qui
apportent, respectivement, le cholestérol et les facteurs de
croissance nécessaires et dont la qualité doit être contrôlée. Un
Tableau 2.
Diagnostic des infections à M. pneumoniae.
Diagnostic direct Diagnostic indirect
Prélèvements Types de prélèvements : 2 sérums prélevés à 2-3 semaines d’intervalle
– écouvillonnage pharyngé
– aspiration nasopharyngée
– expectoration
– LBA
– brossage endobronchique
– aspiration trachéale
– LCR, liquide synovial, pleural ou péricardique
Précautions :
– richesse cellulaire indispensable
– milieu de transport (type 2SP
a
) pour écouvillons et prélèvements
destinés à la culture
– conservation à 4 °C, 48 h et au-delà à –70 °C
Techniques Culture :
– milieu de Hayflick modifié
– milieu SP4
– incubation :
3-4 semaines
Amplification génique :
– cibles les plus courantes :
ARNr 16S, adhésine P1
– méthodologies : PCR monoplex
et multiplex, NASBA, PCR
et NASBA temps réel
Anticorps totaux :
– RFC
– agglutination
IgM/IgG spécifiques :
– IFI
– EIA
b
Interprétation Diagnostic de certitude si résultat positif
Limites :
– éventuelle persistance de la bactérie ou portage asymptomatique
pharyngé (particulièrement en période épidémique)
– absence fréquente de la bactérie dans les localisations
extrapulmonaires (processus immunologique)
Diagnostic de certitude si :
– séroconversion
–×4dutaux d’anticorps (RFC)
– IgM positives (IFI, EIA
b
)
Taux isolé présomptif en RFC : ≥64
Limites : IgM inconstantes lors des réinfections
En pratique Culture : rarement effectuée car fastidieuse et lente
Amplification génique :
– de plus en plus utilisée (rapide, sensible, spécifique)
– trousses récemment commercialisées
– à coupler à la sérologie
RFC :
– fiable, mais fastidieuse
– défaut de sensibilité et spécificité
Agglutination :
– simple et rapide
– performances parfois discutables
IFI : lecture délicate
EIA :
– les plus utilisés (praticables et automatisables)
– performances inégales des trousses commercialisées
LBA : lavage bronchoalvéolaire ; PCR : polymerase chain reaction ; NASBA : nucleic acid sequence based amplification ; RFC : réaction de fixation du complément ; IFD :
immunofluorescence indirecte ; IgM : immunoglobulines M ; ARN : acide ribonucléique ; IFI : immunofluorescence indirecte.
a
Saccharose phosphate de potassium sans antibiotique.
b
Tests immunoenzymatiques.
Infections à Mycoplasma pneumoniae
¶
8-039-V-15
5Maladies infectieuses
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%