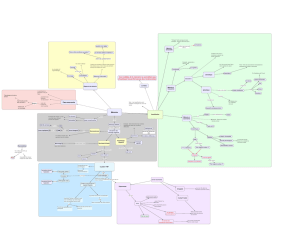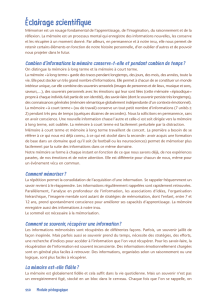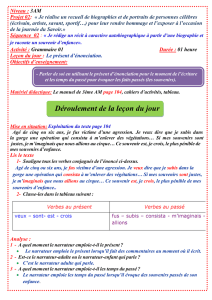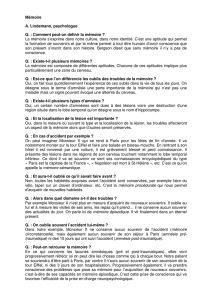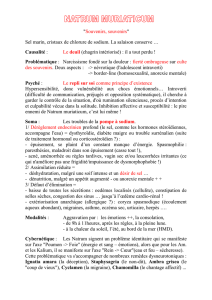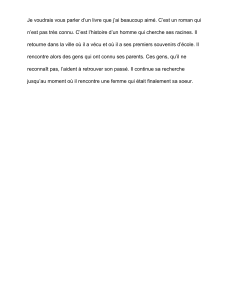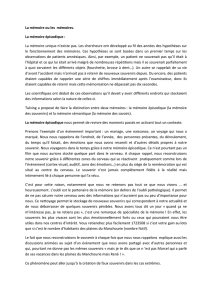EN QUOI LA RECHERCHE DE SOUVENIRS FLASH PEUT-ELLE NOUS
RENSEIGNER SUR LA MÉMOIRE ÉPISODIQUE ET LA MÉMOIRE
SÉMANTIQUE ?
Catherine Thomas-Antérion, Céline Borg, Hélène Vioux, Bernard Laurent
John Libbey Eurotext | « Revue de neuropsychologie »
2010/1 Volume 2 | pages 55 à 60
ISSN 2101-6739
DOI 10.3917/rne.021.0055
Article disponible en ligne à l'adresse :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
https://www.cairn.info/revue-de-neuropsychologie-2010-1-page-55.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution électronique Cairn.info pour John Libbey Eurotext.
© John Libbey Eurotext. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les
limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la
licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie,
sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de
l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockage
dans une base de données est également interdit.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
© John Libbey Eurotext | Téléchargé le 21/02/2022 sur www.cairn.info via Université de Rouen (IP: 195.220.135.36)
© John Libbey Eurotext | Téléchargé le 21/02/2022 sur www.cairn.info via Université de Rouen (IP: 195.220.135.36)

doi: 10.1684/nrp.2010.0055
En quoi la recherche de souvenirs flash
peut-elle nous renseigner
sur la mémoire épisodique
et la mémoire sémantique ?
How the study of flashbulb memorie
can learn us about episodic memory
and semantic memory?
Résumé La mémoire des événements publics comporte des élé-
ments sémantiques et des éléments épisodiques. Dans
certains cas, les sujets peuvent en effet se rappeler des informations détaillées sur des événe-
ments y compris très longtemps après leur survenue ou produire un souvenir flash (SF) qui
correspond à la capacité de rappeler les circonstances personnelles danslesquelles ils ont appris
la survenue d’un fait public. Il est possible, lors de l’examen d’un SF, de distinguer des dimen-
sions canoniques objectives : le lieu, le temps, la phénoménologie. L’effet de l’âge n’existe que
pour les sujets les plus âgés. La capacité à rappeler des SF est effondrée dans la maladie
d’Alzheimer et diminuée dans la maladie de Parkinson. Dans la maladie d’Alzheimer, les
éléments sémantiques de l’événement sont également moins bien récupérés. L’étude des
souvenirs flash nous renseigne sur l’organisation de la mémoire épisodique et sur une mémoire
collective fédératrice. Elle permet d’envisager de nouveaux modèles qui précisent les liens entre
les systèmes mnésiques.
Mots clés : mémoire événementielle
•
souvenir vivace
•
souvenir flash
•
mémoire collective
•
Alzheimer
•
Parkinson
Abstract Public events memory can have semantic and episo-
dic components. In some case, individuals retain
vivid and detailed recollection of the event, even long after the event’s occurrence. The
hallmark of flashbulb memories (FBM) is that individuals remember the details of the
reception event. In examining FBM, we can distinguish responses concerning objective
canonical features: place, time, phenomenological details. These events are particularly
memorable, emotionally charged, surprising and have a strong global impact [the events
of September 11
th
2001 9.11)]. FBM don’t represent a distinct form of memory because
they decay over time and they are affected by ageing. In fact, the effect of age only seems
to exist for elderly subjects. FBM are impaired in Alzheimer’s disease and less in Parkin-
son’s disease. In Alzheimer’s disease, semantic components of public events are also
impaired. The study of FBM learned us about episodic memory and community memory
practices. It is possible to dissociate memory for facts (semantic memory) from memory
for self-relevant information (autobiographical memory) and better understand the rela-
tionships between different systems of memory in new multisystems models of memory.
Key words: public events memory
•
vivid memory
•
flashbulb memories
•
community memory
•
Alzheimer
•
Parkinson
Dossier
Rev Neuropsychol
2010 ; 2 (1) : 55-60
Correspondance :
C. Thomas-Antérion
Catherine Thomas-Antérion,
Céline Borg, Hélène Vioux,
Bernard Laurent
Unité de neuropsychologie-CM2R,
CHU Nord, 42055 Saint-Étienne cedex 02
R
EVUE DE NEUROPSYCHOLOGIE
N
EUROSCIENCES COGNITIVES ET CLINIQUES
55
© John Libbey Eurotext | Téléchargé le 21/02/2022 sur www.cairn.info via Université de Rouen (IP: 195.220.135.36)
© John Libbey Eurotext | Téléchargé le 21/02/2022 sur www.cairn.info via Université de Rouen (IP: 195.220.135.36)

Brown et Kulik ont proposé en 1977 [1] le terme de
flashbulb memory (souvenir flash) pour définir le
souvenir que l’on a des circonstances où l’on a
appris un événement public particulièrement surprenant
ou ayant un impact émotionnel notable (pour revue, voir
[2]). Les questions concernant ces souvenirs flash sont
nombreuses et ont évolué dans le temps. Pendant une
première période, les auteurs se sont essentiellement
intéressés à la nature de ces souvenirs [3, 4] et, plus
récemment, aux effets de l’âge ou des pathologies neuro-
dégénératives [5-7], puis à l’impact éventuel sur l’identité
socialedecetypedesouvenir[8,9].Lessouvenirs
flash sont une forme particulière de souvenirs vivaces
[10]. Il s’agit de souvenirs autobiographiques mais, par
essence, ces souvenirs sont intimement liés à ceux des
événements publics. L’événement public joue ici le rôle
d’un indice de récupération privilégié d’un souvenir
autobiographique. La première description est ancienne
et émane de Colegrove en 1899 : elle concernait le
souvenir qu’avaient ses contemporains de l’assassinat
d’AbrahamLincoln.Ils’agit de souvenirs pour lesquels
un sujet peut évoquer précisément les circonstances où
il se trouvait lorsqu’il a appris un événement dont la
caractéristique est d’être inattendu, spectaculaire et
émotionnel.
Il est classique de distinguer six dimensions canoni-
ques à ces circonstances : où et quand, comment, avec
qui, en train de faire quoi, et dans quel état d’esprit, nous
étions lorsque nous avons appris la survenue de l’événe-
ment et ce que nous avons fait immédiatement au
décours. La littérature concernant ce sujet est difficile à
synthétiser, du fait de la très grande variabilité des para-
digmes utilisés. Ainsi, le délai de recueil du souvenir
flash varie de quelques heures suivant juste l’événement
(le procès d’O.J. Simpson dont le dénouement était
attendu en direct à la télévision [11, 12]) à des décennies
plus tard (la mort de Mustafa Kemal Atatürk en 1938
[13]) sans contrôle sur le moment. Le souvenir est
recueilli une seule fois ou dans des protocoles expéri-
mentaux comportant des phases de test et de retest (là
encore, le délai est variable). Les paramètres recueillis
et le contrôle de la qualité du souvenir de l’événement
public lui-même sont nombreux et parfois complexes.
Les modes de cotation diffèrent. La plupart des études
concernent un événement étudié isolément : l’assassinat
de J.F. Kennedy, le procès d’O.J. Simpson, l’attentat du
président Reagan, la navette Challenger, la mort de Lady
Di, le 11 septembre 2001.
Nous présentons les données de la littérature récente
concernant les caractéristiques des SF, leur lien à la
mémoire sémantique et épisodique, leur relation à l’émo-
tion et leur évolution dans le temps et avec l’âge. Nous
verrons enfin ce que leur étude peut apporter de particulier
dans le domaine des maladies neurodégénératives.
Les caractéristiques des souvenirs flash
qui en font des souvenirs épisodiques
et sémantiques
Brown et Kulik [1] ont popularisé ce type de souvenirs
épisodiques en décrivant la capacité des citoyens améri-
cains à décrire ce qu’ils faisaient précisément et dans quel
état d’esprit ils se trouvaient lorsqu’ils ont appris la mort de
J.F. Kennedy. Cet épisode et ses conséquences sur la
mémoire autobiographique ont été depuis, de multiples
fois, étudiés [14, 15]. Les souvenirs flashes sont détaillés,
imagés et conservent durablement les informations contex-
tuelles de l’épisode d’acquisition de l’événement. Une
question théorique est de savoir pourquoi tel événement
et pas tel autre suscite un souvenir vivace. Pour tenter d’y
répondre, Rubin et Kozin [10] ont proposé à un groupe de
sujets de rappeler un événement personnel choquant
(décès d’un proche) et neuf événements publics : les assas-
sinats de J.F. Kennedy, de Medgar Evers, de Malcom X, de
Martin Luther King, de Robert Kennedy, les agressions de
Georges Wallace, de Gerald Ford, le scandale concernant
Ted Kennedy et le décès du Général Franco. Lorsque le
sujet pouvait rappeler l’événement, il devait indiquer par
écrit les circonstances dans lesquelles il l’avait appris, puis
estimer les conséquences de cet événement dans sa vie per-
sonnelle et le nombre de fois dont il en avait parlé depuis.
Ainsi six catégories d’informations (informations canoni-
ques) ont été répertoriées : le lieu où le sujet a appris l’évé-
nement (Où), l’activité en cours (QUOI), la source de
l’information (QUAND/QUI), les émotions du sujet (COM-
MENT), celles des autres (AVEC), et les conséquences per-
sonnelles (PAR CONSÉQUENT). Pour ces auteurs, le rappel
de l’événement et de l’une de ces dimensions canoniques
suffit à qualifier le souvenir de souvenir flash (ce n’est pas le
cas pour toutes les équipes). Ces données caractérisent les
aspects épisodiques de la mémoire des événements publics
et sont, à la différence du savoir sur l’événement, fortement
corrélées aux fonctions exécutives [16]. L’événement qui
suscitait le plus de souvenirs flash était l’assassinat de JFK.
Les deux variables critiques pour la formation d’un tel sou-
venir étaient le niveau de surprise et les conséquences
personnelles. Plus l’implication affective personnelle était
élevée, plus le souvenir était précis et détaillé. Selon ces
auteurs, les souvenirs flash seraient associés à un méca-
nisme physiologique d’encodage particulier, qui les distin-
guerait des autres traces mnésiques et qui impliquerait
notamment l’amygdale, du fait de leur connotation émo-
tionnelle. Le niveau de conséquence pour le sujet est une
donnée très difficile à apprécier et différentes études l’ont
depuis remis en cause. Ainsi, Pillemer [17], en étudiant
l’événement de la tentative d’assassinat de Ronald Reagan,
a montré que la génération du souvenir flash est surtout
liée à l’intensité de la réaction émotionnelle initiale lors de
l’annonce de l’événement. De même, pour Conway [18],
qui a étudié l’impact de l’explosion de la navette
Challenger, le niveau de surprise, le niveau de conséquence
Dossier
R
EVUE DE NEUROPSYCHOLOGIE
N
EUROSCIENCES COGNITIVES ET CLINIQUES
56
© John Libbey Eurotext | Téléchargé le 21/02/2022 sur www.cairn.info via Université de Rouen (IP: 195.220.135.36)
© John Libbey Eurotext | Téléchargé le 21/02/2022 sur www.cairn.info via Université de Rouen (IP: 195.220.135.36)

et la répétition n’étaient pas essentiels pour la construction
du souvenir flash, à la différence de la réaction émotion-
nelle du sujet dont ils étaient, par ailleurs, indépendants.
La place de l’événement dans les médias et dans les discus-
sions avec d’autres pourrait également expliquer le main-
tien de certains souvenirs flash [19]. L’impact social de
l’événement jouerait alors un rôle important. Dans une
perspective évolutionniste, certains événements pourraient
être plus essentiels à la survie de l’espèce [20] ou plus
importants pour le groupe social, et permettraient ainsi à
l’individu de développer, en marge de sa propre identité,
une identité sociale [19]. Un travail original a consisté à
rechercher des souvenirs flash suite au décès de François
Mitterrand chez des citoyens belges et français [8]. Ce
souvenir particulier –puisque la mort du président était
attendue –génère néanmoins des souvenirs flash. De plus,
le groupe social a effectivement un impact puisque les
Français ont plus de souvenirs flash que les Belges.
L’événement du 11 septembre a donné lieu à plusieurs
études sur les souvenirs flash. Talarico et Rubin [21] ont
étudié les souvenirs biographiques et les souvenirs flash
de cet événement dans trois groupes de 18 sujets jeunes,
1 semaine, 6 semaines et 32 semaines après cette période.
Parallèlement, les auteurs interrogeaient les sujets sur
l’impact émotionnel de l’événement en recherchant des
signes végétatifs. L’évocation de souvenirs n’est pas corrélée
au niveau d’émotion végétative. En revanche, l’importance
de la réaction végétative et de la valence négative attribuée
àl’événement était corrélée au stress post-traumatique.
Récemment Hirst et al. [9] ont pu apporter des données
importantes concernant la nature des souvenirs flash.
Ces auteurs ont étudié l’événement du 11 septembre auprès
d’un échantillon de sujets américains résidant dans divers
États : 391 participants ont répondu une quinzaine de jours
après l’épisode, 11 mois (pour éviter la première commémo-
ration) et trois ans après, à un questionnaire écrit prenant
environ 45 minutes. Ces auteurs n’ont trouvé, dans cette
étude très rigoureuse, aucune relation entre les souvenirs
flash et cinq critères discutés dans la littérature. Il s’agissait
du lieu de résidence (en distinguant : New York et les autres
villes, le quartier des tours et les autres quartiers), les consé-
quences personnelles (une atteinte personnelle objective
comme des dégâts dans le lieu de vie ou la perte d’un emploi
et non un retentissement psychologique subjectif), l’émotion
suscitée par l’événement, le niveau d’intérêtpourletraite-
ment de l’information par les médias et l’importance des
conversations individuelles. Toutes ces dimensions (sauf le
niveau émotionnel) influençaient, en revanche, la qualité
du rappel du souvenir public.
L’évolution dans le temps
des souvenirs flash
Le souvenir flash est un souvenir autobiographique et il
convient de se demander s’il évolue dans le temps comme
l’ensemble de ces souvenirs. Il est admis que la trace mné-
sique perd un certain nombre de détails contextuels lors
de la première année de consolidation d’un souvenir et
que l’on observe ensuite une moindre perte. Dans ce
sens, différents auteurs ont bien montré que les souvenirs
flash n’avaient pas de caractéristiques propres et que,
comme tous les souvenirs épisodiques, ils pouvaient être
soumis à l’oubli et aux déformations, et qu’avec le temps,
le rappel des circonstances d’apprentissage diminuait et
les distorsions augmentaient [3-22]. De plus, la plupart
des travaux objectivent une bonne constance des répon-
ses lorsqu’on teste de nouveau les sujets [8, 22-26]. En fait,
les résultats sont contradictoires, il semble qu’il y ait moins
de constance si l’événement est documenté très tôt après
sa survenue. Les sujets continueraient à apprendre des
choses sur l’événement et enrichiraient alors leur souve-
nir. Hirst et al. [9] montrent ainsi que les sujets, lors
des entretiens à propos du 11 septembre, enrichissent
leur récit de détails vus dans le film de Michael Moore !
Il pourrait s’agir aussi d’un artefact dû à l’oubli des tous
premiers détails. Pour tester cette hypothèse, Winningham
et al. [11] ont évalué le souvenir de l’acquittement d’O.J.
Simpson cinq heures, puis une semaine, après le procès et
confirment l’absence de constance des réponses suggérant
d’analyser la littérature avec soin selon le délai après
lequel on a recueilli le souvenir. Schmolck et al. [12]
ont, quant à eux, rapporté par rapport à ce même événe-
ment qu’en fait, à 15 mois, 40 % des souvenirs flash sont
identiques et que seulement 10 % d’entre eux comportent
de majeures distorsions, mais que ce profil de réponses
s’inverse à 32 mois avec alors seulement 20 % de souve-
nirs flash constants et des distorsions majeures pour 40 %
d’entre eux ! En outre, ces auteurs n’excluent pas que la
nature de l’événement joue également un rôle. La cons-
tance des réponses a été rapportée dans le travail de
Conway et al. [27] qui concernait un événement extrême-
ment émotionnel (de l’ordre du traumatisme pour des mil-
lions d’Américains) puisqu’il s’agit de l’explosionenvol
de la navette Challenger. Talarico et Rubin [21] en étu-
diant le 11 septembre 2001 ont rapporté qu’en fait le
taux de constance des réponses en dépit de la particularité
de ce souvenir très émotionnel était semblable à celui des
souvenirs biographiques survenus les jours précédents
dans la vie des sujets interviewés. Hirst et al. [9], dans
leur évaluation des souvenirs de 391 sujets concernant le
11 septembre, dans un délai de 15 jours, 11 mois et 3 ans,
montrent en fait que le taux d’oubli est plus important la
première année –20 % au moins –puis se ralentit après
la première année (entre 5 à 10 %) et qu’il n’yapasde
différence entre les deux dernières périodes. De plus, ils
ne retrouvent aucun impact de l’âge, du genre, du lieu
de résidence, de l’ethnie, de la religion ou des orientations
politiques ! Surtout, les auteurs ne retrouvent aucune
influence sur le taux d’oubli des facteurs émotionnels,
du lieu de résidence (et des éventuelles conséquences
néfastes personnelles), ni même du niveau d’intérêt porté
aux médias ou l’importance des conversations avec les
proches.
Dossier
R
EVUE DE NEUROPSYCHOLOGIE
N
EUROSCIENCES COGNITIVES ET CLINIQUES
57
© John Libbey Eurotext | Téléchargé le 21/02/2022 sur www.cairn.info via Université de Rouen (IP: 195.220.135.36)
© John Libbey Eurotext | Téléchargé le 21/02/2022 sur www.cairn.info via Université de Rouen (IP: 195.220.135.36)

Souvenirs flash et effet de l’âge
La fréquence de la génération de souvenirs flash et leur
constance pourrait parfois avoir un lien avec l’âge du sujet,
du fait de la nature épisodique du souvenir. Il a été ainsi
observé que des jeunes britanniques interrogés à propos
de la démission de Margaret Thatcher avaient une cons-
tance de leur réponse à un an du premier questionnaire
dans 90 % des cas, alors que pour les sujets âgés, elle
n’était observée que dans 42 % des cas [26]. Il existe peu
de travaux sur la durée du phénomène. Un travail turc a
évalué les souvenirs flash à partir de deux événements :
l’assassinat de Mustafa Kemal Atatürk en 1938 auprès de
sujets âgés et la mort de Turgüt Ozal, président de la Tur-
quie en 1993 auprès de sujets jeunes et âgés [13]. Les sujets
âgés conservaient un souvenir flash plus de 50 ans après cet
événement majeur. Par ailleurs, les sujets âgés avaient
moins que les sujets jeunes de souvenirs flash pour l’événe-
ment récent, dont il faut toutefois souligner la moindre
portée.
Concernant l’événement du 11 septembre, Davidson
et al. [5] ont montré que l’âge ne modifiait pas la génération
d’un souvenir flash et son maintien, un an plus tard. Les évé-
nements publics ne susciteraient pas tous autant de souve-
nirs flash. Davidson et Glisky [23] ont ainsi interrogé
53 sujets âgés en moyenne de 73 ans et 21 sujets âgés en
moyenne de 20 ans, à propos de la mort de Lady Di et de
Mère Thérésa, en recherchant six dimensions canoniques
aux souvenirs flash. Tous les sujets avaient davantage de
souvenirs flash pour la mort de Lady Di que pour celle de
Mère Thérésa, sans effet de l’âge. Malgré tout, il est très dif-
ficile d’apprécier la fréquence de ces souvenirs, puisqu’ils
sont dans une très large majorité de travaux, recherchés à
propos d’événements uniques.
Nous avons nous-même recherché des souvenirs flash
avec la batterie EVE 30 [24, 25] composée de 30 événe-
ments publics, auprès de 108 sujets âgés de 20 à 79 ans.
Un des résultats principaux de cette étude était la fréquence
de leur survenue. Ainsi, au moins huit des événements
parmi les 30 proposés provoquaient l’évocation d’un
souvenir flash dans au moins 40 % des cas : la coupe du
monde, l’effondrement des tours du World Trade Center,
l’explosion d’AZF, le passage à l’euro, les 17 % de voix
pour Le Pen, la mort de Cloclo et la mort de Lady Di.Le
premier pas sur la lune et l’assassinat de JFK s’accompa-
gnaient également de souvenirs flash chez les personnes
âgées de 60 à 79 ans, de même que dans plus de 50 %
des cas. Les événements qui se sont produits au cours des
périodes 1990-1999 et 2001 éveillent des souvenirs flash
plus nombreux chez l’ensemble des sujets, et les événe-
ments relatifs à la période 1960-1969, chez les sujets âgés
de 60 à 79 ans. Nous confirmons ainsi dans ce travail que
les souvenirs flash sont solides : les sujets âgés récupèrent
plus de 40 ans plus tard des souvenirs encodés pendant leur
jeunesse, à la période dite du pic de réminiscence. Pour les
années très récentes, c’est-à-dire à partir de l’année 2000, le
pourcentage de souvenirs flash est réduit chez les per-
sonnes âgées de 70 à 79 ans : l’effet de l’âge pourrait être
différent selon l’âge où l’événement public est vécu, sans
que l’on ne puisse éliminer l’impact social différent de cer-
tains événements, en fonction de l’âge. En tout cas, cette
solidité avec l’âge offre la perspective de rechercher les
souvenirs flash dans les pathologies neurodégénératives.
Souvenirs flash
et maladies neurodégénératives
Comme nous l’avons vu, l’expertise de la mémoire du
passé et des souvenirs flash permet d’évaluer les compo-
santes épisodiques et sémantiques des événements publics
[16]. De plus, l’âge semble avoir peu d’effets dans leur
maintien et ne modifierait la consolidation de nouveaux
souvenirs qu’au-delà de 75 ans. Ces données soulignent
l’intérêt d’évaluer davantage la mémoire du passé et de
rechercher les souvenirs flash dans les maladies neurodé-
génératives. Concernant l’évaluation de la mémoire auto-
biographique, Piolino et al. [28] ont souligné les triples
dissociations que l’on peut observer, lorsqu’on explore
des sujets avec maladie d’Alzheimer (MA), dégénéres-
cence frontotemporale (DFT) ou démence sémantique
(DS), en utilisant l’épreuve du TEMPau afin de recueillir
des souvenirs répartis dans le temps. Les auteurs ont
contrôlé soigneusement l’épisodicité en analysant le rap-
pel de la source d’acquisition (contenu du rappel et cons-
cience autonoétique) avec un paradigme Know versus
Remember (K/R). Les sujets étaient invités à dire s’ils
avaient connaissance du souvenir (et ne pouvaient alors
rapporter plus aucun élément du contexte d’acquisition)
ou s’ils se rappelaient du souvenir et pouvaient préciser
encore des détails du contexte initial. Dans ce travail, les
sujets MA rappelaient davantage de souvenirs anciens, le
gradient temporel était inversé dans la DS et on n’observait
pas de gradient temporel dans la DFT. Les patients DS dont
la caractéristique est de conserver (du moins au début)
une bonne mémoire épisodique, ne se distinguaient pas
des témoins –à la différence des deux autres groupes de
sujet –en termes de conscience autonoétique (source phé-
noménologique, spatiale et temporelle du souvenir). Nous
avions montré, en étudiant des sujets MA et DFT, que le
gradient temporel concernait uniquement les sujets MA,
et ce dans les épreuves de mémoire autobiographique,
mais également dans celles explorant les événements
publics [29].
Dans un travail préliminaire, nous avons enregistré
moins de 5 % de souvenirs flash chez 12 patients évalués
avec la batterie EVE 30 et seulement 15 % chez 12 sujets
MCI, ce qui témoigne de l’atteinte précoce de ce type de
mémoire. Nous avons étudié plus précisément un événe-
ment de la batterie : le 11 septembre 2001 [6]. Son choix
est dû au fait que les sujets normaux obtiennent des perfor-
mances plafond lorsqu’il s’agit de rappeler l’événement
et de générer un souvenir flash [24]. Nous avons interrogé
30 patients âgés en moyenne de 70 ans, en début de
Dossier
R
EVUE DE NEUROPSYCHOLOGIE
N
EUROSCIENCES COGNITIVES ET CLINIQUES
58
© John Libbey Eurotext | Téléchargé le 21/02/2022 sur www.cairn.info via Université de Rouen (IP: 195.220.135.36)
© John Libbey Eurotext | Téléchargé le 21/02/2022 sur www.cairn.info via Université de Rouen (IP: 195.220.135.36)
 6
6
 7
7
1
/
7
100%