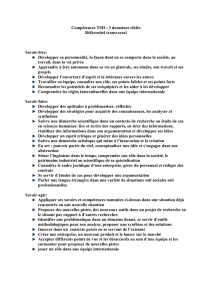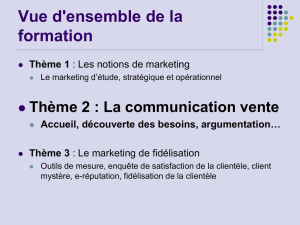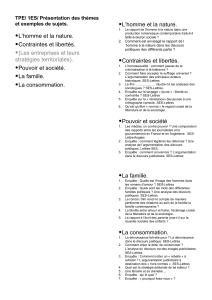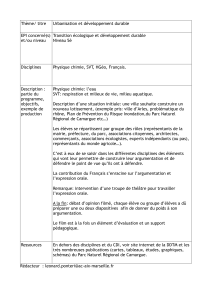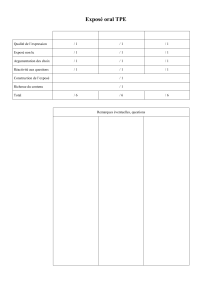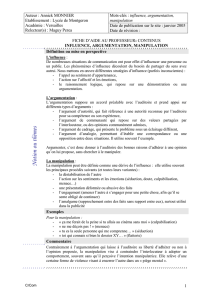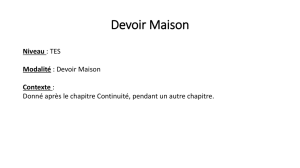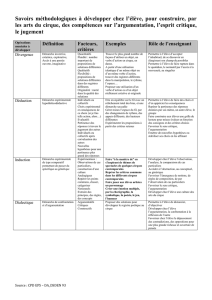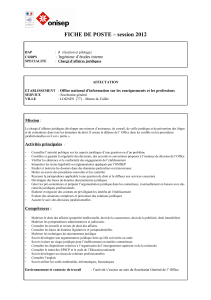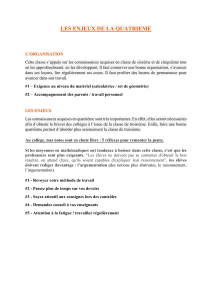Evaluer l'argumentation
De EduTech Wiki
Cet article est en construction: un auteur est en train de le modifier.
En principe, le ou les auteurs en question devraient bientôt présenter une meilleure version.
Resumé - Abstract
Des environnements médiatisés d'apprentissages permettent aux étudiants de développer des dialogues
argumentatifs. Des outils d'analyse permettant d'évaluer la qualité de l'argumentation développée par
les participants ont été créé, illustrant divers points de vue : structure de l'argumentation, nature et
fonction des contributions, nature des raisonnements utilisés, "pattern" d'interactions. L'analyse de la
qualité de l'argumentation est un enjeux pédagogique important en Sciences.
mots clé :
Sommaire
1 Introduction
1.1 Argumenter: par oral ou par écrit ?
1.2 Artefacts technologiques soutenant la production collective d'une argumentation
1.3 Peut-on apprendre en argumentant ? Peut-on apprendre à argumenter ?
2 Définition et enjeux
2.1 L'argumentation dans l'apprentissage des sciences
2.2 Point de vue psycholinguistique
2.3 Les théories de l'argumentation - le modèle de Toulmin
3 Recherches récentes
3.1 Application du modèle de Toulmin par Erduran, Simon et Osborne
3.2 Schwartz, Neumann, Gil et Ilya (2003)
3.3 Clark et Sampson (2007)
3.4 Kuhn et Udell (2003)
Evaluer l'argumentation — EduTech Wiki
http://edutechwiki.unige.ch/fr/Evaluer_l'argumentation
1 sur 11 08/03/2017 10:40

Principle Maker est un des outils d'étayage proposé dans
l'environnement WISE. Son principe est de proposer des phrases sous
forme de menus déroulants avec lesquelles l'élève construit des
affirmations structurées par des faits
3.5 De Vries, Lund et Baker (2002)
3.6 Jimenez, Alexandre & al. (2000)
3.7 Zohar et Nemet (2002)
3.8 Lawson (2002)
3.9 Duschl (2007)
3.10 Leitao (2000)
4 Implication pour l'enseignement et l'apprentissage
5 Conclusion
6 Références
7 Weblio-Biblio
7.1 L'argumentation à l'école
7.2 Argumentation et artefact technologique
1 Introduction
1.1 Argumenter: par oral ou par écrit ?
L'argumentation est la manière de présenter et de disposer les arguments ; le terme désigne aussi l'ensemble
des arguments qui résulte de cette présentation [1]. L'argumentation est fondamentalement un dialogue,
puisqu'il s'agit de faire accepter à une autre personne ou une communauté ses idées. Très tôt dans la scolarité,
les enfants se montrent capable d'argumenter et de défendre oralement leur point de vue. La présence de
l"autre", en face, allège fortement le travail de production d'argument et de contre-argument. La capacité de
développer une argumentation écrite, qui s'effectue dans le cadre de l'apprentissage de la langue première, est
beaucoup plus longue à s'installer. [2]. Plusieurs études menées à l'école secondaire relèvent la difficulté que
rencontrent les élèves dans la rédaction de textes argumentatifs. On observe :
pas ou peu de contre-arguments (les contre-arguments apparaissent vers 13-14 ans)
une développement limités de leur propres arguments
une dépersonnalisation des arguments (j'aime, ...) qui n'intervient que progressivement.
La transition de l'argumentation orale et collective vers l'argumentation écrite individuelle (parfois assimilée à
tort avec une démonstration) n'a rien de naturelle et demande une grande attention de la part des enseignants.
1.2 Artefacts technologiques soutenant la production collective d'une argumentation
Il existe une large palette d'outils
synchrone et asynchrone
(http://edutechwiki.unige.ch
/en/Computer-supported_argumentation)
pour soutenir des étudiants engagés dans
un dialogue argumentatif. Ces outils
cognitifs ont comme point commun
d'enrichir et d'organiser ce que C. Golder
nomme l'espace de production du
discours argumentatif et d'apporter des
avantages spécifiques que Clark et
Sampson (2007)[3] présentent ainsi:
Les outils de communication
asynchrone du type forum, qui
permettent une participation plus
Evaluer l'argumentation — EduTech Wiki
http://edutechwiki.unige.ch/fr/Evaluer_l'argumentation
2 sur 11 08/03/2017 10:40

équitable, et offre plus de temps pour poser les idées et élaborer les arguments
Les outils de communication synchrones, qui permettent un engagement collaboratif plus intense, offre
une meilleure aide à une construction conjointe, mais à le désavantage d'engendrer plus de pression sur
les participants
Les wikis et les outils de production collaborative de cartes conceptuelles, qui facilitent la comparaison
et l'élaboration fine des arguments et leur juxtaposition.
Les environnements d'informations enrichi (par ex BSD), très utiles lorsque le contenu du domaine est
moins bien maitrisé.
Les scripts et outils d"awarness", qui proposent des feedback rapides aux participants.
1.3 Peut-on apprendre en argumentant ? Peut-on apprendre à argumenter ?
L'évaluation d'une production argumentative collective nécessite de distinguer la qualité de l'argumentation
(en terme de structure et de processus) et la qualité des arguments par rapport à l'espace référentiel (le
contenu est-il pertinent ? recevable ?). Le présent article expose quelques modèles d'évaluation récents
appliqués à des argumentations produites collectivement et sur des questions d'ordres scientifiques. Ces
modèles diffèrent selon leur points de vue et l'importance qu'ils donnent tantôt à la structure, au processus ou
la rigueur dans le respect du contenu scientifique. En situation d'apprentissage, le processus en jeu est plus
intéressant que le produit. Sampson et Clark[4] relèvent les questions auxquelles les chercheurs tente de
répondre en développant leurs modèles d'évaluation:
Des personnes non scientifiques sont-elles en mesure de produire une argumentation justifiant ou
réfutant une interprétation d'un phénomène naturel ?
En quoi le processus et le produit développé par ces personnes diffèrent-ils de l'idéal scientifique ?
Les étudiants sont-ils en mesure d'assimiler par un enseignement la pratique de l'argumentation propre
à la communauté scientifique ?
Un auteur comme Baker considère la pratique du dialogue comme un processus d'apprentissage. Il développe
des interfaces spécifiques pour structurer l'activité d'argumentation (C Chene, Damocles, DREW). Cette
structuration de l'interface vise à favoriser l’émergence d’interactions épistémiques sur des notions
scientifiques. Les interactions sont considérées comme les traces de la construction même des connaissances
(Baker 2002, 2004).
Baker observe cependant que la stabilité dans l'argumentation n'est pas atteignable si les savoirs sont en
construction. Ainsi, il affirme : "Il peut paraître trop ambitieux d’exiger de l’argumentation qu’elle suffise à
elle seule à susciter la co-construction de concepts scientifiques; elle est davantage un moyen de
développer l’esprit critique, pour en définitive améliorer la compréhension du problème posé[5]". On peut
l'associer à ce que les didacticien francophone nomme la dévolution du problème.
2 Définition et enjeux
2.1 L'argumentation dans l'apprentissage des sciences
La pratique de l'argumentation dans l'enseignement des sciences revêt une importance particulière :
Elle remplit une fonction épistémique lié à au mode de production du savoir scientifique; la
communauté scientifique est familière des controverses où l'on invoque des raisons pour ou contre une
thèse, on présente les arguments favorables (justification) ou qui nous font rejeter la thèse (réfutation).
Elle est au service de la construction et la structuration des connaissances; selon Leitão[6] elle
augmente la compréhension profonde des concepts. Pour Baker, elle améliore la capacité à produire
des raisonnements. La capacité de produire une argumentation convaincante reliant faits et théories
pour défendre ou réfuter un point de vue est un élément essentiel. Dans un scénario pédagogique
comme une enquête scientifique, l'argumentation met en jeu des processus que M.C. Linn [7] décrit
Evaluer l'argumentation — EduTech Wiki
http://edutechwiki.unige.ch/fr/Evaluer_l'argumentation
3 sur 11 08/03/2017 10:40

ainsi :
l'identification des idées et des preuves à propos d'un phénomène;1. la construction un point de vue et son étayage avec des faits et des preuves;2. l'évaluation de la pertinence d'un point de vue selon divers critères;3. la révision d'un point de vue, suite à l'introduction de nouveaux faits.4.
La pertinence des faits et des preuves est déterminée ici en référence aux savoirs scientifiques partagés. La
nature des situations proposées influent fortement sur le processus de production et l'engagement des
protagonistes. Il nous parait intéressant de distinguer deux catégories proposées par C. Plantin [8] :
l' argumentation en situation de problème, qui est tournée vers le consensus pour élaborer une solution
acceptable, où tous les participants à l'interaction ont intérêt à dégager la solution ou la décision
optimale; La réponse-conclusion préexistant à l'échange, qui a simplement pour fonction de le publier.
On rattachera par exemple les situations d'interprétation d'une expérience ou d'un phénomène
naturelle.
l' argumentation en situations de conflit, sur des intérêts antagonistes, dans lequel les contradictions
peuvent être radicales et les questions n'ont pas de solutions acceptables par tous les protagonistes. On
y rattachera le débat argumentatif autour d'une controverse scientifique ou une polémique socio-
scientifique.
Moins fréquente, il y a des situations de production argumentative individuelle, souvent lié à une situation de
contrôle de la maitrise d'un champ de connaissance particulier et où le dialogue est intériorisé. Cependant, il
ne faut pas négliger le fait que des études comparatives internationales comme TIMSS (Third International
Mathematics and Science Study) ou PISA développe un modèle qui, sans jamais évoquer le terme
d'argumentation, évalue la culture scientifique ("science litteracy") qu'elle définie de manière très
proche.(PISA 2006)[9] : "Les connaissances scientifiques de l’individu et sa capacité d’utiliser ces
connaissances pour identifier les questions auxquelles la science peut apporter une réponse, pour acquérir
de nouvelles connaissances, pour expliquer des phénomènes scientifiques et pour tirer des conclusions
fondées sur des faits à propos de questions à caractère scientifique"
2.2 Point de vue psycholinguistique
C. Golder [10] identifie plusieurs composantes fondamentales dans la production d'un discours argumentatif :
la justification dont la maitrise ne peut être évaluée qu'à travers le contenu des énoncés. Cela renvoie
en particulier à la recevabilité des arguments. Produire une argumentation valable implique un effort
d’explication de la source (adaptation à l'interlocuteur visé) et - particulièrement en science - un
respect de la normalité scientifique (pour l'enseignant ou en terme de respect du document source).
la négociation , qu'elle défini comme la nécessité de prendre ses distances vis-à-vis de son propre
discours pour pouvoir articuler arguments et contre-arguments. Cela implique d'avoir une certaine
connaissance du domaine débattu. Un manque de connaissances dans le domaine spécifique du
problème abordé influence négativement cette capacité de négociation. Des stratégies pédagogiques
existe pour pallier à cela. Elles consistent à enrichir et structurer les connaissances du domaine, par
exemple par un débat en classe, et l'élaboration et la structuration d'une liste d'arguments. Ce qui se fait
parfois aisément à l'oral devient difficile à l'écriture, où il est nécessaire de se représenter la position du
destinataire pour mettre en valeur ses propres arguments.
Le processus de planification de l'écriture. Il existe un espace rhétorique au sein duquel plusieurs
problèmes se combinent : a) quoi dire ? b) comment le dire ? face à cela, il existe diverses stratégies
d'écriture plus ou moins "coûteuse". Scardamalia et Bereiter en définissent deux pôles, qu'ils nomment
la stratégie du knowledge telling qui amène le scripteur novice à produire une liste d'arguments et la
stratégie du knowledge transforming propre au scripteur expert qui parvient à articuler, confronter et
hiérarchiser les arguments et contre-arguments.
2.3 Les théories de l'argumentation - le modèle de Toulmin
Evaluer l'argumentation — EduTech Wiki
http://edutechwiki.unige.ch/fr/Evaluer_l'argumentation
4 sur 11 08/03/2017 10:40

Le modèle de Toulmin, illustré par un exemple d'argumentation à
propos du danger que représente la consommation de cigarettes
Toulmin
[11]
a proposé un modèle de l'argumentation qui prend ses distances avec la logique mathématique
manipulant des idéaux et replace l'argumentation dans le contexte d'un usage naturelle de la langue. Ce
modèle sert de fondement à la grande majorité des cadres d'évaluation destiné à juger de la qualité d'une
argumentation dans l'enseignement.
Toulmin propose de rattacher tout
élément d'une argumentation (orale ou
écrite) à une parmi 6 composantes
possible. Trois d'entre-elles forment
l'ossature minimale [12] :
les données (data ou ground) qui
constitue en quelque sorte les
"preuves" qui fondent la
conclusion
les garanties (warrants) qui
explicite le lien entre les données
et la conclusion. C’est le lieu de la
justification. Elles sont parfois implicites.
la conclusion (claims) , affirmation de ce que l'on estime vrai
Trois autres composantes ne sont pas toujours présentes. Elles consolident et étayent l'argumentation. Ce
sont :
les modalités (qualifiers) qui précisent les conditions particulières à respecter pour que la conclusion
soit vrai;
les restrictions (rebuttals) qui signale les exceptions éventuelles;
les fondements (backings) constitue la « structure profonde » du raisonnement. Ce sont des références
à des textes et des savoirs reconnus.
Toulmin précise que le contexte détermine quelles composantes est structurellement nécessaire à un moment
donné. Il précise que son modèle ne dit rien sur la qualité de chaque composante, qui dépend du domaine. Le
recours à ce modèle ne permet donc pas de juger de la qualité de l'argumentation sous l'angle du contenu. Sa
force dans sa capacité de définir des invariants dans l'argumentation quel que soit le domaine de
connaissance impliqué. Le modèle de Toulmin va servir de modèle prescriptif dans de nombreux
environnements asynchrone, sous une forme parfois simplifiée, afin d'aider les apprenants à structurer et
enrichir leur argumentation. C. Plantin (2005) considère que la proposition de Toulmin est plus approprié à un
monologue qu'à un véritable dialogue argumentatif, bien que la présence des modalités et des restrictions
apporte des éléments propre au dialogue.
Appliqués à l'évaluation, plusieurs auteurs relèvent la difficulté de distinguer si un énoncé est une donnée,
une conclusion ou une garantie, ce qui se traduit par un manque d'accord inter-juge. Walton (1989)[13]
souligne qu'analyser le discours argumentatif en langage naturel au sujet d'une controverse implique pour le
chercheur de faire face à certains problèmes :
il doit être capable de faire face à l'imprécision et ambiguïté de la langue. Le chercheur doit être prêt à
percer la ligne principale d'un argument soutenu durant des échanges prolongés entre deux ou plusieurs
personnes. Walton souligne qu'un argument doit être considéré comme une construction au sein d'un
dialogue interactif de deux (ou parfois plus) de personnes raisonnant ensemble;
il propose de distinguer au sein des dialogues un côté "claire", constitué par l'ensemble des propositions
connues, vues, partagée par tous les participants et un côté "sombre" constitué par l'ensemble de
propositions non connu, non visibles, de certains ou de tous les participants, qui représente les
engagements implicites.
Evaluer l'argumentation — EduTech Wiki
http://edutechwiki.unige.ch/fr/Evaluer_l'argumentation
5 sur 11 08/03/2017 10:40
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%