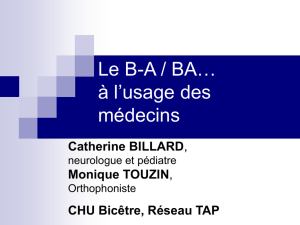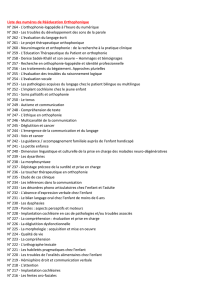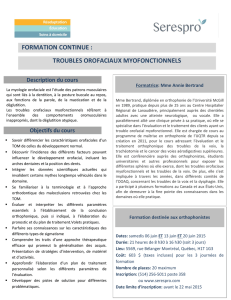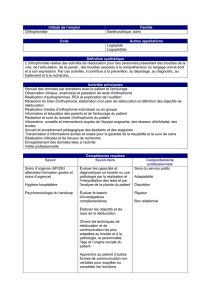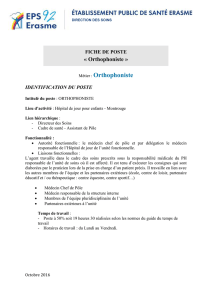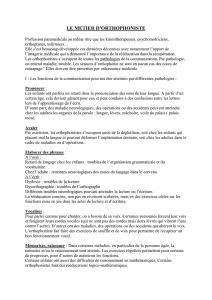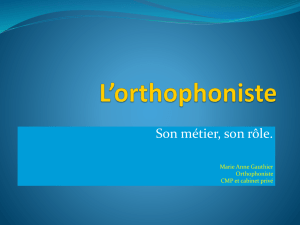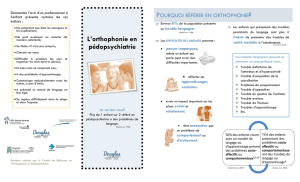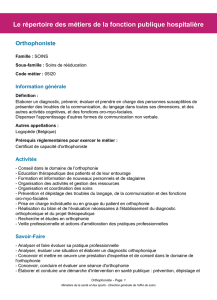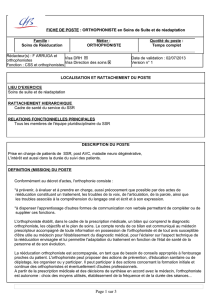Recherche en orthophonie-logopédie et identité professionnelle
Telechargé par
leanounette

erch
on, appro
ques, orthop
données
ve, analyse
mandation p
clinique, effi
ntion, thérap
épistémologi
sés, éthique,
récision
des
recherche, clinique, évalua-
tion, approches thérapeuti-
ques, orthophonie, modè-
les, données probantes,
preuve, analyse critique,
recommandation pour la
pratique clinique, efficacité
de l’intervention, thérapeu-
te, attitude, épistémologie,
savoirs spécialisés, éthique,
responsabilité, précision et
incertitude, méthodes et
Fédération Nationale des Orthophonistes
52eAnnée
mars 2014
Trimestriel
N° 257
Fondatrice : Suzanne BOREL-MAISONNY
ISSN 0034-222X
Rééducation Orthophonique Recherche en orthophonie-logopédie et identité professionnelle N° 257 - 2014
Rééducation
Orthophonique
Rencontres
Données actuelles
Examens et interventions
Perspectives
Recherche
en orthophonie-logopédie
et identité professionnelle
Couv 257_Mise en page 1 26/03/14 15:00 Page1
©ORTHO EDITION 2014

Revue éditée par la Fédération
Nationale des Orthophonistes
Rédaction - Administration :
76, rue Jean Jaurès, 62330
ISBERGUES
—
Tél. : 03 21 61 94 96
—
—
Fax : 03 21 61 94 95
—
Membres fondateurs du comité de lecture :
Pr ALLIERES • A. APPAIX • S. BOREL-MAISONNY
G. DECROIX • R. DIATKINE • H. DUCHÊNE
M. DUGAS • J. FAVEZ-BOUTONNIER • J. GERAUD
R. GRIMAUD • L. HUSSON • Cl. KOHLER • Cl. LAUNAY
F. LHERMITTE • L. MICHAUX • P. PETIT
G. PORTMANN • M. PORTMANN • B. VALLANCIEN.
Réalisation TORI
01 43 46 92 92
Impression : CIA Bourgogne
Comité scientifique
Aline d’ALBOY
Dr Guy CORNUT
Ghislaine COUTURE
Dominique CRUNELLE
Pierre FERRAND
Lya GACHES
Olivier HERAL
Jany LAMBERT
Frédéric MARTIN
Alain MENISSIER
Pr Marie-Christine MOUREN-SIMEONI
Bernard ROUBEAU
Anne-Marie SIMON
Monique TOUZIN
Rédacteur en chef
Jacques ROUSTIT
Secrétariat de rédaction
Marie-Dominique LASSERRE
Abonnements
Sylvie TRIPENNE
Revue créée par l’A.R.P.L.O.E.V.
Paris
Directeur de la publication : la Présidente de la F.N.O. :
Anne Dehêtre
Abonnement normal : 104 euros
Abonnement réduit : 81 euros
réservé aux adhérents F.N.O.,
ou d’une association européenne
membre du CPLOL
Abonnement étudiant : 54 euros
(joindre copie de la carte)
Abonnement étudiant étranger : 5
8
euros
(joindre copie de la carte d’étudiant)
Abonnement étranger : 114 euros
Vente au numéro disponible
sur le site www.orthoedition.com
Commission paritaire : 1110 G 82026
DERNIERS NUMÉROS PARUS
N° 254:LE TONUS - Editorial : Anne Menin-Sicard — Rencontre : Entretien avec Raymond D. Kent, (Raymond
D. KENT) —Données Actuelles : Bilan instrumental de la dysphonie, (Alain GHIO) - Le Phonétogramme :
le champ de liberté vocal, (Bernard ROUBEAU) - Implémentation dans VOCALAB d’indicateurs objectifs de
la qualité de la voix dans le cadre de l’évaluation de la voix, (Etienne SICARD, Anne MENIN-SICARD) -
Bilan orthophonique et bilan phoniatrique : redondance ou complémentarité, (Philippe BÉTRANCOURT) —
Examen et interventions : L’évaluation de la voix : la spécificité du Québec, (Martin FOREST, Julie
FORTIER-BLANC, Annie BERTRAND) - La charge vocale, (Dominique MORSOMME, Angélique
REMACLE) - La voix en images : comment l’évaluation objectivée par logiciel permet d’optimiser la prise
en charge vocale, (Stéphanie PERRIÈRE) - Approche métacognitive dans le cadre de l’évaluation et la rééva-
luation de la voix, (Anne MENIN-SICARD) - Echelles d’auto évaluation des troubles vocaux et qualité de
vie, (Michèle PUECH) - L’évaluation perceptive des dysphonies, (Joana REVIS) - Evaluation clinique de la
voix en orthophonie : E.C.V.O, (Arlette OSTA) - Le bilan vocal de l’orthophoniste : écouter et entendre afin
de mieux s’adapter, (Carine KLEIN-DALLANT) - Voix et techniques manuelles en orthophonie, (Jean-Blaise
ROCH, Alain PIRON, Florence BALDY-MOULINIER) - L’évaluation vocale des patients dysarthriques,
(Véronique ROLLAND-MONNOURY) - Le bilan vocal dans le cadre de la cancérologie ORL, (Jean-Claude
FARENC) - Voix chantée et langues parlées : un bilan de la phonation spécifique ? (Claire PILLOT-
LOISEAU) — Perspectives : L'utilisation du portrait de phase dans l'évaluation vocale : un outil objectif
d'analyse qualitative, (Sébastien CHRISTIAN) - Prévention des troubles de la voix chez les professionnels
« de la voix » et le cas particulier des enseignants, (Agnès VÉRON) - La gestion tonique : jeu de pistes pour
rééduquer le dysphonique, (Gisèle MARTINOT-RANDOUX) - Le contrat thérapeutique en rééducation
vocale. Regard éthique, (Mireille KERLAN)
N° 255:L'ÉVALUATION DES TROUBLES DU RAISONNEMENT LOGIQUE - Editorial : Marie-Paule
LEGEAY — Données Actuelles : L’abstraction réfléchissante : une spécificité des mathématiques ?, (Jean-
Paul FISCHER) - Liens entre la compréhension morphosyntaxique et le raisonnement logique : exploitation
des réponses au TCS dans le cadre d’un bilan logico-mathématique, (Christine MAEDER) - Pertinence de la
présence d’épreuves de logique en complément du bilan du langage écrit : données de la littérature et cas
d’enfant, (Odile MIJEON) —Rencontre : Intérêt du bilan logico-mathématique pour le pédopsychiatre, (Luc
CHAUDOYE) - Marine, Adrien, moi et les autres, (Gaëlle PINGAULT-FERRAND) — Examen et interven-
tions : Le bilan ERLA : Exploration du Raisonnement et du Langage Associé, (Marie-Paule LEGEAY, Lydie
MOREL, Martine VOYE) - Une exploration du fonctionnement de pensée d’enfants en CMPP : outils aty-
piques, aide aux projets de soin, (Viviane DURAND) - Conduites verbales et cognitives de plusieurs enfants
lors d'une épreuve de conservation de la substance de façon à expliciter les concepts de figurativité et d'opé-
rativité, (Céline CARREL) - L’Épreuve des Dichotomies : analyses du Classer, (Marie-Paule LEGEAY) -
Observation de l’adolescent : apport de l’analyse des conduites langagières, (Barbara BELLOT, Clémantine
TRINQUESSE) - Épreuves de sériations : analyse du fonctionnement de pensée et orientation thérapeutique
en orthophonie, (Martine VOYE, Emeline FREY, Mélanie GUÉRIN) - Évaluer les conservations chez l’en-
fant sourd à partir de l’adaptation en LSF du protocole piagétien de l’entretien clinique. Comment est éla-
borée la contre-suggestion d’une épreuve de conservation des longueurs ? (Martine BATT, Juliette
LAMBERT, Pauline PIERREL, Lydie MOREL, Alain TROGNON) - Approche logico-mathématique chez les
adultes cérébrolésés : une perspective complémentaire, (Louise GENDRE-GRENIER, Catherine
VAILLANDE) — Perspectives : Le bilan ERLA : ouverture vers des questions concernant l’accès à la sym-
bolisation et la construction de sens, (Lydie MOREL)
N° 256:LES TRAITEMENTS DU BÉGAIEMENT. APPROCHES PLURIELLES - Editorial : Les traitements
du bégaiement, approches plurielles. Quelles options de traitement et pour quels patients ? (Véronique
AUMONT BOUCAND) — Rencontre : A la découverte du Centre de la Fluidité Verbale de Montréal, (Laure
DRUTEL) - Maman et orthophoniste : ma petite fille bégaie ! A l’aide ! Témoignage et éloge de l’orthopho-
nie française associée au programme Lidcombe, (Johanne CAVÉ) — Examen et interventions : Le
Programme Camperdown pour les adultes et adolescents souffrant de bégaiement, (Sue O’BRIAN, Brenda
CAREY) - La fleur de soi, un outil thérapeutique, ou comment valoriser les qualités de la personne qui
bégaie, restaurer une image de soi altérée par le bégaiement ? (Sylvie BRIGNONE-RAULIN) - Thérapie
d’Acceptation et d’Engagement et Bégaiement, (Juliette DE CHASSEY) - La Re-Conquête de soi, (Alain
LANCELOT, Marie-Pierre POULAT) - Qu'est-ce que le bredouillement ? Pistes pour l'intervention orthopho-
nique, (Yvonne VAN ZAALEN, Isabella K. REICHEL) - L’humour à usage thérapeutique dans la thérapie
du bégaiement, (Patricia OKSENBERG) - La technologie : une alternative valable pour les personnes qui
bégaient ? (Maria D. HARGROVE) - Utilité d’un outil technique dans la thérapie du bégaiement, (Véronique
STUYVAERT) - L’abord médical du bégaiement, (Marie-Claude MONFRAIS-PFAUWADEL) - Les stages théra-
peutiques intensifs, (Véronique SOUFFRONT) - Programme complet de prise en charge du bégaiement. Prise
en charge d’adultes et d’adolescents : ISTAR Programme complet, (Marilyn LANGEVIN, Deborah KULLY)
Couv 257_Mise en page 1 26/03/14 15:00 Page2
©ORTHO EDITION 2014

1
Recherche en orthophonie-logopédie et identité professionnelle
Sommaire mars 2014 N° 257
Rééducation Orthophonique
Ce numéro est dirigé par Agnès Witko, Orthophoniste, MCU en Sciences du langage
14/#65&'.#4'%*'4%*''0146*12*10+' 57
Thierry Rousseau, Orthophoniste, Docteur en psychologie – HDR, Président de
l’Unadréo – Directeur du Lurco, Peggy Gatignol, Orthophoniste, Docteur en neuroscien-
ces- HDR, Directeur de recherches Lurco, Sylvia Topouzkhanian, Orthophoniste, Docteur
en sciences du langage, Directrice adjointe du Lurco, Sablé sur Sarthe
H'8+&'0%'$#5'&24#%6+%'>2146@'&'5146*12*10+56'5
+06@4B6&'54'%1//#0+1052174.#24#6+37'%.+0+37' 71
Christelle Maillart, Professeur, Université de Liège,
Nancy Durieux, Responsable scientifique à la Bibliothèque des Sciences de la Vie
et doctorante en sciences médicales, Université de Liège
%+'0%'5+0(+4/+A4'5&+5%+2.+0#4+5#6+10'6+06'4&+5%+2.+0#4+6@ 83
Monique Rothan-Tondeur, RN, PhD,
Titulaire de la chaire Recherche Infirmière AP-HP EHESP, Paris,
Chantal Eymard, Enseignant-chercheur à l’université d’Aix-Marseille
H#0#.:5'&'.#.+66@4#674'$+1/@&+%#.'
2174+&'06+(+'4.'524'78'5'624'0&4'&'5&@%+5+105 101
Hervé Maisonneuve, Professeur associé, santé publique,
Consultant en rédaction scientifique, Paris
'%*'4%*''6(14/#6+10+0+6+#.'&'5146*12*10+56'5
0%1/26'4'0&7&H'92@4+'0%''0%106'96'70+8'45+6#+4'(4#0?#+5 113
Agnès Witko, Maître de conférence en sciences du langage,
Orthophoniste, Université Claude Bernard Lyon 1
'%*'4%*''0146*12*10+'.1)12@&+''6+&'06+6@241('55+100'..'
Agnès Witko, Orthophoniste, MCU, Lyon 3
06@/1+)0#)'F74'56#74#06%*+01+5 15
Pierre Ferrand, Orthophoniste, Roquecourbe
06@4B6&'.#4'%*'4%*'2174.#%.+0+37''68+%'8'45#.+0+37'→'%*'4%*'→.+0+37'
→'%*'4%*'F:/26D/'5→1&@.+5#6+105→:/26D/'5→1&@.+5#6+105F 21
Jean-Luc Nespoulous, Professeur neuropsycholinguiste,
Département des Sciences du Langage, Université de Toulouse Le Mirail
'%*'4%*''624#6+37'241('55+100'..'&'.H146*12*10+' 35
Marc Monfort, Logopède, Directeur du centre Entender y Hablar,
Adoración Júarez Sánchez, Logopède, Docteur en psychologie, Directrice de l’école Tres
Olivos, Isabelle Monfort Júarez, Psychologue, Madrid
#37'56+10&'5#224'06+55#)'50'#4&'06'1$.+)#6+10 47
Michel Fayol, Professeur émérite, Université Blaise Pascal et CNRS, Clermont-Ferrand
'%*'4%*''0146*12*10+'.1)12@&+''6+&'06+6@241('55+100'..'
.@/'065&'%#&4'574.#4'%*'4%*'
texte 257_Mise en page 03/06/14 14:39 Page1
©ORTHO EDITION 2014

2
'%*'4%*''624#6+37'%.+0+37''0146*12*10+'
&764#05('46>.H@%*#0)'&'%100#+55#0%'5 131
Yves Joanette, PhD, Centre de recherche, Institut universitaire de gériatrie de Montréal,
Perrine Ferré, MPO, Hélène Côté, MPO, Centre de recherche, Institut universitaire de gériatrie
de Montréal, Hôpital de réadaptation Villa Medica, École d’orthophonie et d’audiologie, Montréal
@/#4%*'&'8#.++10&H70'#2241%*'4@##6+8'
&'.#%1//70+%#6+10.H#2*#5+'5@8A4'2*4%#2*#%1/ 143
Isabelle Gonzalez, Orthophoniste, Sarah Marchetti, Orthophoniste, Talence, Hervé Petit,
MPR, Bordeaux, Nelly Munier, Psychomotricienne, Cadre de santé, Bordeaux,
Pierre-Alain Joseph, Professeur MPR, CHU Bordeaux
1//'06#0#.:5'4.#81+9*7/#+0'.#2#41.''6.'%*#06
'5176+.55%+'06+(+37'5'6/@6*1&'5&'.#4'%*'4%*'(10&#/'06#.'>&+5215+6+10
&'.#4'%*'4%*'%.+0+37'574.#81+9'6.'745+/2.+%#6+105'0146*12*10+' 155
Nathalie Henrich Bernardoni, Docteur en Acoustique, Chercheure CNRS en Sciences de
la Voix, Audrey Acher, Orthophoniste, Doctorante en Sciences Cognitives, Saint Martin d’Hères
105647%6+10&H70'$#5'&'&100@'5&'81+9
+06@4B62174.#4'%*'4%*''0146*12*10+''6.'2#46#)'&'24#6+37'5 177
Etienne Sicard, Professeur, Directeur de Recherches au LURCO, INSA/GEI, Toulouse,
Anne Menin-Sicard, Orthophoniste, Master en Sciences du Langage, Chercheur associée au
LURCO, Toulouse, Stéphanie Perrière, Orthophoniste, Chercheur associée au LURCO, Nice
'%*'4%*'%.+0+37''0146*12*10+'%1//'06.#%.+0+37'
&'56417$.'5&7.#0)#)'@%4+68+'06$175%7.'4.'5/1&A.'56*@14+37'5 203
Sylvie Raynaud, Orthophoniste, Docteur en psychologie, Chargée d’enseignement
Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand, Aubière
221465'6.+/+6'5&'.#4'%*'4%*'5%+'06+(+37'
#764#+6'/'06&'.#&:5.'9+''024#6+37'%.+0+37' 221
Gilles Leloup, Orthophoniste, Docteur en sciences du langage, Neuilly sur Seine
+'05'064'%.+0+37''64'%*'4%*'
H146*12*10+''6.#4'%*'4%*' 235
Marine Verdurand, Orthophoniste, Doctorante en Sciences du langage, Membre
du LURCO, GIPSA-Lab, UMR 5216, St Martin d’Hères, Anne Siccardi, Orthophoniste,
Doctorante en Sciences du langage, Lidilem, Université Stendhal Grenoble III
'.#24#6+37'146*12*10+37'>.#0#+55#0%'&H70'&+5%+2.+0'&'4'%*'4%*'
0,'79'6%10(.+65'04'%*'4%*'%.+0+37' 243
Laura Alaria, Orthophoniste, Assistante-Doctorante en logopédie, Université
de Genève – FPSE, Jean-Laurent Astier, Orthophoniste, Chargé de cours Université
Claude Bernard Lyon 1, Doctorant en Logopédie, Université de Genève
'&+4'21745'(#+4'@81.76+10'6'0,'79&'5&+5%1745241('55+100'.5
.#%105647%6+10&7%*#/2146*12*10+37' 255
Marie Sautier, Lycée international de Boston, Cambridge, USA, Renaud Perdrix,
Orthophoniste, Chef de service paramédical, Vaulx en Velin, Nicolas Guilhot,
Maître de conférences en sciences de gestion - Docteur en histoire des sciences, Lyon
41('55+10178'4674'52'452'%6+8'5
texte 257_Mise en page 03/06/14 14:39 Page2
©ORTHO EDITION 2014

33
Rééducation Orthophonique - N° 257 - mars 2014
Science de la réhabilitation langagière ou science orthophonique ? Disci-
pline paramédicale composite ou hybride ? Art ou technique ? Thérapeutique
intégrée à des sphères telles que le neuro-cognitif, le psycho-affectif et le socio-
culturel ? Autant de questions qui sont d'actualité pour interroger les liens et
passerelles entre la recherche sur la pathologie du langage et l'identité profes-
sionnelle des orthophonistes, logopèdes et logopédistes, trois titres équivalents
dans l'espace européen et international francophone, représentés dans cet
ouvrage par les communautés espagnole, belge, canadienne, suisse et française.
En participant au vaste projet de soigner l'humain, l'orthophonie s'inscrit
aujourd'hui dans trois paradigmes : la santé, le handicap et le langage. Cette tri-
ple affiliation oriente la réflexion sur l'identité professionnelle des thérapeutes
du langage sur plusieurs questions : (1) quelles sont les représentations sur l'or-
thophonie en tant que profession de santé publique ? Les réponses émergeront
en interne, du côté des orthophonistes eux-mêmes, de leurs partenaires de soin
et des professions connexes à l'orthophonie, et en externe de la part du monde
profane des patients et des associations de la société civile ; (2) quelle expertise
relative au langage, sain ou pathologique, se développe aujourd'hui ? Si l'on
considère celui-ci, comme un objet et un moyen d'apprentissage privilégié chez
l'homme, un moteur d'épanouissement humain relatif à sa dimension communi-
cationnelle, et un vecteur identitaire du fait des nombreuses langues qui maté-
rialisent le symbolisme verbal, une bonne santé mentale s'appuie à l'évidence
sur un substrat langagier soumis à des conditions environnementales ; (3) quels
)0A5!+6-1
Maître de conférence
Orthophoniste
Département d'orthophonie
Institut des sciences et techniques de la réadaptation
Université Claude Bernard Lyon 1
Adresse postale
UCBL - ISTR - Département d'Orthophonie
8, avenue Rockefeller
69373 Lyon cedex 08
Courriel : [email protected]
Recherche en orthophonie-logopédie et identité
professionnelle
texte 257_Mise en page 03/06/14 14:39 Page3
©ORTHO EDITION 2014
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
 185
185
 186
186
 187
187
 188
188
 189
189
 190
190
 191
191
 192
192
 193
193
 194
194
 195
195
 196
196
 197
197
 198
198
 199
199
 200
200
 201
201
 202
202
 203
203
 204
204
 205
205
 206
206
 207
207
 208
208
 209
209
 210
210
 211
211
 212
212
 213
213
 214
214
 215
215
 216
216
 217
217
 218
218
 219
219
 220
220
 221
221
 222
222
 223
223
 224
224
 225
225
 226
226
 227
227
 228
228
 229
229
 230
230
 231
231
 232
232
 233
233
 234
234
 235
235
 236
236
 237
237
 238
238
 239
239
 240
240
 241
241
 242
242
 243
243
 244
244
 245
245
 246
246
 247
247
 248
248
 249
249
 250
250
 251
251
 252
252
 253
253
 254
254
 255
255
 256
256
 257
257
 258
258
 259
259
 260
260
 261
261
 262
262
 263
263
 264
264
 265
265
 266
266
 267
267
 268
268
 269
269
 270
270
 271
271
 272
272
 273
273
 274
274
 275
275
 276
276
 277
277
 278
278
 279
279
 280
280
 281
281
 282
282
 283
283
 284
284
 285
285
 286
286
1
/
286
100%