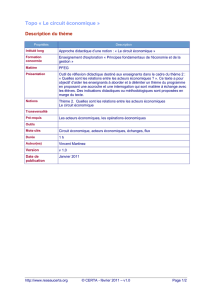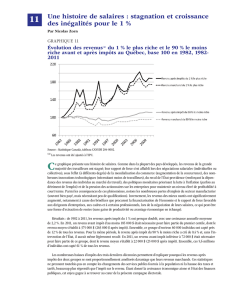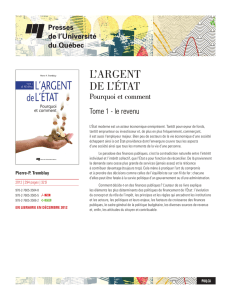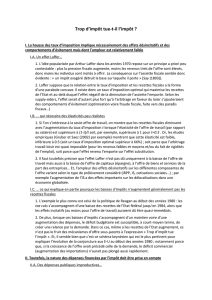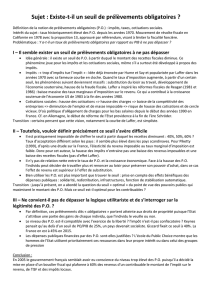ArnaudParienty
Lemythe
dela«théorie
duruissellement»
2018

Présentation
EmmanuelMacron,15octobre2017:«Pourquenotresociétéaillemieux,ilfautdesgensquiréussissent![…]Je
necroispasauruissellement,maisjecroisàlacordée.[…]Sil’oncommenceàjeterdescaillouxsurlespremiersde
cordée,c’esttoutelacordéequidégringole.»Le6janvier2018,leporte-paroledugouvernementenfonceleclou:
«Cen’estpasungouvernementquifaitdescadeauxauxriches!C’estungouvernementquipermetàl’argentd’être
investidanslesentreprisespournosemploisenFrance.»Unrésumésaisissantdelanotiondetrickle-downeffect
(effet de ruissellement) avancée en 1981 par le directeur du budget de Ronald Reagan : « Donner les réductions
d’impôtsauxtranchessupérieures,auxindividuslesplusrichesetauxplusgrandesentreprises,etlaisserlesbons
effets“ruisseler”àtraversl’économiepouratteindretoutlemonde.»
Tellesemble bien lalogique desmesures adoptées depuis 2017 par le gouvernement Macron/Philippe, même s’il
affirme le contraire. Et même si aucun économiste n’a jamais produit une « théorie du ruissellement ». Alors
commentexpliquerquecetteidéesidécriéesoitencoremiseenoeuvre?Enanalysantsonfonctionnementcomme
celuid’unmythe,c’est-à-direuneconstructionimaginairelargementpartagée.C’estcequeproposeArnaudParienty
danscetessaienlevéetpédagogique.Ilydécortiqueavecméthodelesclichésrépétéssurlesplateauxdetélévision:
«tropd’impôtstuel’impôt»,ilsfavorisentl’évasionfiscale,etc.Etilremetenperspectivelafaçondontlespolitiques
néolibérales ont conduit, partout dans le monde, à une explosion des inégalités, sans pour autant favoriser la
croissanceetl’emploi,contrairementàcequeprônentlesadeptesduruissellement.
Pourensavoirplus…
L’auteur
ArnaudParienty,diplômédeSciencesPoParis,estprofesseuragrégédescienceséconomiquesetsociales.Ilest
l’auteur de nombreux ouvrages, manuels et articles de vulgarisation, et, à La Découverte, de School Business.
Commentl’argentdynamitelesystèmeéducatif(2015)etdePrécisd’économie(2017).
Collection
Cahierslibres

DUMÊMEAUTEUR
Productivité,croissance,emploi,laFrancedanslacompétitionmondiale,ArmandColin,coll.«Circa»,2005.
Protectionsociale,ledéfi,Gallimard,coll.«Folio»,2006.
SchoolBusiness.Commentl’argentdynamitelesystèmeéducatif,LaDécouverte,2015,2018.
Précisd’économie.Préparationauxépreuvesd’économiedesconcours,LaDécouverte,2017.

Copyright
L’éditiondecetouvrageaétéassuréeparFrançoisGèze.
Pour les références en note des documents cités disponibles en ligne, les adresses url correspondantes sont
donnéesdansleurversionraccourcieproduitegrâceauprécieuxsitenonmarchand<frama.link>.
©ÉditionsLaDécouverte,Paris,2018.
Compositionnumérique:Facompo(Lisieux),septembre2018.
ISBNnumérique:978-2-348-04126-6
ISBNpapier:978-2-348-03634-7
Cetteœuvreestprotégéeparledroitd’auteuretstrictementréservéeàl’usageprivéduclient.Toutereproduction
oudiffusionauprofitdetiers,àtitregratuitouonéreux,detoutoupartiedecetteœuvreeststrictementinterditeet
constitueunecontrefaçonprévueparlesarticlesL335-2etsuivantsduCodedelapropriétéintellectuelle.L’éditeur
seréserveledroitdepoursuivretouteatteinteàsesdroitsdepropriétéintellectuelledevantlesjuridictionscivilesou
pénale.
S’informer
Si vous désirez être tenu régulièrement informé de nos parutions, il vous suffit de vous abonner gratuitement à
notre lettre d’information bimensuelle par courriel, à partir de notre site www.editionsladecouverte.fr, où vous
retrouverezl’ensembledenotrecatalogue.
Noussuivresur
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
1
/
36
100%