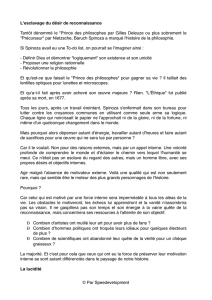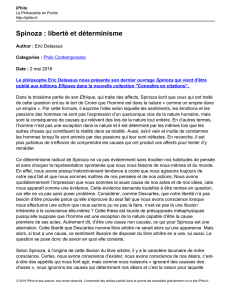Spinoza et la pensée arabe : Parallèles philosophiques
Telechargé par
elmernissiotman

Roger ARNALDEZ Université de Paris-Sorbonne
SPINOZA ET LA PENSÉE ARABE
On ne peut déceler, dans l'œuvre de Spinoza, aucune marque précise d'une
connaissance directe de la pensée arabe et dans ces conditions il n'est pas possible
de parler d'une influence réelle de la falsafa ou du kalâm musulmans sur ses
propres conceptions. D'ailleurs, le système de Spinoza est d'une originalité telle,
que d'une façon générale il est toujours risqué de le jauger d'après des modèles
antérieurs, là même où la filiation est certaine : c'est le cas de ce qu'il doit à
Descartes, en particulier, l'étendue cartésienne prend chez lui une valeur et une
portée qui vont bien au-delà de la res extensa. A plus forte raison sera-t-il peu
prudent de se livrer à un comparatisme rigoureux là où l'on ne dispose que de
conjectures fondées sur de simples ressemblances qui pourraient bien, en plusieurs
cas, n'être que des ressemblances verbales.
Mais à défaut d'une comparaison au sens strict que suppose le comparatisme, il
n'est pas interdit de relever des parallélismes. Or sur ce point, les raisons qui
légitiment l'entreprise ne manquent pas de poids. Spinoza, originaire de la
péninsule ibérique a reçu une éducation juive : il sait l'hébreu et connaît la Bible et
les œuvres des rabbins comme des philosophes juifs médiévaux. Or il est
incontestable, d'une part que les problèmes d'exégèse des textes sacrés et en
particulier de leur utilisation théologique et juridique, sont, chez les juifs et les
musulmans, sinon parfaitement identiques, du moins extrêmement voisins. Il y a là,
chez les uns et les autres, une forme d'esprit tout à fait comparable. Il est également
inconstestable, d'autre part, qu'il y eut, surtout en Espagne, un milieu intellectuel
commun à tous les Page 151
penseurs qui réfléchissaient à la double lumière de la philosophie grecque et
alexandrine, et de la révélation monothéiste, qu'il s'agisse de la Bible, des Evangiles
ou du Coran. C'est au point que la plupart des grands ouvrages écrits par des
musulmans ont été traduits en hébreu et ne nous ont souvent été conservés que dans
cette langue, avant d'être traduits en latin. Il est donc probable que Spinoza a été,
dans une certaine mesure, grâce à sa première formation, sensibilité à cette sorte
de koinè philosophique, à sa vision des problèmes, à ses modes de les poser et de
les résoudre. Il lui était impossible de connaître Maïmonide sans connaître du
même coup implicitement quelque chose de la pensée d'Averroès.
Néanmoins, ce n'est pas tellement à Averroès, loin de là, que fait songer la lecture
des œuvres de Spinoza. Sa critique de Maïmonide frappe également
le Commentator sans qu'il ait besoin de le citer. Je dirai, en ce qui me concerne,
qu'ayant connu Spinoza avant les penseurs arabo-musulmans, c'est la lecture de ces
derniers qui a évoqué souvent en moi, telle ou telle doctrine spinoziste, tantôt plus
générale, tantôt plus particulière. Il ne s'agit là que d'impressions, peut-être

subjectives, dont je m'efforcerai néanmoins de justifier objectivement le bien fondé.
Mais quels sont ces penseurs musulmans qui évoquent le mieux Spinoza ? Il y en a
plusieurs dont nous allons parler, ne serait-ce qu'au passage ; mais sur le plan de la
philosophie, je m'arrêterai essentiellement aux noms d'Ibn Sînâ (Avicenne), Ibn
Bâjja (Avempace) et Ibn cArabî de Murcie.
Mais avant de prendre en considération les idées philosophiques nous examinerons
d'abord les questions relatives à la religion, aux prophètes et à la prophétie, au sens
des textes sacrés.
Ie partie : RELIGION ET PHILOSOPHIE ; FOI ET RAISON
Pour Spinoza, la religion et la philosophie ont deux terrains différents et par
conséquent elles ne sauraient interférer. La religion, comme la philosophie, cherche
pour les hommes le salut c'est-à-dire la béatitude. Mais les voies qu'elles suivent
sont différentes : l'une demande la soumission et l'obéissance, l'autre s'appuie sur la
raison naturelle et cherche la félicité par la connaissance de la Vérité. L'erreur des
théologiens est de croire qu'il y a dans la révélation matière à connaissance et de se
proposer de la mettre en évidence à partir d'une certaine exé- Page 152
gèse des textes sacrés. Les uns, tel Maïmonide, pratiquent une exégèse qui soumet
les textes au jugement de la raison : toutes les difficultés que présentent les versets
dans leur lettre devront être résolues par un examen rationnel. Au contraire,
d'autres, tel Rabbi Jéhuda Alpakhar, veulent expliquer l'Ecriture par l'Ecriture ; ici,
c'est la lettre qui commande, et s'il y a des contradictions entre les textes, c'est
encore à des textes qu'on aura recours pour les lever. Toute la pensée naît, se forme
et se meut dans le moule de l'Ecriture. Or les mêmes questions se posent à l'Islam,
et face à ces problèmes, les musulmans ont pris les mêmes attitudes divergentes
que les juifs. Ibn Rushd est ici l'exact correspondant de Maïmonide sur le plan de la
méthode : dans les Manâhij il explique, à la lumière de la raison, dans quels cas on
peut accepter la révélation dans son sens apparent, le zâhir, et dans quels cas il faut
l'interpréter. Pour lui, comme pour Spinoza, la religion s'adresse essentiellement à
la masse des hommes qui sont incapables de penser par raisons démonstratives et
elle satisfait chez eux des besoins profonds. Mais à la différence de Spinoza, ces
besoins relèvent du désir de savoir et tout particulièrement de connaître les origines
et les fins dernières. Sur ce point, Ibn Rushd estime que la philosophie n'apporte
pas de preuves déterminantes, mais tandis que les sages persévèrent dans la
recherche, le vulgaire n'a pas la patience d'attendre et risque de perdre espoir : aussi
faut-il le conforter par une connaissance qui ne répond certes pas aux exigences des
critères logiques, mais du moins donne des réponses accessibles au commun des
hommes. En présence de ces réponses, dans un langage en général imagé et
imprécis, le philosophe ne se prononcera pas, tant qu'il n'y trouvera rien qui heurte
directement la raison. Mais Spinoza a une position beaucoup plus radicale : en
aucun cas il ne faut chercher dans la révélation ne fût-ce que le germe d'une
connaissance vraie de Dieu, du monde ou de l'homme. La parole des
prophètes écrit-il dans le Traité théologico-politique,n'est décisive qu'en ce qui

concerne la pratique de la vie et les qualités morales. Et encore : La connaissance
révélée ne porte que sur l'obéissance. Donc, s'il est d'accord avec Ibn Rushd pour
reconnaître à la religion une valeur pour le commun des hommes, il lui refuse toute
signification en matière de connaissance.
Mais d'autre part, l'Islam a également connu des exégètes littéralistes comparables à
Rabbi Jéhuda Alpakhar. Le plus célèbre est sans doute Ibn Hazm de Cordoue qui
vivait au XIe siècle Page 153
de notre ère en Espagne. Il est le grand théoricien de l'école appelée zâhirite qui ne
s'appuie que sur le sens apparent des textes, le zâhir. Pour mener à bien son
exégèse, Ibn Hazm a créé une grammaire zâhirite, une logique zâhirite. Son but est
d'expliquer les textes révélés par des textes révélés ou inspirés : le Coran par
le hadîth, et le hadîth par le Coran, sans jamais laisser intervenir une raison
indépendante. L'explication métaphorique est totalement bannie. Y a-t-il une
contradiction dans la lettre, on s'appliquera à chercher si les mots ne comportent un
sens, même rare, qui la réduirait ; ou encore, on se demandera si l'un des deux
textes ne doit pas être entendu universaliter (calâ' l-cumûm) et
l'autre particulariter (clâ 'l-khusûs), de façon à excepter (istithnâ) le second du
premier. Mais que dire si les deux textes contradictoires sont pris également dans
un sens général ? Spinoza envisage cette question à propos de deux versets
bibliques, l'un tiré de I Samuel, 15, 29 : La Gloire d'Israël ne trompe pas et ne se
repent pas, l'autre de Jérémie : Mais cette nation s'est convertie de sa malice… et je
me suis repenti du mal que j'avais songé à lui faire (18, 8). C'est le même
verbe hinnâhêm, au niphcal qui est employé, une première fois négativement : v lô
yinnâhêm (Il ne se repent pas) et une seconde fois affirmativement : va-nihamtî (et
je me suis repenti). Spinoza écrit donc à ce sujet (Traité théologico-
politique, ch. XV) : Ces deux déclarations ne s'opposent-elles pas l'une à l'autre…
Les deux propositions sont universelles et contraires. L'une affirme directement ce
que l'autre nie directement. La question peut embarrasser Rabbi Jehuda. Elle
n'embarrasserait pas Ibn Hazm. En effet l'Islam admet l'abrogation (naskh) : Dieu,
en sa toute puissance, peut quand Il le veut, changer une loi, abroger un verset et le
remplacer par un autre qui peut être tout à fait opposé. Il y a des règles pour
déterminer quel est l'abrogeant et quel est l'abrogé. Ainsi, quand la conciliation est
impossible, comme c'est le cas dans l'exemple précédent on a recours à
l'abrogation. Dieu se repent quand il veut, s'il le veut, il révèle qu'il se repent. Il ne
se repent pas quand il ne le veut pas, et s'il le veut, il révèle qu'il ne se repent pas.
Mais à vrai dire des cas de ce genre, comportant une contradiction à propos d'une
qualification de Dieu ne se rencontrent pas dans le Coran. Mais il faut noter que
dans les controverses contre les juifs et aussi contre les chrétiens, les docteurs
musulmans se sont félicités de cette supériorité de leur Loi qui admet l'abrogation,
alors que la Loi mosaïque n'en fait pas état. On voit donc par cet aperçu rapide que,
lorsque Spinoza Page 154
traite de la religion et de l'exégèse des textes sacrés, bien qu'il n'ait en vue que le
judaïsme, il se meut dans des eaux tout à fait familières aux penseurs musulmans.

On peut aller plus loin. On a fait un mérite à Spinoza, et sans doute à juste titre,
d'avoir été l'un des initiateurs de la critique biblique. Mais nous devons remarquer
que déjà avant lui, les musulmans l'avaient pratiquée dans leurs controverses. C'est
pour eux un article de foi que la Thora et les Evangiles sont altérés et ne renferment
plus, dans leur pureté et leur vérité, les révélations faites à Moïse et au Christ.
Spinoza écrit, contre Rabbi Jehuda : Il lui aurait fallu prouver que le texte littéral de
l'Ecriture nous est parvenu sans corruption. Il parle également d'une lettre morte
que la perversité humaine a pu falsifier. Enfin on connaît sa critique du Pentateuque
selon laquelle Moïse ne peut avoir été l'auteur de ces livres. Sur ce point, l'essentiel
de ses remarques est déjà chez les controversistes musulmans : Bâqillânî, Ibn Hazm
dans son Fisal, Râzî, dans son grand commentaire du Coran, à propos des versets
qui révèlent la falsification de la Thora et des Evangiles. Il est vrai que Spinoza ne
se serait même pas donné la peine d'appliquer la même critique historique au
Coran, tant il est évident pour lui que ce que ce Livre rapporte est dépourvu de
fondement. Il écrit dans les Pensées métaphysiques :
Si nous trouvions en elle (dans l'Ecriture sainte) quelque chose qui fût contraire à la
lumière naturelle, nous pourrions la réfuter avec la même liberté que l'Alcoran et le
Talmud.
Et dans le Traité théologico-politique :
Si donc on lit les récits de l'Ecriture sacrée et qu'on y croit sans tenir compte de la
doctrine qu'elle s'est proposé d'enseigner par leur moyen et sans corriger sa vie,
c'est exactement comme si on lisait le Coran ou des poèmes dramatiques ou du
moins des chroniques ordinaires dans le même esprit que la masse a coutume
d'apporter à ses lectures.
Il est évident que dans ce dernier texte, Spinoza pense à tous les récits coraniques
où sont repris des événements de l'histoire biblique sous une forme que les rabbins
avaient beau jeu de Page 155
dénoncer comme de pures fables. Mais pour les musulmans, le Coran étant la
Parole éternelle de Dieu n'a pas à être soumis à une telle critique. La falsification y
est impossible pour cette raison théologique et de foi ; néanmoins, les apologètes de
l'Islam n'ont pas manqué de faire remarquer que, contrairement à la Bible dont la
rédaction s'étend sur une longue période de temps et dont les origines sont
obscures, contrairement aussi aux Evangiles dont on connaît mal et les rédacteurs et
les circonstances de la rédaction, le Coran a été révélé dans des circonstances
historiques parfaitement repérables et dans un temps connu, celui de la vie du
Prophète, l'établissement définitif du texte datant du Calife cUthmân, une trentaine
d'années après l'hégire. Ce type d'argumentation se trouve longuement développé
dans le Fisal d'Ibn Hazm. On comprend que dans ces conditions, les musulmans
n'ont pas jugé à propos d'appliquer à leur propre Livre les méthodes de critique
qu'ils appliquaient à la Bible et aux Evangiles et qui préfigurent celle de Spinoza.

En conclusion, pour Spinoza, la vérité de la Révélation est d'ordre pratique, moral
et législatif. Si, sur ce point, il est en totale opposition avec les théologiens et les
philosophes qui s'inspiraient des Livres saints, il se retrouve, semble-t-il, en accord
avec les juristes ; et certainement avec certains juristes musulmans, même s'il ne les
connaissait pas. En effet, le fiqh (jurisprudence) est né en Islam bien avant la
théologie (kalâm). Pour les docteurs spécialisés dans cet ordre de recherches,
les fuqahâ', l'essentiel de la Révélation, et d'ailleurs de toute révélation (juive et
chrétienne), c'est la Loi (sharîca). Comme l'a très bien vu Spinoza, la seule chose
qui importe, c'est l'obéissance (taca) et la soumission (islâm). Il faut donc savoir et
déterminer avec exactitude ce que Dieu veut. Tel est le but du fiqh. Sur ce point un
certain islam et un certain judaïsme se rencontrent. Dans cette perspective, que
signifient tous les versets coraniques qui parlent des attributs de Dieu, de la
création et de la conservation du monde (khalq, rizq), de l'intervention de Dieu dans
l'histoire des nations pour leur envoyer des prophètes et châtier dès ici-bas les
peuples qui se rebellent contre ses Envoyés ? Ils ne constituent pas les éléments
d'une théologie, d'une cosmologie, d'une ontologie. Ils sont là uniquement pour que
les hommes comprennent que la Loi est la volonté d'un Seigneur tout-puissant, qui
récompense et qui punit en ce monde ou dans l'autre, et que par conséquent, il faut
lui obéir. Page 156
Mais que faut-il penser des prophètes ? Spinoza écrit dans le Traité théologico-
politique :
Certes nous comprenons bien que Dieu peut se communiquer aux hommes
immédiatement sans recours à des moyens corporels d'aucune sorte ; c'est ainsi qu'il
communique à notre esprit son essence. Toutefois, pour qu'un homme perçût de
façon purement spirituelle une notion quelconque qui ne soit pas impliquée déjà par
les principes premiers de notre connaissance et n'en puisse être déduite, il faudrait
de toute nécessité que son esprit fût d'une qualité plus qu'humaine.
C'est d'ailleurs ce qu'il nie. Ce point de vue, nous allons le voir plus loin, est
exactement celui d'Avempace. Dans ces conditions, il est évident qu'un homme ne
peut au sens propre être inspiré par une révélation venue du dehors. Les prophètes
n'ont saisi les révélations qu'avec le secours de l'imagination dit Spinoza, et il
reprend maintes fois cette affirmation.
Du fait que les prophètes ont saisi les révélations divines avec le secours de
l'imagination il n'est pas douteux que beaucoup de leurs aperçus ont dû porter au-
delà des limites intellectuelles communes. Car à partir de paroles et d'images, on
peut combiner bien plus d'idées qu'à partir des seuls principes et notions sur
lesquels se construit toute notre connaissance naturelle.
Cette doctrine fait penser à celle de Fârâbî. Mais en réalité elle n'a de commun avec
elle que le mot d'imagination. Pour Fârâbî, l'Intellect Agent qui illumine
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
1
/
18
100%