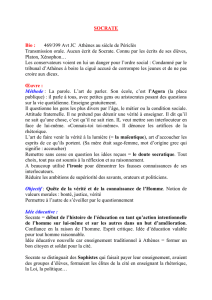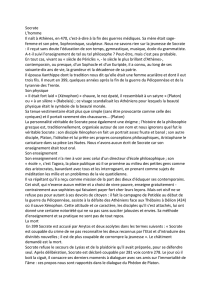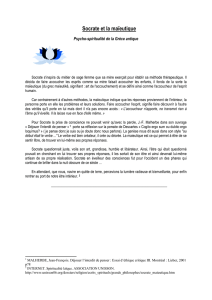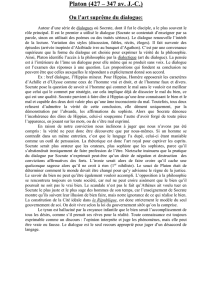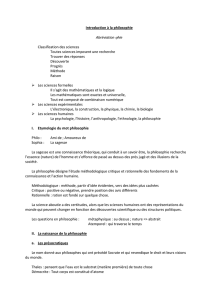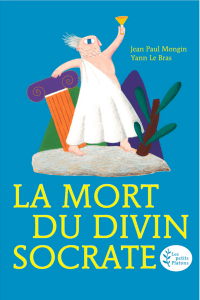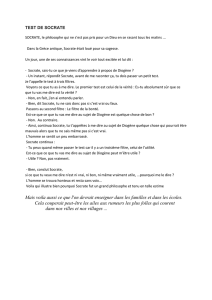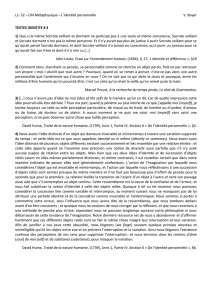279212365
1/23
PLATON : L’apologie de Socrate
Plan général : I° partie : introduction générale au texte du dialogue
II° partie : Plan détaillé du dialogue
III° partie : Texte du dialogue
Introduction Générale [Source : Platon : Oeuvres complètes « les Belles Lettres »Notice
de Michel Croiset.]
En l’an 399 avant notre ère, une accusation capitale fut lancée contre Socrate : elle entraîna sa
condamnation puis sa mort. Il avait alors 70 ans. C’est à cette accusation qu’est censée répondre
« l’Apologie
1
de Socrate » de Platon.
Pour bien en comprendre la portée, il faut établir la spécificité du rôle et de la perception de
l’individu Socrate dans l’Athènes du V° siècle. La cité attique était le lieu d’élection de la pensée.
Toutefois, alors que la plupart des grands penseurs de l’époque ( philosophes de la nature tel
Anaxagore et sophistes autrement dit savants faisant profession d’enseigner leurs sciences
moyennant rétribution) s’interrogeaient sur l’univers en général, Socrate se disait seulement épris de
vertu. Pour diffuser cet enseignement moral, détaché de toute ambition de réussite et de notoriété, il
n’usait pas de beaux discours mais il interpellait chacun de ces concitoyens dans sa conscience. Pour
lui, la vérité n’est pas dans les nuées. Elle est en nous, quoique souvent obscurcie. Il faut donc, par
un questionnement méthodique, éveiller la réflexion. C’est ainsi qu’on pourra la mettre en
mouvement et la conduire pas à pas d’une certitude à une autre.
Dans la perspective de Socrate, les moyens pour y parvenir compte tout autant que le résultat : il
faut n’avancer sur ce chemin que si est obtenu de l’interlocuteur un assentiment libre et entier sur
chaque point successivement abordé. C’est cette pratique exigeante que Socrate met à l’épreuve des
faits. En quoi consiste-t-elle exactement? Il s’agit d’une enquête serrée, subtile, impitoyable, sans
complaisance. Socrate s’en va partout interpellant ces concitoyens, sur la place du marché, dans les
boutiques, dans les gymnases. Soumis à la pression d’un tel examen, par un personnage affable mais
qui ne lâche pas prise facilement, certains étaient mis en difficulté par des vérités gênantes ou par
l’aveu d’une contradiction inaperçue. Si, avec le « petit peuple », la conversation devait tourner court
rapidement, avec les beaux esprits, Socrate était confronté à des protagonistes soucieux de leur
réputation, ne souhaitant ni se dérober, ni se faire tourner en ridicule. Et un entretien avec de tels
interlocuteurs, devenait vite un spectacle, dans cette ville où tout le monde aimait à argumenter et à
entendre argumenter. Socrate a donc été conduit plus d’une fois à mettre à mal la réputation
d’hommes d’esprit fameux, contraints d’avouer pourtant qu’ils n’étaient pas sûrs d’eux-mêmes.
Ne faisant aucune concession aux dépens de la vérité, Socrate se fit autant d’ennemis à mesure
qu’il prétendait faire du bien. Les trente dernières années de sa vie furent celles où l’orage qui devait
l’emporter s’amassa, grossit, pour finir par éclater. De plus, le petit groupe de ses disciples inspirait
une certaine défiance à l’opinion publique : d’ailleurs, on connaissait mal les idées qui y
prédominaient, car Socrate n’avait rien écrit. On devinait seulement qu’elles n’étaient pas celles de la
foule, ni en morale, ni en politique, ni en religion. Ce qui apparaissait clairement à tous, c’est que
l’enseignement de Socrate tendait à modifier profondément les directions traditionnelles de la vie à
Athènes. Alors que tout honnête citoyen était censé s’attacher à conserver son patrimoine, voire à
l’augmenter, selon la règle d’une sagesse traditionnelle, transmise de père en fils, qui valorisait le
travail assidu ainsi que l’économie comme conditions de la réussite sociale, Socrate méprisait les
richesses : plus grave encore, il enseignait à les mépriser ! N’y avait-il pas là une protestation impie
2
1
Discours visant à défendre solennellement une personne qui a été injustement mise en cause.
2
Impie : contraire aux exigences de la piété, c’est à dire de la dévotion due aux dieux.

279212365
2/23
contre la coutume ? Ces inquiétudes se grossissaient en se répandant, attisées par les ressentiments
personnels nourris par certains à l’égard du personnage de Socrate. Déjà il avait été attaqué
publiquement dans la comédie satirique « Les nuées » d’Aristophane qui l’assimilait à un impie et à
un charlatan.
La plainte avait été déposée contre Socrate en 399 par Mélétos et elle était appuyée par Anytos.
Ce dernier était un des hommes importants qui dirigeaient alors un régime démocratique fraîchement
rétabli après l’épisode de la Tyrannie des Trente. Cette plainte reposait sur deux chefs d’inculpation :
l’introduction de nouveaux dieux au détriment de ceux reconnus officiellement par la Cité [Anytos] ;
la corruption de la jeunesse [Mélétos] . Quelle importance avait alors le respect de la religion ? Elle
était pour les Grecs du V° siècle l’âme de la Cité. Elle faisait partie de sa constitution : en elle
résidait la garantie de l’existence commune. Chaque cité avait son culte, fondé sur ses traditions
propres. Offenser les dieux de la Cité, c’était compromettre la sécurité nationale, sinon trahir la Cité.
Le culte s’appuyait sur une légende qui était sa raison d’être. Il y avait des légendes sacrées qui ne
devaient pas être remises en cause. Voilà précisément ce que faisait la philosophie : elle tendait à
substituer dans la conception de l’univers des forces naturelles essentiellement impersonnelles aux
vieilles divinités. Anaxagore, Protagoras, Diagoras avaient tour à tour excité ses alarmes religieuses.
Socrate, certes, professait une philosophie différente et observait les usages religieux de son pays
mais il se distinguait mal aux yeux de la foule des autres philosophes et sophistes. Ne s’occupait-il
pas comme eux de questions obscures, subtiles et sans intérêt pratique ? Une confusion naturelle se
faisait entre eux et lui dans beaucoup d’esprits.
L’accusation d’introduire de nouveaux dieux doit être rapportée à la « voix divine » souvent
invoqué par Socrate : elle le guide, nous dit-il, dans sa conduite pour l’avertir de ce qu’il ne doit pas
faire, en certaines circonstances importantes. Une telle croyance n’était absolument pas contraire à la
religion du temps. Mais ce qui la rendait suspecte, c’était l’affirmation de la présence continue,
auprès d’un homme privilégié, d’un seul et même dieu ou démon
3
. Il était alors tentant d’attribuer ce
prétendu dieu nouveau à une croyance imaginaire créée par Socrate pour évacuer subrepticement les
divinités officiellement reconnues.
Quant au reproche de corrompre la jeunesse, il se prêtait à être étendu selon les besoins de la
cause : le vague de l’accusation ouvrait à ceux qui se proposaient de la développer un champ presque
illimité. Car c’était pour eux préparer de mauvais citoyens que de détacher les jeunes gens des
traditions religieuses que la Cité considérait comme sa sauvegarde.
À ce procès savamment orchestré, Platon a donc eu l’idée de répliquer en faisant parler Socrate
lui-même. Il s’agissait non seulement de réfuter toutes les injustes calomnies
4
, mais aussi d’expliquer
toute sa vie, c’est à dire de révéler clairement l’idée directrice qu’il avait prise pour règle de conduite
de sa vie.
* * *
3
Ce terme de « démons » désignaient alors, dans l’usage courant, des êtres supposés intermédiaires entre les dieux et les
hommes, sans aucune idée de malfaisance.
4
Calomnie : attaque mensongère destinée à salir injustement la réputation ou l’honneur d’un citoyen.

279212365
3/23
Plan détaillé de l’Apologie de Socrate [Sources : Michel Croiset {opus cité} & Luc Brisson –
Premiers Dialogues de Platon - éditions GF 1997] :
1er discours : le « plaidoyer de Socrate »: la question de sa culpabilité
I Exorde
5
: 17a-18a
II Plan du développement : 18a-19a
III Réfutation des accusations portées contre Socrate : Socrate va distinguer deux catégories
d’accusateurs. Il va s’attacher à confondre les plus anciens, c’est à dire ceux qui, tels les poètes
comiques, le présentent comme celui qui dénigre les divinités traditionnelles au nom d’une
certaine science de la Nature.
1) Des anciens accusateurs [19a-24b] :
a) partie négative : ce que Socrate n’est pas : il n’est pas d’abord un philosophe de la nature :
« un homme savant qui s’occupe de ce qui se passe dans le ciel et sous la terre » (18b). Il n’est pas
non plus un sophiste (19d-20c).
b) partie positive : ce que Socrate est vraiment. Ainsi, pour se défendre, Socrate présente son
approche comme indifférente aux recherches sur la nature et attachée entièrement à la connaissance
de l’homme et à la définition du bien. Il a fait un vœu auprès de la divinité après la consultation de
l’oracle de Delphes : celui de philosopher. La réalisation de cette mission impérieuse, confiée à une
volonté inflexible, lui impose dès lors des obligations.
c) Quelle est l’origine des calomnies portées contre lui ?
i) La réponse de l’oracle, telle qu’elle a été recueillie par Chéréphon [selon la Pythie de
Delphes, personne n’est plus savant que Socrate] (20c-21a) ;
ii) L’enquête sur le sens de cette réponse : la tentative socratique de réfutation de
l’oracle : qui peut bien être plus savant que Socrate ? 21b-22 e :
(1) introduction (21b) ;
(2) les hommes politiques (21b –e) ;
(3) les poètes (21 e-22c) :
(4) les «hommes de l’art» c’est à dire aussi bien les artistes que les artisans des métiers
manuels [les grecs y incluent donc les peintres et les sculpteurs tout comme les
manœuvres] (22e-24b).
iii) Les résultats de l’enquête (22 e- 24b) : tous ont certes des connaissances dans leur
domaine mais leur prétention d’en savoir plus occulte
6
la réalité de ce savoir : il vaut donc mieux
savoir exactement où s’arrête ce que l’on sait vraiment :
iv) origine des calomnies : c’est le mécontentement des gens soumis à cette enquête qui
les a suscitées (22 e- 23a) ;
v) Socrate prétend qu’il doit la poursuivre car Apollon lui a donné mission de le faire (23
a-c) ;
vi) Apparition d’imitateurs qui augmentent l’agressivité qui est née contre Socrate (23c-
e) ; vii) ce qui mène à la plainte de Mélétos.
2) Des nouveaux accusateurs : interrogatoire de Mélétos, accusateur de Socrate [sous les trois
chefs d’inculpation : corruption de la jeunesse , non-reconnaissance des Dieux de la Cité et
introduction de nouvelles divinités ( 24b-28a)]. C’est cette accusation qui est la plus difficile à
écarter car le ressentiment dont elle témoigne s’est enraciné dans les esprits.
5
Introduction générale du discours, de la plaidoirie.
6
Occulter : cacher.

279212365
4/23
a) Introduction (24b-c) ;
b) l’accusation de corrompre la jeunesse provient de la prétention de Mélétos de s’occuper des
problèmes d’éducation [alors qu’il ne s’en soucie guère en fait] :
i) 1ère erreur sur la question de l’éducation : qui rend quelqu’un meilleur ? Celui qui est
éducateur de la jeunesse : or Mélétos s’en désintéresse (24c-25c) ;
ii) 2ème erreur : corrompre la jeunesse : est-il possible que cela soit une faute réellement
volontaire ? Non : donc Socrate n’est pas coupable.
c) L’accusation d’athéisme :
i) L’interprétation de la plainte : Socrate corrompt les jeunes gens sur la question des
dieux ( 26a-e)
ii) Ce qui amène Mélétos à se contredire puisque Socrate croit – c’est même une notoriété
- en l’existence des puissances démoniaques (26 e-28a).
d) Conclusion (27e-28a).
3) Conclusion générale : synthèse de ce qui vient d’être dit. Les accusateurs de Socrate sont
animés par l’esprit de calomnie et la jalousie [28a-b].
4) Réponse à deux objections :
1) Première objection : le mode de vie choisi par Socrate est dangereux. En fait,
ce mode de vie prouve la piété de Socrate qui s’est mis au service du Dieu[28b-31c].
a) Considérations tirées de ce qu’il est « moralement beau » (kalon) de faire :
i) Principe général : la tâche – c’est à dire la mission divine qui lui a été confiée - compte
plus que la vie : il faut tenir son rang dans la vie comme dans les combats hoplitiques
7
[28b-d] ;
ii) Application du principe au cas de Socrate : la menace de la mort n’empêchera pas
Socrate d’accomplir sa tâche [28d-30c].
b) Considérations tirées de ce qu’il est « avantageux »[to ophelon] de faire :
i) Les accusateurs ne peuvent causer aucun tort réel à Socrate : seule l’âme compte pour
lui (et non pas le corps) ; il n’y a que ce qui nuit à son âme qui pourrait réellement le troubler.
Donc, s’il est condamné à mourir, il n’en pâtira pas : mais c’est un grand tort qui sera fait à
l’ensemble des Athéniens (30c-d).
2) Pourquoi ? En la privant de Socrate, on prive la Cité d’un avantage que son
existence procure à Athènes : celui de réveiller chacun de ses citoyens (30d-31c). Si ces juges
l’acquittent, cela ne saurait être acquis au prix du reniement de son serment, lequel est de vouer son
existence à la philosophie. [« (…) ; et, d’un autre côté, si je vous dis que le plus grand bien de
l’homme, c’est de s’entretenir chaque jour de la vertu et des autres choses dont vous m’avez
entendu discourir, m’examinant et moi-même et les autres : car une vie sans examen n’est pas une
vie » : 29d]. Platon développe ici l’image célèbre du taon : « car si vous me faites mourir, vous ne
trouverez pas facilement un autre citoyen comme moi, qui semble avoir été attaché à cette ville, la
comparaison vous paraîtra peut-être un peu ridicule, comme à un coursier
8
puissant et généreux,
mais que sa grandeur même appesantit, et qui a besoin d’un taon
9
qui l’excite et l’aiguillonne. »
3) 2ème objection : Socrate aurait dû prendre une part active à la vie politique. Sa
réponse montre que son influence sur les jeunes fut salutaire(31c-34b).
a) Socrate en a été dissuadé par son signe divin (31c-d) ;
b) Il est impossible de rester honnête homme si l’on se mêle de politique à Athènes : on ne peut
se conduire en accord avec la justice dans une cité injuste sans courir le risque de perdre la vie.
7
Hoplites : fantassins pesamment armés de l’Antiquité grecque.
8
Grand et beau cheval de course.
9
Gros insecte qui se nourrit du sang des animaux qu’il suce en piquant leurs peaux.

279212365
5/23
Socrate évoque également les raisons qui l’ont amené à préférer la philosophie à la participation aux
affaires publiques : il montre à ce propos qu’il y a incompatibilité entre la Justice et la Politique. Il
s’appuie alors, avec l’éloquence des plaideurs, sur sa seule expérience de participation aux affaires
publiques. Il a été membre du Conseil des Cinq cents lors du « procès des Arginuses » au cours
duquel ont été jugés huit stratèges présumés coupables d’avoir abandonné des milliers de naufragés à
la suite d’une bataille navale. Au lieu de procéder à une accusation et à un jugement individuels,
l’assemblée a voulu juger collectivement les stratèges, de manière expéditive : « Ce jour-là, je fus le
seul des prytanes qui osai m’opposer à la violation des lois, et le seul à voter contre vous. Malgré les
orateurs qui se préparaient à porter plainte contre moi, à me faire arrêter -et vous poussiez à le faire
par vos vociférations-, j’estimai de mon devoir de braver ce danger, d’être ainsi [32c] de la loi et de
la justice le compagnon au lieu d’être le complice de votre injustice délibérée par peur de la prison
ou de la mort.»
c) Voilà pourquoi Socrate s’en tient aux discussions privées, dont il n’exclut personne (32 e-
33b) ;
d) Son influence sur les jeunes fut salutaire : si tel n’avait pas été le cas, en prenant de l’âge,
certains d’entre eux n’auraient pas manqué de le dénoncer publiquement (33b-34b).
Péroraison
10
: Socrate ne va pas supplier les juges :
1) ce ne serait pas convenable ni pour lui ni pour Athènes (34b-25b) ;
2) ce ne serait pas conforme à la justice : celle-ci n’a pas à être accessible à la pitié, ne
devant reposer en droit que sur l’objectivité et sur la capacité de conviction[35b-c] ;
3) ce ne serait pas conforme à la piété [35c-d].
*
2ème discours : la question de la peine encourue par Socrate
Cette seconde partie constitue une réponse directe aux reproches formulés par Mélétos contre le
soi-disant « corrupteur de la jeunesse ». Socrate va montrer qu’il n’est pas un athée et explique ce
qu’est cet esprit divin qu’il invoque si fréquemment : simple avertissement intérieur que les dieux lui
donnent, il donne le prétexte à Socrate d’expliciter ce qui constitue à ses yeux l’essence de
l’humanité.
Introduction : Socrate a été reconnu coupable par une courte majorité (35e-36b)
Proposition de peine : Mélétos, l’accusateur, propose la condamnation à mort : Socrate est– selon
les règles d’un procès de ce type- appelé à faire une contre-proposition, celle d’une peine de
substitution : les juges seront invités à choisir entre les deux :
1. Détermination de la peine en fonction de ce qu’il mérite : Socrate est un bienfaiteur de
la Cité et il est pauvre [36 b-d]. Par suite, il mérite d’être nourri au prytanée, c’est à dire aux frais de
la Cité (36 d-37a) : mais cette contre-proposition peut apparaître arrogante
11
, donc il faut en faire
une autre.
2. Détermination de la peine en fonction des règles judiciaires :
a) Socrate ne mérite pas de peine : l’exil dans son cas ne servirait à rien (37 a-38b).
b) Si les juges insistent pour que Socrate propose une peine, Socrate propose une
amende d’une mine
12
, proposition qui est portée à trente mines : une telle peine serait en effet sans
dommage puisqu’elle ne ferait aucun mal à son âme (38b).
*
3ème discours : le condamné s’adresse directement à ses divers juges
S’adressant successivement à ceux de ses juges qui l’ont condamné [« si vous me faites périr,
vous en serez punis aussitôt après ma mort par une peine bien plus cruelle que celle à laquelle vous
me condamnez ; en effet, vous ne me faites mourir que pour vous délivrer de l’importun fardeau de
10
Conclusion d’un discours : ici de la plaidoirie.
11
Arrogance : orgueil de celui qui s’arroge plus que ce à quoi il peut prétendre.
12
Monnaie en vigueur à l’époque.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
1
/
23
100%