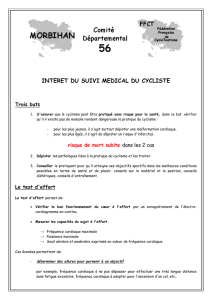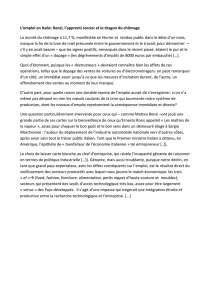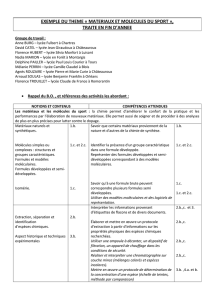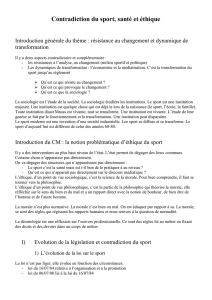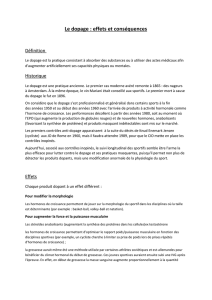Sport, Science et Dopage : L'Influence des Médias sur le Cyclisme
Telechargé par
paulinschou

Cours de sciences humaines et sociales : Sport,
Science et Dopage
Groupe N◦2
L’influence des médias sur la perception
des performances actuelles dans le
cyclisme
Une étude axée sur les performances de Tadej
Pogačar lors du Tour de France 2020 et
l’analyse d’Antoine Vayer
Auteurs :
Cyril Monette, Paulin de Schoulepnikoff et Nicolas Tireford
Synthèse
Dans ce travail, après une brève introduction socio-hisorique, l’interprétation d’Antoine Vayer
sur les performances de Tadej Pogačar lors du Tour de France 2020 a été étudiée. Trois axes
principaux utilisés par Antoine Vayer ont été mis en avant : la pseudo-science, les comparaisons
avantageuses et la défense des coureurs propres. A chaque fois, l’accent a été mis sur la façon
dont il utilise les scandales de dopage passés pour appuyer ses propos.
Le 6 décembre 2020

Table des matières
1 Introduction 1
2 Contexte socio-historique 1
2.1 Jusqu’auxannées60 ................................. 1
2.2 L’inclusion de nouveaux concepts dans l’éthique sportive . . . . . . . . . . . . . 1
2.3 Naissance d’une sous culture cycliste, 1965-1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2.4 Années 2000, médiatisation et scandales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2.5 Le cycliste comme stéréotype du sportif dopé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.6 AntoineVayer..................................... 5
3 Tadej Pogačar, le développement du champion 6
3.1 L’enfanceduprodige ................................. 6
3.2 Lesannées"espoirs" ................................. 6
3.3 L’arrivéechezUAE.................................. 7
3.4 2019, première année professionnelle et éclosion aux yeux du grand public . . . . 7
3.5 2020,laquêtedugraal................................ 8
4 Étude des résultats du Tour de France 2020 8
4.1 Le premier week-end pyrénéen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4.1.1 Peyresourde, un monstre surpassé ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4.1.2 Un lendemain similaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4.2 Un contre la montre pour l’histoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
4.3 Une analyse générale pour couler le milieu du cyclisme . . . . . . . . . . . . . . 12
4.4 D’autrespointsdevues................................ 14
4.4.1 Des ex-coureurs dubitatifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.4.2 Etsonavis,àlui? .............................. 15
5 Conclusion 15
0

1 Introduction
Dans un cyclisme toujours plus controversé auprès des médias et du grand public, il est
normal de se poser la question quant à l’influence des scandales passés sur la perception des
performances actuelles. Là où une partie du grand public voit le cyclisme comme un sport
de dopés, l’autre partie se pose des questions sur l’efficacité des actions antidopage, avec des
chiffres qui font peur, tels les fameux 2% de cas de dopage détectés par an.
La problématique que l’on va donc chercher à étudier dans le présent document est celle de
la perception du cyclisme par des personnes externes à ce milieu. Plus précisément, nous allons
examiner quels sont les éléments qui sont mis à disposition du public, ceux par lesquels celui-ci
voit et comprend le milieu du cyclisme. Nous allons ainsi essayer de comprendre l’origine de
l’image négative de ce sport, qui est pourtant celui dans lequel l’antidopage est le plus actif ainsi
que les raisons pour lesquelles les performances actuelles sont directement remises en cause.
Pour ce faire, et afin d’imager de manière concrète cette étude, nous avons décidé de nous
centrer sur le cas du Tour de France de 2020, en particulier la victoire du slovène Tadej Pogačar,
et l’interprétation de cette performance par Antoine Vayer.
2 Contexte socio-historique
2.1 Jusqu’aux années 60
Un des premiers témoignages de ce qui est appelé aujourd’hui du dopage dans le Tour de
France remonte à 1924. À cette époque, Henri et Francis Pélissier avaient recourt à la cocaïne,
la chloroforme et d’autres pilules non spécifiées, mais leurs intentions divergeaient totalement
de celles attribuées aux actuels sportifs dopés. Effectivement, les conditions étaient extrêmes,
très différentes de ce que l’on peut voir aujourd’hui, "les ongles de doigts de pied", dit Henri,
"j’en perd six sur dix"[1]. Ces cyclistes avaient donc recours à ces produits dans une dynamique
de survie. Jusqu’aux années 60, le dopage n’avait donc pas du tout la diabolisation actuelle.
"Avant la période de prohibition [...], le dopage se présente comme une pratique licite, voir
banale [...], accomplie en toute bonne conscience" [2].
Il n’y avait pas de marquage symbolique, pas de repère, donc pas de ligne de conduite
morale pour les athlètes. La prise de substances pharmaceutiques était tacitement autorisée.
Dans les années 1950, Marcel Bidot, directeur de l’équipe de France sur le Tour, estime à 75%
le pourcentage des cyclistes ayant recours à ces substances. Il n’y avait aucun débat éthique
sur des entités qui n’avaient pas encore de sens. Un sentiment de transgression n’avait donc pas
lieu d’être.
2.2 L’inclusion de nouveaux concepts dans l’éthique sportive
Dans les années 1960, plusieurs incidents comme le malaise de Jean Melléjac en 1955, la
chute de Roger Rivière en 1960 ou les décès de Kund Enmark-Jensen en 1960 et Tom Simpson
en 1967, poussent sportifs, médecins et politiciens à agir. La première loi antidopage apparaît :
"en 1965, je me suis rendu compte des ravages du dopage dans le monde sportif et j’ai alors
fait voter la première loi interdisant le doping par les champions" 1raconte Maurice Herzog.
À ce moment, les premiers jugements moraux apparaissent. Avec les nouveaux concepts liés
à la pratique du dopage, une construction nouvelle de la morale sportive se met en place :
1. Interview perçue dans l’hebdomadaire VSD et rapportée par J. P. de Mondenard dans Sport et vie, hors
série n°11, mars 2000.
1

se doper, c’est tricher. L’argument sanitaire de la mise en place de la loi Herzog se façonne
en un argument moral. C’est le fait que maintenant, le dopage soit dit contraire à l’éthique
sportive, qui justifie la lutte antidopage. La société a alors implicitement décidé que la chimie
n’a pas sa place dans un sport dit d’ "entreprise d’amélioration du genre humain" 2. Une décision
qui n’est pas partagée de tous puisque dans les années 1980, comme raconte Laurent Fignon,
"l’artisanat (est) dépassé par l’usinage " [3] et l’on vit dans "un monde fossé par les excès de
la chimie" [3], le dopage ne fait pas figure d’exception et "perd son caractère artisanal pour
devenir scientifique" [2].
Cependant, la majorité des cyclistes n’abandonnent pas les substances dopantes. Contem-
porain de cette époque, Laurent Fignon observe un passage entre deux cyclismes radicalement
différents, une transition à un dopage généralisé. Lors de cette transition, coïncidant avec la
venue de l’EPO et l’hormone de croissance, un fossé se creuse entre la perception du dopage
par la société et par les cyclistes. Ceci a pour conséquence la naissance d’une dite "sous-culture
cycliste" [4].
2.3 Naissance d’une sous culture cycliste, 1965-1999
L’apparition de la première loi antidopage a engendré une divergence entre deux percep-
tions de la chimie dans le cyclisme. Effectivement, les normes et les valeurs sportives érigées,
décrivant un modèle d’esprit sain dans un corps sain, ne trichant ni avec les autres, ni avec
soi-même, ne convient pas aux habitudes du cycliste de la fin du XXème siècle. Ceci a pour
conséquence l’apparition d’une sous-culture cycliste pouvant être caractérisée par trois dimen-
sions : le dopage comme élément de cohésion du groupe, des coutumes, fêtes, rituels et des
codes de communication propre [4]. En effet, le cycliste va alors se "piquer non plus seulement
pour gagner mais pour exister au sein d’une famille" [4]. Derrière le groupe, la déculpabilisation
est facile. Les rituels auxquels la "véritable fraternité" a donné des noms familiers se font "en
famille". Les normes sont totalement déplacées, la première piqûre entraîne un sentiment de
fierté, le cycliste se dope pour exister ; "les amphétamines c’est comme l’apéro : un rite so-
cial" raconte Erwann Menthéour en 1999 [4]. On y retrouve plusieurs éléments de la théorie du
désengagement moral, comme un vocabulaire propre. En effet, la construction idéologique que
la société a créé autour du dopage est contournée par la construction d’un langage familier. Ce
dernier servant à désacraliser le dopage, renforcer le sentiment d’appartenance à une société à
part et se défendre des agressions extérieurs. Au sein de cette sous-culture, il n’y règne pas de
sentiment de transgression, et on en parle ouvertement : "tiens, voilà de l’EPO, tu en veux ?"
[3]. Le dopage peut alors y être généralisé, systématique et collectif.
Le public n’a pas conscience de l’existence de cette sous-culture. Les liens entre les sportifs
professionnels et les spectateurs sont les médias, or "les journalistes sont retissant à dénoncer
l’existence de pratiques dopantes qu’ils n’ignorent pas" [5], leur intérêt étant de préserver la
bonne relation qu’ils entretiennent avec les coureurs. Ce fossé entre ces deux perceptions du
dopage persiste donc tout au long de la fin du XXème siècle et, comme illustré sur la Figure 1,
son étendue varie discrètement.
2.4 Années 2000, médiatisation et scandales
La dimension spéculative supplémentaire qu’ajoute la société du XXIème siècle, où l’on
assiste à une course vers la productivité, dans un monde où tout peut être capitalisé, ne calme
pas la pratique du dopage. Le sport de haut niveau s’inscrit comme un "idéal d’optimisation
2. A. Ehrenberg (1991)
2

Figure 1 – Représentation schématique de la sous-culture cycliste fondée sur la notion de
conduites dopantes au sens large. Tiré de [4].
comparatrice" [2]. Dans cette perspective, les sponsors font accroître la pression régnant sur les
épaules des coureurs. De plus, le sportif, véritable icône, est fortement médiatisé ce qui accentue
le fossé entre la perception du public et celle de la sous-culture cycliste.
Cette divergence ignorée ne pouvant pas être dans l’ombre éternellement, elle est mise à
la lumière du jour par l’affaire Festina sur le Tour de France de 1998 (voir Figure 2 (a)). Le
décalage des normes apparaît donc comme un choc, ce qui fait paraître le Tour comme bouc
émissaire du sport professionnel. Car, dans une ère de déferlement médiatique avec pour objectif
la maximisation du capital, il n’y a aucune retenue. L’affaire est fortement médiatisée.
(a) (b)
Figure 2 – (a) Interview de Brochard, Virenque, Dufaux et le reste de l’équipe Festina, ex-
clus du Tour de France le 17 juillet 1998, tiré de https://tinyurl.com/y5g64dxc et (b) ar-
ticle sur l’affaire de dopage de Lance Amstrong, tiré de https://tinyurl.com/y5ywgvpa.
Dans les années 2000, plusieurs cas de dopage dans le Tour de France sont déclarés : Lance
Armstrong (voir Figure 2 (b)), l’affaire Puerto, B. Riis... De nombreux contrôles positifs ont
lieu en 2008 : Riccardo Ricco, Manuel Beltran, Moisés Dueñas,... Ces multiples scandales ont
donné lieux à une marginalisation de cette sous-culture, rendant les cyclistes "plus sensibles à
la culture dominante" [4]. Depuis 2008, une diminution de la performance des coureurs et du
nombre de tests positifs semblent signifier une baisse des pratiques dopantes dans le cyclisme.
3
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
1
/
18
100%