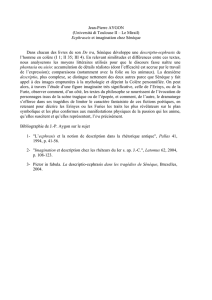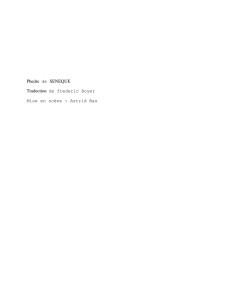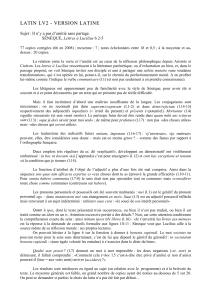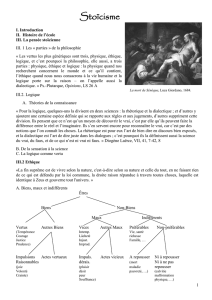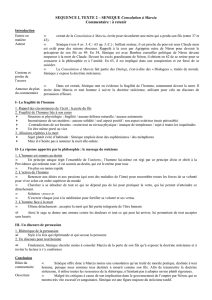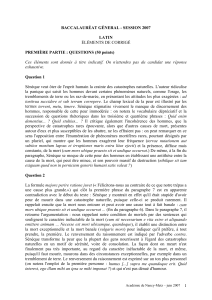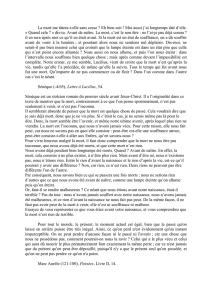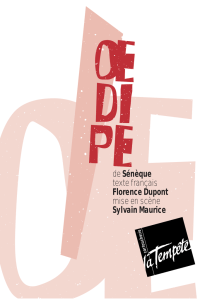Sénèque, La Brièveté de la vie : Corrigé de commentaire
Telechargé par
Anas Boussetta

Eléments de corrigé du commentaire du texte de Sénèque extrait de La Brièveté de la vie.
Le texte :
Dans la foule des vieillards, j’ai envie d’en attraper un et de lui dire : « Nous
te voyons arrivé au terme de la vie humaine ; cent ans ou davantage pèsent sur
toi. Eh bien ! reviens sur ta vie pour en faire le bilan ; dis-nous quelle durée en a
été soustraite par un créancier, par une maîtresse, par un roi, par un client,
combien de temps t’ont pris les querelles de ménage, les réprimandes aux
esclaves, les complaisances qui t’ont fait courir aux quatre coins de la ville. Ajoute
les maladies dont nous sommes responsables ; ajoute encore le temps passé à
ne rien faire ; tu verras que tu as bien moins d’années que tu n’en
comptes. Remémore-toi combien de fois tu as été ferme dans tes desseins,
combien de journées se sont passées comme tu l’avais décidé ; quand tu as
disposé de toi-même, quand tu as eu le visage sans passion et l’âme sans
crainte, ce qui a été ton oeuvre dans une existence si longue, combien de gens se
sont arraché ta vie, sans que tu t’aperçoives de ce que tu perdais ; combien, de ta
vie t’ont dérobé une douleur futile, une joie sotte, un désir aveugle, un entretien
flatteur, combien peu t’est resté de ce qui est tien : et tu comprendras que tu
meurs prématurément. » Quelles en sont les causes ? Vous vivez comme si vous
deviez toujours vivre ; jamais vous ne pensez à votre fragilité. Vous ne remarquez
pas combien de temps est déjà passé, vous le perdez comme s’il venait d’une
source pleine et abondante, alors pourtant que ce jour même, dont vous faites
cadeau à un autre, homme ou chose, est votre dernier jour. C’est en mortels que
vous possédez tout, c’est en immortels que vous désirez tout.
Sénèque, De la brièveté de la vie.
Plan du texte :
Lignes 1 à 9 : Mise en évidence, à travers d’exemples, du temps qu’on perd en choses inutiles et
vaines, dont il ne restera rien.
Lignes 9 à 16 : Mise en évidence, du fait que nous perdons aussi ce que nous avions réussi à
maîtriser et que notre liberté est fragile.
Lignes 16 à 21 : Analyse des causes plus profondes qui proviennent d’une mauvaise conception
insouciante de notre finitude

Problème :
Ce texte pose le problème du temps et de l’usage que l’homme doit en faire pour mourir serein,
assuré d’avoir réussi sa vie et d’être bel et bien en âge de mourir.
Thèse :
La thèse de Sénèque est que la plupart des hommes perdent leur temps à ne rien faire ou à faire
des choses inutiles, ce qui rend leur mort tragique, puisqu’ils paraissent mourir trop jeunes, comme si
la liberté de maîtriser leur existence leur avait manqué.
L’auteur nous invite donc à revoir notre rapport au temps et à l’existence pour centre nos actions
et notre vie sur des choses plus essentielles qui nous assureront la maîtrise et la liberté et qui nous
permettront de mourir sereinement.
Intérêt philosophique du texte :
Sénèque nous propose une définition du bonheur comme vertu, action et non pas comme
passivité.
Principales notions évoquées dans le texte :
- « Vie humaine » : il s’agit de la vie telle qu’elle est menée par la plupart des hommes non
éclairés. Le but de Sénèque est d’inviter l’homme à mieux concevoir son existence pour ne pas
tomber dans une vie qui serait indigne de lui et donc malheureuse.
- « Disposé de toi-même » / « ce qui est tien » : ces expressions renvoie à la notion de
liberté, laquelle est à comprendre comme pouvoir de décision et capacité de maîtrise de soi. Cette
liberté est essentiellement intérieure, reposant sur la pensée et sur notre capacité à nous limiter à ce
qui ne dépend que de nous.
- « Désir aveugle » : Il s’agit des désirs que l’on éprouve pour ce qui ne dépend pas de
nous et qui, par conséquent, nous laissent insatisfaits. L’aveuglement est celui de la pensée qui doit
justement nous éclairer dans cette estimation de ce qui dépend de nous et de ce qui ne dépend pas
de nous.

L’homme étant le seul être qui soit conscient d’avoir à mourir un jour , on pourrait s’attendre à
ce que cette conscience l’aide justement à trouver les moyens de vivre bien et d’être heureux. Or, il
semble que l’homme adopte au contraire, un comportement confus, lorsqu’il est confronté à la fuite du
temps. En effet, pour conjurer l’angoisse de la mort et pour se convaincre d’exister pleinement. Les
hommes ont tendance d’une part, à perdre le sens des choses et la maîtrise de leur existence et,
d’autre part, à se disperser en actions futiles et en désirs vains. Ainsi, quel usage du temps avoir pour
être heureux ?
Sénèque va montrer dans cet extrait de La Brièveté de la vie que l’attitude qui consiste à se
perdre en occupations inappropriées est justement le meilleur moyen d’avoir à craindre la mort, dans
la mesure où l’on s’apercevra, lorsque cette dernière se présentera, combien notre vie aura été vide.
Pour ce faire, l’auteur nous donne dans un premier temps des exemples, du temps qu’on perd en
choses inutiles et vaines, dont il ne restera rien. Puis il met en évidence (« Remémore-toi… ») le fait
que nous perdons aussi ce que nous avions réussi à maîtriser et que notre liberté est fragile. Il
propose enfin une analyse des raisons plus profondes qui proviennent d’une mauvaise conception de
l’existence (« Quelles sont les causes ? (…) » à la fin ).
Ainsi Sénèque affirme-t-il qu’il nous faut concevoir autrement notre rapport au temps. Mais
comment exactement ? Vivre comme si l’on n’allait jamais mourir peut-être une manière de vaincre
l’angoisse de la mort. Dès lors, faut-il vraiment supprimer cet espace d’illusion ?
***
Dans un premier temps, Sénèque développe l’idée que l’homme perd bien souvent son temps.
Le début du texte est brutal, voire violent, car Sénèque cherche à provoquer une véritable prise de
conscience. Il s’agit de montrer à un vieillard – autrement dit à un homme qui est proche de la mort et
qui, donc, est plus réceptif – tout le temps qu’il a perdu et qu’il ne peut plus rattraper. Pourquoi
Sénèque s’adresse-t-il à un vieillard ? Sans doute pour que le sentiment d’avoir irrémédiablement
perdu son temps puisse faire l’effet d’une terrible prise de conscience, et pour que tout le monde
puisse s’identifier au vieillard et se mettre ç craindre d’avoir à vivre un jour la même situation.
L’auteur énumère ensuite une série d’exemples pour montrer combien le vieillard a perdu son
temps au cours de sa vie en s’adonnant à des choses futiles. Les exemples qu’il utilise semblent
empruntés à une vie d’homme ordinaire (bien qu’actif et riche) comme le suggère les mots
« créancier » et « client » qui renvoient à la vie que menaient à l’époque de Sénèque les Patriciens
(hommes de bonne société romaine). Ce choix peut s’expliquer par le fait que si l’on veut montrer
combien les hommes se perdent en futilités, il ne faut pas qu’un tel comportement puisse se justifier
par un mode de vie particulier : si Sénèque avait pris l’exemple d’un homme pauvre accablé de
soucis, on aurait pu lui répondre que le pauvre homme n’avait guère la possibilité de faire autrement
que de courir par monts et par vaux pour essayer de vivre dans un confort correct. Le choix d’un
homme ordinaire plutôt riche est en ce cas plus significatif (outre le fait que la morale de Sénèque est
hautement aristocratique…) Ce n’est pas la pauvreté qui a fait négliger à cet homme l’essentiel
puisqu’il avait tout le loisir de s’y consacrer.
Tous les exemples qu’emploie Sénèque montrent que les hommes ont tendance à gaspiller leur
temps en s’inventant des soucis et en attribuant de l’importance à ce qui n’en a pas : le créancier
renvoie aux dettes, la maîtresse au plaisir, le client à une charge inutile que prenaient certains
Patriciens en protégeant des hommes du peuple ; les esclaves renvoient à l’idée d’un personnel à
gérer et donc à celle d’une charge supplémentaire, enfin les complaisances renvoient aux services
que certains hommes rendaient à d’autres de par leur statut ou leur fonction. L’idée générale est que
l’homme se crée des charges (choses à faire) qui ne sont pas essentielles et auxquelles il consacre
trop de temps.
Sénèque ajoute ensuite des exemples qui ne relèvent plus du domaine de l’action mais qui
engagent la responsabilité des hommes. Le premier concerne « les maladies » et le second « le
temps passé à ne rien faire ». Les maladies auxquelles Sénèque fait allusion sont celles qui peuvent
nous être attribuées, à savoir celles dont nous sommes la cause : on peut en effet se « rendre
malade » en étant trop actif ou en se faisant trop de soucis (comme le suggère par exemple)
l’expression « s’en faire une montagne »). « Le temps passé à ne rien faire » renvoie quant à lui au
temps que l’on perd bêtement et qu’on laisse passer au lieu de l’employer à faire des choses
essentielles.
*

Dans un second temps, Sénèque va mettre en évidence la fragilité de notre liberté : même ce
que l’on arrive à maîtriser nous échappe la plupart du temps sans que nous nous en rendions
vraiment compte.
Le philosophe énumère ensuite d’autres exemples pour montrer combien les hommes sont
faibles face à autrui et combien cette faiblesse peut-être la cause de tout ce qui nous échappe et que
l’on perd. L’expression « remémore » montre que l’homme pourrait toujours tenter de prouver qu’il n’a
pas perdu tout son temps, il n’en serait pas moins confronté à l’idée qu’il n’a pas fait tout ce qu’il
voulait faire. Sénèque renvoie ici la mémoire à la prise de conscience : ce que l’on se rappelle avoir
réalisé disparaît aussi, on nous l’a pris et nous nous sommes laissé faire par négligence. Les
expressions « ferme dans tes desseins », « comme tu l’avais décidé », « disposé de toi-même », « ce
qui est tien » … renvoient à tout ce que l’homme peut faire librement, grâce à un certain pouvoir sur
lui-même et sur ses pensées. La liberté (stoïcienne) est ici à comprendre comme capacité intérieure
de décision, pouvoir de distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Sénèque
suggère donc ici que l’homme serait capable d’une telle liberté, et qu’il serait possible de ne pas
toujours se perdre dans des actions vaines. Cependant, cette liberté est représentée par Sénèque
comme fragile puisque nous pouvons la perdre à tout instant.
Sénèque attribue d’abord à autrui (« combien de gens ») ce pouvoir de nous ôter ce que nous
cherchons à construire (« ton œuvre », « ta vie »), comme si nous avions avec les autres un
rapport conflictuel. Autrui apparaît ainsi comme celui qui nous « arrache » ou nous dérobe notre vie
lorsque l’on parvient à en faire quelque chose de bien. En cela, autrui apparaît comme un être vivant
par procuration, dérobant à celui qui est libre et qui mène sa vie authentiquement de quoi alimenter et
combler son propre vide. L’idée était déjà apparue à travers les premiers exemples (maîtresse,
créancier …) mais elle est amplifiée ici parce qu’autrui est dit nous voler ce que l’on cherche à faire de
bien (alors qu’au début du texte, la liberté n’apparaît pas).
Sénèque prend d’autres exemples pour montrer que l’on peut perdre sa liberté, cette fois, à
cause notamment de la joie, du désir et de la flatterie. Autrement dit, Sénèque incrimine ici les
sentiments, lesquels nous rendent faibles et nous incitent à sacrifier ce qui est pourtant essentiel :
nous-mêmes, nos valeurs.
La leçon est claire : « Tu comprendras que tu meurs prématurément ». C’est dire qu’entre ce que
nous perdons d’inessentiel et ce que nous perdons d’essentiel, il ne nous restera pas grand-chose à
la fin et que notre mort ne peut donc que nous apparaître injuste et absurde. Mais quelles sont les
causes d’un tel comportement ?
*
Sénèque s’interroge ensuite sur les raisons qui provoquent cette perte de temps et donc de vie.
Il passe à un registre plus général et abandonne les exemples. Il s’agit maintenant, après avoir fait un
constat réaliste de nos erreurs et d’en tirer une leçon pour en déduire une véritable conduite
philosophique dans l’existence. Le but est de permettre à chacun et de bien vivre et d’atteindre la
« vertu », c’est-à-dire de vivre selon la raison, en employant sa volonté pour se détacher de tout ce qui
rend malheureux. C’est une véritable philosophie du devoir que nous propose Sénèque : « toujours
vivre comme si … », ainsi qu’une morale reposant essentiellement sur la volonté.
L ‘auteur critique ensuite l’attitude commune qui consiste à ne pas suivre sa raison et à avoir une
conception erronée de l’existence : « vivre comme si l’on devait toujours vivre », ne pas penser à la
mort (« fragilité » renvoie à tout ce qui relève du destin et contre quoi l’on ne peut rien faire : la mort, la
maladie, les revers de la fortune, etc.), concevoir le temps comme inépuisable (« source pleine et
abondante »). Suivre sa raison revient, en revanche, à concevoir le temps comme inépuisable
(« source pleine et abondante »). Suivre sa raison revient, en revanche, à concevoir l’existence
autrement, en étant conscient que l’on ne peut rien faire face au destin et que seuls nous
appartiennent notre volonté et notre pouvoir de décision face à tout ce qui dépend de nous. Par
exemple, je ne peux faire que mon dernier jour ne soit pas le dernier jour, mais je peux faire en sorte
de ne pas « en faire cadeau à un autre, homme ou chose » : là est mon pouvoir sur le destin.
La dernière phrase du texte résume la position de Sénèque ainsi que sa philosophie morale. Il va
ainsi distinguer deux façons de vivre. La première consiste à se savoir mortel et à « posséder tout »,
c’est-à-dire pouvoir disposer de soi et à faire les bons choix en s’attachant uniquement à ce qui
dépend de nous, le terme « tout » suggérant qu’il n’y a rien d’autre à désirer. La seconde façon de
vivre, laquelle a d’ailleurs fait l’objet de la critique, consiste à se croire immortel et à s’épuiser dans la
recherche vaine de tout ce que l’on n’est jamais sûr d’obtenir.
`Le chemin vers le bonheur consistera donc à suivre la première voie et à s’écarter de la
seconde.

*
C’est une véritable leçon de vie que nous offre ici Sénèque en nous invitant à revoir notre rapport
au temps, aux choses et aux autres, afin que l’on puisse disposer davantage de soi-même et que
notre vie soit réellement consistante.
Pourtant, on pourrait se demander jusqu’à quel point on doit faire abstraction de tout ce qui, dans
l’existence, peut apparaître futile et inutile. En effet, la futilité ne contribuerait-elle pas tout de même en
partie à notre bonheur ?
*
L’intérêt de la thèse de Sénèque est de nous inviter à davantage de prudence tout au long de
notre vie pour que l’on ne se retrouve pas, comme le vieillard cité en exemple confronté, peu avant sa
mort, à la conscience d’avoir à peine vécu. En cela, il est bon de se dire, d’une part, que l’on ne doit
pas perdre tout son temps en futilités et en charges inutiles et, d’autre part, que la mort est notre
destin. On comprend que Sénèque mette indirectement en scène le thème du regret, dans la mesure
où vivre au jour le jour et sans se soucier de la mort, c’est risquer plus tard de regretter de n’avoir pas
fait ce qu’il nous sera désormais impossible de faire. Pour ne pas être confronté à ces regrets au
moment de mourir, il faut donc faire les bons choix tout au long de sa vie et s’attacher à tout ce qu’il y
a de plus essentiel dans l’existence, autrement dit à tout ce qui dépend de nous et à tout ce qui nous
permet de maîtriser notre existence. Le reste, comme le montrent les exemples de l’auteur, risquant
au contraire de nous pousser à perdre notre temps dans le fait d’essayer de satisfaire des désirs qui
ne dépendent pas de nous et qui, du coup, nous rendront malheureux : recherche du plaisir ou des
honneurs, disputes…
Cependant, il reste à définir ce qui dans l’existence humaine est vraiment essentiel ! Or, Sénèque
n’en donne aucun exemple dans ce texte. On peut faire l’hypothèse qu’il s’agit de s’appliquer à
accomplir chaque chose de manière parfaite, conformément au principe de vertu et en s’attachant
seulement à ce qui dépend de nous.
On peut donc en déduire que Sénèque ne condamne pas le fait que l’existence humaine repose
sur de petites choses. Il n’est pas toujours possible de choisir ce qu’il faut faire puisque les accidents
ne dépendent pas toujours de nous mais on peut toujours choisir la manière dont on accomplit chaque
tâche de l’existence. En cela, même les petits riens doivent être vécus ou accomplis « comme des
devoirs », autrement dit dans la perfection que leur accomplissement exige.
Quant aux vraies futilités et aux vraies pertes de temps, on pourrait reprocher à Sénèque de
trop les rejeter, car elles semblent tout de même former notre existence, forger notre caractère ou
nous laisser au moins de bons souvenirs ! Au chapitre 1 du 3
e
livre de ses Essais, Michel de
Montaigne, à la fin de sa vie, s’éloigne du stoïcisme rigoureux de Sénèque pour tendre vers
l’épicurisme : il argumente en faveur d’une réhabilitation du plaisir dans ses aspects les plus
physiques et les plus communs : « Quand je danse, je danse ; quand je dors, je dors, etc. » Le plaisir
découle de l’ordre naturel, il accompagne les besoins les plus simples et « c’est injustice de corrompre
ses règles » et il faut donc vivre « à propos », c’est-à-dire vivre pleinement, sans négliger ces petits
riens de la vie quotidienne, certes futiles mais utiles aussi à notre bonheur, en veillant toutefois à ce
qu’ils n’accaparent pas toute notre journée, notre vie.
***
La philosophie de Sénèque nous permet donc de mieux maîtriser notre existence en nous
détachant de tout ce qui ne dépend pas de nous et de tout ce qui nous fait perdre du temps. Sénèque
nous invite ainsi à avoir conscience à tout instant de notre mortalité : nous savoir mortels nous aidera
en effet à accomplir chaque tâche de notre vie avec le plus de perfection possible et nous permettra
d’être suffisamment satisfaits pour pouvoir mourir à chaque instant. Pour autant Sénèque ne nous
détourne pas de la vie ordinaire ni ne nous incite à la retraite. Il nous invite finalement au sein de notre
quotidien à agir au mieux en fonction de soi et de sa raison.
1
/
5
100%