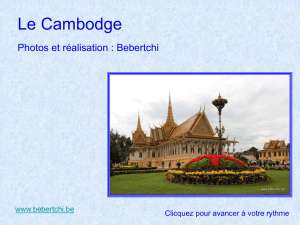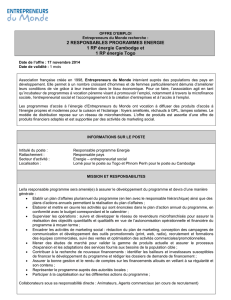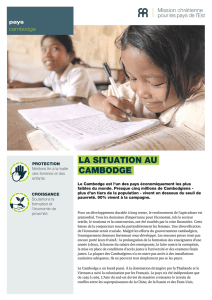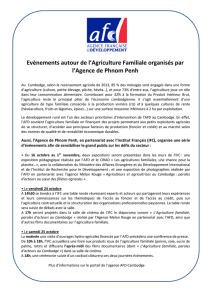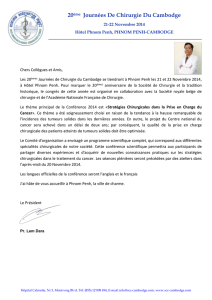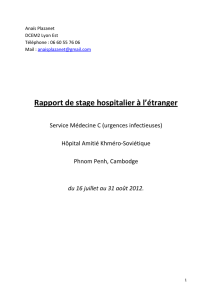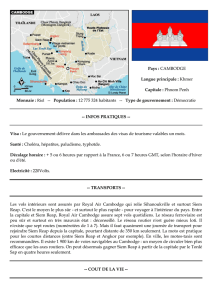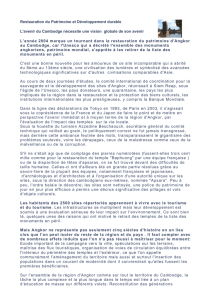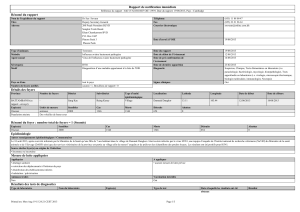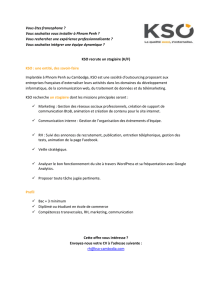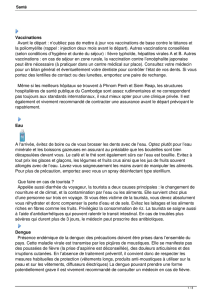FRANCE - CAMBODGE 2011
14/07
© EFEO


retour
sur images
LES TEMPS FORTS DE 2010-2011
5
4

LE TEMPLE-MONTAGNE DU
BAPHUON RENAÎT À ANGKOR
Implanté au cœur de l’ancienne cité
royale d’Angkor Thom, au sud du Pa-
lais royal, occupé sans discontinuité
durant plusieurs siècles, le Baphuon
est l’un des plus grands édifices reli-
gieux du Cambodge ancien. Struc-
ture pyramidale à trois étages sur-
montée de galeries pourtournantes,
ce temple-montagne dédié au culte
du Linga fut construit au milieu du XIe
siècle. Resté caché sous la forêt tro-
picale pendant des centaines d’an-
nées, le Baphuon est l’un des pre-
miers monuments angkoriens à être
exhumé au début du XXe siècle.
En 1960, afin d’enrayer la ruine avan-
cée de l’édifice, l’archéologue Ber-
nard-Philippe Groslier entreprend, à
partir des éléments retrouvés sur
place, une vaste opération d’anasty-
lose incluant la mise en œuvre de
renforts à l’arrière des soubasse-
ments du temple-montagne. Son
projet est malheureusement inter-
rompu par la guerre en 1971. La dis-
parition des archives du chantier en
1975 et l’étendue du champ de dé-
pose en ont fait un des chantiers les
plus difficiles de l’espace angkorien.
Depuis l’appel lancé par Sa Majesté
Norodom Sihanouk en novembre
1991 lors de la conférence de Paris
à l’UNESCO et l’inscription du site
d’Angkor sur la liste du Patrimoine
mondial en 1992, la France s’est
engagée dans un vaste programme
de coopération visant à sauvegarder
et à mettre en valeur le patrimoine
angkorien. Elle y a consacré plus de
10 M€ depuis 1995, dont 6 M€ prove-
nant du ministère des Affaires étran-
gères et européennes.
Menée depuis 1995, la restauration
du Baphuon, également financée par
l’École française d’Extrême-Orient
(2,9 M€) et le ministère de la Culture,
faisait partie intégrante de ce pro-
gramme de coopération. L’EFEO en a
été le maître d’œuvre, en partenariat
avec APSARA, l’autorité cambod-
gienne pour la protection du site et la
gestion de la région d’Angkor. Ce pro-
jet a été conduit dans le cadre de
l’action du Comité International de
Coordination pour la sauvegarde
d’Angkor (CIC), co-présidé par la
France et le Japon.
Le chantier du Baphuon a porté sur
la consolidation des trois étages de la
pyramide du temple et la restaura-
tion des éléments de façade caracté-
ristiques de cette structure (sou-
bassements, galeries, sanctuaires
d’axes). Au-delà du caractère specta-
culaire des travaux réalisés, de la
formation de 300 personnes aux mé-
thodes de restauration, ce chantier
aura aussi été un formidable labora-
toire de recherche sur l’histoire des
techniques de construction et leurs
différentes phases d’évolution. Le
temple, abandonné pendant plu-
sieurs siècles, a enfin retrouvé sa
splendeur que les visiteurs pourront
admirer dès la fin de l’année 2011.
ENTRETIEN AVEC
PASCAL ROYÈRE, ARCHITECTE,
MEMBRE DE L’EFEO,
DIRECTEUR DU PROGRAMME DE
RESTAURATION DU BAPHUON
Quelles sont les particularités du
temple du Baphuon par rapport aux
autres principaux temples d’Angkor ?
Le Baphuon fut probablement l’un
des édifices majeurs, avec l’ensemble
constitué par le Palais Royal, autour
duquel se structura la ville angko-
rienne au cours du siècle qui précéda
la construction de l’enceinte d’Angkor
Thom. Le temple a ensuite été re-
configuré lors de la refonte boud-
dhique du XVIe siècle. Une bonne par-
tie des pierres du monument a été
utilisée pour constituer une repré-
sentation du Bouddha couché. Le
temple fut ensuite progressivement
laissé à l’abandon.
Malgré de nombreuses consolida-
tions, le Baphuon a connu de graves
effondrements et s’est transformé en
une colline couverte de végétation.
LA RESTAURATION DU BAPHUON
La façade Est du temple après dégagement en 1935. © EFEO - Fonds Cambodge réf. CAM11552 Fouille archéologique des remblais de la face Sud.
Restauration de la sculpture du Bouddha couché datant du XVIe siècle sur le 2e étage de la façade Ouest. © Gilles Angles Au début du XXe siècle, l’EFEO a pris
en charge sa conservation, mais
ce n’est qu’en 1960 que les travaux
de restauration débutèrent. Il fallut
opter pour une solution radicale : dé-
monter le temple pierre par pierre,
consolider son ossature, et le recons-
truire.
Quelles ont été les principales diffi-
cultés de la réalisation de ce chan-
tier titanesque ?
Il a fallu patiemment identifier les
300 000 blocs de grès abandonnés
sur plus de dix hectares, redéfinir les
plateformes, reconstruire les gopura
et les galeries des étages supérieurs.
Une dimension nouvelle à Angkor a
alors été intégrée, celle de la conser-
vation et de la restauration de deux
états historiques du monument : le
XIe siècle, avec la restauration de la
pyramide, et le XVIe siècle, au travers
de la conservation de la sculpture
colossale du Bouddha gisant sur le
deuxième étage de la façade Ouest.
De nouvelles techniques de restau-
ration ont-elles pu émerger grâce à
ce chantier ?
L’une des principales difficultés rési-
dait dans la disparition des docu-
ments graphiques ayant servi aux in-
ventaires des maçonneries avant
démontage de l’ensemble des fa-
çades des trois étages. Ces docu-
ments étaient très importants, car ils
constituaient ce que l’on pouvait ap-
peler le « plan d’assemblage » du
temple. Leur disparition en avril 1975
à Phnom Penh nous a contraints à
élaborer une méthode d’identifica-
tion des pierres déposées, en vue de
comprendre l’unique possibilité de
remontage du monument. Pour y
parvenir, nous avons travaillé sur
l’identification des décors qui
caractérisaient ces milliers de pier-
res, pour progressivement aboutir à
la création de familles de pierres
appartenant à un même mur, une
même façade. Il s’agit ici d’une mé-
thode de travail pour recomposer un
puzzle géant en trois dimensions qui
n’avait jamais été utilisée auparavant
à Angkor.
Qu’a permis de découvrir le projet de
restauration sur l’histoire du site ?
Ce chantier a permis de collecter
toute une documentation sur l’his-
toire des techniques, les processus
de construction, mais aussi de com-
prendre les séquences temporelles,
les phases de réaffectation et de re-
fonte religieuse du temple. Nous
avons, par exemple, mis au jour des
informations sur l’existence d’un
temple plus ancien qui aurait occupé
l’espace actuel de l’emprise du Ba-
phuon, et aurait été partiellement
démonté pour permettre la construc-
tion du temple-montagne au milieu
du XIe siècle.
@ www.efeo.fr
www.autoriteapsara.org
L’ÉCOLE FRANÇAISE
D’EXTRÊME-ORIENT (EFEO)
Fondée en 1900 à Hanoi, l’EFEO a pour mission la recherche interdisciplinaire
sur les civilisations asiatiques, de l’Inde au Japon. Établissement public sous
tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, l’EFEO est
présente dans 12 pays d’Asie, à travers 18 centres. Elle regroupe 42 chercheurs
permanents assurant des études sur le terrain et animant un réseau de coopé-
rations locales et d’échanges internationaux entre scientifiques orientalistes.
Au Cambodge, l’EFEO a joué un rôle pionnier dans le dégagement, l’étude et
la restauration des sites archéologiques et des temples. Elle a aussi ouvert la
voie à différentes disciplines (histoire, épigraphie, philologie, ethnologie et
études religieuses). Elle est à l’origine, ou a largement contribué, à la mise
en place d’importantes institutions comme la Conservation d’Angkor (1907),
le Musée national (1920) et l’Institut bouddhique (1930). À l’issue de la pé-
riode khmère rouge, l’EFEO a repris pied à Phnom Penh dès 1990, puis à Siem
Reap en 1992 à la demande du gouvernement cambodgien.
À Phnom Penh, des projets sont hébergés et menés, en partenariat avec des
institutions cambodgiennes : le Fonds d’édition des manuscrits du Cambodge
au Vat Unnalom et l’atelier de conservation-restauration de sculpture du Mu-
sée national. Un inventaire archéologique et des recherches sur des lieux
saints du Cambodge ancien sont également conduits, en liaison avec le mi-
nistère de la Culture.
Le centre de Siem Reap regroupe des activités essentiellement centrées sur
les études angkoriennes : la conservation et l’étude architecturale du temple
(projet Baphuon), l’archéologie urbaine à Angkor, l’étude des âçrama (mo-
nastères), et celle de l’aménagement du territoire angkorien. Son action
s’inscrit dans le cadre d’une coopération internationale, coordonnée par
l’UNESCO, menée en partenariat avec l’Autorité APSARA et des universités
françaises et étrangères.
Bas-reliefs du pavillon axial Nord du 2e étage.
© EFEO
Travaux de finition du pavillon axial Est du 2e étage. © EFEO
Ang
kor
© EFEO
6 7

RETOUR SUR
L’HISTOIRE DU MARCHÉ…
L’édification du Marché central, le
Phsar Thmey, a suivi le développe-
ment de la ville de Phnom Penh. En
1865, deux ans après le début du pro-
tectorat, la cité est choisie pour ac-
cueillir la capitale. En 1875, elle
compte 30 000 habitants.
En 1920, au sortir de la première
guerre mondiale, Phnom Penh
compte trois quartiers distincts, au
Nord le quartier européen autour du
Phnom, essentiellement résidentiel,
au centre le quartier chinois, le plus
commerçant, et au Sud le pouvoir
royal. La France lance en métropole
et dans ses colonies une nouvelle
politique urbaine. Elle envoie un des
éminents architectes de la toute nou-
velle Société française d’urbanisme,
Ernest Hébrard, qui va créer l’École
indochinoise. Basée à Hanoi, celle-ci
impose un style rationnel et hygié-
niste, adapté au climat.
À la fin des années 1920, la construc-
tion d’un nouveau marché s’impose,
le Phsar Chaas (ou « Vieux marché »),
construit en fonte et en brique en
1892, ne suffit plus. La ville compte
alors 90 000 habitants. La municipa-
lité fait appel à la Société des grands
travaux de Marseille pour remblayer
l’emplacement du marché actuel, à
l’époque marécageux. 651 000 m3 de
terre sont apportés pour créer
200 000 m² de terrains nouveaux, en
plein cœur du quartier chinois.
Le projet de marché va être approuvé
en 1930, mais la grande crise va re-
tarder sa réalisation. Il faut attendre
1934 pour établir un programme re-
latif à « la construction du Marché
central et à l’aménagement du nou-
veau quartier Boeng Déchor ». La
réalisation est confiée à Jean Des-
bois, l’architecte de la ville depuis
1925, concepteur notamment de
l’Hôtel royal, qui élabore quatre pro-
jets. Son premier projet, choisi par la
commission municipale en 1934,
sera bâti par la SIDEC (Société Indo-
chinoise d’Études et de Construc-
tion), basée à Saigon. L’architecte
Louis Chauchon, auparavant respon-
sable de la construction de la biblio-
thèque municipale, met en œuvre le
plan de Jean Desbois. Les premières
pierres sont posées en août 1935, le
chantier s’achèvera en juin 1937. La
coupole, d’un diamètre de 30 mètres
et d’une hauteur de 26 mètres, est la
sixième au monde par sa taille. Elle
est inaugurée par le Roi Sisowath
Monivong en septembre 1937.
Extrait de
Marché central, Histoire d’une rénovation,
Melon Rouge Édition, Phnom Penh, 2011.
LA RÉNOVATION DU MARCHÉ CENTRAL
marché
central
Avec l’appui de l’Agence française de Développement (AFD), la municipalité de Phnom Penh s’est engagée dans un vaste programme de rénovation de l’un des joyaux
de la capitale, le Marché central (ou « Phsar Thmey »), comprenant plusieurs composantes : la rénovation du bâtiment historique, l’aménagement des zones com-
merciales développées autour du marché, l’amélioration des conditions de travail, notamment sanitaires, des commerçants, l’accessibilité du marché, la mise en
place d’une régie autonome permettant le financement de la maintenance des installations.
À gauche : les abords du marché en 1938,
tout juste un an après son inauguration. © Jean Desbois
À droite : le Marché central en 2011 © Agence Melon Rouge
HENG PISETH*:
“UN MARCHÉ RÉNOVÉ POUR
MIEUX TROUVER CHAUSSURE
À SON PIED”
« Piseth Heng est né à Phnom Penh en 1983. Très jeune, il commence à tra-
vailler avec sa mère et sa sœur dans la vente de chaussures au Marché cen-
tral, en parallèle à ses études (…).
Piseth prend la suite de sa mère en 2005 (…). Les travaux de rénovation ont
rendu provisoirement l’accès à certains stands plus difficile. Selon Piseth, les
ventes ont souvent pâti de cette situation, même pour les commerces déjà
installés dans la partie rénovée (…).
Néanmoins, la rénovation du Marché central a amené l’hygiène, le confort et
une meilleure sécurité (…). L’accès aux stands a été facilité. Si la rénovation a
donc pu ralentir l’économie des commerçants et réduire leur espace de vente,
le secteur rénové offre aujourd’hui un lieu plus propre, accessible et agréable
pour eux et la clientèle. »
Extrait de Marché central, Histoire d’une rénovation, Melon Rouge Édition, Phnom Penh, 2011.
* L’éditeur a volontairement modifié les noms afin de préserver l’anonymat des personnes interrogées.
En lisant le livre Marché central, His-
toire d’une rénovation, on se rend
compte qu’il s’est écoulé dix ans
entre les premières discussions au-
tour du projet et l’inauguration des
travaux en mai 2011. Quelles ont été
les principales étapes de ce projet et
les difficultés rencontrées ?
Alors que le projet initial en discus-
sion concernait trois marchés de la
capitale - outre le Phsar Thmey, le
Phsar Chaas et le Phsar Kandal -, le
choix final a été de se concentrer uni-
quement sur le Phsar Thmey. S’en-
gage alors une phase institution-
nelle : le projet, approuvé par l’AFD
en 2003, bénéficie d’une subvention
de 4,5 millions d’euros en octobre
2004. Après avoir obtenu confirma-
tion d’un cofinancement de la muni-
cipalité de Phnom Penh d’un mon-
tant de 1,5 millions d’euros, plusieurs
conditions devaient être remplies
pour engager le projet, notamment le
recensement des commerçants tra-
vaillant dans le Marché et la mise en
place d’une structure de recette au-
tonome chargée de financer la main-
tenance des installations.
Cette phase institutionnelle s’est
achevée en 2007 avec l’adoption des
statuts de la Régie autonome du Mar-
ché central. Afin d’assurer la péren-
nité des travaux de réhabilitation,
cette nouvelle structure devra gérer
les produits de redevance et garantir
des prestations de service par un
partenariat public-privé.
Parallèlement, le travail de concep-
tion et de construction du nouveau
Marché central a été attribué fin
2006, après un long processus de re-
crutement, au cabinet d’architectes
français, Arte-Charpentier, dont
l’une des plus prestigieuses réalisa-
tions est celle de l’Opéra de Shan-
ghai, et à l’entreprise VillaParc, réu-
nis en groupement. La conception
s’est avérée complexe compte tenu
LA RÉNOVATION DU MARCHÉ CENTRAL
UN PROJET DE LONGUE HALEINE
Question posée au directeur de l’Agence française de Développement,
M. Eric Beugnot
des nombreux enjeux liés au mar-
ché : la définition des objectifs des
pouvoirs locaux en termes de mobi-
lité et de stationnement à l’échelle du
quartier, le diagnostic de l’état phyto-
sanitaire de la structure historique,
l’organisation et le dimensionnement
des stands, un déplacement des
commerçants pendant la phase de
chantier, qui leur permettrait de
conserver leur activité économique.
Particulièrement délicat, étant donné
la crainte de beaucoup de commer-
çants de perdre leur concession, ce
problème a été résolu par la
construction de stands provisoires à
la périphérie immédiate du bâtiment.
Les travaux ont pu démarrer début
2009 et se sont déroulés pendant la
durée prévue, un peu plus de deux
années. Ce projet a constitué un défi :
rendre au Marché central sa splen-
deur d’antan, tout en maintenant
l’activité commerciale qui l’a tou-
jours accompagnée.
© Agence Melon Rouge
Inauguration du Marché central, par le gouverneur de Phnom Penh, S.E.M. Kep Chuktema,
et l’ambassadeur de France (Phnom Penh, 25 mai 2011).
© AFD
Disponible à la vente à l’agence Melon Rouge (contact : [email protected]).
MARCHÉ CENTRAL
HISTOIRE D’UNE RÉNOVATION
Cet ouvrage de l’AFD retrace l’histoire du
marché et l’historique du projet de réhabilita-
tion, notamment à travers des témoignages
d’experts et de commerçants, ainsi que des
reportages photos.
8 9
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%