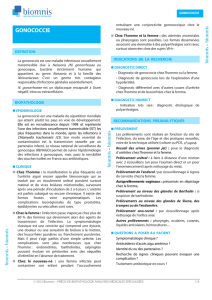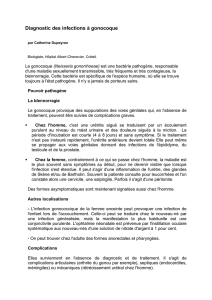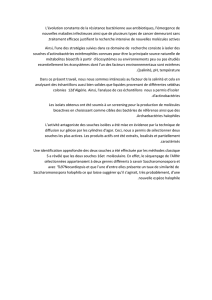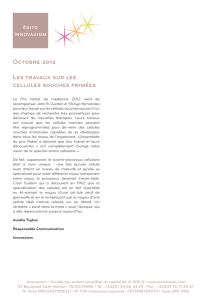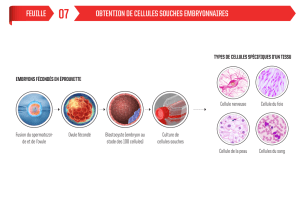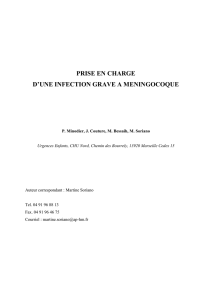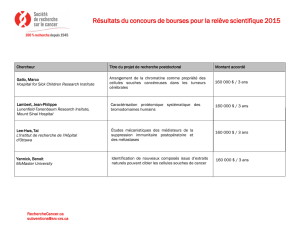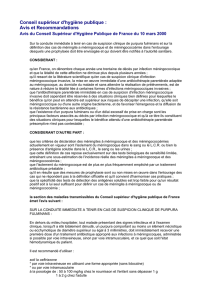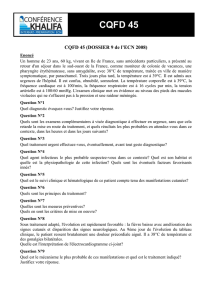Gonocoque et Méningocoque : Caractéristiques et Infections
Telechargé par
Mohamed Aymene Merad

Gonoccoque
les formes généralisées, plus fréquentes chez la femme.
bactérie est très fragile, n'est pathogène que pour l'espèce humaine
La reconnaissance d'une infection gonococcique impose une enquête épidémiologique à la recherche des
partenaires contaminants ou contaminés pour les traiter efficacement et éviter le risque de dissémination.
On peut également révéler les antigènes gonococciques par co-agglutination ou technique
immunoenzymatique.
L’infection à chlamydia est le plus souvent associée à une infection à gonocoque.
Les infections cutanées du gonocoque sont des purpura.
méningocoque
apparaissant parfois capsulés et en situation intraleucocytaire dans le liquide céphalo-rachidien purulent.
Elle peut se cultivée sur milieu ordinaire.
une bactérie fragile, craignant le froid, les variations de pH, la dessication. Il ne survit que très peu de
temps dans le milieu extérieur.
Lactose(-) (ce dernier caractère le différencie de Neisseria lactamica, commensal souvent confondu avec
Neisseria méningitidis)
Facteurs de virulence : Le méningocoque ne produit pas d'exotoxines mais possède une endotoxine à
structure lipopolysaccharidique. Les souches pathogènes possèdent des pili facilitant leur adhésion et
produisent des IgA protéases.
"purpura fulminans" de Henoch ou syndrome de Waterhouse-Frederichson, est caractérisée par une
infection méningée et septicémique accompagnée de purpura hémorragique et de collapsus.
C'est dans les tranches d'âge où les taux d'anticorps circulants sont les plus faibles que la maladie est la plus
fréquente (6 à 24 mois)
L'immunisation naturelle se produirait par la colonisation du rhino-pharynx par des méningocoques ou par
des commensales proches telle que Neisseria lactamica.
La fixation est facilitée par l'IgA protéase
rares souches produisent une pénicillinase (des souches de sensibilité diminuée aux bêtalactamines)
1
/
1
100%