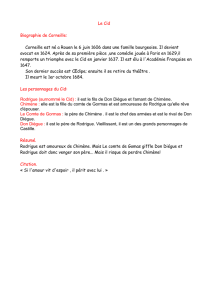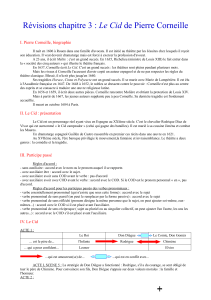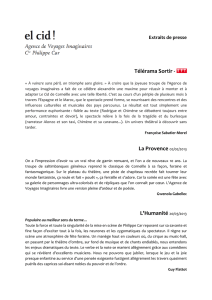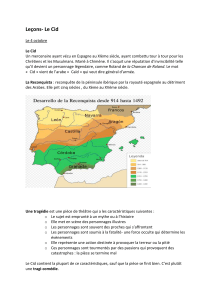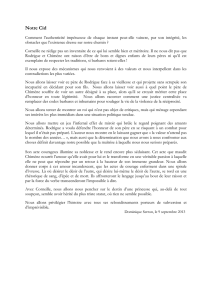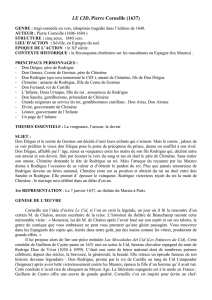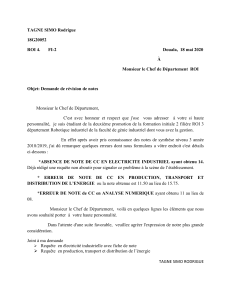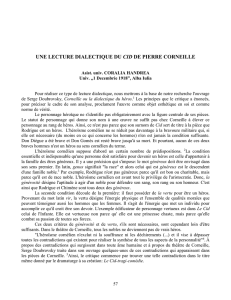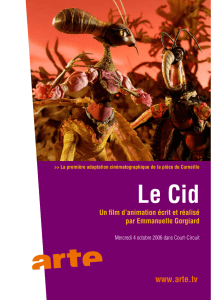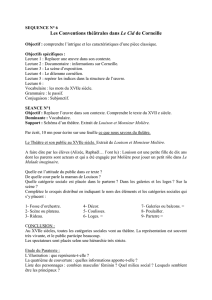Le Cid de Corneille : Analyse et Contexte - Cours de Français
Telechargé par
ferrandmarc01

—
©
Cned, Français 4e
140
Sommaire
Séquence 12
Percevoir les enjeux tragiques d’une pièce atypique :
Le Cid de Corneille
Durée approximative de la séquence : 10 h.
Séance 1 Situer l’œuvre dans son contexte
Séance 2 Saisir les enjeux d’une scène d’exposition
Séance 3 Comprendre la mise en place du tragique
Séance 4 Percevoir ce qu’est le dilemme cornélien
Séance 5 Comprendre la conséquence du dilemme
Séance 6 Découvrir un récit épique
Séance 7 Découvrir un dénouement tragi-comique
Séance 8 Je m’évalue

©
Cned, Français 4e —
141
Séquence 12
Socle commun
Durant cette séquence, tu auras l’occasion d’employer et de développer tes connaissances et
compétences relevant des domaines suivants :
COMPÉTENCE 1. La maîtrise de la langue française
Lire à haute voix, de façon expressive, un texte en prose ou en vers.
Dégager l’idée essentielle d’un texte lu ou entendu.
Comprendre un énoncé, une consigne.
Rédiger un texte bref, cohérent, construit en paragraphes, correctement ponctué, en
respectant des consignes imposées.
COMPÉTENCE 5. La culture humaniste
Lire une œuvre majeure de la culture française et la situer dans l’histoire littéraire et
culturelle.
COMPÉTENCE 7. L’autonomie et l’initiative
Connaître ton potentiel et t’auto-évaluer.

—
©
Cned, Français 4e
142
Séquence 12 — séance 1
Séance 1
Situer l’œuvre dans son contexte
Durée approximative : 1 h.
Dans cette séquence, tu vas étudier une pièce de théâtre très célèbre : Le Cid de Pierre Corneille.
Tu dois avoir fini la lecture avant de commencer cette séquence et terminé la fiche de lecture que tu
utiliseras pour répondre aux questions.
Avant toute chose, cette séance va te permettre de situer l’œuvre dans son époque : le XVIIe siècle,
une période riche en matière de création littéraire, notamment au théâtre.
Avant de commencer, prends ton cahier. En haut d’une nouvelle page, recopie en rouge le numéro
et le titre de la séquence. Encadre-les. Écris ensuite en rouge le numéro et le titre de la séance.
Souligne-les.
A
Découvrir le siècle du théâtre
Trois auteurs de pièces de théâtre du XVIIe siècle sont particulièrement connus.
1- a) Fais une recherche sur internet pour associer par des flèches les portraits de ces
auteurs à leur nom et à leurs œuvres (les noms des artistes peintres sont inscrits sous
les tableaux).
Charles Le Brun (1619-1690)
© RMN / Droits réservés
Jean Racine
Le Tartuffe
Dom Juan
Les Fourberies de Scapin

©
Cned, Français 4e —
143
Séquence 12
séance 1 —
Pierre Mignard (1612-1695)
© RMN / Agence Bulloz
Molière
Phèdre
Athalie
Bérénice
Gérard Edelinck (vers 1643-1680)
© Château de Versailles, Dist. RMN /
image château de Versailles
Pierre Corneille
Horace
Le Cid
Tite et Bérénice
b) En te référant à tes cours de sixième, es-tu capable de citer deux autres auteurs du
XVIIe siècle ?
Il est connu pour ses fables : .................................................. .
Il est connu pour ses contes : ................................................. .
Vérifie tes réponses.
2- a) En relisant les titres des œuvres dans le tableau (de la question 1.a), quelle remarques
peux-tu faire pour deux d’entre eux ?
b) Que serais-tu tenté(e) d’en déduire ?
Vérifie tes réponses.
c) De qui La Fontaine s’est-il inspiré pour écrire ses fables ?
d) À quelle époque cet auteur a-t-il vécu ?
Vérifie tes réponses.
Recopie le « Je retiens » qui suit dans ton cahier et apprends-le.

—
©
Cned, Français 4e
144
Séquence 12 — séance 1
Le siècle du classicisme
Étymologiquement, un texte classique désigne un texte qui est digne d’être étudié en
classe. Les œuvres classiques sont donc des œuvres reconnues comme des œuvres d’une
très grande qualité.
Effectivement, les auteurs du XVIIe siècle cherchent à atteindre la perfection. Ils
s’inspirent donc des auteurs qui, selon eux, ont écrit les plus belles œuvres durant
l’Antiquité pour tenter de les surpasser. Il ne s’agit donc pas d’une simple copie : on
parle d’émulation.
j
e retiens
le coin des curieux
Le classicisme n’est pas un mouvement seulement littéraire. Tu trouveras sur Internet des
exemples de peinture classique, de sculpture classique, d’architecture classique, etc. Le
château de Versailles, par exemple, illustre le goût du XVIIe siècle pour les lignes classiques.
B
Comprendre la querelle du Cid
C’est donc dans le contexte particulier des débuts du classicisme que Corneille crée Le Cid en
1637.
1- a) Qui est au pouvoir en France à la date de la création du Cid ?
b) Quel est le personnage, dans Le Cid, qui prononce la dernière réplique ?
c) Est-ce un hasard, à ton avis ?
Vérifie tes réponses.
d) Contre quel pays, à cette époque, la France est-elle en guerre ?
e) Où se déroule l’action du Cid ?
f) Cela risque-t-il d’être bien perçu par le public de la pièce ?
Vérifie tes réponses.
j
e sais déjà
En sixième, tu as certainement vu la règle des trois unités. Voici un petit rappel.
Le théâtre classique se doit de respecter les règles qui étaient en vigueur sous l’Antiquité,
période durant laquelle elles ont été mises par écrit par le philosophe Aristote :
• L’unité de temps veut que l’action représentée sur scène n’excède pas vingt-quatre heures
(ce qu’Aristote désigne comme une « révolution du soleil ») ;
• L’unité de lieu veut que l’action représentée sur scène se déroule en un lieu unique ;
• L’unité d’action veut que la pièce s’intéresse à une action principale sans se perdre dans
de multiples actions secondaires.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
1
/
36
100%