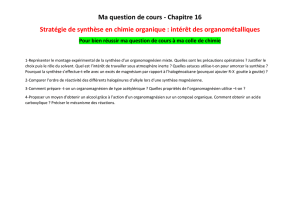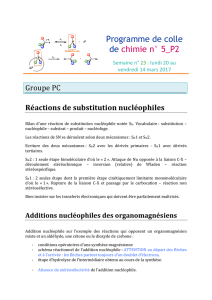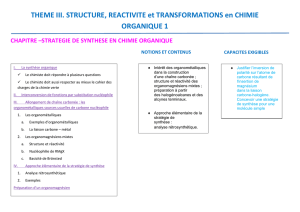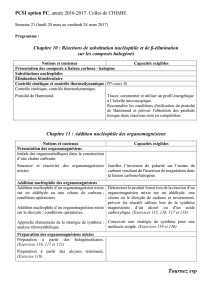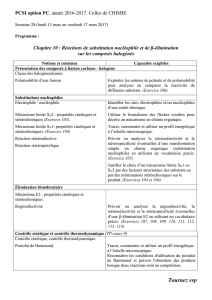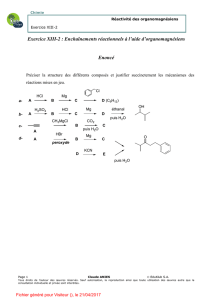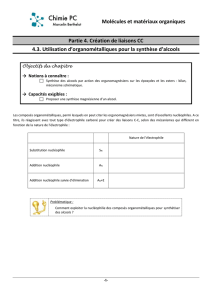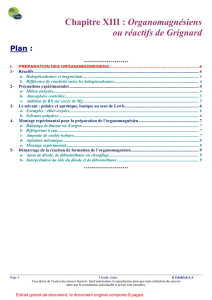Chapitre 14
Organomagnésien et addition nucléophile
(An)
Contents
14.1 LesOrganomagnésiens .......................................188
ADonnées structurales .......................................188
BNucléophilie et basicité de l’organomagnésien .......................... 189
14.2 Synthèse d’un organomagnésien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
ALa réaction de synthèse ...................................... 191
BLe choix du solvant ....................................... 191
CLe choix de l’halogène ...................................... 192
DDémarrages diciles et autres précautions ........................... 192
14.3 Applicationensynthèse.......................................193
ALa stratégie de synthèse organique ................................ 193
BRallonger le squelette carboné .................................. 193
CRéaction avec l’eau ........................................ 193
DRéaction avec le dioxygène .................................... 193
ERéaction avec les aldéhydes et les cétones ............................ 193
187

188 CHAPITRE 14. ORGANOMAGNÉSIEN ET ADDITION NUCLÉOPHILE (AN)
14.1 Les Organomagnésiens
ADonnées structurales
⌘Liaison carbone-métal
Les organomagnésiens appartiennent à la catégorie des composés organométalliques. Ces composés com-
portent une liaisons entre un atome de carbone et un métal. Il convient de comparer les électronégativités de
ces composés aÆn de décrire avec le bon modèle (covalent ou ionique) cette liaison.
Figure 14.1 – Eléctronégativité dans l’échelle de Alled-Rochow
La Ægure 14.1 montre que le carbone est plus électronégatif que les métaux, et en particulier plus électroné-
gatif que le magnésium. De ce fait dans une liaison Carbone-métal, le carbone portera une charge partielle .
On peut estimer cette charge partielle par une formule empirique :
=0,016+0,0035()2
L’application de cette formule donne les résultats du tableau 14.2.
Figure 14.2 – Pourcentage d’ionicité des liaisons carbone-métal
On voit que le pourcentage d’ionicité bien qu’important reste loin de 1, la description de la liaison carbone-
métal en terme de liaison covalente semble donc appropriée.
⌘Structure de Lewis d’un organomagnésien
Les organomagnésiens mixtes de Grignard possède la structure présentée ci-après où Xdésigne un halogène
et Run groupe alkyl.
RMg X
Figure 14.3 – Structure de Lewis d’un organomagnésien
La nomenclature de ces composés est du type halogénure d’alkylemagnésium ou d’arylmagnésium

14.1. LES ORGANOMAGNÉSIENS 189
Figure 14.4 – Exemples d’organomagnésiens mixtes
(a) est l’iodure d’isopropylmagnésium
(b) est le bromure de phénylmagnésium
(c) bromure de benzyl magnésium
(d) chlorure de 2-méthylprop-1-énylmagnésium
(e) chlorure de 2-méthylprop-2-énylmagnésium
(f) Bromure de hex-1-ynylmagnésium
Lors de la synthèse des organomagnésien, ceux-ci ont tendance à réagir entre eux dans le milieu réactionnel
si bien qu’on peut les trouver sous forme de dimères (notamment en présence de chlore comme halogène) Outre
Figure 14.5 – Structure dimérique
cette structure dimérique, il s’établit un équilibre entre la forme décrite par la Ægure 14.3 et un dialkylmagnésium.
ces formes montrent la complexité du composé étudié ici, toutefois nous adopterons la structure simple de la
Figure 14.6 – Equilibre de Schlenk
Ægure 14.3 pour la suite de ce cours.
BNucléophilie et basicité de l’organomagnésien
⌘Basicité de l’organomagnésien
La basicité de l’organomagnésien peut tout d’abord s’expliquer par les lacunes présentes sur l’atome de
magnésium. ces lacunes rendent l’organomagnésien accepteur de doublets électroniques donc base de Lewis.

190 CHAPITRE 14. ORGANOMAGNÉSIEN ET ADDITION NUCLÉOPHILE (AN)
Figure 14.7 – Description Ionique et caractère basique
d’autre part, comme l’a mis en évidence l’étude de la liaison carbone-magnésium, cette liaison est fortement
polarisée si bien que dans un cas limite, on pourra s’appuyer sur une description ionique de la liaison. On voit
apparaitre dans cette description l’anion R, base du couple RH/R. Cette base est une base forte et le pKa
du couple considéré dépasse 14, il doit donc être déterminer dans un autre solvant que l’eau.
Le pKa du couple ainsi déÆni dépend de l’alkyle ou de l’aryle auquel est lié l’atome de magnésium.
Figure 14.8 – pKa de quelques organomagnésiens
la Ægure 14.8 montre que les organomagnésiens réagissent quantitativement avec les acides, même avec les
acides très faibles dans l’eau. On constate notamment que les organomagnésien peuvent donner une réaction
acido-basique avec les alcools, les amines non tertiaires, les aldéhydes et les cétones (notamment avec les
hydrogènes en ↵du groupe caractéristique.) La Ægure 14.9 donne comme exemple la réaction d’un chlorure de
magnésium avec l’eau.
Figure 14.9 – Exemple de réaction acido-basique
On constate que cette réaction aboutit à un alcane, cette fonction étant peu prisée lors d’une stratégie de
synthèse, il s’agit souvent d’une réaction parasite. D’autre part, il se forme outre cet alcane, les ions HOet
+MgX. Nous avons noté entre guillemets cette paires d’ions aux vues de la diérence d’électronégativité entre
l’oxygène et le magnésium mais cette structure n’a pas été mise en évidence.
En milieu acide, il se forme les ions Mg2+ et chlorure Cl. Tandis qu’en milieu basique, il se forme le
précipité Mg(OH)2
⌘Nucléophilie
Pour comprendre la réactivité des organomagnésiens il faut encore une fois s’intéresser à la diérence
d’électronégativité entre le carbone et le magnésium. Le carbone étant plus électronégatif il porte une charge
partielle ce qui en fait un nucléophile.
Les organomagésiens sont des nucléophiles ils sont très réactifs vis à vis des sites électrophiles. On citera
pour l’heure l’exemple de la réaction entre un organomagnésien et un halogénoalcane. Cette réaction porte le
nome de réaction d’alkylation ou de couplage.

14.2. SYNTHÈSE D’UN ORGANOMAGNÉSIEN 191
Figure 14.10 – Réaction d’alkylation de Würtz
14.2 Synthèse d’un organomagnésien
ALa réaction de synthèse
Il est possible de synthétiser une grande variété d’organomagnésiens, mais quelque soit l’espèce synthétisée
il s’agit toujours d’une opération délicate.
On utilise pour réaliser l’organomagnésien, un montage à reØux avec un ballon bicol. Une ampoule de coulée
contenant l’halogénoalcane dans le solvant et fermée par une garde sèche (au CaCl2) pour empêcher toute
entrée d’eau. Le ruban de magnésium est introduit dans le ballon puis juste recouvert de solvant parfaitement
sec. Un agitateur magnétique est introduit lorsque la quantité de métal est importante.
Quelques gouttes d’halogénoalcanes sont introduites et la réaction si elle ne démarre pas spontanément peut
être amorcée par un léger chauage (la paume de la main ou un sèche cheveux). Une fois la réaction amorcée,
celle-ci étant exothermique, il n’est plus nécessaire de chauer.
Le schéma du montage est donné Ægure 14.11
Figure 14.11 – Montage pour la synthèse d’un organomagnésien
BLe choix du solvant
L’organomagnésien doit être synthétisé dans un solvant parfaitement anhydre, l’eau étant protogène, et
l’organomagnésien une base forte, l’eau ne peut pas servir de solvant. Outre cette précaution, le magnésium
comporte deux lacunes et sera donc stabilisé par un solvant comportant des doublets d’électrons. On utilise
principalement deux solvants :
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%