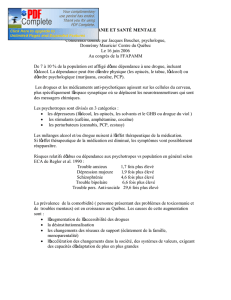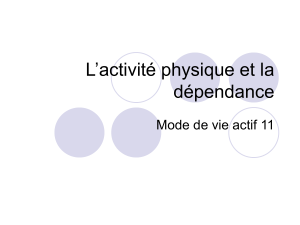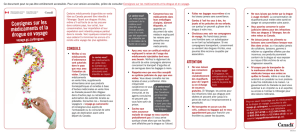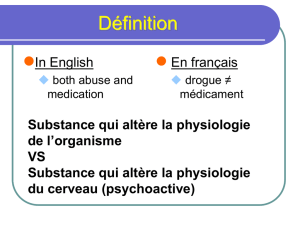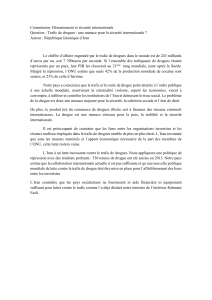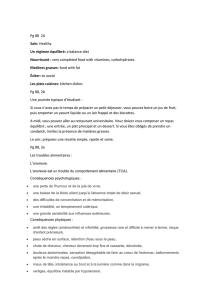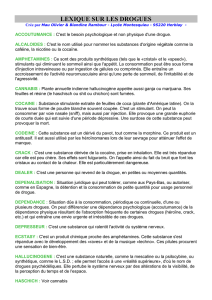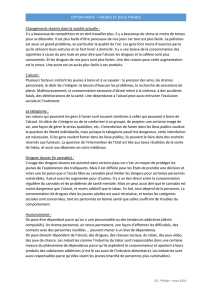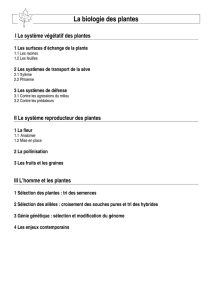Des plantes magiques au développement économique

1
Université de Paris X Nanterre
Université de Paris I Panthéon Sorbonne
Institut National Agronomique Paris Grignon
Des plantes magiques au développement économique
Le recours à l’économie de la drogue dans les pays du Sud
Mémoire de D.E.A.
Formation doctorale
« Géographie et pratique du développement dans le Tiers-Monde »
Pierre-Arnaud Chouvy
pachouvy@yahoo.com
www.geopium.org
Sous la direction de
Monsieur le Professeur Roland Pourtier
1997

2

3
« La drogue colle à l’homme comme la peau à sa chair »
Jean-Marie Pelt, Drogues et plantes magiques, 1983, p. 7
« Infusions et concentrés, décoctions et élixirs, poudres et pilules, onguents, pâtes et
gommes peuvent servir de drogues, en ce sens spécifique. La matière peut être solide,
liquide, fumeuse ou gazeuse ; elle peut être mangée, bue, absorbée par massage, inhalée,
fumée, prisée, injectée. »
Ernst Jünger, Approches, drogues et ivresse, 1973, p.31

Tables des matières 2
Introduction (4)
1. Géographie mondiale des plantes à drogues (7)
1. 1. De la géographie humaine à la géographie des plantes à drogues (7)
1. 1. 1. De la diversité et de la profusion des plantes à drogues (7)
1. 1. 2. L’homme et les plantes à drogues, une géographie particulière (9)
1. 2. Des plantes à drogues aux drogues, entre traditions et modernité (12)
1. 2. 1. Quelles notions pour quelles réalités ? (12)
1. 2. 2 Représentations collectives et réalités objectives: traditions et modernité (14)
1. 2. 3. Les plantes à drogues et les drogues dans l’histoire (18)
1. 3. Géographie du développement et production des plantes à drogues (24)
1. 3. 1. La répartition mondiale des cultures des plantes à drogues (24)
1. 3. 2. La production des plantes à drogues et les aires de sous-développement (30)
1. 3. 3. Les principaux producteurs de plantes à drogues (35)
Conclusion (40)
2. Les structures de l’économie de la drogue (42)
2. 1. L’économie mondiale de la drogue, de la production à la consommation (43)
2. 1. 1. Le commerce de la drogue, une économie politique (43)
2. 1. 2. Spécificités de l’économie de la drogue (45)
2. 1. 3. Les données de l’économie mondiale de la drogue (48)
2. 2. Des plantes aux drogues : rendements, prix et acteurs (53)
2. 2. 1. Du pavot à l’héroïne (54)
2. 2. 2. De la coca à la cocaïne (56)
2. 2. 3. Les revenus des acteurs, une répartition inégalitaire (60)
2. 3. Les dialectiques drogues-développement (63)
2. 3. 1. La production de plantes à drogues comme conséquence
du sous-développement (64)
2. 3. 2. Les conséquences socio-économiques de la production (69)
de plantes à drogues dans les pays en voie de développement
2. 3. 3. Le développement alternatif : quelles réalités ? (74)
Conclusion (78)

Tables des matières 3
3. Etats, drogues et sociétés (80)
3. 1. Des conflits sous l’emprise de la drogue (81)
3. 1. 1. La dialectique drogues/conflits dans les pays du Sud (81)
3. 1. 2. La frontière afghano-pakistanaise (84)
3. 1. 3. Les guérillas péruviennes (86)
3. 2. Le Triangle d’Or, un « laboratoire vivant de la géopolitique » des drogues (90)
3. 2. 1. Le Triangle d’Or, espace polyethnique et interétatique de production
illégale (90)
3. 2. 2. Les guérillas de la drogue, Khun Sa et l’Etat shan (95)
3. 2. 3. Les géopolitiques de l’intégration dans le Triangle d’Or (100)
3. 3. Les territoires entre Etats et sociétés (104)
3. 3. 1. De l’Etat et des modèles politico-territoriaux (105)
3. 3. 2. « L’irruption des sociétés » et le recours à l’économie de la drogue (107)
3. 3. 3. La production de drogues au cœur de « la dialectique
de l’intégration/exclusion » (110)
Conclusion (113)
Conclusion générale (114)
Bibliographie (116)
Table des cartes, tableaux et graphiques (122)
Index (123)
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
1
/
117
100%