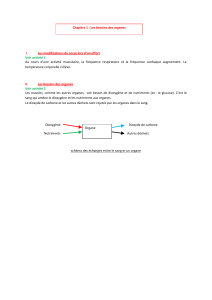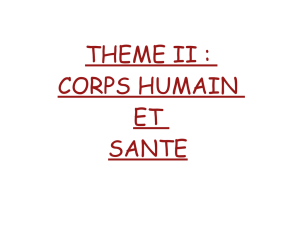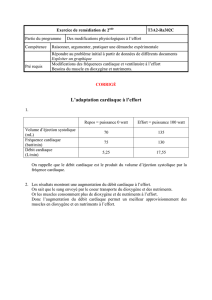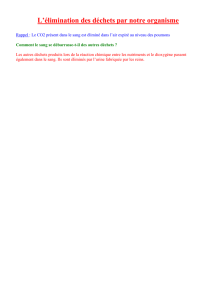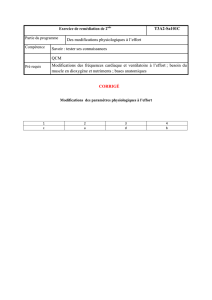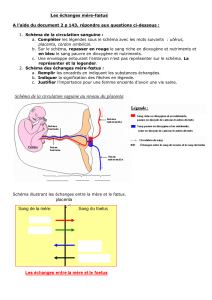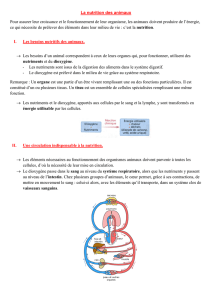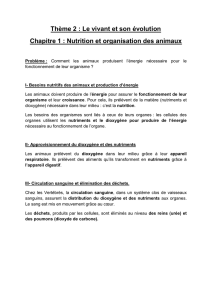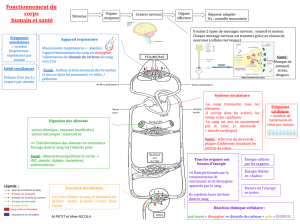les principaux biomes aquatiques (extrait de Campbell 2007)

Figure 50.17
Les biomes aquatiques
Milieu physique Les étendues d'eau dormante vont des étangs de quelques
mètres carrés aux lacs s'étendant sur plusieurs milliers de kilomètres carrés.
L'intensité de la lumière diminue avec la profondeur, ce qui crée une strati-
fication verticale (figure 50.16a). Dans les lacs des zones tempérées, la ther-
mocline peut être saisonnière (voir la figure 50.13)
;
dans les lacs des basses
terres tropicales, la thermocline est présente toute l'année.
Lac oligotrophe à
Grand Teton, au
Wyoming
Lac eutrophe dans le delta
de l'Okavango, au Botswana
Milieu chimique La salinité (teneur en sel), la concentration en dioxygène
et la teneur en nutriments, qui
diffèrent
beaucoup d'un lac à l'autre, peuvent
varier considérablement selon les saisons. Les lacs oligotrophes sont pauvres
en nutriments et en général riches en dioxygène; les lacs eutrophes, quant à
eux, sont riches en nutriments et présentent souvent une concentration en
dioxygène réduite lorsqu'ils sont recouverts de glace durant l'hiver et dans
leur partie la plus profonde au cours de l'été. La quantité de matière orga-
nique décomposable dans les sédiments benthiques est faible dans les lacs
oligotrophes et élevée dans les lacs eutrophes.
Caractéristiques géologiques Les lacs oligotrophes tendent à avoir
une moins grande superficie par rapport à leur profondeur que les lacs
eutrophes. Avec le temps, les lacs oligotrophes peuvent devenir eutrophes, à
mesure que le ruissellement y apporte des sédiments et des nutriments.
Organismes photosynthétiques L'activité de photosynthèse est plus grande
dans les lacs eutrophes que dans les lacs oligotrophes. Les plantes aquatiques
enracinées et flottantes abondent dans la zone littorale, soit dans les eaux
peu profondes et bien éclairées qui se situent à proximité du rivage. Plus
éloignée du rivage, la zone limnétique, où les eaux sont trop profondes pour
permettre aux plantes aquatiques de s'enraciner, contient diverses espèces de
phytoplancton et de Cyanobactéries.
Animaux Dans la zone limnétique, de petits Animaux en suspension, le
zooplancton, se nourrissent de phytoplancton. La zone benthique est habi-
tée par divers Invertébrés, dont la composition en espèces dépend en partie
des taux de dioxygène. Des Poissons vivent dans toutes les zones des lacs qui
contiennent suffisamment de dioxygène.
Conséquences de l'activité
humaine
L'enrichissement en nutriments
des lacs attribuable à la pollution causée par le ruissellement provenant
des terres fertilisées et le déversement des déchets urbains peut donner lieu
à la prolifération des Algues, à la réduction de la quantité de dioxygène et à
la mort des Poissons.
Milieu physique
An
sens large, une terre humide est une zone de terre cou-
verte d'eau pendant une période assez longue pour permettre à des plantes
aquatiques d'y vivre. En fait, les terres humides vont des sites périodique-
ment inondés aux
sols
saturés d'eau en permanence.
Milieu chimique En raison de la production et de la décomposition élevées
des matières organiques dans les terres humides, l'eau et le
sol
sont périodi-
quement pauvres en dioxygène dissous. Leur capacité de filtrer les nutri-
ments dissous et les polluants chimiques est élevée.
Caractéristiques géologiques Les
terres
humides de bassin se forment dans
des mares peu profondes, qui vont des dépressions dans des milieux secs aux
lacs et étangs envahis par la végétation. Les terres humides riveraines se
forment le long des rives peu profondes et périodiquement inondées des
rivières et des cours d'eau peu profonds. Enfin, les terres humides du littoral
se trouvent le long des côtes des grands lacs et océans, où l'eau effectue un
mouvement de va-et-vient résultant du niveau d'eau qui s'élève ou de
l'action des marées. Ainsi, ces terres humides font partie aussi bien d'un
biome
dulcicole que d'un
biome
marin.
Organismes photosynthétiques Les terres humides comptent parmi les
biomes les plus productifs de la Terre. Leurs
sols
saturés d'eau favorisent la
croissance de plantes, comme les nénuphars (Nuphar sp.), les quenouilles
(Typha sp.), de nombreux carex (Carex sp.), les mélèzes (Larix laricina) et les
épinettes noires (Picea mariana), qui sont spécialement adaptées pour vivre
dans l'eau ou dans un
sol
rendu périodiquement anaérobie par la présence
de l'eau. Les plantes ligneuses dominent la végétation des marécages, et la
sphaigne (Shagnum sp.), celle des tourbières.
Animaux Les terres humides sont le milieu de vie d'une communauté variée
d'Invertébrés, qui, à leur tour, nourrissent une grande variété
d'Oiseaux.
Les
Okefenokee National Wetland
Reserve,
en Géorgie (États-Unis)
herbivores, des Crustacés aux rats-musqués communs (Ondatra zibethicus)
en passant par les larves d'Insectes aquatiques, consomment des Algues, des
détritus et des Végétaux. Elles abritent aussi de nombreuses espèces de carni-
vores,
dont les libellules, les loutres, les alligators et les chouettes.
Conséquences de l'activité humaine Dans certaines régions, l'assèchement
et le remblayage ont détruit jusqu'à 90 % des terres humides.
1188 HUITIèME PARTIE
L'écologie

Milieu physique La principale caractéristique physique des ruisseaux, des
rivières et des fleuves est le courant. Tout en amont, l'eau des ruisseaux est
froide, claire, agitée et coule rapidement. En aval, lorsque plusieurs affluents
se sont rejoints pour former une rivière, l'eau est généralement plus chaude
et plus trouble, car les rivières charrient d'ordinaire plus de sédiments que
leurs eaux d'amont. Les fleuves, les rivières et les ruisseaux se
stratifîent
en
zones verticales, qui s'étendent de l'eau de surface à l'eau de fond.
Milieu chimique La teneur en sel et en nutriments des ruisseaux, des
rivières et des fleuves est plus élevée en amont qu'à l'embouchure. Dans les
ruisseaux, l'eau d'amont est en général riche en dioxygène. Les rivières et
les fleuves peuvent aussi contenir une importante quantité de dioxygène,
sauf là où l'eau est enrichie de matières organiques d'origine naturelle ou
provenant de l'activité humaine.
Caractéristiques géologiques En amont, les chenaux des ruisseaux sont
souvent étroits
;
ils présentent un fond rocheux formé alternativement de
seuils et de fosses. En aval, l'écoulement des eaux des rivières et des fleuves
s'effectue dans des chenaux qui sont généralement larges et sinueux. Leur fond
est souvent limoneux
:
des sédiments s'y sont déposés au fil du temps.
Organismes photosynthétiques En amont des ruisseaux qui coulent dans
les prairies ou les déserts, l'eau est parfois riche en Algues ou en plantes
aquatiques à racines; mais dans les ruisseaux qui coulent dans les forêts
tempérées ou tropicales, les feuilles mortes et d'autres matières organiques
provenant de la végétation terrestre constituent la principale source d'ali-
mentation des organismes aquatiques. Dans les rivières et les fleuves, les
matières organiques sont constituées en grande partie des matières dissoutes
et très fragmentées qui proviennent de l'eau d'amont des ruisseaux forestiers
charriée par le courant.
Animaux Une grande diversité de Poissons et d'Invertébrés vivent dans les
ruisseaux, les rivières et les fleuves non pollués. La distribution des espèces
s'effectue à travers les zones verticales.
Conséquences de l'activité humaine La pollution urbaine, agricole et
industrielle dégrade la qualité de l'eau et tue les organismes aquatiques.
L'endiguement et la lutte contre les crues perturbent le fonctionnement
naturel des écosystèmes que constituent les ruisseaux, les rivières et les fleuves,
et menacent les espèces migratrices comme le saumon.
Ruisseau d'amont dans
les Great
Smoky
Mountains
Le fleuve Mississippi, loin
de ses eaux d'amont
Estuaire en delta de la Copper River, en Alaska
Milieu physique Un estuaire est la zone de transition entre un fleuve et
l'océan. L'eau des estuaires présente des mouvements très complexes.
Lorsque la marée monte, l'eau de mer remonte le chenal de l'estuaire, puis
se retire lorsque la marée descend. Souvent, le fond du chenal contient de
l'eau de mer, de forte densité, tandis que de l'eau fluviale, d'une densité
moindre, forme une couche superficielle qui se mélange peu avec
la
couche
inférieure salée.
Milieu chimique Dans les estuaires, la salinité de l'eau n'est pas la même
partout
:
elle varie de celle de l'eau douce à celle de l'eau de mer. La salinité
varie également suivant le cycle quotidien des marées. Enrichi par les nutri-
ments provenant des fleuves, les estuaires, comme les terres humides,
comptent parmi les biomes les plus productifs de la Terre.
Caractéristiques géologiques Les mouvements de l'eau des estuaires conju-
gués aux sédiments charriés par les fleuves et les marées créent un réseau com-
plexe de chenaux à marée, d'îles, de levées alluviales naturelles et de vasières.
Organismes photosynthétiques Les plantes herbacées des marais salants
et les Algues, y compris le phytoplancton, sont les principaux producteurs
des estuaires.
Animaux Des vers, des huîtres, des crabes et de nombreuses espèces de
Poissons comestibles habitent aussi les estuaires. En raison de l'abondante
nourriture qu'ils y trouvent, de nombreux Invertébrés et Poissons marins s'y
reproduisent ou s'y arrêtent au cours de leur migration vers les habitats
dulcicoles situés en amont. Enfin, les estuaires constituent des aires de nutri-
tion pour de nombreux Vertébrés semi-aquatiques, pour les Oiseaux de
rivage en particulier.
Conséquences de l'activité humaine Partout dans le monde, les polluants
déversés en amont, de même que les travaux de remblayage et de dragage,
portent atteinte aux estuaires.
Suite à la page suivante
CHAPITRE
50 L'écologie et la biosphère
:
introduction
1189

Figure 50.17 (suite)
Les biomes aquatiques
ZONES INTERTIDALES
tïf"™
J$
J -
-" •
<<*À
-'.
'**<>-«•'
**.&*
-
Zone intertidale rocheuse du littoral de l'Oregon
Milieu physique Une zone intertidale est tour à tour submergée et décou-
verte au cours du cycle biquotidien des marées. Les zones supérieures sont
plus longtemps exposées à
l'air,
et leur milieu physique présente de plus
grandes variations. Parmi les contraintes physiques auxquelles font face les
organismes qui y vivent, on compte les fluctuations de la température et de
la salinité de l'eau, ainsi que la force mécanique des vagues. Les différences
dans les conditions physiques qui caractérisent la zone intertidale supérieure
et la zone intertidale inférieure limitent la distribution de nombreuses
espèces d'organimes à certaines strates, comme l'illustre la photo.
Milieu chimique Les concentrations de dioxygène et de nutriments sont
généralement élevées et se renouvellent à chaque retour de la marée.
Caractéristiques géologiques Les substrats des zones intertidales, qui sont
en général soit rocheux, soit sablonneux, déterminent des adaptations com-
portementales et anatomiques chez les organismes de la zone intertidale. La
configuration des baies ou du littoral influe sur l'amplitude des marées et
l'exposition relative des organismes intertidaux à l'action des vagues.
Organismes photosynthétiques Les zones intertidales rocheuses, surtout
inférieures, abritent des Algues enracinées dont la diversité et la biomasse
sont imposantes. En raison de l'instabilité du substrat, les zones sablonneuses
exposées à de fortes vagues ne contiennent pas de plantes ni d'Algues
enracinées, alors que celles qui se trouvent dans des baies protégées ou des
lagunes portent souvent de riches bancs d'Algues et d'herbes marines
comme les zostères.
Animaux Beaucoup des Animaux vivant dans les zones intertidales
rocheuses possèdent des adaptations structurales qui leur permettent de
s'attacher au substrat dur. Dans les zones supérieures, la composition, la
densité et la diversité des Animaux sont sensiblement différentes de celles
des zones inférieures. Là où les substrats sont sablonneux (plages) ou
vaseux, de nombreux Animaux, tels les vers, les palourdes et les Crustacés
prédateurs, s'enfouissent dans le sable ou dans la vase et se nourrissent à
marée montante. Les Porifères (les Éponges), les Cnidaires (les anémones de
mer),
les Mollusques, les Échinodermes, de même que de petits Poissons,
sont aussi communs dans ces milieux.
Conséquences de l'activité humaine La pollution par le pétrole a eu des
effets nuisibles sur de nombreuses zones intertidales. Par ailleurs, l'utilisa-
tion à des fins récréatives du littoral a fait beaucoup diminuer le nombre
d'Oiseaux nichant sur les plages et le nombre de tortues de mer.
BIOME OCÉANIQUE PÉLAGIQUE
Milieu physique Le biome océanique pélagique est une vaste étendue
d'eaux libres bleues, sans cesse agitées par les courants causés par les vents.
Les eaux de surface des océans tempérés se renouvellent de l'automne au
printemps. En raison de
la
plus grande clarté de ses eaux, la zone euphotique
est plus profonde que celle des eaux côtières.
Milieu chimique En général, ces eaux présentent un taux de dioxygène élevé
et sont généralement plus pauvres en nutriments que celles du littoral. Dans
certaines régions tropicales, les eaux superficielles sont plus pauvres en nutri-
ments que celles des océans tempérés parce que leur stratification thermique
se maintient pendant toute l'année. Dans les zones euphotiques des océans
des régions tempérées et des régions proches des pôles, le
renouvellement qui se produit de l'automne au printemps
permet l'échange de nutriments entre la surface et le fond.
Caractéristiques géologiques La caractéristique la plus mar-
quante du biome océanique pélagique est son immensité et la
grande profondeur des bassins océaniques. Ce biome couvre
approximativement 70% de la surface de la Terre, et sa pro-
fondeur moyenne atteint près de 4 000 m. Le point le plus
profond de l'océan se situe à
plus
de 10 000 m de la surface.
Organismes photosynthétiques Le phytoplancton, qui com-
prend les Bactéries photosynthétiques, forme le principal
ensemble d'organismes photosynthétiques qui sont transpor-
tés par les courants océaniques. Le renouvellement printan-
nier et la remontée des nutriments provoquent, dans les
océans tempérés, une prolifération de phytoplancton. Malgré
l'étendue de son biome, le plancton photosynthétique est à
l'origine de moins de la moitié de l'activité photosynthétique
effectuée sur la Terre. Pleine mer,
Animaux L'ensemble d'Animaux et d'autres hétérotrophes le plus abondant
dans ce biome est le zooplancton. Le zooplancton, constitué de Protistes, de
vers,
de Copépodes, de krill (Euphausia superba) et de méduses, ainsi que les
petites larves d'Invertébrés et certains Poissons se nourrissent de phyto-
plancton. Le biome océanique pélagique comprend aussi des Animaux
qui nagent librement, comme les calmars, les Poissons, les tortues et les
Mammifères marins.
Conséquences de l'activité humaine La surpêche a appauvri les stocks
de Poissons de tous les océans de la Terre, qui ont aussi été pollués par
les
déchargements de déchets et les déversements de pétrole.
au large de
l'île
d'Hawaii
1190 HUITIèME
PARTIE
L'écologie

Milieu physique Les récifs de corail ne se trouvent que dans la zone eupho-
tique des milieux marins tropicaux relativement stables dont les eaux sont
très limpides. Ils sont affectés par les températures de moins de 18 à 20 °C et
de plus de 30 °C.
Milieu chimique Les coraux nécessitent des taux de dioxygène élevés et ne
peuvent vivre dans les milieux où l'apport en eau douce et en nutriments est
considérable.
Caractéristiques géologiques Pour se fixer, les coraux ont besoin d'un
substrat solide. Un récif de corail, formé en grande partie du carbonate de
calcium provenant des squelettes des coraux, se constitue lentement sur une
île océanique. D'abord récif frangeant sur une jeune île haute, il devient plus
tard au cours de l'histoire de
l'île
un récif-barrière extracôtier, puis un atoll
corallien tandis que
l'île
est submergée.
Organismes photosynthétiques Les Dinoflagellés mutualistes qui vivent
dans les tissus des coraux créent une association symbiotique permettant à
ces derniers d'obtenir des molécules organiques. Diverses Algues marines
rouges et vertes sont aussi responsables d'une grande partie de la photosyn-
thèse effectuée sur les récifs coralliens.
Animaux Les coraux eux-mêmes, constitués de divers groupes de Cnidaires
(voir le chapitre 33), sont les Animaux qui prédominent sur les récifs coral-
liens.
Toutefois, on y trouve aussi une variété exceptionnelle de Poissons et
d'Invertébrés. À l'échelle planétaire, la diversité des Animaux vivant sur les
récifs coralliens rivalise avec celle des forêts tropicales.
Conséquences de l'activité humaine La cueillette des squelettes coralliens,
souvent faite à l'aide de poisons et d'explosifs, de même que la surpêche pra-
tiquée soit à des fins alimentaires, soit pour l'élevage en aquarium ont réduit
les populations de coraux et de Poissons de récifs. Le réchauffement de la
planète et la pollution sont aussi susceptibles de contribuer à la destruction
à grande échelle des récifs de corail.
ZONE BENTHIQUE MARINE
Milieu physique La zone benthique marine est constituée du plancher
océanique qui se trouve sous les eaux de surface de la zone côtière, ou zone
néritique, et sous celles de la zone extracôtière, ou pélagique (voir la fi-
gure 50.16b). Bien que la zone benthique des eaux côtières peu profondes
reçoive assez de lumière pour abriter des organismes photosynthétiques, la
majeure partie de la zone benthique océanique est dans l'obscurité. Dans ce
milieu, plus on s'enfonce, plus la température est basse et plus la pression est
élevée. Par conséquent, les organismes qui occupent la zone très profonde,
ou zone abyssale, sont adaptés à un froid continu (environ 3
°C)
et à une
pression extrêmement élevée.
Milieu chimique Sauf en certains endroits riches en matières organiques,
les concentrations de dioxygène sont suffisantes pour faire vivre des Animaux
très divers.
Caractéristiques géologiques La majeure partie de la zone benthique
est couverte de sédiments mous. Toutefois, il existe des zones de substrat
rocheux sur les récifs, les montagnes sous-marines et la nouvelle croûte
océanique créée par les volcans du plancher océanique.
Organismes producteurs de nutriments Les organismes photosynthé-
tiques, principalement les laminaires et les Algues filamenteuses, n'occupent
que les endroits peu profonds où la lumière parvient en quantité suffisante.
Des communautés uniques d'organismes, comme celle qui apparaît sur la
photo, sont associées aux sources hydrothermales sous-marines d'origine
volcanique qui se trouvent sur les dorsales océaniques. Dans ce milieu
obscur, chaud et pauvre en dioxygène, les organismes producteurs de
nutriments sont des Bactéries chimioautotrophes (voir le chapitre 27) qui
obtiennent leur énergie en oxydant le
H2S
issu de la réaction entre l'eau
chaude et le sulfate dissous (ou ion tétraoxosulfate,
S0
42~).
Animaux Les communautés de la zone benthique nérétique se composent
de nombreux Invertébrés et de nombreux Poissons. Au-delà de la zone
euphotique, la plupart des Animaux dépendent entièrement des matières
organiques qui proviennent des zones supérieures. Parmi les Animaux des
communautés vivant près des sources hydrothermales sous-marines, on
trouve des vers tubicoles géants (sur la photo, à gauche) atteignant parfois
plus de 1 m de long. Il semble que ces vers se nourrissent de Bactéries
chimioautotrophes qui vivent ensuite en leur sein en symbiose. De nom-
breux autres Invertébrés, notamment des Arthropodes et des Échinodermes,
abondent aux alentours des sources hydrothermales.
Conséquences de l'activité humaine Dans la zone benthique, la surpêche a
décimé d'importantes populations de Poissons, comme la morue des Grands
Bancs de Terre-Neuve. De plus, le déchargement de déchets organiques y a
créé des zones privées de dioxygène.
Communauté d'organismes vivant à proximité d'une source hydrothermale
sous-marine
CHAPITRE
50 L'écologie et la biosphère
:
introduction
1191
1
/
4
100%