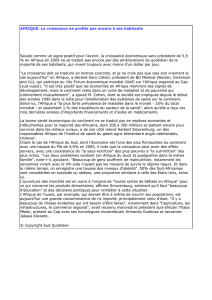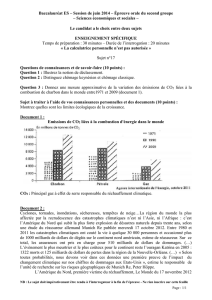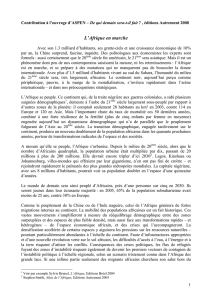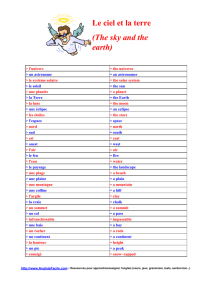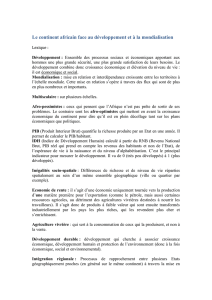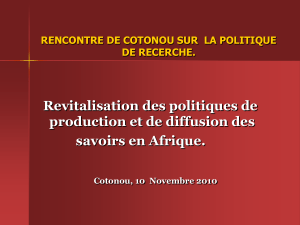AFRIQUE Les ambitions africaines d’IBM ’

LES ÉCO AFRIQUE MARDI 14 MAI 2013
AFRIQUE
ZOOM
Cette fois-ci serait-ce la bonne ?
p.15
CAHIER DE L’INTÉGRATION
S&P met en garde contre
l’eet «boomerang» ! p.16
LE MARCHÉ DE LA SEMAINE
Au Togo, l’État privatise
à tour de bras. p.17
VUE DU CAMEROUN
Dangereuses «distorsions»
sur la ibre optique. p.19
Les ambitions
africaines d’IBM
●Banques, télécoms, administrations et gestion
des ressources naturelles, sont les priorités de la multinationale
américaine pour l’Afrique. Baba Zoumanigui, vice-président
d’IBM Software Group Afrique/Moyen-Orient, se livre aux ÉCO.
P. 18

LES ÉCO AFRIQUE MARDI 14 MAI 2013
Les échos du continent
Meeting. Le prochain «Davos»
Africain aura lieu au Nigéria
Le géant africain a été officiellement désigné, ven-
dredi, pour accueillir la prochaine rencontre du
Forum économique mondial pour l’Afrique, en
2014. Ce choix est évidemment motivé par la dyna-
mique économique de ce pays d’Afrique de l’Ouest,
l’une des principales locomotives de la région et du
continent. La 23eédition du «Davos» africain s'est
terminée vendredi dernier au Cap, en Afrique du
Sud. Il a été question de plusieurs thématiques cen-
trales, liées globalement à la dynamique écono-
mique et de croissance du continent. Il s’agit no-
tamment de la nécessité des économies africaines
à diversifier leurs ressources pour rendre durable
leur croissance, le développement des infrastruc-
tures, ainsi que la promotion des investissements.
Les protagonistes des échanges qui ont eu lieu en
marge de ce forum ont en effet confirmé l’enthou-
siasme économique que connaît le continent, avec
une croissance moyenne maintenue à plus de 5%
en 2012 et attendue à près de 6% en 2013.
Monétique. Au Nigéria, Mastercard
transforme les CIN en cartes
bancaires
La compagnie américaine spécialisée dans les tech-
nologies de paiement vient de s’associer avec la
Commission nigériane nationale de gestion de
l'identité (NIMC) pour le déploiement, sur la base
d’un projet pilote, de 13 millions de cartes intelli-
gentes d’identité nationale (National Identity Smart
Cards). Flanquées de la marque MasterCard, ces
nouvelles cartes disposeront en effet de capacités
de paiement électronique. Elles font partie du sys-
tème de cartes récemment développé par le Sys-
tème nigérian de gestion de l'identité (NIMS).
Formation. Consécration régionale
pour L’OFPPT
L’OFPPT a décroché le prix «Academy Outreach Award, North Africa
2013», en reconnaissance des efforts déployés pour la promotion du pro-
gramme de formation Cisco NetWorking Academy. Cette distinction a été
décernée à l'occasion de la 4eédition de l’«Arabian Adventure Roads-
how» de Cisco, qui s’est déroulée à Tunis les 23 et 24 avril 2013. Ce certi-
ficat décerné à l’OFPPT vient ainsi récompenser les efforts entrepris pour
l’intégration des cursus CISCO dans la formation dispensée par les éta-
blissements de l’OFPPT. Ce prix est le fruit du partenariat développé avec
CISCO et qui porte sur les axes suivants : l’expansion au programme
CISCO Networking Academy au Maroc et sa promotion dans les établis-
sements de formation, l’appui à la formation des formateurs et la qualité
des relations établies avec les équipes CISCO. Ce résultat est l’aboutisse-
ment d’un processus de partenariat initié en 2001. En effet, l’OFPPT a
abrité, à l’Institut supérieur industriel de Casablanca (ISIC), la première
académie régionale CISCO au Maroc.
Pharmacie. Sanoi Maroc franchit
le seuil des 200 millions de traitements
Le groupe pharmaceutique français marque la journée mondiale de lutte
contre le paludisme, célébrée le 25 avril dernier, avec un aperçu chiffré
sur les performances de son produit phare contre cette pathologie : l’Asaq
Winthrop. Produit depuis 2007 à partir de son usine de Zénata, dans la
périphérie industrielle casablancaise, l’enseigne a dépassé le seuil des
200 millions de traitements distribués dans 32 marchés dans le monde,
dont 30 sur le continent. l’Asaq Winthrop est une solution thérapeutique
et industrielle, issue d’un partenariat entre Sanofi et Drugs for Neglected
Diseases initiative (DNDi), fondation indépendante à but non lucratif. Ce
médicament, non breveté, combine l’artésunate et l’amodiaquine dans
une association à dose fixe permettant de réduire les risques de résis-
tance. Le produit est vendu sur ces marchés à un prix inférieur à 1 dollar
US pour les adultes et 0,50 dollars US pour les enfants. Pour rappel, le
groupe a récemment inauguré une importante plateforme logistique sur
son site de production industrielle. L'objectif est de doper sa supply-chain
sur le continent.
Formation. HEM accueille l’AABS
Connect 2013
La business school accueille depuis hier et jusqu'au 17 mai la rencontre
annuelle «AABS Connect 2013», en partenariat avec l’Association des Bu-
siness School africaines (African Business Schools-AABS). Cette manifes-
tation devrait donner un nouvel élan à sa visibilité sur la scène continen-
tale. C’est en tout cas ce qu’espèrent les organisateurs, lorsqu’ils nous
confient que «HEM ambitionne, à travers l’organisation de cette rencontre,
de rayonner encore davantage sur la scène africaine et internationale et de
continuer à être cet espace de débat qu'elle est depuis sa création». Cette ren-
contre annuelle, tenue pour la première fois en Afrique du Nord et placée
sous le thème de «Business Schools : Générateurs de compétitivité en
Afrique», aura pour objectif principal d’offrir une plateforme d'échange,
de partage d’idées et de bonnes pratiques en abordant aussi bien avec des
pédagogues que des professionnels du monde de l'entreprise, plusieurs
questions et enjeux de l’heure liés à la création de ressources humaines
hautement qualifiées au service de l’économie du continent.
55%
C’est désormais la part détenue par le groupe Attijariwafa
bank dans le capital de la Banque internationale pour
l’Afrique, dont la cession par l’État Togolais, vient d’être
inalisée entre les deux parties.
Safall Fall
s.fall@leseco.ma
BILLET
14
«AIA»… Bien plus
qu’une abréviation,
ces trois lettres mar-
quent l’avènement
d’une nouvelle approche des politiques
d’investissement des économies afri-
caines. Elles témoignent d’une subite
prise de conscience - mieux vaut tard
que jamais - du gotha politico-écono-
mique du continent, de l’intérêt de pro-
mouvoir l’intégration financière via le
développement des investissements
intra-africains. C’est l’idée qu’il faut re-
tenir du dernier «Davos» africain 2013,
tenu au Cap, en Afrique du Sud, du 8 au
10 mai. Qui inves
tit quoi et dans quel
secteur ? Dans un récent rapport
consacrés à l’état de l’intégration régio-
nale en Afrique, la Commission écono-
mique des Nations unies pour l’Afrique
dressait déjà un constat peu enthou-
siasmant. Reprenant les chiffres de la
Conférence des Nations unies pour le
commerce et le développement (CNU-
CED), l’organisme panafricain estime
que les flux d’IDE intra-africains ont
très peu progressé sur la dernière dé-
cennie. Ces investissements étaient es-
timés à 2 milliards de dollars par an du-
rant les années 2002-2004, avant de
plonger à 1,6 milliard de dollars sur la
période 2005-2007, «ne représentant
ainsi que de minuscules parts des en-
trées totales d’IDE en Afrique). Ces in-
vestissements vont vers quatre sec-
teurs : industries extractives et pétrole,
finances, services aux entreprises et
transport et entreposage. Autre carac-
téristique, la majeure partie de ces ca-
pitaux intra-africains es
t souvent desti-
née à financer des fusions et
acquisitions, plutôt que le développe-
ment de nouveaux projets d’investisse-
ment. En attendant la multiplication
des accords internationaux de promo-
tion et de protection des investisse-
ments,des structures comme la
Banque africaine de développement
proposent des solutions. L’une d’entre
elles, présentée en marge du World
economic forum for Africa, est un ins-
trument permettant aux Banques cen-
trales africaines d'investir une partie de
leurs réserves dans le continent.
●
Africa invests
in Africa

LES ÉCO AFRIQUE MARDI 14 MAI 2013
Zoom
15
ment sur l’ouverture prochaine d’une
ligne maritime entre les deux pays pour
mieux booster leurs échanges commer-
ciaux. Ce projet devrait être entériné
par un second accord à Rabat, dans les
semaines à venir, et a d’ailleurs semble-
t-il été parmi les sujets soulevés par les
deux ministres la semaine dernière. Il
est en effet certain que les potentiels du
secteur et de trafic, entre le Maroc et le
Sénégal, sur le secteur maritime, de-
meurent encore très inexploités en
dépit des positionnements géogra-
phiques très stratégiques des ports de
Des accords et conventions de
coopération, le protocole de
la diplomatie économique,
entre Dakar et Rabat, en a vu
beaucoup circuler ces dernières années.
Cela, au profit d’autant de secteurs d’ac-
tivités, ainsi qu’à des fortunes diverses.
Les transports et la logistique, dans leur
globalité, sont de ces domaines dans les-
quels la coopération entre les deux pays
voudrait se renforcer. Cette ambition a
été réitérée par les deux parties à l’occa-
sion de la dernière édition du Salon Lo-
gismed, spécialisé dans la logistique et
les transports. Le Sénégal, justement, y
a été le pays à l’honneur.
«Un choix signi-
ficatif, pour permettre au business de pa-
rachever les acquis institutionnels et de
passer à la mise en œuvre des engage-
ments pris à Dakar, en mars dernier»
,
commente Thierno Alassane Sall, le mi-
nistre sénégalais des Infrastructures et
des transports, à l’issue de trois jours de
visite de travail et de rencontres des
opérateurs marocains du secteur, en
marge du Logismed. Ce dernier affirme
aussi avoir convenu avec son homo-
logue marocain, Abdelaziz Rabbah, de
prendre des mesures concrètes de faci-
litation réciproque de circulation des
biens et des personnes, à travers notam-
ment la baisse des tarifs douaniers sur
l’axe routier.
Sur tous les fronts
Une des principales concrétisations at-
tendues sur ce volet porte principale-
Dakar, Casablanca et Tanger Med. L’ob-
jectif est évidemment de booster les
échanges commerciaux entre les deux
pays. Pour rappel, ceux-ci ont certes
progressé sur les dernières années,
mais pourraient beaucoup mieux faire :
la faiblesse des connexions terrestres et
maritimes pèse beaucoup sur les statis-
tiques. Le Sénégal est le second plus im-
portant client du royaume dans la ré-
gion subsaharienne. En 2010, les
exportations vers ce marché ont atteint
660 MDH, contre 181 MDH au début de
la décennie. ●
Cette fois-ci serait-ce
la bonne ?
● Maroc-Sénégal. Les deux pays ont fait le point sur les derniers acquis dans le secteur
des transports et de la logistique. Leurs engagements ambitionnent de faire de Rabat et Dakar
de véritables hubs régionaux. Un projet de ligne maritime régulière, la baisse des tarifs douaniers
routiers et une coopération plus renforcée sur l’aérien sont les principales concrétisations en vue.
●●●
La faiblesse
des
connexions
terrestres et
maritimes
pèse sur les
échanges.
Les ÉCO : Qu’est-ce que les nou-
veaux accords vont changer ?
Thierno Alassane Sall : Les deux par-
ties avaient déjà des accords importants
dans ce secteur. Ceux que nous avons si-
gnés dernièrement à Dakar viennent ainsi
en renforcement des acquis des deux pays
dans le secteur des infrastructures de
transport et de circulation des personnes et
des biens. Les autorités des deux pays ont
déjà fait montre d’une forte conviction à
promouvoir le couloir logistique Casa-
blanca-Dakar.
C’est aussi une façon de soutenir
les échanges commerciaux ...
Il faut d’abord fluidifier et organiser les
flux de circulation des personnes, des mar-
chandises et des biens. Cela dans une lo-
gique win-win et de transferts de compé-
tences. dans les secteurs de la logistique et
des infrastructures de transport, en général
et de mise en place de projets d’investisse-
ments communs entre les opérateurs éco-
nomiques des deux pays.
Sur le secteur aérien, est-ce
qu’une coopération serait à nou-
veau envisageable ?
Plusieurs projets sont en cours et d’autres
sont à l’étude, au profit de ce secteur. Il
s’agit toutefois, pour la plupart des projets
d'une coopération portant sur les
échanges d’expertises. Là aussi, les acquis
sont importants puisqu’une bonne partie
des RH de l’aviation civile sénégalaise a
été formée au Maroc. Il y a donc de nou-
velles perspectives qui se dégagent ●
Thierno Alassane Sall
Ministre des Infrastructures
et des transports
Q/R

Analyse
LES ÉCO AFRIQUE - MARDI 14 MAI 2013
Cahier de l’intégration
ments bilatéraux entre États, traditionnel-
lement considérés comme l’une des prin-
cipales voies de financement auxquelles
ont recours les économies africaines»,
constatent les experts de S&P. Le recours
aux emprunts internationaux tend ainsi
à supplanter les financements dans le
cadre des coopérations bilatérales.
À double tranchant
Si cet engouement pour les emprunts
internationaux est essentiel pour le fi-
Les économies africaines sont
en train de rattraper progressi-
vement leur retard sur le mar-
ché international des capitaux
en multipliant les sorties, mais sem-
blent prêter peu d’attention aux effets
boomerang de cette tendance : la pro-
gression des dettes extérieures. Tel est,
en substance, le constat du rating ser-
vice de l’agence internationale de nota-
tion Standard & Poor’s, récemment livré
à la presse. «Au moment où l’Afrique du
Sud était encore le seul État à multiplier
les recours au marché international en
termes d’émissions d’obligations, plu-
sieurs autres économies africaines se
sont aussi très vite lancées sur la même
voie durant les deux dernières années»,
relève-t-on dans la note de l’agence. Les
chiffres parlent d’eux-mêmes : depuis
2007, sept États africains ont eu recours
aux emprunts à l’international, d’une
valeur totale estimée à 5 milliards de
dollars US et la tendance s’accentue
d’année en année. L’agence explique
cette situation par le fait que les faibles
retours sur investissement sur les mar-
chés européens et américains, en
l’occurrence, poussent les capitaux in-
ternationaux à se tourner vers les éco-
nomies en développement et émer-
gentes, en l’occurrence en Afrique. Les
économies du continent ont ainsi de
plus en plus de promptitude à émettre
des obligations d’États sur les marchés
internationaux, au détriment du marché
domestique. De plus, «les mesures d’aus-
térité prévalant dans la plupart des écono-
mies en développement, depuis l’éclate-
ment de la crise financière internationale,
pèsent beaucoup sur les prêts et finance-
S&P met en garde contre
l’eet «boomerang» !
●Eurobonds. L’agence de notation américaine constate une nette augmentation des recours
aux emprunts internationaux chez les économies africaines. La réorientation des capitaux
occidentaux vers les marchés en développement a accentué la tendance, mais cela n’est pas
sans impact sur les dettes extérieures des pays africains.
nancement de la dynamique de crois-
sance de la plupart des économies du
continent, cela constituerait cependant
un risque d’accentuation des dettes ex-
térieures de ces États, selon les appré-
ciations de l’agence de notation améri-
caine. Il faut dire que le volume des
emprunts commerciaux contractés par
les pays africains est loin d’être au ra-
lenti. «Nous estimons que pour les 16
pays étudiés dans la région subsaha-
rienne, les emprunts commerciaux de-
16
Emprunter pour inancer les infrastructures
Pour S&P, la forte demande en financement de projets d’infrastructures, impulsée par la dynamique économique soutenue du continent, est l’un des facteurs pous-
sant de plus en plus de pays africains à avoir recours aux capitaux internationaux. Une lecture qui rejoint la positon du cabin
et Ernst&Young (EY). Selon l’enseigne,
rien qu’en 2012, près de 800 projets d’infrastructures ont été lancés à travers le continent, dans plusieurs secteurs, pour une valeur combinée d’investissements
dépassant les 700 milliards de dollars US. L’Afrique du Sud est évidemment le premier marché en termes de projets d’investissements infrastructurels, avec une
valeur globale de près de 130 milliards de dollars US. «Le ministre sud-africain des Finances a également récemment annoncé que près de 100 milliards de dollars
US du Budget de l'État ont été alloués à la réalisation de projets d’infrastructures dans le pays sur les trois prochaines années
», annonce EY. Le Nigéria est le deuxième
plus important pays du continent dans le lancement de projets infrastructurels. À fin février dernier, le pays comptait 106 pro
jets d’infrastructures en cours de réa-
lisation, pour un montant global de près de 95,4 milliards de dollars US. L’Égypte talonne les deux premiers avec 82 projets, p
our 60 milliards de dollars US. En Afrique
de l’Est, le Kenya, l’Ouganda, la Tanzanie et le Mozambique
, viennent compléter le top 10 africain en termes de projets d’infrastructures lancés.
ÉTAT D’AVANCEMENT DES PROJETS D’INFRASTRUCTURES
LANCES SUR LE CONTINENT (EN %)
37% 299 projets
Conception et faisabilité
36% 293 projets
Closing financier,
pré-lancement
27% 225 projets
En cours, bientôt livrés
SOURCE : BUSINESS MONITOR INTERNATIONAL; ERNST & YOUNG ANALYSIS
ÉMISSIONS D’OBLIGATIONS D’ÉTAT SUR LES MARCHES
INTERNATIONAUX (EN MILLIONS $ US)
2007
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rwanda
400
Sénégal
500
Gabon 1000 Ghana 750
Sénégal 500
Nigeria
500 Namibie
500
Angola 1000
Tanzanie
600
Zambie 750
SOURCE : STANDARD & POOR’S 2013
vraient progresser de 25% en 2012,
pour atteindre la valeur de 56 milliards
de dollars US (emprunts internationaux
et domestiques compris). Même si
une bonne partie de ces emprunts a été
opérée sur les marchés domestiques, le
recours aux euro-obligations, en l’oc-
currence, se révèle de plus en plus un
réflexe partagé chez ces États. En 2007,
le Ghana et le Gabon ont été les pre-
mières économies de la région, hors
Afrique du Sud, à émettre des
Eurobonds. Une seconde vague d’émis-
sions a démarré depuis 2011. Sur les 12
derniers mois, sur une échéance plus
récente, trois autres économies afri-
caines se sont greffées à la tendance. Il
s’agit de la Zambie pour un montant de
750 millions de dollars, de l’Angola
pour 1 milliard de dollars US et du
Rwanda pour une valeur de 400 mil-
lions de dollars US.
Diversification
Les intérêts des pays africains recourant
aux capitaux internationaux ne se limi-
tent pas uniquement aux Eurobonds.
Selon le rapport de S&P, une bonne par-
tie de ces États envisagent également
d'émettre des «sukuks», des obligations
islamiques conformes aux règles de la
charia. Pour l’heure, la tendance à la fi-
nance islamique reste limitée. Seuls la
Gambie et le Soudan ont récemment
procédé, pour le moment, à des émis-
sions régulières de sukuks sur leur mar-
ché domestique respectif. Toutefois,
d’autres économies comme le Sénégal,
l’Afrique du Sud, la Mauritanie et le Ni-
géria, ont récemment manifesté leur in-
térêt pour ce type de recours au finance-
ment islamique à l’international, sans
qu’aucun de ces pays n’ait encore fait
réellement le pas. ●
Depuis 2007, les
recours aux emprunts
à l’international
s'accentuent d’année
en année.

LES ÉCO AFRIQUE - MARDI 14 MAI 2013
Cahier de l’intégration
Le marché de la semaine
17
Avec la cession officialisée en mi-
lieu de semaine dernière de
55% des participations de l'État
dans le capital de la Banque in-
ternationale pour l’Afrique (BIA), au profit
du groupe Attijariwafa bank, les autorités to-
golaises avancent un pion de plus dans la
mise en œuvre de leur programme de priva-
tisation massive des banques publiques du
pays. Cette stratégie a démarré au mois
d’août dernier avec la cession de la Banque
togolaise de développement (BTD) à Ora-
group, un holding bancaire et financier actif
sur le marché ouest
-africain (Orbank est
présente au Togo, en Guinée, au Tchad, au
Bénin, au Gabon et en Mauritanie). Le mon-
tant du deal : 30 millions d’euros. Ce pro-
gramme de désengagement - partiel ou
total, en fonction des banques concernées -
s’inspire des recommandations faites par le
FMI aux autorités gouvernementales du
pays. À l’heure actuelle, deux autres établis-
sements financiers à contrôle étatique, at-
tendent sur l’autel des privatisations.
L’Union togolaise des banques (UTB) est
l’une d’elles. L’enseigne est l’une des pièces
maîtresses du secteur bancaire local. Elle est
entièrement sous contrôle de l’État depuis
près de 20 ans, suite aux départs précipités
et quasi simultanés, en 1994, des investis-
seurs privés qui détenaient la grande majo-
rité des parts de la banque, découragés par
les troubles politiques que connaissait le
pays. Il s’agissait en l’occurrence du Crédit
Lyonnais, de la Deutsche Bank et de la
Banca Commerciale Italiana, qui détenaient
respectivement 35, 18 et 12% de parts du ca-
pital de la banque à l’époque. Depuis lors,
sous le contrôle de l’État Togolais et grâce à
la fragile stabilité politique qui règne dans le
pays, l’enseigne a commencé à reprendre du
poil de la bête.
Relance et diversification
Elle commercialise sur le marché Togo-
lais les prestations de la compagnie inter-
nationale de transfert de fonds Western
Union, joue la proximité pour développer
la bancarisation des populations défavo-
risées et s’attaque de plus en plus au fi-
nancement des PME, principale force de
l’économie nationale. Cependant, la dy-
namique de croissance de ses activités
demeure encore bien au ralenti. L’en-
seigne ne dispose, aujourd’hui, que d’un
réseau de 37 agences, pour une popula-
tion de plus de 6 millions d’habitants. La
situation est quasiment la même pour la
Banque togolaise du commerce et de l’in-
dustrie (BTCI), la quatrième enseigne
bancaire du pays dont l’État compte se
délester très prochainement. Cette struc-
ture est dans une très délicate situation
financière, tributaire de plusieurs années
de gestion quasi laxiste de ses activités,
de la part de l’État et de mauvaise gestion
opérationnelle. Il faut savoir qu’avec un
taux de bancarisation qui dépasse à
peine la barre des 4%, les futurs repre-
neurs de ces banques togolaises auront
fort à faire pour les remettre sur les rails
de la croissance.
Au Togo, l’État privatise
à tour de bras
● Avec un taux de bancarisation qui dépasse à peine les 4%, l’État Togolais confie une après une
ses banques à des groupes r
égionaux à même de les «booster».
FICHE PAYS
TOGO
Taille
6 millions de consommateurs
potentiels (2011)
Monnaie
Franc CFA
PIB
3,6 milliards de dollars US (2011)
Croissance PIB
4,2% en 2012, 4,5% en 2013
Région économique
Communauté économique
des États de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO),
Doing Business 2013
156e mondial sur 185 pays
(161eau DB2012)
Importations 67491 34622 48688 65316 8,69% 28090 64374 129,17%
Part dans les importations globales(%) 0 0 0 0 - 0 0 -
Exportations 141816 177655 303859 203041 21,04% 52560 343187 552,94%
Part dans les exportations globales(%) 0 0 0 0 - 0 0 -
Solde 74325 143034 255170 137724 41,61% 24470 278813 1039,4%
Taux de couverture (%) 210 513 624 311 - 187 533 -
ÉVOLUTION DES ÉCHANGES COMMERCIAUX ENTRE LE MAROC ET LE TOGO (EN MILLIERS DH)
2008 2009 2010 2011 ÉVOL.MOY.08/11 JAN.JUIN.11 JAN.JUIN.12 ÉVOL.12/11
SOURCE : OFFICE DES CHANGES
Risque pays
Perspectives de croissance favorables :
En 2013, les perspectives de croissance demeurent favorables (4,5%). L’activité sera
soutenue par de nouveaux investissements dans les infrastructures (routes, ports…), dans le secteur du phosphate, principal
produit d’exportation du pays, et dans la production de ciment.
Tensions sociopolitiques accrues : En mars 2010, Faure Gnassingbé a été réélu à la tête de l’État pour un second mandat. À la
suite des élections, le principal parti d’opposition (UFC) a connu une scission entre deux courants : ceux qui ont reconnu les ré-
sultats de l’élection présidentielle et rejoint la coalition menée par le parti présidentiel et les dissidents qui ont créé un nouveau
parti, l’Alliance nationale pour le changement (ANC). Ces évolutions politiques, ainsi que le mécontentement de la population
face à la situation économique devraient rendre plus fréquentes en 2013 les manifestations menées par des groupes dissidents.
 6
6
 7
7
1
/
7
100%