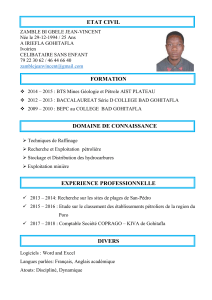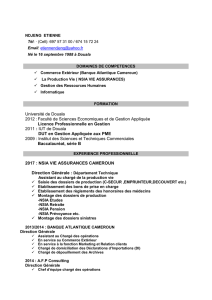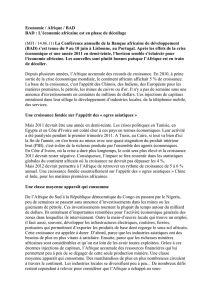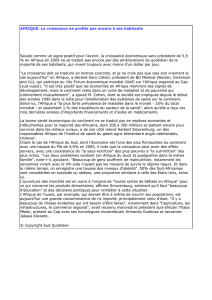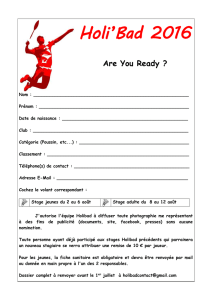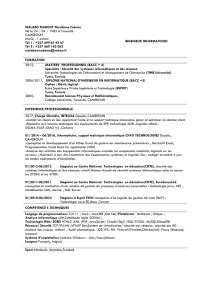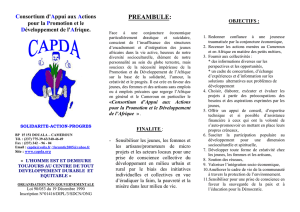AFRIQUE ’

LES ÉCO AFRIQUE MARDI 7 MAI 2013
AFRIQUE
ZOOM
Les exportateurs prennent
les choses en main. p.15
CAHIER DE L’INTÉGRATION
La BAD décline sa
stratégie 20132022. p.16
LE MARCHÉ DE LA SEMAINE
Bissau… La Guinée
de tous les paradoxes. p.17
VUE DU CAMEROUN
Le casse-tête des
logements sociaux. p.19
UEMOA, tout sur
la monétique !
●Tendances d’usage, degrés de maturité du marché,
le mobile-banking : solution miracle à la bancarisation
du continent, l’apport des investissements marocains dans
le secteur des banques… Blaise Ahouantchédé, directeur général
du Groupement interbancaire et monétique de l’UEMOA, basé
au Sénégal, se livre sans concessions. Entretien. P. 18

LES ÉCO AFRIQUE MARDI 7 MAI 2013
Les échos du continent
Tourisme. l’Afrique australe sonne
l’offensive
Dans le sillage de l'Afrique du Sud en plein boom tou-
ristique, les autres pays de la région veulent aussi atti-
rer davantage de visiteurs, mais leur union pour se
vendre à l'international masque mal une concurrence
avivée par la crise économique. «La région a beaucoup
à offrir», assure Kwakye Donkor, le responsable marke-
ting de l'Organisation régionale du tourisme d'Afrique
australe (Retosa), un organisme intergouvernemental
basé à Johannesburg, cité par l’AFP «Chaque pays est
unique en soi. Chaque pays a quelque chose de très spé-
cial à offrir. Quand les gens viennent dans la région, ils
devraient essayer de voir au moins deux ou trois pays !».
La Communauté de développement d'Afrique australe
(SADC), qui comprend aussi des pays comme la Répu-
blique démocratique du Congo, la Tanzanie, Maurice
et les Seychelles, représente, selon Retos, 2% du mar-
ché mondial du tourisme, soit environ 20 millions de
visiteurs par an, dont plus de 9 millions vont en
Afrique du Sud.
Industries. le Gabon met le paquet
En partenariat avec les opérateurs privés, le Gabon am-
bitionne d’investir 17.000 milliards FCFA (26 milliards
€) au cours des 12 prochaines années afin de réaliser
les objectifs de la Stratégie nationale d’industrialisation
(SNI), de sources de presse. Cette stratégie devrait re-
poser sur la valorisation des filières hydrocarbure,
mine, métallurgie, pêche, aquaculture, agriculture,
agro-industrie, forêt, bois et matériaux de construction.
Elle a d’ailleurs fait l’objet du premier Forum national
de l’industrie, tenu du 26 au 28 avril derniers à Libre-
ville. L’accent sera ainsi mis sur la création massive
d’emplois et une profonde transformation de la struc-
ture productive de l’économie, qui est aujourd’hui dé-
pendante des hydrocarbures à hauteur de 40% du PIB
et de 60%, des recettes de l’État. La mise en œuvre des
principaux projets de la nouvelle politique industrielle
du Gabon devrait permettre de faire passer la contribu-
tion du secteur secondaire de 8% du PIB à plus de 35%
à l'horizon 2025 et de générer par an 3.350 milliards
FCFA (5,11 milliards €) de valeur ajoutée.
Stratégie. OBG «applaudit»
la coopération Sud-Sud du Maroc
Le cabinet international d'intelligence économique, Oxford Business
Group (OBG), approuve les efforts consentis par le royaume dans le
renforcement de la coopération Sud-Sud. Selon OBG, ces efforts in-
terviennent dans un contexte où la récession économique mondiale
continue de peser sur les échanges commerciaux avec la zone euro,
premier partenaire commercial du pays. Rappelant les accords signés
en mars dernier par le Maroc, notamment avec le Sénégal, la Côte
d'Ivoire et le Gabon, le cabinet britannique note que ces accords
contribueront à renforcer les liens économiques du royaume avec
l'Afrique centrale et de l'ouest. Ces accords viennent soutenir les
orientations de la politique d’exportation du Maroc dans le but de dé-
velopper ses échanges commerciaux et renforcer sa présence sur le
continent africain. Les défis restent entiers, toutefois OBG observe
qu’en dépit de la signature de près de 500 accords avec plus de 40
pays dans plusieurs secteurs économiques au cours des dix dernières
années, les échanges avec les pays africains ne représentent que près
de 5% du commerce extérieur du royaume.
Banques. Société Générale
s’intéresse aux petits revenus
Le groupe français Société Générale vient d’annoncer la création
d’une nouvelle institution financière destinée à la bancarisation des
populations à revenus modestes. Le Sénégal sera le premier marché-
cible de cette structure. Baptisée «Manko», sa mise en place s’inscrit
dans le cadre d’un nouveau concept bancaire, entre micro-finance et
banque traditionnelle, qui a pour ambition de bancariser les popula-
tions disposant de revenus modestes mais réguliers et n'ayant encore
pas accès au système bancaire traditionnel. Filiale à 100% du groupe
Société Générale, Manko a signé une convention avec la Société Gé-
nérale de banques au Sénégal (SGBS), filiale à 63,28% du groupe, lui
permettant de distribuer une offre de produits et de services ban-
caires adaptés aux populations visées. Ce statut a été pleinement va-
lidé par les autorités réglementaires compétentes. Manko s'appuie
sur Yoban'tel, un service de paiement par téléphone mobile déployé
par SGBS.
Télécoms. croissance ralentie
au Mali pour IAM
4,5%, c’est la croissance du revenu généré par Maroc Telecom à partir
des activivités de sa filiale malienne, Sotelma, à la fin du dernier tri-
mestre. En dépit des perturbations politiques que traverse ce pays, la
rentabilité est toujours au rendez-vous au Mali, même si elle
contraste beaucoup avec 37,2% de progression du chiffre d’affaires
au premier trimestre 2012. Cette année, ce chiffre d’affaires est de
640 millions dirhams. Au niveau des autres filiales subsahariennes
du groupe, les performances sont autant maintenues. Au Gabon, le
chiffre d’affaires de la filiale du groupe s’est établi à 342 millions de
dirhams au premier trimestre 2013, en hausse de 13,5%, malgré une
base de comparaison défavorable du fait de l’impact positif de l’orga-
nisation de la Coupe d’Afrique des Nations en début 2012. En Mauri-
tanie, le chiffre d’affaires du groupe est en progression de 6,5% pour
s’établir à 346 millions de dirhams à fin mars. La progression est
aussi de 6,8% au Burkina Faso, avec un chiffre d’affaires de 535 mil-
lions de dirhams.
1,8 MMdh
C’est le chire d’aaires global du groupe Maroc Telecom à
l’international (Mali, Mauritanie, Gabon,Burkina Faso), à in
mars 2013. Ce revenu global est en progression de 7%,
impulsé notamment par le segment du Mobile.
Safall Fall
s.fall@leseco.ma
BILLET
14
C’est le paradoxe qui
saute aux yeux dès la
première lecture du
13e rapport annuel
des «Indicateurs sur le genre, la pauvreté
et l’environnement sur les pays Africains
2013», publié par le Département des
statistiques du groupe Banque afri-
caine de développement. Ce rappro-
chement entre insécurité alimentaire et
production globale de richesses est
d’autant plus pertinent, dans un
contexte de confirmation par le FMI, du
maintien de l’exception africaine dans
sa dynamique économique. Il permet
de mettre le doigt sur le fait que derrière
les chiffres et autres calculs d’économé-
trie, aux résultats fort enthousiasmants,
se cache parfois une forêt de déséquili-
bres socio-économiques. Eh oui !
L’Afrique traîne ses casseroles. Et les
stéréotypes n’en sont que plus renfor-
cés : si l’obésité trône au sommet des
maux urbains du siècle dans les pays
avancés, la malnutrition continue de
prévaloir dans nos frontières. Dans le
rapport de la BAD, qui prend en compte
la période 2010-2012, ce fléau est sur-
tout circonscrit dans les pays dits «États
fragiles». C’est en effet le cas de la Répu-
blique démocratique du Congo (37%
de la population), de l’archipel des Co-
mores (70%) et du Burundi (73%), qui
détient d’ailleurs le triste record conti-
nental. Des contrastes frappants exis-
tent aussi. L’Angola en est une excel-
lente illustration. Classé dans le cercle
encore très restreint des pays exporta-
teurs de pétrole – qui regroupe la plu-
part des économies VIP (Very Impor-
tant Productivity) du continent avec
une croissance de 6,7% attendue en
2013 – 27% de sa population souffre de
malnutrition. Ce chiffre est de 33% au
Tchad, une autre grande économie ex-
portatrice d’or noir et à fort taux de
croissance. Seuls les pays du Maghreb
parviennent jusque-là - et à coup de
subventions parfois suicidaires pour les
budgets publics - à aligner croissance
respectable et suffisance alimentaire.
Le taux de prévalence de la malnutri-
tion ne dépasse pas les 5% sur la pé-
riode étudiée. ●
Riche et
«mal nourrie»

LES ÉCO AFRIQUE - MARDI 7 MAI 2013
Zoom
15
deux marchés. «Le degré relativement im-
portant de méconnaissance mutuelle de ces
opportunités, en plus d’autres facteurs liés
à la fiscalité des échanges et aux
contraintes logistiques, pèsent beaucoup
sur l’exploitation à plein régime des possi-
Le business a encore devancé le
politique de plusieurs pas, ven-
dredi, dans la dynamique com-
merciale entre le royaume et l’un
des géants économiques de la Commu-
nauté économique et monétaire d’Afrique
centrale (CEMAC), le Cameroun. Les opé-
rateurs à l’export des deux pays se sont en
effet engagés à porter plus loin leur parte-
nariat afin de donner le tremplin qu’il faut
aux échanges commerciaux. Cet engage-
ment a été pris en marge d’une réunion
de travail restreinte tenue entre les deux
parties au siège de l’Association maro-
caine des exportateurs (ASMEX).L’une
des principales retombées de cette ren-
contre est concrète : l’Asmex compte ou-
vrir très prochainement une représenta-
tion sur le marché camerounais. «Il s’agira
d’une structure qui nous permettra de mar-
quer notre présence commerciale sur ce
marché par une mise en relation directe
ainsi que le partage d’informa-
tions entre les exportateurs des
deux pays», commente Has-
san Sentissi, le président de
l’ASMEX. Si le statut et les
contours juridiques de cette
future entité ne sont pas en-
core bien définis à l’état initial
du projet, ses missions sont
d'ores et déjà connues. Elle
devrait jouer le rôle d’une vé-
ritable passerelle de promo-
tions commerciales et de mise en avant
des opportunités d’exportation, mais
aussi d’investissements, sur chacun des
bilités commerciales existant de part et
d’autre», nous explique Hervé Mbarga,
homme d’affaires camerounais et prési-
dent de l’African Pineapples and Bananas
Association (APIBANA), qui regroupe les
producteurs et/ou exportateurs africains
des filières «bananes et ananas». En dépit,
effectivement, d’une tendance très mar-
quée à la croissance, ces échanges sont
bien loin de refléter ces possibilités. Les
exportations du royaume vers ce marché
ont progressé de 32% entre 2010 et 2011,
selon les chiffres les plus actualisés de
l’Office des changes. Ces exportations ont
totalisé une valeur de quelque 282 MDH
en 2011, contre 123 MDH pour des impor-
tations en amélioration, sur la même
échéance, de 43%. Les produits les plus
Les exportateurs prennent
les choses en main
● Maroc-Cameroun. L’Asmex négocie un projet de représentation commerciale à Douala. Il
devrait être réalisé en partenariat avec les exportateurs camerounais. Objectif : disposer d’une
plateforme de mise en relation et d’échanges d’informations sur les opportunités d’affaires dans
les deux pays.
● Les exportations du Maroc vers le Cameroun ont progressé de 32 % entre 2010
et 2011.
échangés sont l’engrais, les lubrifiants et
divers produits alimentaires du côté ma-
rocain, là où le Cameroun fournit le
royaume en bois, bananes fraîches et café,
principalement.
Relance
Il faut savoir que cette volonté de rappro-
chement commercial entre les opéra-
teurs des deux marchés, ne date pas d’au-
jourd’hui. En 2010 déjà, en marge du
passage de la Caravane de l’export à
Douala, la capitale économique camerou-
naise, un projet quasi identique avait été
mis sur pied entre l’Asmex et le Mouve-
ment des entreprises du Cameroun
(CAMC). L’initiative portait en effet sur la
création d’un Centre d’affaires Maroc-Ca-
meroun (CAMC), avec deux antennes à
Casablanca et à Douala, dont la mission
était de «répondre aux besoins des opéra-
teurs économiques souhaitant promouvoir
leurs produits et services», selon les expli-
cations des initiateurs du projet. Ce der-
nier avait d’ailleurs reçu le plein soutien
des autorités publiques des deux pays.
Celles-ci devaient d’ailleurs contribuer
au financement de la concrétisation de
l’initiative. La création de la CAMC devait
ainsi doter les opérateurs des deux pays
d’un point d’ancrage sur leurs marchés
ainsi que sur leurs sous-régions respec-
tives (CEMAC, UMA et pays arabes, etc..).
En détail, cet objectif se décline en une di-
zaine de missions concrètes. L’une des
plus importantes est d’organiser la repré-
sentation et la commercialisation des
produits et services à travers un show-
room d’exposition permanent et
constamment actualisé, au niveau de
chacun des deux marchés. Le projet
prend également en compte la création
d’entrepôts de stockage de marchandises
liés au CAMC, pour concrétiser des opé-
rations réalisées par les entreprises et par
le biais du centre d’affaires. Le CAMC de-
vrait de fait, gérer ce service d’entrepo-
sage, lequel pourrait constituer ultérieu-
rement la base du projet d’un véritable
comptoir commercial. ●
●●●
Si le statut
juridique de
cette future
entité n’est pas
encore bien
défini, ses
missions sont
déjà fixées :
elle jouera un
rôle de
passerelle et
de promotion
commerciale.
Les produits les plus
exportés, du côté ma-
rocain, sont les en-
grais et les lubrifiants .

Analyse
LES ÉCO AFRIQUE MARDI 7 MAI 2013
Cahier de l’intégration
mier porte sur «la croissance inclusive» et
consiste à réaliser une dynamique écono-
mique se traduisant non pas seulement
par l’égalité de traitement et d’opportuni-
tés, mais aussi par des réductions pro-
fondes de la pauvreté et un accroissement
massif et correspondant des emplois. «En
permettant d’exploiter le vaste potentiel du
continent - et en améliorant ses chances de
tirer parti du dividende démographique - la
croissance inclusive induira la prospérité par
un élargissement de la base économique qui
transcende les obstacles liés à l’âge, au sexe
et à la situation géographique», explique-t-
on dans le même rapport. La BAD promet
ainsi d’investir davantage dans une infra-
structure qui libère le potentiel du secteur
privé, favorisant l’égalité des sexes et la par-
ticipation communautaire. Quant au se-
«Cette vision, qui couvre une
décennie, peut faire de ce
continent, en l’espace
d’une génération, le pôle
de croissance mondial que nous savons qu’il
peut être et qu’il veut devenir». C’est en ces
mots que Donald Kaberuka, le président
du groupe de la Banque africaine de déve-
loppement (BAD), résume la toute nou-
velle stratégie décennale (2013-2022) de
l’institution financière panafricaine. Les
ambitions sont importantes, à la hauteur
de la dynamique du continent. «Cette stra-
tégie est conçue pour placer la banque au
centre de la transformation de l’Afrique et
améliorer la croissance du continent», ex-
plique-t-on auprès des responsables de la
BAD, dans le communiqué annonçant
l’implémentation de cette vision straté-
gique. Sa conception et sa mise en œuvre
partent du constat selon lequel le continent
s’est engagé dans un véritable processus de
transformation économique. Cette straté-
gie vise ainsi à élargir et approfondir ce
processus de transformation, essentielle-
ment en faisant en sorte que la croissance
soit partagée et non isolée. «Cette crois-
sance doit maintenant se traduire en une vé-
ritable transformation économique qui
créera des emplois et offrira des opportunités
aux populations. C’est pour cette raison que
la prochaine décennie sera si déterminante
et que la stratégie de la BAD pour la période
2013-2022 revêt une si grande importance».
Cette nouvelle feuille de route de la banque
panafricaine vise aussi à favoriser une
croissance qui ne soit pas simplement du-
rable au plan écologique, mais aussi habi-
litante au plan économique.
Objectifs
La BAD s’est d’ailleurs donné deux grands
objectifs à atteindre via la mise en œuvre
de sa nouvelle stratégie décennale. Le pre-
La BAD décline sa stratégie 20132022
●La Banque africaine de développement dispose d’une nouvelle feuille de route pour la période
2013-2022. L’institution panafricaine ambitionne d’accompagner la «transformation» structurelle
des économies africaines. Objectifs : promouvoir une croissance plus inclusive et homogène
et aider le continent à s’engager dans une véritable «croissance verte». Détails.
cond grand objectif de la stratégie, elle
concerne la «transition vers la croissance
verte». La BAD ambitionne d’aider les éco-
nomies du continent à rendre leur crois-
sance «durable», en l’aidant à se mettre sur
la voie d’une transition progressive vers la
«croissance verte». Le but, ici, est de
maintenir la tendance économique ac-
tuelle du continent tout en protégeant les
moyens de subsistance en améliorant la
sécurité hydrique, énergétique et alimen-
taire. Il s’agit également de favoriser l’uti-
lisation durable des ressources naturelles
et de stimuler l’innovation, la création
d’emplois et le développement écono-
mique. Pour la BAD, les priorités de
l’heure et pour les économies africaines
afin d'aller dans le sens de la croissance
verte, sont «le renforcement de la rési-
lience face aux chocs climatiques, la mise
en place des infrastructures durables, ainsi
que la création de services d’écosystème».
L’exploitation rationnelle des ressources
naturelles – en particulier l’eau – sont
aussi dans cette liste de priorités.
5 secteurs opérationnels
Concrètement, tout cela devrait se maté-
rialiser à travers cinq grands axes d’inter-
vention sur lesquels la BAD axera désor-
mais ses activités. Il s’agit notamment du
développement de l’infrastructure, de l’in-
tégration économique régionale, du déve-
loppement du secteur privé, de la gouver-
nance et de la responsabilisation, du
développement des compétences et de la
technologie. Ce nouveau programme pro-
pose également, en seconde priorité, de
«rechercher des modalités nouvelles et inno-
vantes de mobilisation des ressources pour
accompagner la transformation de l’Afrique,
notamment en utilisant de façon optimale
ses propres ressources», relève-t-on auprès
de la BAD. Par ailleurs, une part belle est
également accordée, dans la même feuille
de route 2013-2022, au recours aux parte-
nariats public-privés, «aux arrangements
de cofinancement» ainsi qu’aux instru-
ments d’atténuation des risques qui de-
vraient attirer de nouveaux investisseurs
pour le continent. ●
16
Les freins «immatériels» à l’intégration économique
L’intégration régionale est l’une des principales problématiques que la BAD cherchera à adresser sur les vingt prochaines années, aux gouvernements africains.
Selon l’institution financière, cet obstacle ne pourrait être définitivement aplati que si les économies africaines décident de s’attaquer directement aux facteurs «im-
matériels» de la désintégration régionale. Ces aspects sont liés aux impératifs de simplification et d’harmonisation des procédures et réglementations commerciales
et douanières complexes et fastidieuses, de rationaliser les règles d’origine restrictives et d'éliminer la corruption ainsi que d’autres obstacles informels au commerce.
La BAD «favorisera les cadres juridiques et réglementaires qui facilitent la circulation de la main-d’œuvre et des capitaux, en inscrivant ses interventions dans une
perspective régionaliste». Concrètement, elle compte «investir dans les postes-frontières à guichet unique» et les «services nationaux d’immigration dotés d’agents
bien formés et motivés». La Banque assistera également les économies africaines dans l’acquisition des compétences nécessaires pour tirer parti d’économies plus
intégrées. Il faut en effet savoir que l’Afrique ne commerce pas assez avec elle-même. D’après les statistiques de l’Organisation mondiale du commerce, la valeur
des exportations africaines a augmenté de 11,3% par an entre 2000 et 2009, contre une moyenne mondiale de 7,6%. Cependant, seule une part relativement limitée
de 12% de ce commerce est intrarégionale, «soit le niveau le plus faible au monde», selon les commentaires de la BAD.
Intrants/R&D Production Transformation Logistique Commercialisation
Irrigation
Unités communautaires
Stockage
Marchés ruraux
Accès amélioré aux Productivité accrue Ajout de valeur Accès accru aux Sécurité alimentaire
semences et engrais renforcée
Vulnérabilité aux chocs Pertes post-récoltes Revenus agricoles
climatiques réduite réduites renforcés
ROUTES RURALES
PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ
Rôle
de la
Banque
Résultats
LES INVESTISSEMENTS DE LA BANQUE DANS LES INFRASTRUCTURES APPUIENT
LA CHAÎNE DE VALEUR DANS L’AGRICULTURE ET RENFORCENT LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
DE L’EXPLOITATION AGRICOLE À LA BOUCHE
Mise en œuvre
de la stratégie
• Plan triennal glissant
• Budget annuel
• Stratégies pays
• Stratégie régionale
• Stratégies sectorielles
• Plans d’action sectoriels
MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE À TROIS NIVEAUX
Niveau
national
et régional
Niveau
sectoriel
Niveau
institutionnel
SOURCE : BAD
SOURCE : BAD

LES ÉCO AFRIQUE MARDI 7 MAI 2013
Cahier de l’intégration
Le marché de la semaine
17
Pendant longtemps dans l’ombre
du Sénégal et de l’autre Guinée
(Conakry), deux géants écono-
miques de l’Ouest continental, la
Guinée Bissau est un autre exemple de ces
micro-économies africaines aux potentiels
incommensurables, mais mal mis à profit.
Le pays traîne également les boulets de l’in-
sécurité et une instabilité politique aux-
quelles la dynamique économique s’est ha-
bituée, comme en témoignent les évolutions
en dents de scie du taux de croissance du
PIB. Le pays, classé dans la catégorie des
économies à «faibles revenus» par le FMI, a
bouclé 2011 avec une croissance de 5,6%,
avant retomber à -2,8% en 2012 ! Cette ré-
cession est tributaire de la suspension des
activités de production dans tous les sec-
teurs , suite au coup d’État d’avril 2012 (voir
encadré ). Toutefois, un semblant de réta-
blissement est annoncé par le FMI, qui voit
le PIB du pays croître de 3,5% à fin 2013,
des chiffres honorables pour une économie
qui a du mal à s’assurer une stabilité
prompte à séduire les investisseurs du privé,
étrangers ou locaux. La confirmation de ces
perspectives est évidemment assujettie à
d’innombrables conditions. Notamment, la
reprise, avec un volume relativement plus
soutenu , des exportations du pays en noix
de cajou, accompagnées d’un léger raffer-
missement des cours de ce produit sur les
marchés internationaux, ainsi que par la re-
lance de projets d’investissements publics
mis en stand-by par les perturbations poli-
tiques. Le FMI soumet également la reprise
de la croissance à un maintien de la stabilité
politique.
Au bord de l'asphyxie
Les autorités font face, par ailleurs, à une in-
flation grandissante. Le pays importe en
effet une bonne partie de ses biens de
consommation, ce qui rend l’économie vul-
nérable aux chocs exogènes conjoncturels
comme les flambées des cours des matières
premières alimentaires. Cette situation n’ar-
range évidemment pas le développement
humain : le pays enregistre un taux de pau-
vreté très élevé. En 2012, la Guinée-Bissau a
fini à la 176e place sur un total de 186 pays
dans le dernier index annuel de développe-
ment humain des Nations Unies. De plus,
en mal de diversification, l’économie conti-
nue de reposer son avenir sur l’agriculture
et la pêche, qui constituent à elles seules
44% du Produit national brut. Le secteur
agricole, emploie 80% de la population ac-
tive et représente 90% des exportations. Un
important déficit en infrastructures publics
vient assombrir davantage ce tableau, mais
laisse entrouvertes d’importantes opportu-
nités d’investissements. ●
Bissau… La Guinée
de tous les paradoxes
● L’instabilité politique a plongé l’économie du pays dans de grandes incertitudes en 2012.
En dépit de perspectives de reprise cette année - 3,5% - le pays fait encore face à de nombreux
défis. La production économique est peu diversifiée. L’agriculture emploie, à elle seule, 80%
de la population active. Découverte de l’une des économies les moins avancées du continent.
FICHE PAYS
GUINÉEBISSAU
Taille
1,6 million de consommateurs
potentiels (2011)
Monnaie
Franc CFA
PIB
967,8 millions de dollars US
(2011)
Croissance PIB
-2,8% en 2012, 5,7% en 2013
(FMI)
Région économique
Union économique et moné-
taire ouest-africaine (UEMOA)
Doing Business 2013
179emondial sur 185 pays (178e
au DB2012)
Importations 0 0 0 2347 % 0 29 %
Part dans les importations globales(%) 0 0 0 0 - 0 0 -
Exportations 19899 29607 41520 52113 38,18% 26958 6559 -75,67%
Part dans les exportations globales(%) 0 0 0 0 - 0 0 -
Solde 19899 29607 41520 49766 36,29% 26958 6530 -75,78%
Taux de couverture (%) 0 0 0 2220 - 0 22774 -
ÉVOLUTION DES ÉCHANGES COMMERCIAUX ENTRE LE MAROC ET LA GUINÉE-BISSAU (EN MILLIERS DH)
2008 2009 2010 2011 ÉVOL.MOY.08/11 JAN.JUIN.11 JAN.JUIN.12 ÉVOL.12/11
SOURCE : OFFICE DES CHANGES
«Paradis» du narcotraic
Chez Coface, la Guinée Bissau figure dans la liste de la douzaine de pays «interdits au titre du risque exportateur caution et pré-
financement», diffusée début février. Rien de vraiment étonnant : il faut savoir que le pays semble tout faire pour collectionner
les mauvaises notes. En avril 2012, l’armée renverse le pouvoir civil en place mais ne resteront pas longtemps au pouvoir. L’in-
tervention des autorités de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest a permis de rétablir l’ordre constitution-
nel. Un président - Serifo Nhamadjo - est nommé pour diriger un gouvernement de transition et relever une économie mise à
genou, avec toutes les compétences et pouvoirs d’un chef d’État élu. Dans cet imbroglio politique où tout est permis, le pays
est devenu au fil des ans et des instabilités, un des «paradis» mondiaux du narcotrafic et du narcoterrorisme.
 6
6
 7
7
1
/
7
100%