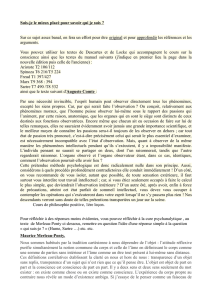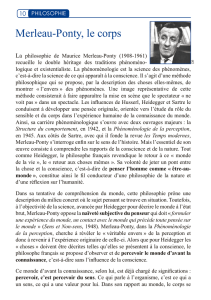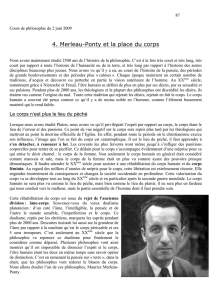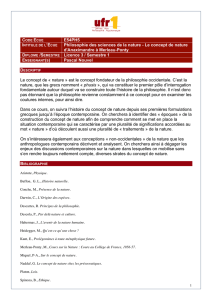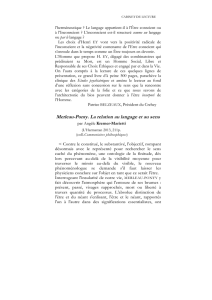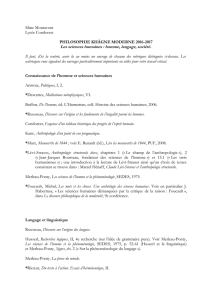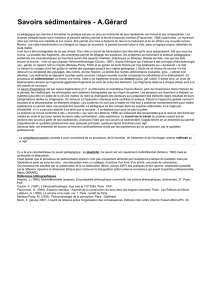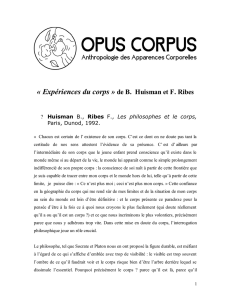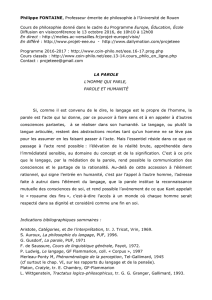1 « L`ESPACE COMME CHIFFRE DE L`ETRE

1
« L’ESPACE COMME CHIFFRE DE L’ETRE » : MERLEAU-PONTY ET L’ESPACE
PROJECTIF.
INTRODUCTION
Le temps comme schème en lequel se résolvent à terme toutes les contradictions est une évidence
pour tout le 19éme siècle et une bonne partie du 20éme. Ce moment de la pensée, qui court de Hegel
à la fin de la seconde guerre mondiale, est le siècle du messianisme1, tant dans ses aspects hégéliens
et marxistes que dans ses aspects moins optimistes, qu’incarnent par exemple Rozenzweig ou
Benjamin2. Selon ce schéma, le temps apparaît comme ce en quoi les contradictions seront
dépassées, les impossibilités levées, les problèmes résolus. C’est cette manière de faire du temps la
matrice de toute solution, cette temporalisation de toutes nos oppositions qui est unanimement
remise en question depuis deux générations. Ainsi, M. Foucault entend mettre l’accent sur la
manière dont l’organisation spatiale supplante désormais la dimension historique, « grande hantise
du 19éme », et ainsi expliquer pourquoi la « géographie doit bien être au cœur de ce dont <il s’>
occupe »3. Avec son concept « d’hétérotopie », apparu dès Les Mots et les choses4, il tente ne plus
penser à partir de l’absence de lieu (U/topie) mais à partir d’un lieu qui, bien que réel, nous décentre
de nos lieux naturels, un lieu qui, littéralement, nous « excentre ». C'est avec ce même objectif que
François Jullien aujourd’hui reprend cette notion. Soucieux de porter un regard décentré sur la
philosophie occidentale, il entreprend de faire un détour par la pensée chinoise qui devient ainsi
« l’espace du dehors » d'où mieux reconsidérer le champ initial. Cette opération de décentrement, de
décalage, ou encore de « révolution du point de vue » est sans doute un des aspects les plus décisifs
de cette volonté de spatialisation des questions. C’est encore à la suite de Foucault, qu’a pu être crée,
par E. Soja, le concept d’hétérotopologie, pensée qui entend faire de la géographie et non de
l’histoire le paradigme de nos investigations5. Mais ce n’est pas seulement Foucault hier et Jullien
aujourd’hui qui spatialisent les concepts là où Hegel les aurait temporalisés, mais bien l’ensemble
des penseurs de ces quarante dernières années. Ainsi, de manière évidente, citera t-on Deleuze qui,
par la notion de pli6, par sa référence à Leibniz et à l’analysis situs opère l’arrachement au temps et
la restitution de la pensée à l’espace. C’est aussi Lacan qui multiplie les schémas placés sous le
signe de la topologie7. C’est encore Piaget qui, dans sa tentative de psychologie génétique, montre
comment la spatialité de l’enfant est immédiatement projective au lieu que l’espace adulte est un
espace euclidien, où les propriétés métriques seules importent. C’est plus, près de nous, F. Dagognet
qui emprunte encore à la topologie dans sa construction d’une « néo-géographie » philosophique8,
ou encore J. Benoist qui entend « rompre avec l’idéalisme historique : respatialiser nos concepts »9.
Bref, « la pensée contemporaine semble caractérisée par la multiplication de références spatiales ou
1 Pour autant qu’on entende par ce terme la résolution des contradictions dans le futur, donc la résolution des problèmes par le temps.
2 Sur ce point voir S. Mosès dans son livre significativement intitulé L’ange de l’histoire, (Paris : Gallimard, folio, 2éme édition, 2006).
3 « Questions à M. Foucault sur la géographie », in Herodote, N°1, janvier-Mars 1976, p. 72.
4 Concept dont les potentialités sont développées l’année suivante dans sa conférence : « Des espaces autres » (1967). Dits et écrits, II. sous la
direction de D. Defert et F. Ewald, Paris, Gallimard, 2001.
5 Voir Soja, Edward W. Postmodern Geographies. The Reassertion of Space in Critical Social Theory. London, New York: Verso, 1989
6 Notion de pli que nous retrouverons également chez Foucault qui parle de « pli du savoir » : « l’homme n’est qu’une invention récente, une
figure qui n’a pas deux siècles, un simple pli dans notre savoir et qu’il disparaîtra dès que celle-ci aura trouvé une forme nouvelle. » Les mots et
les choses, Gallimard, p. 15.
7 Par exemple avec des concepts tel le ruban de Moëbius ou la bouteille de Klein, etc. Sur ce point voir J. P. Gilson, la topologie de Lacan :
une articulation de la cure analytique, Montréal, Editions Balzac, 1994, ainsi que Jeanne Granon-Lafont, la topologie ordinaire de Lacan, paris,
point hors-Ligne, 1985, ou encore Guy. Duportail, L’a priori Littéral, Cerf 2002, qui étudie la topologie chez Lacan, et aussi les indications sur
Lacan de E. de St Aubert dans : Vers une ontologie indirecte, Vrin 2005 p. 223 et sq (reprise de son article paru dans Alter en 2001) ainsi que son
article de 2006 dans les Archives de philosophie « la promiscuité, Merleau-Ponty à la recherche d’une psychanalyse ontologique ».
8 Voir Une épistémologie de l’espace concret. Néo-géographie, Vrin, 1977.
9 Titre d’un article de J. Benoist dans le collectif Historicité et spatialité, Vrin 2001.

2
spatialisantes »10 et emprunte donc assez logiquement bon nombre de ses concepts à la topologie
mathématique, cette prolongation de l’analysis situs de Leibniz, que développera particulièrement
Poincaré11. Or, il se trouve que ce que ce que nous pourrions appeler ce « tournant spatial » de la
pensée la plus contemporaine, nous le devons, au premier chef, à Merleau-Ponty. C’est cette
entreprise de « spatialisation de nos concepts » que je souhaiterais interroger ici. Pour ce faire, après
avoir brièvement montré en quoi nous assistons dés la Phénoménologie de la perception à une
revalorisation philosophique de l’espace (I), j’envisagerai les raisons pour lesquelles Merleau-Ponty
dans son œuvre tardive emprunte de plus en plus de concepts à la pensée topologique (II), pour
pouvoir mieux ensuite interroger le statut de ces concepts (III) et ainsi tirer quelques
enseignements de cette toute première tentative contemporaine de « spatialiser nos concepts ».
I) DU TEMPS COMME HORIZON DE L’ETRE A L’ESPACE COMME « CHIFFRE DE
L’ETRE ».
Il convient de noter tout d’abord combien Merleau-Ponty introduit une rupture dans la tradition
philosophique eu égard au traitement de l’espace. En effet, si, certes, espace et temps furent le plus
souvent liés dans l’analyse, il n’en demeure pas moins que, des schèmes temporels de la Critique de
la raison pure aux extases de Heidegger, en passant par les analyses sur la durée de Bergson, c’est
bien le temps plus que l’espace qui fut considéré comme « horizon de l’être ». Or, dés la
Phénoménologie de la perception se révèle une insistance toute particulière sur les questions de
spatialité. C’est ainsi que l’espace fait l’objet de deux chapitres relativement longs, là où le temps
est traité en un seul et court chapitre.12 Mais, outre ces pures considérations quantitatives, il apparaît
également que la question de l’espace est fondatrice du propos le plus général de l’entreprise.
En effet, à l’espace euclidien (conçu comme l’expression mathématique du dogmatisme de l’être
et de la scission sujet-objet13), Merleau-Ponty opposera la diversité des espaces vécus : espace de
l’enfant, du rêve, du malade, du primitif14, mais aussi de la peinture15, de la nuit16, de la musique17.
Toutes ces spatialités sont « spatialités qualitatives », non mesurables ni objectivables. Merleau-
Ponty entreprendra donc, tout au long de son livre, de restituer la richesse et la diversité de ces
expériences spatiales. Néanmoins, ces descriptions de nos spatialités singulières, pour multiples et
hétérogènes qu’elles soient, ne sont pas simples descriptions empiriques (« mon » vécu de la nuit18),
10 J.Benoist et F. Merlini p 1 de leur introduction, intitulée « spatialiser, historiciser » du livre précédemment cité,.
11 Le véritable essor des questions topologiques a lieu avec Riemann, puis surtout Poincaré. Poincaré estimait que la topologie était la partie la
plus utile des mathématiques car elle s’occupait non plus de mesures mais des formes concrètes effectivement perçues par la conscience commune
(telle la notion intuitive de voisinage, si centrale en topologie de Poincaré au groupe Bourbaki). D’un strict point de vue mathématique, la
topologie étudie étudie les propriétés géométriques invariantes sous l’effet de transformations biunivoques continues. En topologie, les distances
n’existent pas : sphère et ellipses sont équivalentes de même que le tore, une chambre à air ou une tasse de thé. Ce qui explique la plaisanterie
classique qui définit le spécialiste de topologie comme celui qui au moment du goûter ne distingue pas la tasse à thé du beignet. Sur l’importance
de la topologie et de Poincaré dans les mathématiques du XXéme siècle, voir E. Cassirer, Problèmes de la connaissance, Tome IV, Cerf, 1995,
Traduction I.Thomas-Fogiel, Livre I : Mathématiques et physique.
12 Phénoménologie de la perception (à l’avenir PP), Paris, 1ére ed. 1945 : respectivement p 114-172 ; 281-344 et 469-495.
13 Merleau-Ponty associe toujours, dans la PP l’espace métrique, qu’il nomme plus volontiers : « l’espace euclidien » ou encore « espace
universel » à la métaphysique, et l’oppose à la spécificité de « l’espace corporel » que, très tôt, il définira comme espace projectif et donc
topologique. Voir notamment op.cit p332 : « l’espace géométrique s’oppose à l’espace topologique » comme « l’espace géographique à
« l’espace du paysage ». L’espace euclidien comme espace « sans transcendance, réseau de droites » est « en profonde convenance » nous dit
Merleau-Ponty, avec la notion cardinale de la métaphysique dogmatique classique : « l’ens realissimum »
14 Voir PP 333, « espace du rêve, espace mythique, espace schizophrénique », comme trois « espèces » de l’espace de l’homme.
15 PP 331, le tableau n’est pas « dans l’espace où il habite comme chose physique » mais institue l’espace de lui-même, à partir de lui-même.
16 PP 328 : « la nuit est profondeur pure, sans plans sans surface, sans distance d’elle à moi »
17 Voir l’espace « expressif créé par l’organiste » ou encore l’expérience du « concert » où s’oppose « l’espace précis et mesquin » de la fin du
concert et l’espace opposé où la musique se déploie, PP p. 256.
18 Ce serait là un écueil possible de l’analyse phénoménologique qui décrirait la série infinie des espaces singuliers sans jamais atteindre à
l’essence, écueil qui viendrait de ce que, comme le dit Merleau-Ponty : à la limite : « il y a autant d’espaces que d’expériences spatiales
distinctes » (PP : 337), ce qui en dernière instance rendrait vaine tout saisie générale ou conceptuelle. Comme l’analyse du langage en contexte

3
ni psychologiques (la spatialité enfantine)19, ni ethnologiques (l’espace du primitif). Ces descriptions
tentent, en fait, de retrouver ce que Merleau-Ponty nomme, dès la Phénoménologie, « l’ espace
originaire », qu’il associera à « l’espace naturel et primordial »20, à là « spatialité primordiale »21,
qui s’oppose à l’espace euclidien , « espace sans transcendance, réseau de droites », espace isotrope,
« forme suprême de l’objectivité en général »22, aussi éloigné de notre expérience que l’est la carte
de géographie du paysage. Cette spatialité primordiale est « toujours déjà là », inéliminable
condition de possibilité, et en ce sens « a priori23 », spatialité qui s’associe à la vivante présence de
notre corps propre. La spatialité primordiale est la forme que prend notre présence au monde, forme
que fonde le corps de chair, qui seul nous permet de répondre à la question « où suis-je » ? Les
spatialités qualitatives permettent donc à Merleau-Ponty de dépasser l’ego empirique comme l’Ego
transcendantal, pour se mettre en quête de ce « troisième genre d’être », finalité de toutes les
analyses de la Phénoménologie de la perception.
C’est dire l’importance de l’espace puisque, en dernière instance, c’est par lui que nous accédons
au corps de chair, corps phénoménal, corps situé, et réalité originaire irréductible, novation propre
à l’analyse de Merleau-Ponty, qui lui permet de dépasser les classiques oppositions : empirique et
transcendantal, a priori, a postériori, corps, esprit, etc.
Cette centralité théorique de l’espace commandera, dés la Phénoménologie, un grand nombre de
réélaborations conceptuelles des dimensions spatiales : réélaboration de la notion de profondeur qui,
contre la pensée classique24, devient peu à peu, comme l’a noté R. Barbaras25, la véritable dimension
originaire, fondatrice de la largeur et de la longueur ; réélaboration de la notion de juxtaposition,
ensuite, qui progressivement se voit remplacer par le concept topologique « d’enveloppement ». En
effet, à la pure extériorité des parties entre elles (que dit la juxtaposition), Merleau-Ponty
substituera la relation d’une partie du corps à une autre, parties qui « s’enveloppent les unes les
autres »26 et ne se juxtapose ni ne se côtoient. Cette omniprésence de l’espace ne fera que se
confirmer au fil des œuvres de la Prose du monde27, qui reprend en les synthétisant les analyses de
la Phénoménologie, en passant par L’œil et l’esprit qui fait de l’espace : « le chiffre par excellence
anglo-saxon doit veiller à ne pas devenir simple description de situations de parole contingentes et infinies, l’analyse phénoménologique doit
veiller à ne pas devenir déclinaison à l’infini de vécus multiples. Sans quoi, l’analyse du langage deviendrait linguistique et qui plus est
linguistique empirique (étude des contextes réels dans une langue donnée) et la phénoménologie, psychologie et, qui plus est, psychologie
empirique. C’est pourquoi Merleau-Ponty tentera au-delà des multiples « spatialités qualitatives » de trouver les « eide » propres à l’espace.
19 Même si c’est à Piaget et à Wallon que Merleau emprunte l’idée d’une spatialité spécifiquement enfantine très éloignée de l’expérience
adulte, voir par exemple : Psychologie et pédagogie de l’enfant, Cours en Sorbonne, 1949-1952, par exemple « chez l’adulte la spatialité serait
une série de relations, chez l’enfant l’espace est une qualité collant à l’image » p. 526, Paris, Lagrasse, 2001.
20 PP P.340.
21 PP.475.
22 PP 251.
23 C. Taylor a montré qu’on pouvait lire la Phénoménologie de la perception à partir de « l’argument transcendantal ». Dans la mesure où
Merleau-Ponty doit construire une eidétique de l’espace et non multiplier les descriptions empiriques, on peut considérer qu’il part d’un certain
nombre de vécus pour « remonter » à un « toujours déjà là », inéliminable, et en ce sens a priori, qui est condition de possibilité sans laquelle nous
ne pourrions ni penser ni même éprouver ces expériences multiples. Sur la structure de l’argument transcendantal en général et sa possible
fécondité aujourd’hui, nous nous permettons de renvoyer à notre livre Référence et autoréférence, Paris, Vrin 2006.
24 Voir notamment la polémique sur la largeur contre Berkeley, dans PP, 303 et sq
25 Il écrit : « la réflexion de Merleau-Ponty sur l’espace est toute entière concentrée sur une méditation de la profondeur » De l’être au
phénomène, 1992, p.238.
26 Sur l’enveloppement voir PP p. 117 et sq, 306, ou encore l’opposition p. 84 entre « l’objet qui n’a rien d’enveloppé mais est tout entier
étale » et le vécu spatial de mon corps, etc. On pourrait multiplier les citations où figure le terme « d’enveloppement », figure topologique qui
entend se substituer à l’appréhension euclidienne des objets, puisqu’elle permet de penser la distinction entre « situation » et position » : Sur la
distinction entre « la position » de la chose dans l’espace euclidien et la « situation topologique « de mon corps, voir le livre central d’ A de
Waehlens : Une philosophie de l’ambiguïté, L’existentialisme de MP, Louvain 1978 p. 119 et sq. F.D. Sebbah dans Usage contemporain de la
phénoménologie, Paris, ed. sens et Tonka, collège international de philosophie, 2008, analyse avec précision les figures spatiales utilisées par
Merleau-Ponty (enveloppement, chiasme, etc) en vue de penser la relation entre philosophie et psychologie. Dans un article de 2001, Intellectica,
2001, 1, intitulé « la constitution de la perception spatiale. Approche phénoménologique et expérimentale », il développait également cette
potentialité de Merleau-Ponty.
27 Gallimard, 1969 (PM), notamment p. 73 et suivantes.

4
de l’être »28, jusque dans les tout derniers textes, derniers fragments, dernières notations qui
consacrent l’importance de cette réflexion sur l’espace, qui se mènera de plus en plus à partir des
concepts empruntées à la topologie. C’est l’usage de ces concepts de topologie qu’il nous faut
maintenant interroger, puisque comme l’a noté amplement E. de St Aubert, Merleau-Ponty est l’un
des premiers à avoir déployé la possible fécondité des ces structures topologiques29. Quelle est la
signification et le statut de ce conceptuel « import-export » des mathématiques vers la philosophie ?
C’est ce qu’il nous faut déterminer pour approfondir ce « tournant spatial » opéré par Merleau-
Ponty.
II) SIGNIFICATION DES NOTIONS TOPOLOGIQUES
A) FONCTION DES CONCEPTS TOPOLOGIQUES
Par le recours à ces concepts, Merleau-Ponty entendait penser avec Husserl plus loin que
Husserl. Certes, reconnaîtra Merleau-Ponty, la Krisis a su promouvoir non seulement le
dépassement de la conscience commune mais encore de l’attitude scientifique qui objective.
Certes, avec l’Epoché, Husserl a pu mettre fin à la relation du sujet et de l’objet telle qu’elle fut
promue par la science moderne, relation en laquelle le regard d’un sujet souverain « embrasse »,
selon l’expression de Descartes, l’objet et l’épuise en même temps, puisque nulle épaisseur, nulle
opacité ni mystère ne vient contrarier sa visée souveraine. Néanmoins, Husserl par le statut qu’il
accorde très tôt30 à l’Ego transcendantal, -synthèse et donc centre des multiples phénomènes qu’il
fonde et constitue-, reconduit la métaphysique de la subjectivité comme le primat de la
présence31. En dernière instance, le sujet de Husserl, est, comme le sujet cartésien, centre d’un
monde qu’il détaille et construit. Le sujet omniscient est face au monde comme le géographe face
à ses cartes ou, mieux encore, comme le spectateur leibnizien scrute la ville en haut d’une tour
située en son exact milieu. C’est dans la volonté d’en terminer définitivement avec cette posture
qu’intervient l’innovation propre de Merleau-Ponty et que réside la signification de son
introduction des concepts empruntés à la topologie mathématique. En effet, comme nous le
montrent nos « spatialités qualitatives », je n’embrasse pas le monde entier ni la pluralité de ses
éléments comme le géographe peut le faire d’une carte située sous son regard. Aussi le
phénoménologue, s’il veut se rapprocher de l’expérience réellement éprouvée, devra t-il revenir à
28 P. 47 et 88 qui reprennent au demeurant la suggestion de PP p. 255.
29 Sur ce point voir son importante étude « Sources et sens de la topologie chez Merleau-Ponty » in Alter, N°9, 2001, p.331-364, reprise dans
le scénario cartésien, Vrin 2005 p.207 et suivantes. Le recours de Merleau à la topologie est aujourd’hui bien connu et abondamment commenté.
Voir, par exemple J. Petitot, « topologie phénoménale : sur l’actualité scientifique de la phusis phénoménologique de Merleau-Ponty » in
Merleau-ponty, le philosophe et son langage , Cahier N° 15 du groupe de recherche sur la philosophie et le langage, Grenoble, CNRS, 1993, p.
291-312, ainsi que dans le même numéro Arion L. Kelkel « Merleau-Ponty entre Husserl et Heidegger, de la phénoménologie à la topologie de
l’être », aussi bien que I.Matos Dias, dans son chapitre I de Poeitique du sensible,, intitulé « Topologie de la réflexion » Presses universitaires de
Toulouse, 2001, ou encore Maël Renouard dans son article : « le point de vue de Sirius ou la cartographie du visible » in Historicité et spatialité ,
le problème de l’espace dans la pensée contemporaine, sous la direction de J. Benoist et F. Merlini, Vrin 2001 ou encore M. Gambazzi in
Monades, plis et miroirs dans la revue italienne Chiasmi 1, Milan Mimesis, 1998, Publicazzine della società di studi su Merleau-Ponty, qui
significativement prend le titre d’un concept topologique central à savoir celui de Chiasme. Dans le livre précédemment cité, F.D. Sebbah a
insisté sur la relation en chiasme de Merleau-Ponty à la psychologie. Françoise Dastur dans Chair et langage, essais sur Merleau-Ponty, Encre
Marine, Paris, 2001, a, dans ce livre fondateur de toutes les études sur Merleau-Ponty qui ont suivies, insisté sur « la pensée de l’empiètement et
de la promiscuité générale », sur « l’entrelacement » et le « chiasme » (contre la pensée du face à face), chiasme qui unissait chez Merleau-Ponty,
la phénoménologie à la « non-philosophie » et à la pensée ordinaire. Dans une même optique, on lira J.C. Beaune (ed) dans « Phénoménologie et
psychanalyse, étranges relations », colloque de 3 et 4 Mars 1995, Champ-Vallon, Seyssel, 1998, l’article intitulé : « Jacques Lacan et la traversée
de la phénoménologie », qui interprète cette relation à l’aide de concepts spatiaux, ou encore St Aubert qui a également comparé les deux
démarches dans son article « la promiscuité, Merleau-Ponty à la recherche d’une psychanalyse ontologique », dans le collectif 2006 déjà cité, ou
enfin très récemment G.F. Duportail dans Les institutions du monde de la vie, Lacan et Merleau-Ponty, Millon, 2008 qui entreprend de renouer le
dialogue interrompu entre Lacan et Merleau-Ponty à partir d’une analyse de leur utilisation respective des notions comme celle du « chiasme ».
30 J.F Lavigne a reconstitué la genèse de l’idéalisme transcendantal dans son Husserl et la naissance de la phénoménologie, (Paris : PUF,
2005). Après la lecture de ce livre, on est en droit de se demander si le soi-disant « tournant transcendantal » qui viendrait rompre
spectaculairement avec la période des Recherches logiques a vraiment existé, en un mot s’il n’a pas toujours été déjà là.
31 Ce sont également les critiques très proches de Heidegger et Derrida.

5
l’espace vécu, à cet espace du « primitif » qui « dans le désert est à chaque instant orienté
d’emblée sans avoir à se rappeler ni à additionner les distances parcourues et les angles de dérive
depuis le départ »32. A l’espace du géomètre (espace métrique), il nous faut substituer le lieu de
notre corps en mouvement (espace projectif). C’est pourquoi : « revenir aux choses mêmes, c’est
revenir à ce monde d’avant la connaissance dont la connaissance parle toujours et à l’égard
duquel toute détermination scientifique est abstraite, signitive et dépendante, comme la
géographie à l’égard du paysage où nous avons d’abord appris ce que c’est qu’une forêt, une
prairie ou une rivière »33. Dans l’esprit de Merleau-Ponty, ces concepts topologiques permettent
de mieux revenir à l’espace vécu de la chair, de mieux saisir les vécus grâce auxquels nous
pouvons « habiter le monde ». Et de fait, comme le remarquait déjà Poincaré lui-même, comme
ensuite Bourbaki, le concept de « voisinage », dont sont directement issues les figures merleau-
pontienne d’empiétement, d’entrelacement, de pli, sont plus « intuitives » et immédiates que ne le
sont les figures euclidiennes et par suite sont plus susceptibles d’être en prise sur le vécu de la
chair, sur l’expérience du corps dans le monde, que ne l’était la représentation classique d’un
espace qui unifie la diversité des perspectives à partir d’un plan géométral. L’approche
projective, nous libérera de cette posture de maîtrise, nous délivrera de l’entrave d’un
positionnement galiléen, nous affranchira de ce regard qui, supposé tout voir, ne voit de nulle
part. Envisageons plus précisément le contenu de ces concepts.
B) CONTENU DES CONCEPTS TOPOLOGIQUES
Comme le note E. de St Aubert, l’ensemble des notions empruntées à la topologie
s’organisent autour du concept d’empiètement qui, dans l’œuvre tardive de Merleau-Ponty, ira
jusqu’à qualifier l’acte même de philosopher34. Qu’est ce que philosopher sinon empiéter, passer
d’un domaine à l’autre, en voisinant, en tressant, en enlaçant. Il s’agit par cette notion de briser la
relation de face à face avec l’objet, par laquelle je toise l’autre sans être à côté de lui ni avec lui.
Initialement, ce concept d’empiètement fut utilisé par Merleau-Ponty pour penser le corps propre,
le corps de chair que je suis. A propos de l’enveloppement, qui est empiètement, il écrit : « la
philosophie est la remémoration de cet être-là dont la science ne s’occupe pas parce qu’elle
conçoit les rapports de l’être à la connaissance comme ceux du géométral et de ses projections et
qu’elle oublie l’être de l’enveloppement, ce qu’on pourrait appeler la topologie de l’être »35. Mais
il peut sembler qu’au fil des textes, ce concept d’empiètement, point de départ d’une topologie de
l’être, deviendra la matrice de toute relation à l’autre (qu’il s’agisse de ma relation à autrui mais
aussi de la relation de la phénoménologie à une autre discipline : l’histoire, l’art, etc36.). Avec
cette notion « d’empiètement », le sujet n’est plus ce spectateur transcendantal, point limite du
monde parce que non situé en lui ; il est corps enveloppé par le monde, constitué de la même
chair que lui, participé par le monde et non face à lui. Monde et corps sont une seule entité, et non
plus une substance (res cogitans) face à une autre (res extensa) ; ils sont un même continuum, fait
32 PP, 117
33 Op.Cit. préface, p. III.
34 Voir la citation fameuse : « l’empiètement qui est pour moi la philosophie », in Notes de lecture et de travail autour de Descartes, dans les
manuscrits conservés à la Bibliothèque Nationale, vol XXI, cité par St Aubert dans Du lien des êtres aux éléments de l’être, Merleau-Ponty au
tournant des années 1945-1951. Il revient longuement sur ce point dans son troisième essai consacré à cet auteur : Vers une ontologie indirecte,
(Paris : Vrin 2006).
35 Préface de Signes, (Paris : Gallimard, 1980) 30.
36 Thématiser la relation entre la phénoménologie et les autres disciplines est, en dernière instance, la grande préoccupation du dernier
Merleau-Ponty. Toutes les facette de cette tentative ont été mises en lumière dans un numéro récent des Archives de philosophie, intitulé
Merleau-Ponty, Philosophie et non-philosophie, qui envisage successivement la relation de sa philosophie à des disciplines aussi diverses que la
psychanalyse, la sociologie, l’histoire, l’art). Voir L’article déjà mentionné de St Aubert sur Lacan, de Bimbenet sur la sociologie : Sens et
pratiques réflexives. Quelques développements sociologiques de l’ontologie merleau-pontyenne ; de D. Belot : un tableau de l’histoire
humaine » ou de Kristensen Une esthétique du mouvement . Ce numéro est une excellente synthèse de la relation de la philosophie à son autre
chez Merleau-Ponty
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%