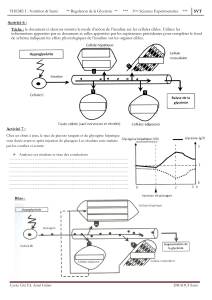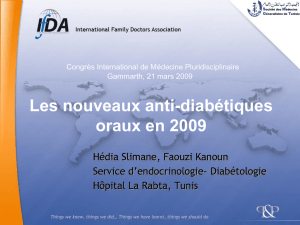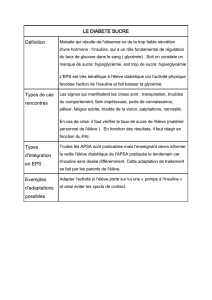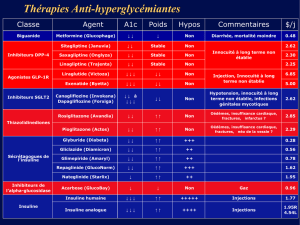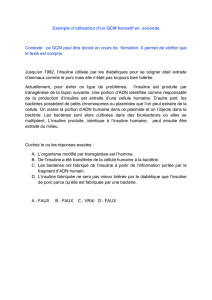Téléchargez le PDF - Revue Médicale Suisse

B. de Kalbermatten
J. Jaafar
F. R. Jornayvaz
J. Philippe
introduction : le diabète de type 2 et
son traitement souvent insuffisant
Physiopathologie du diabète de type 2
On compte à ce jour 382 millions de personnes diabétiques
dans le monde, dont environ 90% ont un diabète de type 2.
C’est une maladie évolutive dont la physiopathologie est as-
sociée à de multiples anomalies incluant, d’une part une sur-
production hépatique de glucose, responsable de l’hyperglycé-
mie à jeun, et d’autre part, une sécrétion d’insuline diminuée
ainsi qu’une insulinorésistance des tissus cibles périphériques
(muscles squelettiques, foie et tissu adipeux) responsables
des excursions glycémiques postprandiales.1-3 La dysfonction des îlots de Lange-
rhans est un élément-clé et un prérequis dans le développement du diabète de
type 2. Au stade de prédiabète, la production d’insuline est normale mais pro-
portionnellement trop faible par rapport au degré de sensibilité à l’insuline, qui
lui, est réduit. Par la suite, la production d’insuline diminue et la glycémie s’élève
(figure 1). On observe, en outre, une surproduction (postprandiale et à jeun) de
glucagon par les cellules a pancréatiques, aggravant la néoglucogenèse hépa-
tique 3 et une diminution de l’effet incrétine (tableau 1). En effet, une réduction
des taux postprandiaux de GLP-1 (
Glucagon-Like-Peptide
/peptide analogue au glu-
cagon), responsable en partie de l’hyperglycémie postprandiale, a été observée
chez les patients diabétiques de type 2.1 Le résultat global de ces anomalies est
donc une production excessive de glucose et une sous-utilisation de celui-ci.
Les traitements conventionnels et leurs limites
Le diabète de type 2 est une maladie complexe aux complications potentiel-
lement sévères.3 Sa prise en charge efficace est d’une importance évidente pour
la prévention de ses complications vasculaires.4 Cependant, environ 55% des pa-
tients diabétiques de type 2 ont une HbA1c en dessus des cibles recommandées
pour leur situation.
L’utilisation combinée de médicaments aux mécanismes d’action divers a été
largement acceptée dans le traitement du diabète de type 2.2 Ces traitements
Combined treatment of insulin and GLP-1
analogs : what do we expect ?
Type 2 diabetes mellitus is a progressive and
heterogeneous disease. The decrease in in-
sulin secretion by pancreatic b cells and the
increase of glucagon secretion by pancreatic
b cells, are the two major pathophysiologic
characteristics. The majority of type 2 diabe-
tics will therefore require insulin in the evo-
lution of their disease, with weight gain and
hypoglycaemia as side effects. GLP-1 analogs
are effective therapeutic alternatives due to
their actions on glucagon and insulin secre-
tion, on satiety and gastric emptying. For pa-
tients inadequately controlled with conven-
tional antidiabetics, GLP-1 analogs, introduced
as an alternative or in combination with insu-
lin, can prevent or reduce the side effects as-
sociated with insulin. Indeed, the risk of hy-
poglycaemia is reduced and the vicious circle
of weight gain secondary to insulin/need to
increase insulin doses is limited.
Rev Med Suisse 2014 ; 10 : 1235-40
La diminution de la sécrétion d’insuline et l’augmentation de
celle du glucagon représentent les deux caractéristiques physio-
pathologiques principales du diabète de type 2. La majorité
des patients vont devoir recourir à une insulinothérapie avec
comme conséquences une prise pondérale et un risque d’hy-
poglycémie accru. Les analogues du GLP-1 sont une alterna-
tive thérapeutique efficace de par leur action sur la sécrétion
de glucagon et d’insuline, la satiété et le ralentissement de la
vidange gastrique. Chez les patients insuffisamment contrôlés
par les traitements oraux conventionnels, introduits en alter-
native ou en combinaison à une insuline, ils permettent d’éviter
ou de limiter les effets secondaires liés à l’insuline. Le risque
d’hypoglycémie est réduit et la spirale infernale prise de poids/
augmentation des doses d’insuline est limitée.
Traitement combiné d’insuline et
d’analogue du GLP-1 : qu’en attendre ?
le point sur…
0 Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
4 juin 2014
Drs Bénédicte de Kalbermatten,
Jaafar Jaafar et François R. Jornayvaz
Pr Jacques Philippe
Département des spécialités
de médecine
Service d’endocrinologie, diabétologie,
nutrition et hypertension
HUG, 1211 Genève 14
Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
4 juin 2014 1235
11_16_37943.indd 1 28.05.14 08:58

Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
4 juin 2014 0
conventionnels visent principalement à potentialiser la sé-
crétion d’insuline (sulfonylurées, glinides) et à améliorer la
sensibilité à l’insuline (metformine, glitazones). Par leur con-
trôle sur l’équilibre glycémique, ils ont prouvé réduire, du
moins pour certains, le risque des complications, notamment
microvasculaires.1,4 Leur utilisation est cependant limitée
par leurs effets secondaires et leur incapacité à agir à long
terme malgré une efficacité initiale.5 En effet, ils n’agissent
pas sur des voies déterminantes dans la physiopathologie
du diabète de type 2, telles la diminution de la sécrétion
d’insuline et l’hypersécrétion de glucagon. La détérioration
progressive de la fonction des cellules b pancréatiques est
le facteur principal de l’évolution de la maladie et, en con-
séquence, de l’échec des traitements oraux conventionnels.
La nécessité d’adapter la médication au cours du temps est
intrinsèque à l’évolution naturelle de la maladie. De nom-
breux patients requièrent donc, après plusieurs années de
diabète, des thérapies combinant des antidiabétiques oraux
et l’insuline pour arriver à un contrôle glycémique accep-
table (figure 1).
Diabète de type 2 : quelle cible thérapeutique
et quel traitement ?
Il est actuellement recommandé d’obtenir un bon con-
trôle glycémique avec une HbA1c à moins de 7% chez la
plupart des patients, notamment afin de réduire le risque
d’atteintes microvasculaires. En pratique, on recommande
des glycémies à jeun l 7 mmol/l et postprandiales l 10
mmol/l. Des cibles plus strictes (HbA1c : 6-6,5%) sont envi-
sageables chez certains patients sélectionnés (diabète de
courte durée, longue espérance de vie, absence de maladie
cardiovasculaire), si celles-ci peuvent être obtenues sans
risque d’hypoglycémie majeure ou autres effets secondaires.
A l’inverse, chez certains patients, des cibles moins strictes
(7,5-8%) sont appropriées. En effet, l’ensemble des essais
cardiovasculaires dans le diabète de type 2 suggère qu’il
est important d’individualiser les cibles thérapeutiques au
contexte du patient.3
Sur le plan pratique, les recommandations internatio-
nales actuelles 3 préconisent, conjointement à l’instauration
de mesures hygiéno-diététiques, une monothérapie par
metformine en première ligne de traitement (efficacité éle-
vée sur la diminution de l’HbA1c, faible risque d’hypoglycé-
mie, perte de poids possible, faible coût). Si la cible d’HbA1c
n’est pas atteinte après environ trois mois de monothérapie
par metformine, un traitement de deuxième ligne doit être
envisagé. Une sulfonylurée, une glitazone, un agent incrétine
ou même une insuline (généralement basale) sont possibles.
En général, l’association d’un second médicament oral réduit
l’HbA1c de 1% environ.3 S’il n’y a pas de baisse significative
de la glycémie malgré une bithérapie bien conduite, le mé-
1236 Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
4 juin 2014
Tableau 1. L’effet incrétine
(D’après réf.3).
Le GLP-1 (glucagon-like peptide 1) et le GIP (glucose-dependent insu-
linotropic polypeptide) sont des hormones intestinales sécrétées en
réponse à une prise alimentaire
Elles induisent la sécrétion d’insuline par les cellules b et réduisent la
sécrétion de glucagon par les cellules a, en réponse à un repas. Cette
activité du GLP-1 est glucose-dépendante et est responsable de 70% de
la sécrétion d’insuline chez le sujet sain. Leur effet est pléiotrope avec
également un ralentissement de la vidange gastrique et une augmentation
de la sensation de satiété
Les hormones incrétines endogènes sont inactivées en quelques minutes
par une enzyme, la dipeptidyl-peptidase-4 (DPP-4)
Figure 1. Physiopathologie, évolution du diabète de type 2 et échappement aux traitements
Mesures
hygiéno-diététiques
Traitements
oraux en
monothérapie
Traitements
oraux
combinés
Insulinothérapie
Insulinorésistance
Sécrétion de glucagon
Glycémie
Production d’insuline
Fonction des cellules b
Prédiabète Diagnostic
du diabète
Développement des
complications macro
et microvasculaires
4 ans 7 ans 10 ans 16 ans
11_16_37943.indd 2 28.05.14 08:58

Diabète? Troubles du métabolisme des lipides?
Réponses directement dans votre cabinet médical
Système Point of Care cobas b 101
Permet la surveillance et le traitement des patients diabétiques
• Dosage de l’hémoglobine glyquée (HbA1c)
Indique si le patient court un plus grand risque de développer une maladie cardiovasculaire
• Mesure du profi l lipidique (CHOL, HDL- et LDL-CHOL, TG)
Diagnostic du syndrome métabolique
• Surveillance de la glycémie à long terme (HbA1c)
et des valeurs des lipides sanguins (HDL- et LDL-CHOL, TG)
COBAS, COBAS B et LIFE NEEDS ANSWERS sont des marques de Roche.
© 2014 Roche
Roche Diagnostics (Suisse) SA
6343 Rotkreuz
www.roche-diagnostics.ch/fr/cobas-b-101
Système Point of Care
cobas b 101
cobas-b-101_Inserat_FR_A4_140417.indd 1 17.04.14 11:06
1007085

Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
4 juin 2014 0
dicament de deuxième ligne peut être remplacé par un
autre ayant un mécanisme d’action différent. Au stade de la
trithérapie, les mêmes combinaisons orales et injectables
sont possibles. Cependant, l’insuline reste le traitement le
plus efficace, particulièrement quand l’HbA1c est très éle-
vée.3
traitement par insuline
En raison du déclin progressif de fonctionnement des
cellules b, le recours à un traitement d’insuline est fréquem-
ment requis (plus de 20% des patients). Cette progression
naturelle de la maladie, combinée à l’augmentation de sa
prévalence, et le fait que les patients sont diagnostiqués à
un âge de plus en plus précoce signifient que le nombre de
patients nécessitant,
in fine
, un traitement par insuline pour
maintenir un contrôle glycémique adéquat va croître.1 La
majorité des patients diabétiques de type 2 maintiennent
cependant des taux non négligeables de sécrétion d’insu-
line endogène, même à des stades tardifs de la maladie. En
conséquence, le recours à des stratégies thérapeutiques d’in-
sulinothérapie simple (basale) est habituellement pos sible.3
Comme mentionné précédemment, l’insuline peut être
introduite en deuxième ou troisième ligne de traitement,
en association avec un ou plusieurs autres antidiabéti ques.
Il est important de débuter par une insuline basale avant
d’aller vers des stratégies d’insulinothérapie com plexes.
La stratégie la plus pratique comporte une seule injection
d’insuline basale à faible dose (0,1-0,2 U/kg/jour) dans le
but d’inhiber la néoglucogenèse hépatique et de restaurer
une glycémie à jeun normale. L’horaire de celle-ci va dépen-
dre des activités du patient et de son profil glycé mi que. Au
final, il est important de retenir que n’importe quelle insu-
line permet toujours d’abaisser la glycémie et l’HbA1c. Ce-
pendant, le risque d’hypoglycémie en est la barrière prin-
cipale.2 Les hypoglycémies sont associées à une morbidité
et à une mortalité augmentées.1,5 La prise de poids sous
insuline (estimé à environ 2 kg pour chaque diminution
d’HbA1c de 1%) est l’autre facteur principal limitant son
utili sation.1 La prise de poids varie bien sûr en fonction du
régi me d’insuline utilisé (moindre sous régime d’insuline
basale que régime basal/prandial) et de la dose totale ad-
ministrée. La prise concomitante de certains antidiabé-
tiques oraux (glitazones et sulfonylurées) augmente encore
davantage cette prise de poids. En outre, dans les essais
cliniques,2 la proportion de patients traités atteignant un
contrôle glycémi que satisfaisant sous insuline excède rare-
ment 60% et cela au prix d’événements hypoglycémiques.
Par conséquent, de nouveaux régimes de traitement mini-
misant les effets secondaires de l’insuline, améliorant l’ad-
hérence des patients et aidant à préserver potentiellement
la fonction des cellules pancréatiques b, sont requis.1 Les
analogues du GLP-1 représentent dans ce sens une classe
thérapeuti que intéressante.6
traitement par analogue du glp-1
Cibler le système des incrétines est devenu une ap-
proche thérapeutique importante dans la prise en charge
du diabète de type 2.7 Les inhibiteurs de la DPP-4 (dipep-
tidyl-peptidase-4) et les analogues du GLP-1 sont les deux
classes de médicaments développés à cet effet. En mimant
ou potentialisant l’action des hormones incrétines endo-
gènes,2,8,9 ces agents améliorent le contrôle glycémique
global en agissant tant sur la glycémie à jeun que sur les
excursions glycémiques postprandiales, et cela sans risque
majeur d’hypoglycémie.1,8,10 Les recommandations inter-
nationales admettent l’utilisation des agents incrétines oraux
(inhibiteurs de la DPP-4) ou injectables (analogues du
GLP-1) en deuxième et troisième lignes de traitement après
échec par des antidiabétiques conventionnels seuls ou en
association. De façon globale, il faut noter que l’efficacité des
analogues du GLP-1 s’est révélée supérieure à celle des in-
hibiteurs de la DPP-4 sur le contrôle glycémique global.11
Les analogues du GLP-1, en plus de leur capacité à sti-
muler la sécrétion d’insuline, ont une série d’effets pléio-
tropes comme la diminution de l’appétit, le ralentissement
de la vidange gastrique et, dans des modèles animaux, po-
tentiellement sur la survie des cellules b.9 Même lorsque
la fonction des cellules b est sévèrement altérée, les ana-
logues du GLP-1 agissent sur la glycémie en supprimant la
sécrétion de glucagon par les cellules a, ciblant par là un
défaut pathogénique majeur du diabète de type 2, négligé
par les autres traitements conventionnels.1 Il n’y a pas
d’avantage théorique à associer inhibiteur de la DPP-4 et
analogue du GLP-1 dans le sens où la finalité est d’aug-
menter l’effet incrétine.
Analogue du GLP-1 en alternative à une
insuline basale : résultats d’études
L’introduction d’un analogue du GLP-1, en alternative à
une insuline basale (ou prémix) chez des patients diabé-
tiques de type 2, insuffisamment contrôlés sous antidiabé-
tiques oraux conventionnels en mono ou bithérapie, sem-
ble présenter de nombreux avantages. Par leur action prin-
cipalement sur les excursions glycémiques postprandiales,
leur introduction précoce à la place d’une insuline fait sens.
Une efficacité similaire à l’insuline sur le contrôle glycé-
mique a été démontrée, avec un risque moindre d’hypo-
glycémie et une perte de poids significative (2,3 à 3,6 kg)
et durable sur le long terme.2 En combinaison aux traite-
ments antidiabétiques oraux conventionnels, une baisse
de l’HbA1c de 0,8 à 1,7% peut être attendue.7 Toutefois, il
n’existe pas de critères fiables permettant de prédire quel
patient va répondre aux analogues du GLP-1. Certaines
études suggèrent qu’ils seraient une alternative de choix à
l’insuline, principalement chez des patients sévèrement
obèses (IMC L 35 kg/m2) mais avec une HbA1c encore infé-
rieure à 8,5%.2,6,10,12
Différents types d’analogues du GLP-1 existent en Suisse.
Leurs caractéristiques, différences et indications reconnues
en Suisse sont décrites dans le tableau 2.
traitements combinés insuline et
analogue du glp-1 : avantages,
désavantages, résultats d’études
L’association d’un analogue du GLP-1 à l’insuline répond
à une logique théorique de par leurs actions complémen-
taires et additives. L’insuline basale contrôle la glycémie à
1238 Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
4 juin 2014
11_16_37943.indd 3 28.05.14 08:58

Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
4 juin 2014 1239
jeun et les analogues du GLP-1, par leur action glucose-dé-
pendante sur la sécrétion d’insuline et leurs effets sur la
satiété et la vidange gastrique, agissent sur les excursions
glycémiques postprandiales. Cette combinaison va donc
permettre un meilleur contrôle glycémique global.10 En
outre, par l’inhibition de la sécrétion de glucagon, les agents
incrétines améliorent les glycémies postprandiales, même
si la fonction cellulaire b est fortement altérée.
Les bénéfices de l’ajout d’un analogue du GLP-1 à un
traitement d’insuline basale et vice-versa (chez des patients
en plus sous metformine et/ou sulfonylurée en mono ou
bithérapie) ont maintenant été largement étudiés. Les bé-
néfices, aussi bien des analogues de courte durée que de
longue durée d’action,13 comparés à une insulinothérapie
basale seule, sont une diminution supplémentaire de l’HbA1c
(notamment par un meilleur contrôle des glycémies post-
prandiales), une possible diminution de la dose totale d’in-
suline, une diminution du risque d’hypoglycémie et une
perte de poids ou une limitation de la prise de poids liée
à l’insuline.
L’adjonction d’un analogue du GLP-1, en alternative à
l’insuline rapide chez des patients insuffisamment contrôlés
sous antidiabétiques oraux et insuline basale, a également
été étudiée.2,6,14 La baisse d’HbA1c s’est avérée similaire
et une perte de poids ainsi qu’une diminution des épiso-
des d’hypoglycémie ont été retrouvées dans le groupe sous
analogue du GLP-1. Cette association semble particulière-
ment adaptée chez les patients obèses, polymorbides ou
âgés, chez qui l’intensité du contrôle glycémique doit par-
ticulièrement être relativisée au risque d’hypoglycémie et
de prise pondérale.
L’arrêt de l’insuline prandiale après l’initiation d’un ana-
logue du GLP-1, chez des patients traités par insuline ba-
sale-bolus ou insuline prémix, a également été démontré
possible.1,11,14 C’est par ailleurs dans ces situations que la
diminution de la dose totale d’insuline s’est avérée la plus
importante.1
L’arrêt de l’insuline basale après introduction d’un ana-
lo gue du GLP-1 n’est pas recommandé car on observe une
aggravation du contrôle glycémique dans 50% des cas.2,11
La diminution des doses d’insuline, tant basale que pran-
diale, après introduction d’un analogue du GLP-1, doit donc
se faire de façon progressive en fonction du contrôle glycé-
mique.
Actuellement, il n’y a pas de données relatives à l’asso-
ciation analogue du GLP-1/insuline à propos de la diminu-
0 Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
4 juin 2014
Molécules Exénatide (Byetta) Liraglutide (Victoza) Exénatide LAR (Bydureon)
Durée d’action Courte Longue Ultra longue
L 24 heures L 24 heures 1 semaine
Demi-vie 2,4 heures Demi-vie 13 heures Demi-vie 5-6 jours
Posologie Injection SC Injection SC Injection SC
Dose initiale de 5 mg 2 x/jour Dose initiale de 0,6 mg à titrer Dose de 2 mg 1 x/semaine.
durant 1 mois puis 10 mg 2 x/jour. après 1 semaine à 1,2 mg puis Sans lien avec les repas
Avant les repas 1,8 mg. Sans lien avec les repas
Prix Dose max. : CHF 4.66/jour Dose max. : CHF 7.53/jour Dose max. : CHF 5.31/jour
Avantages 3,8 En comparaison aux analogues de En comparaison aux analogues de courte durée d’action
longue durée d’action • Diminution supplémentaire de l’HbA1c et de la glycémie à jeun
• Effet supérieur sur les excursions • Evénements hypoglycémiques moindres
glycémiques postprandiales • Meilleure tolérance digestive
• Plus forte inhibition de la vidange
gastrique
• Moins de tachyphylaxie
Effets indésirables • Effets gastro-intestinaux : nausées, vomissements, diarrhées, constipation, douleurs abdominales, dyspepsies (généralement
transitoires en début de traitement)
• Pancréatites aiguës (données d’études controversées)
• Rares hypoglycémies (principalement quand combinées aux sulfonylurées)
Adaptation en cas Peut être utilisé avec précaution jusqu’à un stade CHILD B.
d’hépatopathie17 (Pharmacocinétique étudiée principalement pour la liraglutide)
Adaptation en cas Si TFG 60-30 ml/min : adaptation de dose Si TFG 60-30 ml/min : pas d’adaptation Si TFG 60-30 ml/min : pas d’adaptation
d’insuffisance à 5 mg 2 x/jour au maximum de dose nécessaire de dose nécessaire
rénale16,17 Si TFG l 30 ml/min : contre-indiqué Si TFG l 30 ml/min : contre-indiqué Si TFG l 30ml/min : contre-indiqué
Contre-indications Maladies gastro-intestinales sévères, gastroparésies, pancréatites
Indications 1. Diabète de type 2 insuffisamment contrôlé sous antidiabétiques oraux 1. Diabète de type 2 insuffisamment
approuvées (metformine en monothérapie OU association metformine/sulfonylurée contrôlé sous antidiabétiques
et remboursées et metformine/glitazone) r IMC M 28 kg/m2
oraux (metformine en monothérapie
en Suisse 2. En association avec de l’insuline basale (et w metformine) chez les diabétiques OU association metformine/
de type 2 insuffisamment contrôlés sous antidiabétiques oraux préalables sulfonylurée et metformine/glitazone)
r IMC M 28 kg/m2
r IMC M 28 kg/m2
Pour le Victoza, condition de remboursement avec insuline basale
stricto sensu : analogue GLP-1 puis insuline et non l’inverse.
Pas remboursé en association avec des insulines prandiales
Tableau 2. Caractéristiques, différences et indications reconnues en Suisse des analogues du GLP-1
TFG : taux de filtration glomérulaire.
11_16_37943.indd 4 28.05.14 08:58
 6
6
1
/
6
100%