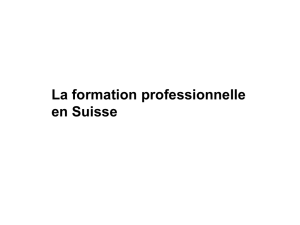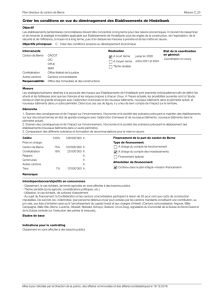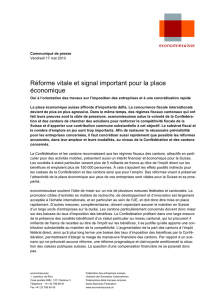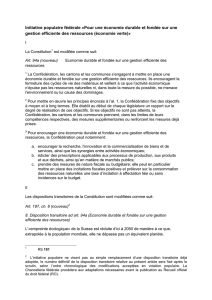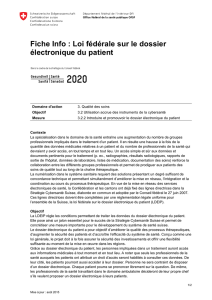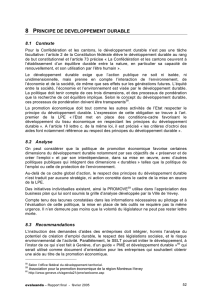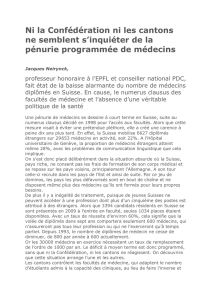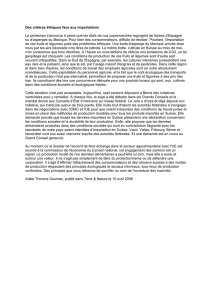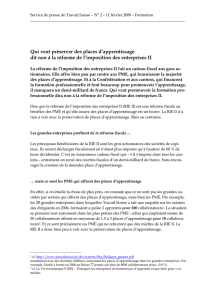Confédération

1/10
URL: http://www.hls-dhs-dss.chF26413.php
© 1998-2017 DHS: tous les droits d'auteur de cette publication sont réservés au Dictionnaire historique de la Suisse, Berne. Les textes sur
support électronique sont soumis aux mêmes règles que les textes imprimés. Droits d'utilisation et modalités de citation (PDF)
08/02/2012 |
Confédération
On appelle confédération, depuis 1350 environ, l'un des nombreux réseaux d'alliances jurées apparus sur le
territoire de la Suisse actuelle. Cet ancien système communal et républicain, métamorphosé et révolutionné
entre 1798 et 1848, a donné naissance à l'Etat fédéral moderne, que la Constitution dénomme Confédération
suisse (all. Schweizerische Eidgenossenschaft, it. Confederazione Svizzera, rom. Confederaziun svizra, lat.
Confoederatio helvetica). Si le terme français vient du lat. foedus (traité d'alliance), le mot allemand fait
référence au serment (all. Eid), forme suprême d'engagement, juré devant Dieu par des Genossen
(compagnons) égaux en droits, pour une période limitée ou à perpétuité. La confédération s'oppose à
l'organisation hiérarchique du pouvoir féodal, qui repose sur l'hommage vassalique.
Le terme d'Eidgenossen (confédérés) se trouve dans plusieurs alliances jurées du XIIIe s., mais les dérivés
abstraits n'apparaissent que dans la première moitié du XIVe s. dans un sens juridique et en 1351 pour
désigner un territoire. Ensuite, Eidgenossenschaft s'utilise en concurrence avec diverses variantes du titre
officiel (Liga vetus et magna Alamaniae superioris du XVe au XVIIIe s., alter grosser Pund obertütscher Landen
du XVe au XVIIe s.) et avec des termes plutôt réservés au langage courant (Helvetien, Schweiz). La formule
Schweizerische Eidgenossenschaft, rare aux XVIe et XVIIe s., devient plus fréquente au XVIIIe. Les langues
romanes utilisent des termes où l'idée de serment n'apparaît pas, les dérivés de coniuratio ayant un sens
négatif: on dit en français Ligues, Treize Cantons, République suisse, Corps helvétique (de Corpus
helveticum), Suisse, en italien Lega, Helvezia, Corpo Elvetico, Svizzera. Quant au mot francisé eidguenots, il
désignait seulement le parti pro-suisse à Genève au début du XVIe s.
L'ancienne Confédération comprenait huit cantons de pleins droits dès 1353, puis treize de 1513 à sa chute
en 1798, une douzaine de pays alliés aux droits diversement limités (villes, principautés, républiques à
structures confédérales des Grisons et du Valais), des bailliages communs administrés par plusieurs cantons
(mais en aucun cas par tous) et quelques protectorats. Les membres de ce système complexe entretenaient
de nombreuses alliances avec les puissances européennes.
1 - Historiographie et recherche
L'historiographie de l'ancienne Confédération fut d'abord marquée par la forme populaire du mythe
fondateur, dont les éléments sont le serment du Grütli, la légende de Guillaume Tell, la destruction des
châteaux et le tyrannicide (Mythes fondateurs). Apparu d'abord dans le Livre blanc de Sarnen dans les années
1470, transmis par Aegidius Tschudi, puis par d'autres chroniqueurs, il sera stylisé et popularisé par Jean de
Müller et par Schiller. Mis en doute vers 1760 déjà par la publication du Pacte fédéral de 1291, texte latin qui
était tombé dans l'oubli, et par la découverte des racines nordiques de la légende de Tell, les récits des
chroniqueurs se virent renvoyés dans le domaine du mythe par Joseph Eutych Kopp et l'(Histoire) scientifique
du XIXe s., fondée sur les sources, notamment sur les pactes fédéraux, et confirmée au XXe s. par Werner
Meyer et l'archéologie médiévale. Sur cette base critique, l'histoire générale de la Confédération fut presque
toujours présentée, dans la seconde moitié du XIXe s., selon une optique protestante, libérale puis radicale,
étatique, comme une évolution continue depuis la confédération d'Etats aux liens peu contraignants jusqu'à
l'Etat fédéral de 1848 (Charles Monnard, Louis Vuillemin, Karl Dändliker, Johannes Dierauer, Wilhelm Oechsli).
A cette vision trop finaliste, déformée en outre, à l'époque de la défense spirituelle, par un prisme patriotique
et démocratique (Karl Meyer), s'opposèrent les représentants d'une nouvelle démythologisation (Marcel Beck)
et ceux de l'histoire économique et sociale (Hans Conrad Peyer), qui ne s'imposa qu'à partir des années 1970

2/10
URL: http://www.hls-dhs-dss.chF26413.php
© 1998-2017 DHS: tous les droits d'auteur de cette publication sont réservés au Dictionnaire historique de la Suisse, Berne. Les textes sur
support électronique sont soumis aux mêmes règles que les textes imprimés. Droits d'utilisation et modalités de citation (PDF)
(Roger Sablonier). Ces tendances, qui offrent une image moins consensuelle, se reflètent dans la Nouvelle
histoire de la Suisse et des Suisses (1982-1983). Guy P. Marchal, Ulrich Im Hof, Bernhard Stettler, Matthias
Weishaupt ont étudié l'historiographie de la Confédération; Peter Blickle l'a située dans le contexte européen
du mouvement communal des paix territoriales. La question de savoir si l'ancienne Confédération est un Etat,
une fédération, une confédération d'Etats ou un Etat fédéral n'a guère progressé depuis Jean Bodin et Josias
Simler (1576), à moins de lire, avec Blickle, le Contrat social de Rousseau (1762) comme une théorie de la
coniuratio ou de la confédération. Les historiens actuels considèrent que chaque canton était détenteur de
souveraineté, mais que la Confédération ne satisfaisait pas aux critères qui définissent un Etat, puisque la
plupart des attributs de l'Etat moderne lui faisaient défaut: monopole de la violence légitime, gouvernement
central, administration et justice institutionnalisée. De même lui manquaient les signes de la souveraineté:
sceau, armoiries, trésor, etc. Même ses symboles (couronne d'armoiries, treize Confédérés prêtant serment)
la présentent comme la somme de ses membres, les signes unitaires (Helvetia, Croix fédérale) ne s'imposant
qu'au XIXe s. Néanmoins, l'Europe la voyait comme une unité. Les controverses autour des anniversaires de
1991 et 1998 ont montré l'écart séparant les conceptions savante et populaire de l'histoire suisse, écart
d'autant plus profond que l'identité nationale, fragilisée pour diverses raisons à la fin du XXe s., s'appuie
fortement sur l'image, revivifiée pendant la Deuxième Guerre mondiale, d'une Confédération au destin unique
et pratiquant dès 1291 la démocratie et la défense armée.
Auteur(e): Andreas Würgler / PM
2 - Des origines à 1353
C'est dans le traité de 1351 par lequel Uri, Schwytz, Unterwald et Lucerne s'allient avec Zurich qu'apparaît le
terme de "confédération" au sens à la fois d'alliance jurée et de territoire où est due l'entraide. Ce traité servit
de modèle pour ceux de 1352 avec Zoug et Glaris et de 1353 avec Berne. Le passage de "confédérés" à la
notion plus abstraite de "confédération" est d'autant plus remarquable que l'on utilise le singulier. Pourtant,
les huit cantons de 1353 formaient non pas un mais six réseaux différents et tous partiels; par exemple,
Berne n'était pas allié avec Lucerne, Zurich, Zoug et Glaris, mais seulement avec Uri, Schwytz et Unterwald;
Glaris était allié avec ces trois derniers et avec Zurich, mais non avec Berne, Lucerne et Zoug, même si des
ententes annexes et des accords séparés bilatéraux établissaient des liens indirects complémentaires. De
telle sorte que jusqu'à la bataille de Sempach (1386), Zurich, Berne et Lucerne se traitaient dans les
correspondances officielles non pas de "confédérés" mais d'"amis". L'emploi d'un mot suggérant une alliance
unique résulte peut-être du caractère inhabituel d'un système illimité dans la durée, mais limité dans
l'espace.
Il existait au XIIIe s. sur le territoire de la Suisse, alors intégré au Saint Empire romain germanique, quatre
régions principales relativement indépendantes les unes des autres dans lesquelles se formèrent, étant donné
la faiblesse ou l'absence du pouvoir impérial, d'innombrables alliances, généralement éphémères, ayant pour
but le maintien de la paix et l'entraide militaire contre des nobles locaux ou des puissances voisines (Savoie,
Bourgogne, Habsbourg, Milan). A l'ouest, la confédération bourguignonne dirigée par la ville de Berne montre
les multiples possibilités d'évolution de telles alliances, puisque ses membres devinrent finalement, soit des
bailliages bernois (vallée du Hasli, couvent d'Interlaken, villes de Berthoud et de Payerne, par exemple), soit
des cantons suisses (Soleure, Fribourg), soit des alliés de la Confédération (ville de Bienne, comté de
Neuchâtel). La ville de Bâle regardait surtout vers le nord, celles de Zurich, Schaffhouse et Saint-Gall vers la
région du lac de Constance, mais toutes s'intéressaient aussi aux grandes alliances urbaines (Ligue du Rhin
de 1254, des villes souabes de 1376/1385, des villes alsaciennes de 1379).
Alliances perpétuelles des cantons ("Pactes fédéraux")
Année Cantons
1291 UR SZ NW

3/10
URL: http://www.hls-dhs-dss.chF26413.php
© 1998-2017 DHS: tous les droits d'auteur de cette publication sont réservés au Dictionnaire historique de la Suisse, Berne. Les textes sur
support électronique sont soumis aux mêmes règles que les textes imprimés. Droits d'utilisation et modalités de citation (PDF)
Année Cantons
1315 UR SZ UWa
1332 UR SZ UW LU
1351 UR SZ UW LU ZH
1352/1473 UR SZ UW - ZH avec
GL
1352/1365 UR SZ UW LU ZH - ZG
1353 UR SZ UW - - - - BE
1408 - - - - ZH GL - -
1421 - - - LU - - - BE
1423 - - - - ZH - - BE
1481 UR SZ UW LU ZH GL ZG BE avec
FR SO
1501 UR SZ UW LU ZH GL ZG BE FR SO avec
BS
1501 UR SZ UW LU ZH GL ZG BE FR SO BS avec
SH
1513 UR SZ UW LU ZH GL ZG BE FR SO BS SH avec
APb
a UW: Unterwald
b AP: Appenzell
Sources:Auteur
Le long de la route du Gothard apparut la confédération des communautés de vallées de la Suisse primitive
qui a des équivalents au Vorarlberg, aux Grisons et autour de Briançon dans le Dauphiné. L'alliance d'Uri,
Schwytz et Nidwald, attestée en août 1291, existait peut-être déjà entre 1240 et 1290. Ses membres
voulaient assurer la sécurité extérieure et intérieure par l'assistance militaire et par l'arbitrage. Après avoir
battu les Habsbourg à Morgarten en 1315, ils renforcèrent leurs liens par un nouveau pacte, en allemand
celui-ci, et élaborèrent une politique extérieure commune dans le domaine de la défense et des alliances.
L'association sur pied d'égalité et sans limite de durée entre cantons campagnards et villes du Plateau fut un
phénomène inhabituel. A Lucerne, ville sujette des Habsbourg, les bourgeois conjurés et prêts à prendre le
pouvoir cherchaient en 1332 un appui militaire auprès des campagnards; les bourgeois de Zurich, ville
impériale, firent de même en 1351 et s'assurèrent ainsi le maintien de la constitution qu'ils s'étaient donnée
en 1336 après avoir expulsé les nobles. L'alliance avec Zurich maintenait la liberté de conclure d'autres
alliances, comprenait une délimitation claire du territoire où l'entraide était due, précisait les procédures
d'arbitrage et exigeait l'unanimité en cas de révision. Nées dans la violence, les alliances avec Zoug (1352,
1365) et Glaris (1352, 1393) firent de la Confédération un territoire d'un seul tenant. L'alliance perpétuelle
d'Uri, Schwytz et Unterwald avec Berne, ville impériale, succéda en 1353 à des pactes temporaires
d'assistance militaire (dès 1323) et entraîna un rapprochement avec la Confédération bourguignonne. Elle
permit de délimiter les zones d'influence dans l'Oberland et d'assurer la défense contre les Habsbourg et la
noblesse locale. La Confédération des huit cantons fut désormais considérée, même à l'extérieur, comme une
entité durable.
Tel Zurich en 1336, la plupart des cantons connurent au XIVe s. une sorte de mouvement communal, assez
mal documenté: des familles roturières enrichies par le commerce et la guerre chassèrent du pouvoir la
noblesse, avec l'aide des landsgemeinde ou des corporations. On put racheter en même temps les droits
seigneuriaux, déjà sans doute bien affaiblis, qui impliquaient encore des statuts non libres.
Auteur(e): Andreas Würgler / PM

4/10
URL: http://www.hls-dhs-dss.chF26413.php
© 1998-2017 DHS: tous les droits d'auteur de cette publication sont réservés au Dictionnaire historique de la Suisse, Berne. Les textes sur
support électronique sont soumis aux mêmes règles que les textes imprimés. Droits d'utilisation et modalités de citation (PDF)
3 - Consolidation et élargissement (1353-1515)
Le système se consolida par des alliances nouvelles (Zurich et Glaris en 1408, Berne et Lucerne en 1406 et
1421, Zurich et Berne en 1423) ou modernisées (suppression de la réserve des droits des Habsbourg dans les
alliances de Lucerne, Zurich et Zoug en 1454, révision de l'alliance de Glaris en 1473) et surtout par des
accords entre cantons. La Charte des prêtres (1370) ôta beaucoup de compétences aux tribunaux étrangers,
surtout ecclésiastiques, et interdit la guerre privée. Après les victoires de Sempach (1386) et de Näfels
(1388), auxquelles avaient pris part pour la première fois tous les cantons (ainsi que Soleure), le convenant
de Sempach (1393) stipula qu'aucun canton ne pourrait commencer une guerre sans l'accord des autres. Les
empereurs de la maison de Luxembourg, Charles IV et Wenceslas, antihabsbourgeois, confirmèrent en
1360-1362 et 1376-1379 les alliances confédérales, ce qui est d'autant plus remarquable que la Bulle d'or
avait interdit en 1356 toutes les coniurationes ou autres confederationes et que toutes les ligues urbaines
d'Allemagne seront dissoutes en 1389.
Accords
Année Nom Cantons
1370 Charte des prêtres UR SZ UWaLU ZH - ZG -
1393 Convenant de
SempachbUR SZ UW LU ZH GL ZG BE
1481 Convenant de Stans UR SZ UW LU ZH GL ZG BE
1647 DéfensionalcUR SZ UW LU ZH GL ZG BE FR SO BS SH APd
1668/1674 DéfensionaleUR SZ UW LU ZH GL ZG BE FR SO BS SH APd
a UW: Unterwald
b plus Soleure, pays allié
c plus l'abbé et la ville de Saint-Gall, alliés
d AP: Appenzell
e plus l'abbé et la ville de Saint-Gall, la ville de Bienne, alliés
Sources:Auteur
L'élargissement territorial de la Confédération comme de ses membres résulta de conquêtes, d'achats, de
prises en gage, de la conclusion de combourgeoisies; en outre les cantons octroyaient, malgré l'interdiction
inscrite dans la Bulle d'or, la bourgeoisie foraine à des personnes qui échappaient ainsi aux liens féodaux
(Seigneurie territoriale). Des combourgeoisies ou autres alliances ne conférant pas des droits égaux,
généralement jurées unilatéralement et non perpétuelles, liaient quelques cantons, parfois même un seul,
avec une ville, un seigneur, un pays, par exemple avec Appenzell (1403, 1411, 1454), l'abbé de Saint-Gall
(1451, 1479), la ville de Saint-Gall (1454), Schaffhouse (1454), Rottweil (1463), Mulhouse (1466), le comte et
la ville de Neuchâtel (1406), l'évêque de Sion et les dizains du Valais (1416-1417, 1475), l'évêque de
Constance (1469), etc. Les territoires conquis et pris en gage étaient propriété, non de la Confédération en
tant que telle, mais de huit cantons (l'Argovie de 1415 à 1798) ou de sept (la Thurgovie de 1460 à 1798), à
titre de bailliages communs. Leurs administrateurs devaient rendre des comptes au cours d'une séance qui
eut lieu presque chaque année de 1416 à 1797 et qui contribua à la tenue régulière de la Diète fédérale,
principale institution de la Confédération, issue des conférences réunies occasionnellement pour arbitrer les
conflits. Contrairement aux huit anciens cantons, les pays alliés n'avaient pas automatiquement un siège ou
une voix à la Diète; ils ne participaient pas à l'administration des bailliages communs.
Alliances perpétuelles, traités de combourgeoisie entre cantons et alliésa

5/10
URL: http://www.hls-dhs-dss.chF26413.php
© 1998-2017 DHS: tous les droits d'auteur de cette publication sont réservés au Dictionnaire historique de la Suisse, Berne. Les textes sur
support électronique sont soumis aux mêmes règles que les textes imprimés. Droits d'utilisation et modalités de citation (PDF)
Année Cantons Alliés
1344 FR Bienne
1352 BE Bienne
1382 SO Bienne
1400 GL Ligue grise
1406 BE Comte et ville de Neuchâtel
1407/1419 UR OW Ligue grise
1416/1417 UR UWbLU Dizains du Valais
1446 BE Dizains et évêque de Sion
1451 SZ LU ZH GL Abbé de Saint-Gall
1454 SZ LU ZH ZG GL BE Ville de Saint-Gall
1475/1500 BE Dizains et évêque de Sion
1479/1490 SZ LU ZH GL Abbé de Saint-Gall
1489 BE FR SO Bienne
1495 FR Neuchâtel
1497 UR SZ UW LU ZH ZG GL Ligue grise
1498 UR SZ UW LU ZH ZG GL Ligue de la Maison-Dieu
1501 LU SO Neuchâtel
1515 UR SZ UW LU ZH ZG GL BE BS FR SO SH APcMulhouse
1519 UR SZ UW LU ZH ZG GL BE BS FR SO SH APcRottweil
1529 UR SZ UW LU ZG FR Valais
1536 BE Genève
1584 ZH BE Genève
1590 ZH GL Ligue des Dix-Juridictions
1602 BE Ligues rhétiques
a L'alliance de 1579 entre les cantons catholiques et le prince-évêque de Bâle, non perpétuelle, fut renouvelée
à plusieurs reprises et se termina en 1735.
b UW: Unterwald
c AP: Appenzell
Sources:Auteur
En s'alliant avec les Habsbourg en 1442, Zurich mit en danger l'existence de la Confédération. Comme dans
une situation analogue en 1393, Schwytz et les Confédérés intervinrent (guerre de Zurich) et purent
supprimer la clause autorisant Zurich à conclure d'autres alliances.
La Confédération s'agrandit encore par l'admission de cinq nouveaux cantons entre 1481 et 1513 et par la
conquête de territoires qui devinrent des bailliages communs à sept cantons (Sargans de 1483 à 1798, le
Rheintal de 1490 à 1798), à deux et demi (Riviera, val Blenio, Bellinzone occupés par Uri, Schwytz et Nidwald
en 1500/1503), à douze (bailliages tessinois en 1512 et de 1515 à 1798), à deux (Grandson, Morat, Orbe-
Echallens pris par Berne et Fribourg en 1475 et 1484). Le protectorat sur le duché de Milan (1513-1515) resta
éphémère. La diplomatie perdit la Franche-Comté conquise par les armes (1513).
Les villes de Zurich, Berne et Lucerne, qui se sentaient menacées après les guerres de Bourgogne
(1474-1477) par l'agitation de jeunes mercenaires de Suisse centrale, conclurent une combourgeoisie
perpétuelle avec Fribourg et Soleure. Craignant la prépondérance des villes, les cantons campagnards s'y
opposèrent. Le conflit (1477-1481) fut résolu, grâce à la médiation de Nicolas de Flue, par l'adoption du
convenant de Stans. Ce texte réglait le partage du butin bourguignon, garantissait l'intégrité territoriale des
cantons et les obligeait à s'entraider même en cas de révolte intérieure; il s'appliquait aussi aux pays alliés,
qui pourtant n'avaient pu le discuter. Le même jour, Fribourg et Soleure furent admis dans la Confédération
(le Convenant de Sempach considérait déjà Soleure comme confédéré en 1393), mais pas tout à fait de plein
droit: les cantons campagnards leur refusèrent jusqu'en 1501 un siège à la Diète et jusqu'en 1526 l'égalité
dans les serments d'alliance. L'arrivée de Fribourg ne posa pas de problème de langue, ce canton bilingue
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%