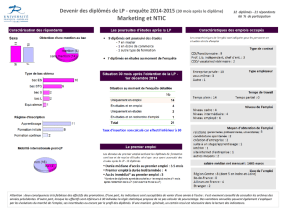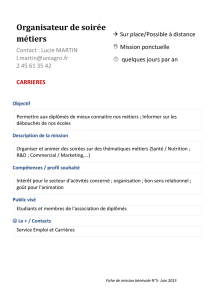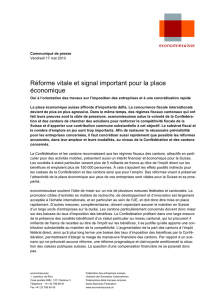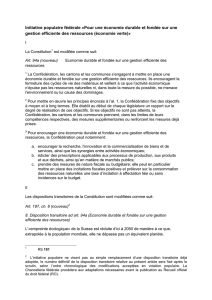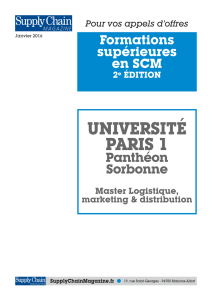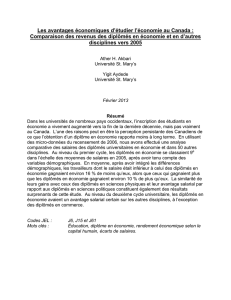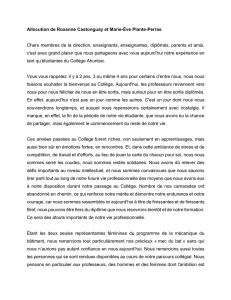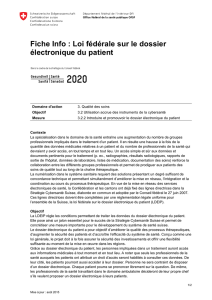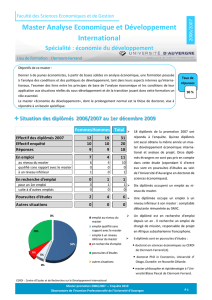Pénurie médicale par J. Neirynck

Ni la Confédération ni les cantons
ne semblent s’inquiéter de la
pénurie programmée de médecins
Jacques Neirynck,
professeur honoraire à l’EPFL et conseiller national PDC,
fait état de la baisse alarmante du nombre de médecins
diplômés en Suisse. En cause, le numerus clausus des
facultés de médecine et l’absence d’une véritable
politique de la santé
Une pénurie de médecins se dessine à court terme en Suisse, suite au
numerus clausus décidé en 1998 pour l’accès aux facultés. Alors que cette
mesure visait à éviter une prétendue pléthore, elle a créé une carence à
peine dix ans plus tard. En effet, la Suisse mobilise 6627 diplômés
étrangers sur 29 653 médecins en activité, soit 22%. A l’Hôpital
universitaire de Genève, la proportion de médecins étrangers atteint
même 28%, avec les problèmes de communication linguistique que cela
implique.
On s’est donc placé délibérément dans la situation absurde où la Suisse,
pays riche, ne consent pas les frais de formation de son corps médical et
se repose sur les pays voisins, principalement l’Allemagne. A son tour
celle-ci recrute dans les pays de l’Est et ainsi de suite. Par ce jeu de
dominos, les pays les plus défavorisés sont en bout de chaîne et ne
disposent même plus des médecins qu’ils ont formés pour leurs propres
besoins.
De plus il y a inégalité de traitement, puisque de jeunes Suisses ne
peuvent accéder à une profession dont plus d’un cinquième des postes est
attribué à des étrangers. Alors que 3394 candidats résidents en Suisse se
sont présentés en 2009 à l’entrée en faculté, seules 1034 places étaient
disponibles. Avec un taux de réussite d’environ 60%, cela signifie que la
volée de diplômés dans sept ans comportera seulement 600 médecins, qui
n’assureront pas tous leur profession ou qui ne l’exerceront qu’à temps
partiel. Depuis 1993, le nombre de diplômes de médecin ne cesse de
diminuer, de 800 par année à 600 actuellement.
Or les 30 000 médecins en exercice nécessitent un taux de remplacement
de l’ordre de 1000 par an. Le déficit à moyen terme est donc programmé,
sans que ni la Confédération, ni les cantons ne réagissent. On découvrira
que cette situation arrange l’une et les autres.
Les cantons contrôlent les facultés de médecine, qui adaptent le nombre
d’étudiants admis à la capacité des cliniques, au lieu de faire l’inverse et

d’ajuster la capacité d’accueil des facultés au nombre de médecins
nécessaires. Le nombre total de places en clinique est de 835 en 2010, en
augmentation de 14% par rapport au 731 places disponibles en 2007.
Mais cette hausse provient surtout des Universités de Lausanne et de
Genève, qui forment à elles seules plus du tiers des médecins suisses,
tandis que Bâle et Berne se sont refusés à tout accroissement de leur
capacité.
De son côté, la Confédération n’est pas pressée d’augmenter le nombre de
praticiens et promulgue même des moratoires sur le nombre de cabinets
médicaux, ce qui signifie en clair qu’à son point de vue il sort trop de
médecins des facultés et pas trop peu.
En effet, elle gère difficilement l’assurance maladie et soutient la thèse
selon laquelle les dépenses croissent en fonction du nombre de médecins,
en évaluant à un demi-million le coût de tout nouveau cabinet. Le pouvoir
fédéral se situe ainsi dans une perspective étrange: un cabinet médical
supplémentaire constituerait une dépense à fonds perdus, dont on ne peut
attendre aucun résultat positif.
On se situe ainsi à l’interface entre cantons et Confédération, où les
partenaires ont tendance à réduire les coûts sans tenir compte des
besoins réels et sans que personne ne se sente responsable d’une
politique d’ensemble. En son principe, elle est évidente. Il faut coûte que
coûte que la Suisse assure la pérennité de son système de santé,
indubitablement un des meilleurs du monde, en ne laissant pas se créer
une pénurie de médecins.
Le bien public demande que la Suisse ne s’engage pas dans une spirale
dissimulée de rationnement des soins et qu’elle cesse de compter sur
l’étranger pour fournir l’appoint des médecins nécessaires. Toutes les
instances compétentes sont d’accord sur ce point: le Conseil suisse de la
science et de la technique, l’Académie suisse des sciences médicales, la
Fédération des médecins suisses préconisent un relèvement de 20% des
médecins diplômés.
Le critère de limitation des étudiants admis est un test d’aptitude pour
Bâle, Berne, Fribourg et Zurich, tandis que Genève, Neuchâtel et
Lausanne procèdent jusqu’à maintenant à une sélection interne à la fin de
la première année. Inutile de s’enferrer dans une controverse portant sur
les mérites comparés des deux méthodes. Il est évident aussi qu’une
procédure de sélection améliore la qualité des diplômés et réduit le
nombre des années d’études en évitant les redoublements.
Mais il est inacceptable que la barre soit placée trop haut pour des raisons
uniquement budgétaires. Plus on réduit le nombre de diplômés, meilleurs
seront-ils, évidemment: plus aptes aux études, mieux motivés, mieux
encadrés, déployant plus d’efforts dans un milieu hautement compétitif.
Mais à quoi cela servira-t-il au patient dans dix ans: il ne parviendra plus
à trouver un médecin, parce que celui qui aurait pu être formé serait
moins bon que celui qui est débordé et inaccessible? L’argument de la
qualité est donc fallacieux: on ne demande pas les meilleurs médecins du
monde, indisponibles parce que trop rares, on demande suffisamment de
médecins pour soigner les malades avec la qualité que l’on peut attendre.

Comme un rationnement de la médecine empêche les actions préventives
et la prise en charge rapide des patients, il peut mener finalement à
davantage de coûts.
A première vue, la solution est simple. Il appartiendrait à la
Confédération, garante de la santé nationale, d’imposer aux universités de
relever le quota d’étudiants admis et d’adapter les places en clinique aux
besoins du pays et non à leur budget présent. Mais l’autonomie des
universités s’y oppose. En réponse à une interpellation Gutzwiller, le
Conseil fédéral «recommande» aux cantons d’augmenter le nombre des
diplômés. Ce genre de réaction incitative n’est pas suffisant. Il nous faut
une politique de la santé au niveau national avec une prise de
responsabilité sérieuse.
Si nécessaire, la Confédération a du reste la base légale pour créer une
faculté de médecine rattachée aux EPF et implantée dans le Tessin, qui
constitue un champ d’action non exploité pour un hôpital universitaire.
Mais une telle solution prendra au moins dix ans pour produire les
premiers diplômés. Il y a donc urgence.
Cette impasse illustre, une fois de plus, les dangers d’un fédéralisme mal
compris. Le Conseil fédéral manque cruellement d’un département
consacré uniquement à la formation et à la recherche qui serait en
position d’assumer des responsabilités au plan national.
On pourrait du reste confier à ce nouveau département la mission
périlleuse d’assurer la meilleure utilisation des ressources de
l’enseignement dans toutes les disciplines. Certaines professions sont
véritablement engorgées. S’il faut créer un numerus clausus, ce serait
pour celles-ci. Ou alors il faudra admettre une fois pour toutes que le libre
choix des étudiants pour leurs études est un principe intangible.
La Confédération a la base légale pour créer une faculté rattachée aux EPF
et implantée dans le Tessin
!
1
/
3
100%