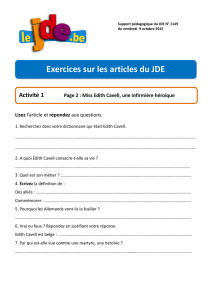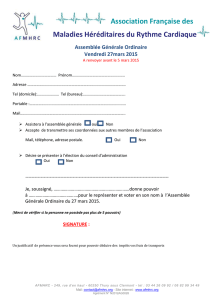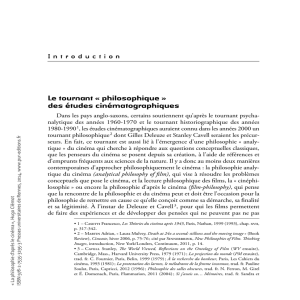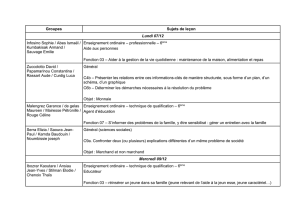Langage ordinaire et vouloir dire : Stanley Cavell défenseur critique

1
Langage ordinaire et vouloir dire : Stanley Cavell défenseur critique d’Austin
(in La philosophie du langage ordinaire, Histoire et actualité de la philosophie d’Oxford,
Christophe Al-Saleh & Sandra Laugier (Eds.), Olms, 2011)

2
Par RAOUL MOATI
Le premier texte de Stanley Cavell sur la pensée d’Austin, « Devons-nous vouloir dire ce que nous
disons ? », voit le jour sous la pression des circonstances, il s’agit pour le jeune Cavell de défendre la
pensée du philosophe d’Oxford contre les attaques formulées par Benson Mates à l’endroit de la
philosophie du langage ordinaire. « Devons-nous vouloir dire ce que nous disons ? » se présentait au
départ comme une réponse de Cavell à l’interprétation donnée par Benson Mates (Mates 1964) du
débat ayant opposé Ryle à Austin sur le statut des expressions décrivant une action volontaire. Dans
« Devons-nous vouloir dire ce que nous disons ? » Cavell prend partie pour Austin contre Ryle, et plus
généralement contre l’interprétation dépréciative de la philosophie du langage ordinaire que Mates
induit de sa compréhension de ce débat. Les circonstances de la polémique contre Mates sont
restituées par Cavell dans Un ton pour la philosophie (Cavell 2003). Cavell rappelle dans un premier
temps, les circonstances de sa rencontre avec Austin, il décrit le rôle fondamental que jouèrent dans sa
propre vocation philosophique les William James Lectures données par Austin à Harvard en 1955. Se
manifestant à ses collègues comme bien décidé à défendre quoi qu’il en coûte la pensée d’Austin
contre ses éventuels détracteurs, Cavell raconte ensuite qu’on décida de l’inviter en 1958 à une séance
de réunion organisée par l’Association américaine de philosophie, en attendant de lui qu’il réponde
aux critiques que Benson Mates adressait à la philosophie du langage ordinaire, et qui, d’après les
mots de Cavell, « trouvait l’apport philosophique des travaux d’Austin (pour dire les choses
brutalement) tout à fait nul » (Cavell 2003.94). Toujours dans Un Ton pour la philosophie, Cavell
rappelle qu’à l’occasion du séminaire d’Austin à Berkeley, où Austin était professeur invité pour un
semestre, on décida de consacrer la première session du séminaire aux réponses apportées par Austin
aux critiques formulées par Mates. Avant son intervention Austin demanda à Cavell un exemplaire de
son texte, sans pour autant jamais le citer au cours de son séminaire, ni même l’évoquer au moment de
la discussion, ni plus tard en privé, à la grande déception du jeune philosophe. Cavell interpréta le
silence d’Austin comme un signe de sa désapprobation. Ce n’est que quelques années plus tard qu’il
apprit non sans joie, qu’Austin à son retour à Oxford avait recommandé à ses étudiants ce qui n’était
autre que le prototype du futur « Must We Mean What We Say ? », de sorte que le silence d’Austin
finit par être interprété par Cavell comme le témoin de sa profonde et rassurante approbation. Ce
revirement d’interprétation par rapport au silence du maître n’a pas été sans jouer un rôle décisif sur
Cavell quant à l’opportunité de publier son texte, et plus tard de donner à son premier livre le titre de
son premier essai « Must We Mean What We Say ? ».
Bien que ces circonstances aient joué un rôle décisif dans l’élaboration et la finalisation de l’article de
Cavell, on aurait toutefois tort de résumer « Devons-nous vouloir dire ce que nous disons ? » à un
texte dont la portée serait réductible aux circonstances polémiques qui en ont motivé l’élaboration : à
travers la réhabilitation d’Austin qu’il propose par-delà les critiques de Mates, il s’agit déjà pour
Cavell de déterminer la signification de la démarche philosophique propre à la philosophie du langage
ordinaire, et de se demander ainsi sur la voie de quelle problématisation de la question du vouloir dire
(Mean), la philosophie du langage ordinaire d’Austin nous engage. C’est à cette question et à la
révélation du caractère paradoxal, c’est-à-dire non mentaliste, du statut du vouloir dire impliqué par le
langage ordinaire que sera consacré la première partie de cet exposé, avant de tenter de comprendre,
dans un second temps, le revirement de position qui conduisit Cavell à prolonger sa méditation sur
l’articulation du langage ordinaire au vouloir dire, contre certaines tendances de la pensée d’Austin à
gommer le scepticisme qui lui est constitutif.
1.Devons-nous (vraiment) vouloir dire ce que nous disons ?
Revenons dans un premier temps sur l’opposition théorique entre Austin et Ryle. Sur quoi porte-t-
elle ?
Selon Ryle, l’utilisation du mot « volontaire » pour décrire une action, l’insistance sur le caractère
« volontaire » de celle-ci, renverrait au fait que nous entendrions par là nécessairement que l’action

3
accomplie se serait faite sous l’égide de motifs moralement douteux :
Nous ne discutons pour savoir si l’action de quelqu’un était ou non volontaire (voluntary) que lorsque l’action
semble avoir été sa faute (when the action seems to have been his fault). (Cavell 2009.76)
Austin récuse la systématisation par Ryle de la relation de l’action décrite comme volontaire à la faute
morale dont elle devrait procéder. Austin objecte à Ryle l’existence d’une diversité d’usages du mot
« volontaire », permettant de qualifier des actions douteuses, anormales sans que celles-ci, le soient
nécessairement dans un sens moral.
Si Ryle, tout comme Austin, s’accordent sur le fait que qualifier une action de « volontaire » n’est
pertinent que dans des cas où l’action n’est pas accomplie normalement, autrement dit, qu’une
anomalie frappe le régime de l’action, en revanche, Austin n’est pas prêt à accepter la généralisation
rylienne quant à la nature systématiquement morale du défaut qui caractériserait l’action exécutée. Je
peux par exemple faire un cadeau volontairement, soutient Austin, sans que cela me mette en porte-à-
faux moral, ni traduise une faute. Il faut toutefois reconnaître que dire « le cadeau a été fait
volontairement » n’est pas sans impliquer que quelque chose d’inhabituel s’est produit : par exemple
illustre Cavell, que « au lieu de la bouteille que vous lui donnez chaque année pour Noël, vous donnez
au policier du secteur un chèque de 1000 dollars », ou encore « vous laissez vos héritiers sans le sou et
vous léguez votre maison à votre chat » (Cavell 2009.79). C’est seulement dans ce genre de
circonstances inhabituelles que la question de savoir si un tel don était « volontaire » devient
pertinente, et peut alors se poser de manière intelligible. Gilbert Ryle a donc raison de montrer que la
signification du recours au vocable « volontairement » exige que l’action se soit effectuée dans des
circonstances particulières, toutefois, il a tort de restreindre ces circonstances à celles d’une déviance
d’ordre moral. D’après Austin, Ryle a raison de rapporter l’utilisation de « volontairement » à un genre
de circonstances inhabituelles, mais sa spécification est beaucoup trop restrictive et la généralisation
qu’il propose est abusive pour cette raison même. Il faut rappeler que cette dispute entre Ryle et Austin
fait fond sur une entente du langage ordinaire qui demeure toutefois largement commune aux deux
penseurs d’Oxford. Celle-ci est fondée sur la distinction entre trois « types » d’énoncés produits
lorsque l’on réfléchit sur le langage ordinaire rappelée par Cavell :
Pour évaluer le désaccord entre Austin et Ryle, nous pourrons distinguer trois types dans les énoncés qu’ils
produisent sur le langage ordinaire :
1. Il y a les énoncés qui produisent des exemples de ce qui se dit dans un langage (« Nous disons bien… mais nous
ne disons pas » ; « Nous demandons si… mais nous ne demandons pas si ».
2. Parfois ces exemples sont accompagnés d’explications – des énoncés qui explicitent ce qui est sous-entendu
(what is implied) quand nous disons ce que nous disons selon les exemples que constituent les énoncés du premier
type (« quand nous disons … nous sous-entendons (suggérons, disons) », « Nous ne disons pas … à moins que
nous voulions dire… ». De tels énoncés sont contrôlés si nous nous référons aux énoncés du premier type »
3. Pour finir, il y a les généralisations que nous testerons en nous référant aux énoncés des deux premiers types.
(Cavell 2009.75)
Austin récuse concernant la thèse de Ryle non pas son recours parfaitement légitime aux deux
premiers types d’énoncés : il existe dans le langage ordinaire bien des cas où en effet nous nous
demandons à propos d’une action que nous jugeons moralement douteuse, si elle a été faite de manière
volontaire ou pas. Ce qu’Austin critique chez Ryle c’est que de dernier produise à partir de là, un
énoncé du troisième type, c’est-à-dire généralise l’utilisation du vocable « volontaire » aux seules
actions que nous jugerions moralement répréhensibles.
D’après Benson Mates maintenant, l’objection d’Austin est contestable : elle se situe d’emblée au
niveau des énoncés du troisième type, alors qu’il serait possible de récuser Ryle dès le premier niveau
d’énoncés dans la mesure où « (Ryle) n’est pas en position de produire un énoncé du premier type (un
énoncé qui présente un exemple de ce que nous disons) en l’absence d’études expérimentales qui
démontrent son occurrence dans le langage » (Cavell 2009.76).
La première critique de Cavell contre Mates repose sur la notion de pertinence conférée par Mates à
notre recours aux expressions du langage ordinaire par « l’expérimentation empirique ». Un tel recours
selon Cavell, traduit une approche du langage ordinaire qui l’aborde à partir d’un point de vue qui lui
reste extérieur. Mates s’interroge sur le langage ordinaire comme si la position d’énonciation du
locuteur pouvait, et devait être suspendue, pour les besoins de l’accumulation de preuves fournie par

4
l’expérimentation empirique. Ce suspens n’est rien d’autre qu’artificiel aux yeux de Cavell. Pour
l’auteur de Dire et vouloir dire, en effet ce n’est pas de l’expérimentation empirique que tire sa
légitimité un énoncé qui présente un exemple de ce que nous disons ordinairement. Dans un tel cas de
figure en effet, il faudrait envisager la nécessité d’appuyer la pertinence de notre recours à un énoncé
exemplifiant le langage ordinaire, par des preuves, ce qui pour Cavell aurait pour conséquence de
minorer gravement le fait qu’un tel recours a le plus fréquemment lieu pour un locuteur à l’intérieur
de sa propre langue maternelle. La critique de Mates par Cavell consiste dans la réfutation du fait
qu’un locuteur parlant sa langue maternelle ait besoin de preuves extérieures à son propre usage
naturel de cette langue qui est bien la sienne, pour produire des énoncés exemplifiant ce qui peut se
dire à bon droit par opposition à ce qui ne peut pas se dire au sein d’une telle langue. L’élucidation des
mécanismes du langage ordinaire repose sur la production de tels énoncés. Dans un tel cas de figure,
aucune absence de preuves ne peut venir faire obstacle à la légitimité pour tout un chacun parlant sa
langue maternelle de produire des énoncés de ce type.
Parce que nous parlons une langue donnée, nous sommes en mesure de prétendre fournir des énoncés
doués de sens concernant ce qu’il est usuel de dire à l’intérieur de notre langue. Je prétends que « c’est
que nous disons bien » dans la production d’un énoncé du premier type, parce que je parle la langue
que j’examine, et je ne tire jamais ma légitimité à prétendre parler adéquatement ma langue
maternelle par autre chose que par le fait que je la parle. On voit donc défendue par Cavell la thèse
d’après laquelle notre capacité à formuler des énoncés du premier type tire sa légitimité non
d’expériences en troisième personne, auxquelles en appelle Mates par l’expérimentation empirique,
mais entièrement et exclusivement de la prétention portée par le locuteur de recourir légitimement à
des énoncés tirés de la langue qu’il parle, dans la mesure où celle-ci lui est maternelle. Comme le
formule Cavell : « le locuteur qui parle dans sa langue maternelle peut se fier à sa propre tête (the
native speaker can rely on his own nose) » (Cavell 2009.77).
On ne se fie à soi-même pour Cavell, sans autre recours que soi-même, autrement dit, ni par l’intuition
ni même par la mémorisation des emplois linguistiques existants. Ces deux formes, intuition et
mémorisation, supposent en effet une mise à distance quasi-objectivante du locuteur vis-à-vis de sa
propre langue, au détriment du facteur central que représente le fait que cette langue est bien celle
qu’il parle effectivement. Il est constitutif pour le locuteur qui parle sa langue maternelle de tirer de lui-
même et non d’une source extérieure ou semi extérieure (intuition, mémoire) la légitimité du produire
un énoncé portant sur le langage ordinaire :
Quand j’affirme savoir (in claiming to know) en général, si nous utilisons ou non une expression, je ne prétends
pas (I am not claiming) avoir une mémoire infaillible pour ce que nous disons (…) Il se peut qu’une personne
normale oublie et se rappelle certains mots, ou ce que veulent dire certains mots dans sa langue maternelle, mais il
ne se souvient pas de la langue (he doesn’t remember the language). (Cavell 2009.77)
On voit dans cette citation apparaître la notion qui sera amenée à jouer un rôle de plus en plus central
dans la philosophie de Cavell à savoir la notion de « Claim ». Un des aspects du « Claim » au sens où
l’entendra Cavell, repose sur le fait que je me dois d’accepter que ma prétention au caractère
universellement pertinent de ce que je dis, ne repose jamais sur des garanties extérieures à ma propre
voix, que ce soit sous la forme de preuves ou de fondements. La notion de « Claim » signifie que je ne
peux jamais me défausser quant à fait d’avoir à soutenir ma prétention à parler au nom de tous (en
l’occurrence à produire des énoncés exemplifiant le langage ordinaire), en attendant que des preuves
ou des fondements m’exonèrent de cette tâche.
Dans notre présent texte, ce qui s’annonce sous la forme du « Claim » repose sur le fait que dans le cas
de figure examiné par Cavell, n’importe quel locuteur parlant sa propre langue est légitimé à fournir
des énoncés capables d’exemplifier les énoncés du langage ordinaire, sans qu’il ait besoin d’avoir
recours à des preuves. Il s’agit donc de comprendre que la légitimité du locuteur à produire de tels
énoncés n’est jamais de l’ordre du quantitatif. Cependant, il faut souligner que nous avons affaire à un
recours encore peu déterminé du « Claim » par Cavell dans le cas de figure décrit ici concernant ma
légitimité à produire des énoncés capables d’exemplifier les énoncés du langage ordinaire sous la
forme des trois types mentionnés ci-dessus. En effet, la trame de la notion de « Claim » telle qu’elle
sera développée ultérieurement par Cavell, révèlera une complexité supplémentaire par rapport à la
question telle qu’elle se présente ici, elle renverra à l’épreuve que constitue pour tout un chacun la
légitimité de sa prétention à parler au nom des autres : car si je suis à moi seul la source à partir de

5
laquelle interroger ce que tous les locuteurs d’une langue donnée disent et ne disent pas, cette solitude
dans la prétention n’est pas sans questionner la possibilité de mon accord avec les autres locuteurs. De
tels développements concernant la question de l’accord, verront plus explicitement le jour chez Cavell
dans ses essais consacrés à Wittgenstein (notamment dans Les Voix de la raison
1
).
La deuxième critique adressée par Cavell à Mates, concerne son rejet des énoncés du deuxième type, à
savoir ceux que Cavell appelle des « énoncés d’explication » qui explicitent ce qui est impliqué par les
énoncés du premier type. Ces énoncés du deuxième type revêtent la forme « quand nous disons …
nous sous-entendons (suggérons, disons) », « Nous ne disons pas … à moins que nous voulions
dire… ». Autrement dit, comme le soutient Cavell :
J’ai dit que le philosophe du langage ordinaire avait aussi et également droit à des énoncés du deuxième type
distingué plus haut, ce qui veut dire qu’il a droit non seulement à dire ce que nous disons, mais également à dire ce
que nous devrions vouloir dire (Mean) en les disant. (Cavell 2009.82)
Cavell met ce type d’énoncés au cœur de la démonstration de « Devons-nous vouloir dire ce que nous
disons ? ». De tels énoncés nous renseignent en effet sur le statut spécifique du « vouloir dire » mis en
jeu dans le langage ordinaire.
A travers les énoncés du deuxième type, Cavell montre qu’il existe de nombreux cas où ce que nous
sommes amenés à dire n’a de sens que dans la mesure où cette chose que nous disons implique
nécessairement l’existence d’autre chose que l’énoncé sous-entend ou présuppose. Il s’agit alors de se
demander « comment nous devons expliquer le fait (en supposant que ce soit un fait) que nous disons
ou demandons A (« X est volontaire » ou « X est-il volontaire ? ») que quand B a lieu (X a quelque
chose de douteux ou qui semble douteux) (…) Les philosophes qui partent du langage ordinaire
maintiendront probablement que si vous dîtes A quand B n’a pas eu lieu, vous ferez un mauvais usage
(misusing) de A, ou vous déformerez sa signification » (Cavell 2009.82).
Or Cavell rappelle que de nombreux philosophes hostiles à la philosophie du langage ordinaire, au
premier rang desquels se trouve Benson Mates, contestent que la liaison entre A et B soit de stricte
nécessité dans la mesure où son statut n’est pas logique. En effet, Mates rappelle qu’il ne peut y avoir
de relation logique et ainsi nécessaire qu’entre une proposition et une autre proposition, jamais entre
une proposition A (« X est volontaire ») et un fait du monde B (« X a quelque chose de douteux ou qui
semble douteux »). Donc le lien entre A et B n’a rien d’une nécessité d’ordre logique, mais procède
bien plutôt pour Mates de la distinction entre d’une part le contenu sémantique d’un énoncé et d’autre
part l’occasion pragmatique du recours à un tel énoncé. A partir de la distinction entre sémantique et
pragmatique, Mates est en mesure de montrer qu’il existe des cas où notre utilisation de l’énoncé A
(« X est volontaire ») dépend bien du fait que B a lieu (« X est douteux ») mais cette dépendance n’a
rien de logique, ni d’intrinsèque, autrement dit, rien ne m’interdit d’utiliser l’énoncé A sans que B ait
lieu, tout dépend d’après Mates, de la modalité pragmatique sous laquelle j’investis l’énoncé A. Dans
la mesure où le rapport entre A et B n’a rien de logique, mais dépend des conditions pragmatiques
d’utilisation, le locuteur L peut utiliser A quand B a lieu, mais sans y être contraint, il peut utiliser A y
compris si B n’a pas lieu, de sorte que A peut être correctement utilisé y compris si B n’a pas lieu.
Or Cavell n’est pas prêt à laisser passer que la pertinence du recours à l’énoncé A ne soit en rien
conditionnée par le fait que B ait lieu. Cavell soutient en effet que s’il est incontestable que la relation
entre A et B « ne peut pas être une relation logique », en revanche on aura le plus grand mal à soutenir
« que de l’énoncé de A rien ne s’ensuit (nothing follows) pour B » (Cavell 2009.82). En effet, comme
nous l’avons vu plus haut avec Ryle et Austin, il resterait fort improbable que la question « avez-vous
fait cela volontairement ? » puisse se poser à propos de n’importe quel type d’action, alors qu’elle ne
se pose que dans les circonstances où l’action présente quelque chose d’inhabituel ou d’anormal.
Du point de vue de Cavell, l’argumentation de Mates vise à se soustraire au rapport d’implication
inévitable qui existe entre le recours à l’énoncé A et le fait que B ait lieu. Cavell ne soutient pas qu’un
tel rapport entre A et B soit d’ordre strictement logique, il affirme plus précisément qu’il faut y voir ce
qu’il appelle une relation de « quasi-logicité » procédant d’une « troisième sorte de logique » (Cavell
2009.85).
Cavell prend l’exemple suivant pour appuyer sa démonstration : si quelqu’un vous demande si vous
1
cf. Cavell 1979, ch.1. Cf. également les analyses de Sandra Laugier dans Laugier 2006a
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
1
/
15
100%