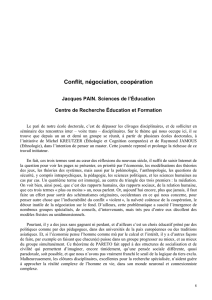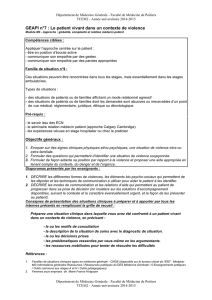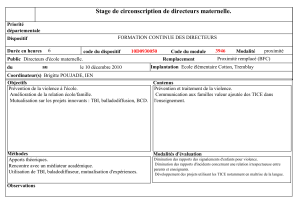Salles de surveillance post-interventionnelles Anesthésie Spécial RSTI

24
Spécial RSTI
L’ identification des risques liés à l’acte chi-
rurgical et à la pratique d’anesthésie a
abouti à la mise en place des salles de sur-
veillance post-interventionnelle (SSPI), rendue
obligatoire par le décret du 5 décembre 1994,
tout comme la consultation pré-anesthésique
en cas de chirurgie programmée. Cette sur-
veillance par le monitorage commence en salle
d’opération et se poursuit après l’intervention,
y compris pendant le transport, jusqu’au retour
de l’autonomie respiratoire, de l’équilibre circu-
latoire et de la récupération neurologique du
patient. Elle a pour objet de contrôler les effets
résiduels des médicaments anesthésiques et de
faire face, à tout moment, aux complications
éventuelles liées à l’acte chirurgical ou à l’anes-
thésie générale ou locorégionale. La SSPI doit
donc être située à proximité du site où sont pra-
tiquées les anesthésies et dotée de tous les dis-
positifs médicaux nécessaires. La présence d’au
moins une infirmière DE formée à ce type de
surveillance est impérative. A noter : en France,
le nombre d’infirmières anesthésistes demeure
insuffisant. Le personnel paramédical est placé
sous la responsabilité d’un médecin anesthé-
siste-réanimateur dont le rôle est d’intervenir
sans délai. En outre, il décide du transport du
patient et autorise sa sortie en accord avec le
chirurgien.
Un autre arrêté du 3 octobre 1995 sur la ma-
tériovigilance rappelle que le matériel et les
dispositifs médicaux doivent faire l’objet d’une
vérification de leur bon état et de leur bon fonc-
tionnement avant l’utilisation sur les patients. En
outre, il est précisé qu’il faut recourir aux sys-
tèmes de désinfection afin d’éviter tout risque de
contamination par l’intermédiaire du matériel
utilisé. Pour que ces textes puissent être appli-
qués, un certain nombre de conditions s’impo-
sent, notamment une collaboration entre les
équipes du bloc opératoire et de la SSPI, une
connaissance par le personnel des décrets, et une
adhésion de toute l’équipe à l’organisation de la
surveillance du malade. Certains patients à
risque, notamment les porteurs des complica-
tions cardiovasculaires (50 % des complications
postopératoires) nécessitent un passage prolon-
gée en SSPI et, en général, plus la cotation d’ASA
(qui reflète l’état général du patient) est impor-
tante, plus le risque de complications est grand.
La prise en charge de la douleur postopératoire
s’est améliorée car elle est mieux évaluée, grâce
à des échelles d’intensité douloureuse comme
l’échelle visuelle analogique, ou EVA (alors que
la hétéro-évaluation tend à sous-estimer la dou-
leur ressentie par le patient) ; elle est aussi
mieux traitée grâce à un protocole adapté au pa-
tient comprenant le dépistage des effets secon-
daires éventuels. L’EVA doit être égale ou infé-
rieure à trente figures parmi les critères de sortie
de SSPI, outre le retour à l’état de conscience
normal, de l’autonomie respiratoire, de la stabi-
lité hémodynamique, de la normothermie et de
l’absence de problèmes chirurgicaux.
Il importe de souligner que, si la SSPI est un ser-
vice spécifique, il est aussi un lieu où les soins
sont relationnels et éducatifs. En effet, les patients
désorientés et stressés par leur opération ont be-
soin d’explications sur ce qui s’est passé et sur la
raison de leur séjour en SSPI, même s’ils ont déjà
reçu cette information au cours de la consultation
pré-anesthésique. ■
Anesthésie
Salles de surveillance
post-interventionnelles
Le réveil du patient après l’anesthésie est une période à haut
risque. Des complications immédiates postopératoires,
notamment des accidents d’origine respiratoire, peuvent
conduire au décès ou à des séquelles neurologiques graves.
D’où la nécessité de mettre en place des procédures assurant
des soins de qualité et la sécurité du patient.

25
Les infections urinaires prédominent, suivies
des infections respiratoires basses et des
infections du site opératoire. La mission du
CLIN n’est pas de culpabiliser mais d’aider à
analyser les raisons d’un échec et à comprendre
les causes de la survenue des infections, afin de
mettre en place des mesures d’hygiène adaptées.
Ainsi le CLIN-Nord a mis en place le réseau
INCISO de surveillance des infections du site
opératoire avec, pour objectif, de sensibiliser
l’équipe chirurgicale et de lui fournir un outil
standardisé pour mesurer le risque infectieux
dans le service. Les infections postopératoires
peuvent survenir jusqu’à 30 jours après l’inter-
vention (jusqu’à un an en cas de prothèse de
hanche). Le taux d’infections est déterminé par
le NNIS, index du risque construit à partir de
trois facteurs : durée de l’intervention, score
ASA (permettant d’estimer l’état général de
santé du patient) et classification d’Altemeier
(chirurgie propre, contaminée, sale).
En 1998, 120 services ont participé à ce ré-
seau en recueillant des données concernant
16 506 patients opérés : le nombre de patients
infectés au site opératoire était de 3,9 %, en
moyenne 9 jours après l’intervention. Il en res-
sort aussi que le taux des infections du site
opératoire augmente avec le niveau NNIS
(5,5 % pour le NNIS de niveau 1, 26,7 % pour
le NNIS de niveau 3) et que même les patients
à faible risque (le NNIS égal à zéro) atteignent
un taux de 2,2 %. Heureusement, on trouve,
dans 70 % des services, des taux de 0 à 2 %,
mais quelques services ont des taux supé-
rieurs à 7 %, ce qui suggère un problème de
l’hygiène. Selon F. Golliot (CLIN), on a observé,
en 1999, une diminution des infections dans
ces services “en rouge”. En effet, l’évaluation
mobilise l’ensemble de l’équipe chirurgicale au-
tour d’une démarche de prévention des infec-
tions nosocomiales.
Des facteurs d’infection restent mal connus, par
exemple les ectoparasites. Ils vivent sur ou dans
la peau et les phanères, peuvent véhiculer des
germes pathogènes et être à l’origine d’infec-
tions nosocomiales et parfois d’épidémies
(galle). La lutte passe d’abord par une bonne
connaissance de leur cycle de reproduction et
de leurs conditions de vie, ainsi que par l’élimi-
nation des sources de contamination et des fac-
teurs favorisants (comme des miettes de gâteaux
dans les chambres).
Les consultations d’ophtalmologie dans les éta-
blissements et dans les cabinets médicaux sont
également concernées par la prévention d’infec-
tions nosocomiales. On connaît la sensibilité de
l’œil aux produits irritants (traces de désinfec-
tants mal rincés). Les données épidémiolo-
giques ne sont pas nombreuses, cependant, on
admet que les kérato-conjonctivites à adénovi-
rus et entérovirus peuvent être transmises par
les mains et le matériel.
Même les appareils qui ne sont en contact
qu’avec la peau peuvent constituer un point
d’ancrage pour les micro-organismes et donc fa-
voriser leur transmission de patient à patient.
Pour le matériel non immergeable, le groupe de
travail au sein du CLIN n’a trouvé aucune pro-
cédure sans risque pour la cornée à ce jour.
Comme l’a souligné Mme Bardez (Hôtel-Dieu),
il faut susciter une réflexion sur les pratiques
professionnelles et préciser les bonnes pratiques
de la prise en charge des dispositifs médicaux
(telle qu’une procédure minimale après chaque
consultation) qui sont fragiles, thermosensibles
et difficiles à démonter. ■
Hygiène
Supprimer les infections
nosocomiales
Aujourd’hui, chaque établissement public est doté
d’un CLIN chargé de la prévention des infections acquises
pendant le séjour à l’hôpital. Cinq à 10 % des malades
contractent en effet une infection nosocomiale
avec un taux de résistance des souches incriminées élevé.

Cité
des Sciences
et de l’Industrie
La Villette
Paris
21-22 novembre 2000
21-22 novembre 2000
“Ensemble,
donnons
du sens au soin”
10es
10es
“Ensemble,
donnons
du sens au soin”

Mardi 21 novembre
CANCÉROLOGIE
CLa recherche
et l’actualité thérapeutique
CA1 Les plaies cancéreuses
CA2 Les soins palliatifs
CA3 La prise en charge à domicile
CA4 La qualité de vie et la douleur
NEUROLOGIE
NLa recherche
et l’actualité thérapeutique
NA1 La sclérose en plaques
NA2 La maladie de parkinson
NA3 L’hygiène et la prise en charge
des blessés médullaires
(pansements, incontinence...)
NA4 L’Alzheimer
BLOC
BLes différents axes
de la chirurgie
BA1 L’hygiène et la stérilisation
BA2 L’anesthésie
BA3 La douleur postopératoire
BA4 Les dispositifs et le matériel
RESPONSABILITÉ
RL’évolution de la responsabilité
est-elle compatible avec les risques
nécessaires à la pratique soignante ?
RA1 La surveillance du malade
et le respect de ses libertés
RA2 La gestion de l’écrit
dans la pratique soignante
RA3 Les droits de l’enfant
RA4 L’information préalable
et le consentement
Mercredi 22 novembre
GÉRIATRIE
GLa prise en charge
de la personne âgée
(à domicile, handicap, démence...)
GA1 Les droits des personnes âgées
GA2 La violence en institution
GA3 La nutrition
GA4 L’hygiène et la qualité de vie
DOULEUR
DLes différentes perceptions
de la douleur selon que l’on soit
soignant ou soigné
DA1 La douleur de l’enfant
DA2 La douleur en rhumatologie
DA3 La douleur dans le soin des plaies
DA4 La douleur chez le brûlé
PSYCHIATRIE
PLes nouvelles orientations
des soins
PA1 Les soins dans l’urgence
PA2 La précarité et l’exclusion
PA3 Les violences subies par l’enfant
PA4 Faire face à l’aggression
ÉVOLUTION
PROFESSIONNELLE
EComment le “social” a transformé
la prise en charge du patient
EA1 L’avenir de la profession libérale
EA2 Vers une specialisation des soins
EA3 Pourquoi appartenir à un réseau ?
EA4 Les nouvelles technologies
au service des soignants
Une formation complète
pour une application immédiate au quotidien
Pré-programme
Chaque journée est conçue en deux sessions distinctes et complémentaires :
LE MATIN : la conférence plénière pour une formation scientifique
“la recherche, l’actualité thérapeutique, les pratiques de soins...”
et aussi “les nouvelles orientations de la profession...”
L’APRÈS-MIDI : les ateliers pratiques sur les soins quotidiens.
BULLETIN D’INSCRIPTION
Droit d’inscription
1 jour 2 jours
Établissement : 110 F (90 F) 200 F (160 F)
Individuel : 60 F (50 F) 100 F (80 F)
Je suis : abonné à Profession Santé infirmier-infirmière
ou salarié APHP : 40 F (30 F) 60 F (50 F)
Étudiant : 1 jour offert 60 F (50 F)
Inscription avant le 30 juin 2000 : prix rouges
MODE DE PAIEMENT
❑
par virement bancaire à réception de facture
(réservé aux établissements, merci de nous adresser un bon de commande)
❑
par chèque (à l’ordre de CDTM Éditions)
❑
par carte Visa, No
Eurocard Mastercard
Date d’expiration
:
Signature :
✁
A retourner à
CDTM Éditions, 62-64, rue Jean-Jaurès, 92800 Puteaux
Tél. : 01 41 45 80 00 - Fax : 01 41 45 80 45
Matin
LES CONFÉRENCES
1conférence au choix
Après-midi
LES ATELIERS
DE FORMATION
2 ateliers au choix*
Mardi 21 novembre
La conférence Les ateliers
□
C
Cancérologie :
□
CA1
□
CA2
□
CA3
□
CA3
□
N
Neurologie :
□
NA1
□
NA2
□
NA3
□
NA4
□
B
Bloc :
□
BA1
□
BA2
□
BA3
□
BA4
□
R
Responsabilité :
□
RA1
□
RA2
□
RA3
□
RA4
Mercredi 22 novembre
□
G
Gériatrie :
□
GA1
□
GA2
□
GA3
□
GA4
□
E
Évolution professionnelle :
□
EA1
□
EA2
□
EA3
□
EA4
□
D
Douleur :
□
DA1
□
DA2
□
DA3
□
DA4
□
P
Psychiatrie :
□
PA1
□
PA2
□
PA3
□
PA4
□□
Cochez par ordre de préférence de 1 à 4 les ateliers auxquels vous souhaitez assister.
* Nous tenterons de respecter vos choix d’ateliers en fonction des impératifs horaires et du nombre limité de places.

28
Spécial RSTI
de détruire, nuire, humilier, etc. «Il peut donc y
avoir agression sans ressenti de violence chez
l’agresseur, ou ressenti de violence sans qu’il y ait
eu réellement agression, estime Laurent Morasz,
mais il faut un acteur en relation avec une cible,
dans un environnement particulier. Il y a violence
lorsqu’il y a interaction entre ces trois éléments ».
Selon lui, les hommes sont généralement à la
fois les cibles et les acteurs de la violence. En ef-
fet, même si les femmes en parlent beaucoup,
ce sont les hommes qui se font le plus souvent
agresser. L’état émotionnel entre également en
jeu : par exemple, le stress du soignant peut
prédisposer à un acte violent de l’autre ou en-
core un sentiment d’insécurité, qui domine
chez beaucoup de personnes. La personnalité
du sujet est un autre facteur, mais aucun pro-
fil psychiatrique particulier n’a été dégagé jus-
qu’à présent. Enfin, être une cible dépend bien
sûr de ce qu’elle représente : le soignant est le
représentant d’un hôpital, donc d’une institu-
tion envers laquelle le patient peut éprouver du
mécontentement.
Lorsqu’elle se déclenche, l’agression, quelle que
soit la forme qu’elle revêt, s’organise en six
phases : l’activation (le stress), l’intensification, la
crise (le passage à l’acte violent), la récupération,
la stabilisation et enfin l’élaboration d’une ré-
flexion ou d’un dialogue. Comme le constate et
le regrette Laurent Morasz, «dans nos structures,
nous ne prenons jamais le temps de revenir sur la
situation d’agression et de penser à ce qu’elle a en-
gendré afin de comprendre... avec ou sans la pré-
sence simultanée de l’agresseur et de sa cible ». ■
Si la violence est de plus en plus présente dans
nos préoccupations, ce n’est pas tant par son
apparition brutale que par le changement de sa
nature. Il y a irruption nouvelle, dans notre espace
soignant, d’une violence qu’elle soit physique ou
psychique », prévient d’emblée le Dr Laurent
Morasz, psychiatre à l’hôpital Saint-Jean-de-
Dieu à Lyon.
La classification de Buss retient l’agression phy-
sique directe (coups et blessures) ou indirecte
(le refus d’assistance), et l’agression verbale di-
recte (insultes) ou indirecte (médisance, refus
systématique, ignorance). La violence psycholo-
gique serait l’une ou l’autre de ces agressions,
mais sous une forme nettement plus passive.
«Le soignant redoute la violence physique chez le
patient alors qu’il est constaté que la violence la
plus courante est la violence verbale. Pourtant, la
violence la plus douloureuse reste la violence psy-
chologique », poursuit Laurent Morasz.
Trois buts peuvent motiver une agression : l’in-
tention d’échapper à une situation de malaise
entre soignant et patient (mésentente, traite-
ment douloureux...), le besoin impérieux d’at-
teindre un but précis (se procurer certaines sub-
stances, être soigné sans délai) ou la volonté
délibérée de ne s’exprimer que par la violence.
La violence est à distinguer de l’agression. La
première est considérée du point de vue de la
victime, de son ressenti personnel, même si la
violence implique une interaction entre deux
personnes et certaines circonstances. L’agression
est en revanche un acte exercé par une personne
capable de pulsions violentes, et dont le but est
La violence en institution
En comprendre
les mécanismes...
La violence est à distinguer de l’agressivité.
Elles s’expriment toutes deux dans les mêmes conditions
et requièrent une interaction entre un acteur, une cible
et un environnement. Quand cet environnement
est un lieu de soins, les pulsions de l’un
et les ressentis de l’autre se trouvent exacerbés…
«
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%