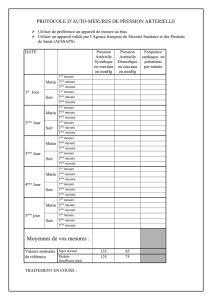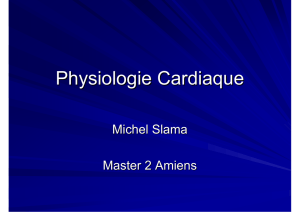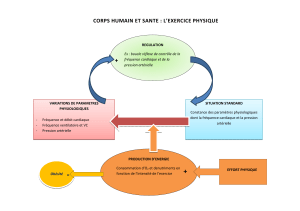R e t o u r d e ... XIII congrès de l’American Society

137
Act. Méd. Int. - Hypertension (10), n° 6, juin 1998
Utilisation du Viagra®(sildéfanil)
chez l’hypertendu traité
Les troubles de l’érection sont une
plainte fréquente des hypertendus trai-
tés. L’efficacité du Viagra®(sildéfanil)
chez ces patients a été étudiée sur une
cohorte de 3 413 sujets qui se plai-
gnaient de troubles de l’érection. L’un
des sous-groupes était constitué de
1 218 sujets hypertendus traités par des
antihypertenseurs de toutes les familles
thérapeutiques. L’étude en double
aveugle a évalué l’efficacité du Viagra®
ou d’un placebo chez ces hommes d’un
âge moyen de 56 ans sur des durées
d’utilisation maximales de 6 mois. Le
Viagra®permet une amélioration sta-
tistiquement significative de trois cri-
tères : la qualité de la pénétration, le
maintien de l’érection et l’améliora-
tion de l’érection. Ces résultats posi-
tifs sont aussi observés chez l’hyper-
tendu traité. Les bénéfices sont com-
parables, que les sujets prennent ou
non un traitement antihypertenseur.
La tolérance du traitement a été com-
parable entre les deux groupes. Il est
probable que, lorsque le Viagra®sera
disponible en France, les médecins
prenant en charge des hypertendus
seront particulièrement sollicités pour
prescrire cette thérapeutique.
Les IEC protègent-t-ils du cancer ?
Les conséquences de la prescription
au long cours des antihypertenseurs
sur le risque de cancer sont régulière-
ment discutées. Une étude de cohorte
réalisée par la clinique d’hypertension
de Glasgow a évalué le risque de can-
cer lié à la prescription des IEC. A
partir du suivi de 5 207 hypertendus,
sur une période de 16 ans, le groupe
des sujets, chez lesquels un IEC avait
été prescrit, a été comparé au groupe
n’en ayant pas reçu. Les taux ont été
comparés à l’incidence des cancers
survenue dans la population de
l’Ouest Ecossais pour la même pério-
de. Les résultats indiquent que le
risque-ratio est de 0,64 pour les uti-
lisateurs d’IEC. Le bénéfice du trai-
tement apparaît uniquement si la
durée de la prescription est supérieure
à 3 ans. Le risque diminue particu-
lièrement chez la femme et pour les
cancers spécifiquement “féminins”.
La coprescription de l’IEC et d’autres
médicaments antihypertenseurs ne
modifie pas ces résultats, lesquels
nécessitent à l’évidence d’être confir-
més par une étude portant sur une
autre population, mais doivent cepen-
dant nous conduire à poursuivre les
recherches sur le rôle joué par le sys-
Retour de congrès
* Service de médecine interne,
hôpital Broussais, Paris.
XIIIecongrès de l’American
Society
of Hypertension
New York - mai 1998
Xavier Girerd*
Le XIIIecongrès de l’American Society of Hypertension
s’est tenu à New York du 13 au 16 mai 1998. Ce rendez-
vous traditionnel des médecins nord-américains spécia-
listes de l’hypertension artérielle a mis en avant la
recherche française avec la remise du prix Robert
Tigerstedt au Pr Pierre Corvol, du Collège de France et de
l’hôpital Broussais, pour ses travaux sur le système rénine-
angiotensine. A cette occasion, le récipiendaire a donné
une “leçon” particulièrement brillante sur l’enzyme de
conversion de l’angiotensine, qui a permis à chacun de
découvrir tous les secrets de cette enzyme, cible privilégiée
d’une famille thérapeutique d’utilisation quotidienne chez
l’hypertendu. A côté de ce moment fort, de très nombreux
sujets cliniques ont été abordés, comme le veut la tradition
de ce congrès toujours à la pointe des nouveautés de la
formation médicale continue en hypertension artérielle.
MEPjuin 98 15/04/04 10:40 Page 137

138
Retour de congrès
Act. Méd. Int. - Hypertension (10), n° 6, juin 1998
tème rénine-angiotensine-aldostérone
sur les phénomènes d’apoptose cellu-
laire.
L’hyperuricémie est un facteur de
risque : le retour
Au début des années 1980, l’hyperuri-
cémie était considérée comme un fac-
teur de risque de maladies cardiovas-
culaires, au même titre que l’hyper-
tension ou le tabac. De nombreux
patients se sont vus, à cette époque,
prescrire un hypo-uricémiant en plus
de leur traitement antihypertenseur.
C’est en fait le diurétique prescrit
qui favorisait l’hyperuricémie, et
l’utilisation des méthodes statistiques
avec “ajustement” a fait disparaître
l’hyperuricémie de la catégorie des
facteurs de risque indépendants. M.
Alderman (New York) a apporté un
nouvel éclairage sur le rôle pronos-
tique joué par l’hyperuricémie. A par-
tir d’une cohorte de 7 906 hyperten-
dus suivis pendant 7 ans, une analyse
multivariée a montré que l’uricémie
était bien un facteur de risque indé-
pendant de survenue d’une cardiopa-
thie coronaire. En effet, la relation
entre hyperuricémie et coronaropathie
persistait après avoir pris en compte
tous les facteurs de risque “clas-
siques” de la maladie coronaire. Les
auteurs qui avaient signalé que le rôle
pronostique, apporté par l’uricémie,
restait modeste par rapport aux
autres facteurs de risque, ont calcu-
lé que ce rôle défavorable pouvait par-
ticiper à la diminution de l’action pro-
tectrice des diurétiques vis-à-vis de la
prévention des coronaropathies. Ils
ont estimé que le “bénéfice” du traite-
ment par diurétiques se trouvait dimi-
nué de 7 %, du fait de l’hyperuricémie
induite par ces traitements. En conclu-
sion, M. Alderman ne recommandait
pas la prescription d’un hypo-uricé-
miant chez tous les hypertendus, mais
indiquait qu’il lui semblait justifié de
maintenir le dosage de l’uricémie
dans le bilan initial de l’hypertendu,
afin de dépister les sujets ayant une
élévation importante de l’uricémie.
Pour ces patients, il conseillait de ne
pas choisir un diurétique comme
traitement antihypertenseur de pre-
mière intention.
Le contrôle de la pression artérielle
dans l’étude ALLHAT
L’étude ALLHAT est un “méga-essai”
mené aux Etats-Unis, incluant 35 000
hypertendus, chez lesquels sont compa-
rés l’efficacité, sur la prévention des
complications coronaires, de l’amlodipi-
ne, de la chlortalidone, de la doxazosine
et du lisinopril. Cette étude est menée en
double aveugle, et le protocole se fixe
comme objectif tensionnel d’obtenir une
pression de consultation inférieure à
140/90 mmHg. Si la monothérapie est
insuffisante, l’aténolol, la réserpine, la
clonidine et l’hydralazine sont successi-
vement ajoutés. La communication du
pourcentage des patients ayant atteint
l’objectif tensionnel, après un an de
suivi, est particulièrement intéressante.
Une pression < 140/90 mmHg est obte-
nue chez 53 % des sujets. Ce résultat
n’est que de 49 % dans le groupe des
Noirs et de 55 % chez les Caucasiens. Il
est de 56 % chez les sujets âgés de 55 à
59 ans et de 48 % chez les plus de 80 ans.
Si l’on ne considère que la PAD
(< 90 mmHg) pour définir les contrôlés,
le pourcentage est de 86 %. En revanche
si, pour définir les contrôlés, on ne tient
compte que de la PAS (< 140 mmHg), le
pourcentage tombe à 55 %. Il en ressort
que c’est sur le contrôle de la PAS que
les efforts thérapeutiques devraient
préférentiellement porter. Il est pos-
sible que le choix des traitements puisse
influencer ce résultat. La suite de l’étude
ALLHAT apportera probablement des
réponses à ces questions essentielles.
Retentissement cardiaque de
l’hypertension
Obtenir une régression de l’hypertro-
phie cardiaque chez l’hypertendu est un
objectif que le clinicien cherche à
atteindre par le traitement pharmacolo-
gique de l’hypertension. G. Schillaci
(Perugia, Italie) a évalué les consé-
quences d’une normalisation des
chiffres tensionnels chez des hyper-
tendus traités et suivis dans la cohorte
PIUMA depuis 3 ans. Il a comparé ces
patients à des normotendus de même
âge, de même sexe et de même mor-
phologie. Les hypertendus étaient tous
contrôlés, avec une pression artérielle
< 140/90 mmHg en consultation et une
confirmation de la normalisation ten-
sionnelle par une MAPA. La pression
artérielle sur 24 heures était compa-
rable dans les deux groupes (120/
76 mmHg). La masse cardiaque a été
évaluée par échographie, et les auteurs
montrent que les hypertendus possè-
dent une masse ventriculaire gauche
supérieure en moyenne de 13 % à celle
des normotendus. Une géométrie du
ventricule gauche de type “hypertro-
phie concentrique” est plus fréquente
chez les sujets hypertendus. Les auteurs
concluent que, malgré un contrôle
tensionnel satisfaisant, il persiste une
hypertrophie cardiaque chez l’hyper-
tendu traité. Des facteurs indépen-
dants de la pression artérielle expli-
quent sans doute ce résultat. Il reste à
montrer que certaines thérapeutiques
antihypertensives pourraient agir sur
ces facteurs, qui ne sont malheureuse-
ment toujours pas identifiés.
MEPjuin 98 15/04/04 10:40 Page 138

139
Quel est le risque cardiovasculaire
des hypertendus pris en charge :
Framingham donne des chiffres
Une des nouveautés du dernier JNC VI a
été de proposer de fixer la décision du
traitement antihypertenseur non plus
uniquement en fonction du niveau de la
pression artérielle, mais en estimant le
risque absolu du patient (la probabilité
qu’un sujet a de présenter une complica-
tion cardiovasculaire dans un intervalle
de temps donné). Pour évaluer ce risque
de façon très simple, un tableau a été mis
au point, définissant trois groupes à
risque en fonction des facteurs de risque
associés à l’hypertension artérielle, de
l’atteinte des organes cibles ou des mani-
festations cardiovasculaires cliniques.
Groupe A : Pas de facteurs de risque,
pas d’atteinte des organes cibles.
Groupe B : Au moins un facteur de
risque n’incluant pas le diabète. Pas
d’atteinte des organes cibles.
Groupe C : Diabète et/ou atteinte des
organes cibles ou manifestations car-
diovasculaires.
La combinaison entre le groupe de risque
et le niveau de la pression artérielle fixe
l’attitude thérapeutique (tableau I).
L’équipe de Framingham a voulu savoir
comment les hypertendus, issus d’une
population générale, se répartissaient
au sein de ce tableau à 9 cases. Un
groupe de 2 794 hypertendus de la
cohorte de Framingham a permis de
réaliser cette répartition. Les résultats
figurent dans le tableau II (exprimés en
% du total de la population).
Ces données quantitatives sont très
informatives, car elles montrent que
dans deux tiers des cas l’évaluation du
risque absolu du patient va conduire à
proposer un traitement antihyper-
tenseur dès le début de la prise en
charge. Si la décision était fondée uni-
quement sur le seul niveau tensionnel,
en choisissant le niveau du stade 2
(PAS ≥160 ou PAD≥100), seulement
un patient sur deux se verrait propo-
ser une thérapeutique médicamenteuse
dès le début de la prise en charge. Bien
que ces données quantitatives ne soient
pas exactement transposables à la situa-
tion rencontrée en France, elles appor-
tent des arguments pour faire rentrer le
principe de risque absolu dans notre
mode de décision thérapeutique.
La pression pulsée ambulatoire est un
marqueur du risque cardiovasculaire
La pression pulsée, c’est-à-dire la dif-
férence entre la pression systolique et
la pression diastolique est en passe de
devenir le nouveau paramètre tension-
nel à prendre en compte pour détermi-
ner le risque cardiovasculaire de l’hy-
pertendu. Après la publication du rôle
pronostique indépendant de ce para-
mètre, à partir de plusieurs grosses
populations (Framingham, IPC,
SAVE), l’intérêt de la mesure de la
Pression Groupe A Groupe B Groupe C
artérielle
de consultation
(mmHg)
PAS : 130-139 Modifications Modifications Traitement
PAD : 85-89 du style de vie du style de vie médicamenteux
PAS : 140 - 160 Modifications Modifications Traitement
PAD : 90 - 100 du style de vie du style de vie médicamenteux
(pendant 12 mois) (pendant 6 mois)
PAS ≥160 Traitement Traitement Traitement
PAD ≥100 médicamenteux médicamenteux médicamenteux
Pression Groupe A Groupe B Groupe C
artérielle
de consultation
(mmHg)
PAS : 130-139 0,04 % 16 % 7 %
PAD : 85-89
PAS : 140 - 160 0,04 % 15 % 8 %
PAD : 90 - 100
PAS ≥160 0,02 % 28 % 25 %
PAD ≥100
Tableau I : Classification des choix thérapeutiques selon le JNC VI.
Tableau II : Répartition des hypertendus de Framingham selon la classification du JNC VI.
MEPjuin 98 15/04/04 10:40 Page 139

140
Retour de congrès
Act. Méd. Int. - Hypertension (10), n° 6, juin 1998
pression pulsée, obtenue sur un enre-
gistrement de MAPA, est avancé par
les résultats du suivi de la cohorte de
l’étude PIUMA. Chez 1 942 sujets sui-
vis en moyenne depuis 3,6 années, la
MAPA a été enregistrée initialement,
et le rôle pronostique de la pression en
consultation comparativement à celui
des mesures ambulatoires a été évalué.
Lorsque le rôle pronostique de la
moyenne de la pression pulsée sur 24
heures est estimé sur l’ensemble des
complications cardiovasculaires, il
apparaît que le risque relatif est de
1,71 (CI 95 %, 1,20 à 2,42) chez les
sujets dont la pression pulsée est
supérieure à 53 mmHg. De plus, le
rôle pronostique de la pression pulsée
mesurée en ambulatoire est un
meilleur prédicteur que la pression
pulsée mesurée à la consultation. Ces
résultats sont bien évidemment obte-
nus après ajustement sur les facteurs
prédictifs usuels et en particulier sur
l’âge. Ce résultat est un argument sup-
plémentaire pour considérer que la
pression artérielle évaluée en dehors
du cabinet médical apporte plus d’in-
formations que celle mesurée en
consultation. Il conforte l’idée que la
pression pulsée est un indice simple et
informatif qu’il est probablement très
utile de calculer chez l’hypertendu.
La prescription d’un AINS a-t-il
vraiment une incidence sur
la pression artérielle ?
Il a été rapporté que la prescription
d’un anti-inflammatoire non stéroïdien
(AINS) pouvait s’accompagner d’une
élévation de la pression artérielle
chez l’hypertendu. Cette donnée n’est
toutefois pas confirmée dans une
méta-analyse regroupant les résultats
de 44 essais. Le groupe des ensei-
gnants français de thérapeutique de
l’APNET ont réalisé une étude qui a
été présentée oralement par X. Girerd
(Paris), dont l’objectif a été d’évaluer
l’impact de la prescription d’un AINS
sur la pression artérielle de patients
suivis par des spécialistes (médecins
internistes, cardiologues, rhumato-
logues) dans des hôpitaux universi-
taires. Cette étude a été réalisée sur le
mode d’une enquête “un jour donné”
par 22 médecins qui ont inclus tous les
patients examinés au cours d’une
même consultation. Un questionnaire
comportant des données démogra-
phiques, médicales et le détail des
prescriptions médicamenteuses a été
rempli pour chaque patient quel que
soit le motif de la consultation. La
pression artérielle a été mesurée en
position assise en utilisant un mano-
mètre à mercure. Un questionnaire
complet a été obtenu pour 259
patients. La population a été divisée
selon deux critères : la présence ou
l’absence d’une hypertension artérielle
traitée, et la présence ou l’absence de
prise d’un traitement AINS le jour de
la consultation. Les résultats indiquent
que la pression artérielle n’est pas
statistiquement différente en pré-
sence ou en l’absence de prise d’un
traitement AINS. Cette absence d’ef-
fet est observée dans le groupe des
hypertendus ainsi que dans celui des
normotendus. Ils suggèrent que l’in-
teraction décrite entre les traitements
AINS et la pression artérielle chez cer-
tains patients n’a probablement pas de
conséquence clinique sur une popula-
tion générale.
Imprimé en France - Differdange S.A.
95110 Sannois -
Dépôt légal 2ème trimestre 1998 -
© janvier 1989 - Médica-Press
International
MEPjuin 98 15/04/04 10:40 Page 140
1
/
4
100%