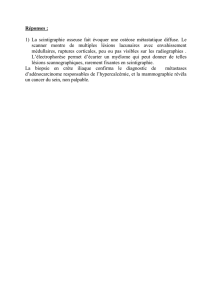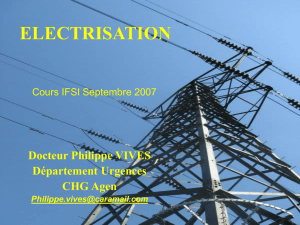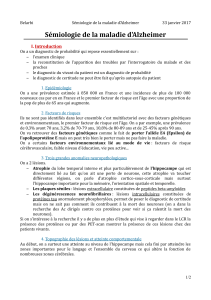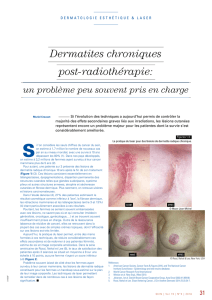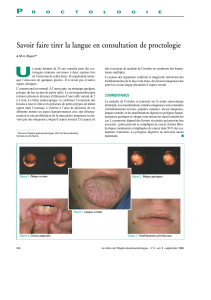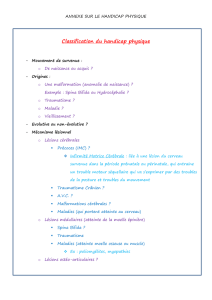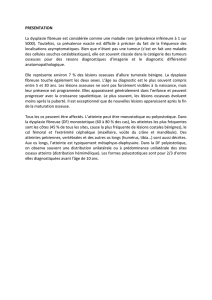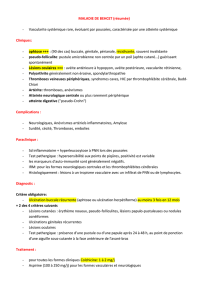L
e maintien d’une ventilation artificielle par une sonde
d’intubation est la source d’un traumatisme interne lié à
la compression mécanique constante de la sonde et du
ballonnet sur la filière laryngotrachéale, auquel s’ajoutent parfois
des lésions traumatiques lors de la mise en place de la sonde.
Certains facteurs favorisent le développement de lésions séquel-
laires, liées à l’intubation elle-même et à sa durée, à l’affection ayant
motivé l’intubation ainsi qu’à l’état laryngotrachéal sous-jacent.
Cependant, l’évolution de ces lésions vers la sténose est rare (1).
L’ORL est amené à faire un bilan lésionnel lorsqu’une dysphonie,
une dyspnée ou des troubles de la déglutition apparaissent au
décours d’une extubation. La prise en charge initiale des lésions
précoces, à ce stade inflammatoires et évolutives, donc potentiel-
lement instables, a pour but d’éviter une évolution vers la sténose
et d’assurer le maintien d’une filière respiratoire satisfaisante (2).
Le bilan est anatomique ; il doit préciser la topographie des lésions,
leur sévérité, et permettre d’évaluer leur pronostic.
LES ZONES DE FRAGILITÉ
Certaines structures anatomiques sont particulièrement exposées
aux traumatismes d’intubation : la commissure postérieure, car c’est
à son niveau que s’appuie la sonde, le cartilage cricoïde et la tra-
chée cervicale (1-6). Le cartilage cricoïde est le seul cartilage laryngé
qui, par sa forme circulaire, maintient le calibre aérien de la filière
laryngée. Il est cependant inextensible. Les surfaces cartilagineuses
du cartilage cricoïde, comme les anneaux trachéaux, ne sont proté-
gées que par le plan de la muqueuse respiratoire, les rendant parti-
culièrement vulnérables à toute dénudation muqueuse traumatique.
La vascularisation de ces cartilages est constituée d’une fragile
microvascularisation, développée au niveau du périchondre interne,
qui expose la muqueuse à l’ischémie s’il existe une zone de pres-
sion, comme c’est le cas en regard du ballonnet.
APPRÉCIATION DE LA SÉVÉRITÉ DES LÉSIONS
La dyspnée
La dyspnée fait toute la gravité des lésions post-intubation. Elle
est inspiratoire lorsque l’obstacle est laryngé ou qu’il intéresse
la trachée cervicale ; elle est aux deux temps respiratoires si l’obs-
tacle est étendu à la trachée thoracique. La dyspnée est dite sévère
lorsque sont présents des signes de lutte, des signes d’hypercap-
nie et une tachypnée. L’auscultation de l’axe laryngotrachéal per-
met de situer le siège de l’obstacle (bruit de la colonne d’air contre
l’obstacle). Une dysphonie ou des troubles de la déglutition asso-
ciés permettent d’orienter vers le siège topographique de la lésion.
Appréciation de l’efficacité de la toux
Cela est essentiel, le blocage des sécrétions étant responsable
d’une décompensation respiratoire et d’épisodes asphyxiques. En
dehors des cas évidents d’obstruction pariétale responsable d’une
accumulation des sécrétions trachéobronchiques en aval, l’incom-
pétence glottique entraîne une toux inefficace.
PREMIER BILAN ANATOMIQUE TOPOGRAPHIQUE
ET DYNAMIQUE : LA LARYNGOSCOPIE INDIRECTE
AU NASOFIBROSCOPE
(1-9)
Le bilan lésionnel anatomique de l’axe laryngopharyngotrachéal
est fait dans un premier temps par une laryngoscopie indirecte,
à l’aide d’un nasofibroscope, au lit du malade. Une anesthésie
locale n’est faite qu’en l’absence de dyspnée, celle-ci diminuant
le réflexe protecteur de toux. L’examen de la trachée est effec-
tué en dernier, celui-ci étant mal toléré sans anesthésie locale.
Cette fibroscopie constituera aussi l’examen principal du suivi
du patient, qui sera réalisé, dans la mesure du possible, par le
même opérateur.
Quel est l’état de la filière respiratoire ?
Dans un premier temps, le risque de décompensation respiratoire
est apprécié, en évaluant le calibre de la filière laryngée puis tra-
chéale. Les lésions sont sévères lorsqu’elles réduisent la filière
respiratoire de plus de 50 %, exposant aux risques d’une décom-
pensation respiratoire. L’obstruction de la filière peut être secon-
daire soit à une lésion pariétale, telle qu’un granulome obstructif
ou un délabrement muqueux, soit à un défaut de mobilité laryn-
gée. Même en présence d’une lésion laryngée, d’autres trauma-
tismes associés, en particulier trachéaux, doivent être recherchés.
Le larynx est-il mobile ?
L’appréciation de la mobilité du larynx permet de distinguer les
patients dont la mobilité laryngée est normale ou perturbée.
L’absence de troubles de la mobilité laryngée signe l’intégrité
DOSSIER
Prise en charge initiale des lésions laryngotrachéales
post-intubation chez l’adulte
●
S. Périé*
19
La Lettre d’Oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale - no257 - novembre 2000
* Chef de clinique-assistant, service d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie
cervico-faciale, hôpital Tenon, 4, rue de la Chine, 75020 Paris.

des articulations crico-aryténoïdiennes ; la présence d’une dys-
pnée peut, dans ces conditions, être secondaire à un obstacle glot-
tique, sous-glottique ou trachéal. L’atteinte de la mobilité aryté-
noïdienne peut être liée à une désarticulation crico-aryténoïdienne
(caractérisée par une dysphonie et par une odynophagie), à des
synéchies interaryténoïdiennes ou encore à des “péri-arthrites”
crico-aryténoïdiennes. Ces dernières peuvent se cicatriser sur un
mode fibreux sténosant, conduisant à une ankylose crico-aryté-
noïdienne. Le caractère uni- ou bilatéral d’une diminution de la
mobilité laryngée est précisé, l’atteinte bilatérale en fermeture
entraînant une dyspnée, et l’immobilité bilatérale en ouverture
exposant au risque de fausses routes.
Malgré l’absence de lésion pariétale évidente, une diminution de
la mobilité des cordes vocales est parfois observée, mais celle-ci
peut être rapidement réversible. En cas d’atteinte bilatérale, si la
dyspnée est tolérée, la mobilisation du larynx doit être favorisée
avant d’envisager une réintubation. En effet, dans un certain
nombre de cas, une remobilisation laryngée survient en moins de
24 heures. L’hypothèse pourrait être celle d’une forme d’anky-
lose laryngée ou d’une parésie laryngée secondaire à l’immobi-
lisation du larynx pendant la durée de l’intubation.
Les lésions sont-elles évolutives ? Quel est leur pronostic ?
Les lésions précocement observées au décours d’une extuba-
tion sont inflammatoires, par définition évolutives et instables.
Cette évolution aboutit dans la majorité des cas à une restitution
ad integrum des structures traumatisées, plus rarement à une
évolution sur un mode sténosant (1).
Les lésions laryngées localisées à type d’œdème ou d’hyperhé-
mie sont fréquentes et le plus souvent réversibles, provoquant
une dysphonie transitoire et, plus rarement, une dyspnée. Au
niveau des aryténoïdes, ces lésions sont favorisées par le reflux
œsophagique et la sonde nasogastrique (10). Les granulomes des
tiers postérieurs des cordes vocales sont très fréquents, situés juste
en avant de l’appui de la sonde, et entraînent une dysphonie qui
disparaît, le plus souvent, en moins de 15 jours. Au niveau de la
trachée, les lésions les plus fréquentes se situent en regard du bal-
lonnet, sur la trachée cervicale. L’aspect d’œdème ou d’épais-
sissement muqueux limité en regard, sans ulcération, a une évo-
lution classiquement favorable. En revanche, les lésions à type
d’ulcérations dénudent les cartilages laryngés et trachéaux ; elles
favorisent la formation de granulomes, l’évolution vers la chon-
drite puis la constitution d’une sténose.
La place de la fibroscopie de la déglutition
Elle peut être réalisée au lit du malade. Elle est indiquée lorsque
les lésions ou la symptomatologie laissent suspecter un risque de
fausses routes. L’ingestion d’aliments de textures variables pen-
dant l’examen au fibroscope permet de visualiser directement les
fausses routes, déterminantes dans le choix d’une alimentation
par voie orale ou, au contraire, par l’intermédiaire d’une sonde
nasogastrique. Même en l’absence de fausses routes, les chon-
drites sévères du cricoïde sont une indication à l’arrêt d’une ali-
mentation orale, réalisée au mieux par l’intermédiaire d’une gas-
trostomie, pour permettre une cicatrisation de la muqueuse du
cricoïde dénudé.
PRISE EN CHARGE :
LES MESURES GÉNÉRALES MÉDICALES
Diminuer les facteurs irritatifs sur la filière
La réduction des facteurs irritatifs sur la filière laryngotrachéale
doit être assurée par le drainage des sécrétions salivaires et
trachéobronchiques, grâce à des aspirations douces et à une
kinésithérapie respiratoire. En effet, en cas de filière étroite, les
décompensations asphyxiques sont secondaires au blocage des
sécrétions en aval de l’obstacle. L’humidification de l’atmosphère
et les aérosols permettent de fluidifier ces sécrétions, et la kiné-
sithérapie permet de les drainer.
L’ablation d’une sonde nasogastrique, lorsqu’elle est possible
(ou tout au moins la mise en place d’une sonde fine et souple),
et l’institution d’un traitement antireflux permettent de diminuer
l’irritation potentielle d’un reflux sur la margelle laryngée.
Lutter contre l’infection
La présence de lésions muqueuses favorise la dénudation des sur-
faces cartilagineuses, source de chondrite. Les lésions muqueuses
ulcérantes, les granulomes inflammatoires et les dénudations car-
tilagineuses justifient une antibiothérapie active sur les bacilles
à Gram négatif et les anaérobies.
Équilibrer le diabète
L’équilibre du diabète est indispensable, toute décompensation
favorisant la surinfection des lésions.
Remobiliser le larynx
En présence de lésions laryngées, tolérées sur le plan respiratoire,
la remobilisation du larynx permet de lutter contre l’ankylose et
de développer une toux efficace grâce à une kinésithérapie active.
Pas de place pour la corticothérapie
La prescription de corticoïdes n’a pas fait la preuve de son effi-
cacité dans le cadre des lésions sténosantes inflammatoires ; bien
au contraire, elle aggraverait les lésions cartilagineuses. Elle peut
cependant permettre de diminuer un éventuel œdème, dans les
premières heures d’une extubation.
L’alimentation
La reprise d’une alimentation orale après intubation doit être pro-
gressive, du fait de la “parésie” transitoire du carrefour (11). En
l’absence de fausses routes ou de la nécessité de mettre au repos
le cartilage cricoïde ou l’œsophage, elle est préférable à l’irrita-
tion générée par une sonde nasogastrique (10), permettant une
remobilisation laryngée et un apport nutritionnel physiologique.
Chez les patients présentant une dyspnée sévère, du fait du risque
de décompensation respiratoire, l’arrêt de l’alimentation orale est
initialement nécessaire.
PRISE EN CHARGE : LES MESURES SPÉCIFIQUES
(2-10)
La prise en charge thérapeutique vise à assurer une filière
laryngotrachéale satisfaisante, à réduire le risque d’évolution
vers la sténose tout en évitant une iatrogénie liée au traitement.
DOSSIER
20
La Lettre d’Oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale - no257 - novembre 2000
.../...

Le but est de diriger la cicatrisation de lésions évolutives en
séquelles organisées, qui peuvent conduire, dans un certain
nombre de cas, à proposer un traitement chirurgical sur
des lésions stables, facteur nécessaire pour éviter des échecs
thérapeutiques.
Atteintes sévères de la filière respiratoire :
la place du nettoyage endoscopique au tube rigide,
des dilatations, du calibrage et de la trachéotomie
Ces traitements sont réservés aux obstructions de la filière de
plus de 50 %. Les patients doivent être hospitalisés dans une
structure de réanimation ou dans un service permettant à tout
moment de faire face à une aggravation de leur état respiratoire.
La tolérance des lésions et leurs traitements doivent tenir compte
de l’état général du patient, en particulier sur les plans pulmo-
naire, cardiaque et rénal. Il faut privilégier, chez un patient dia-
lysé ou présentant une angine de poitrine, une sécurité respira-
toire. Si le patient est transportable, un scanner laryngotrachéal
avec la réalisation de coupes frontales permettra d’apporter des
précisions quant à l’état de la charpente cartilagineuse, la topo-
graphie et l’étendue des lésions.
La décision de réaliser un bilan précis topographique par laryn-
gotrachéoscopie au tube rigide, sous anesthésie générale, doit
prendre en compte le bénéfice potentiel de cette endoscopie et
le risque de trachéotomie. Dans ce contexte, on doit de principe
prévoir une intubation difficile. Cette endoscopie est discutée
cas par cas, entre réanimateurs et ORL. En effet, si le nettoyage
des lésions et les dilatations au tube rigide permettent de pas-
ser une étape dans un certain nombre de cas, une décompensa-
tion respiratoire est toujours à craindre, tout geste sur la filière
relançant le processus inflammatoire, avec le risque de tra-
chéotomie au décours. Dans un certain nombre de cas cepen-
dant, la réalisation d’une trachéotomie est préférable, permet-
tant, dans des conditions de sécurité ventilatoire, le traitement
endoscopique de lésions, en particulier laryngées, et de mettre
en place un calibrage précocement.
Atteintes laryngées
L’existence d’une diminution bilatérale de la mobilité du larynx
persistante, mal tolérée, doit faire discuter une trachéotomie,
avant d’envisager un traitement spécifique ultérieur. Il est en effet
dangereux et inadéquat de proposer un geste à type de cordoto-
mie sur une filière instable et potentiellement évolutive. En cas
d’atteinte sévère du cricoïde, la trachéotomie est aussi nécessaire
pour court-circuiter l’obstacle, afin de mettre au repos le seul car-
tilage laryngé assurant sa filière. Après l’exérèse des lésions obs-
tructives, un calibrage réalisé avec un tube de silicone est indi-
qué en présence de lésions sténosantes, inflammatoires et
granulomateuses.
Le traitement endoscopique des lésions permet un nettoyage de
la filière et offre la possibilité de réaliser des dilatations. Le net-
toyage endoscopique est réalisé aux micro-instruments ou au
laser CO2, et, plus récemment, au laser KTP ou au laser diode.
Lorsqu’ils sont obstructifs, de volumineux granulomes peuvent
ainsi être enlevés, mais, en l’absence de conséquence sur la
filière respiratoire, ils sont laissés en place, car ils récidivent
tant que le mode évolutif des lésions est présent. Des dilatations
aux trachéoscopes ou aux bougies de différentes tailles y sont
souvent associées pour reperméabiliser la filière et, dans cer-
tains cas, pour pouvoir mettre en place un calibrage. Les dila-
tations peuvent être répétées jusqu’à obtenir un état stable des
lésions, avant d’envisager un traitement curatif. Les calibrages
utilisés sont de préférence des tubes en T en silicone, de type
Montgomery, et sont posés en cas de lésions obstructives pré-
sentant un risque élevé de cicatrisation fibreuse sténosante. Ils
sont maintenus pendant toute la durée de la période évolutive.
Par la suite, leur retrait permettra d’apprécier le calibre laryngé
et d’envisager, si nécessaire, une chirurgie visant à agrandir la
filière laryngée.
Atteintes trachéales
Dans les lésions trachéales, le but du traitement est d’éviter la
réalisation d’une trachéotomie, en favorisant le traitement médi-
cal, l’antibiothérapie et le drainage des sécrétions. En cas
d’échec et en cas de mauvaise tolérance respiratoire, ne per-
mettant pas d’attendre l’effet du traitement médical, deux solu-
tions thérapeutiques doivent être envisagées. Dans le premier
cas, sur des lésions obstructives inflammatoires limitées en hau-
teur, une trachéoscopie sous anesthésie générale peut permettre
l’ablation des lésions obstructives et la dilatation des lésions,
en évitant une trachéotomie. Cette dilatation peut être répétée
régulièrement jusqu’à l’obtention de lésions stables pouvant
bénéficier d’une résection-anastomose de la trachée. La fré-
quence des dilatations et leur rythme, imposé en fonction de
l’état respiratoire, fournissent des renseignements sur l’évolu-
tivité des lésions. Cependant, en cas de lésions étendues et
d’atteinte majeure de l’armature cartilagineuse trachéale, une
trachéotomie sous anesthésie locale sera réalisée, si possible en
regard des lésions les plus importantes. La mise en place d’un
tube de Montgomery au décours permet de diriger la cicatrisa-
tion, la trachéotomie étant la source d’une iatrogénie impor-
tante sur une trachée traumatisée.
Les règles de la trachéotomie
La trachéotomie réalisée dans ce contexte doit obéir à plusieurs
règles visant à diminuer sa iatrogénie : elle est faite à distance
du cartilage cricoïde (au troisième ou quatrième anneau tra-
chéal) ; sa réalisation en H permet de diminuer le risque de for-
mation d’un éperon sus-canulaire et de respecter au maximum
les anneaux trachéaux tout en assurant un accès facile en cas de
décanulation accidentelle. Une désinfection locale pluriquoti-
dienne pour éviter l’infection ascendante est nécessaire. En
l’absence de fausses routes, il est préférable d’utiliser une canule
dépourvue de ballonnet, pour éviter une stase de sécrétions en
amont du ballonnet et pour diminuer une source d’hyperpres-
sion trachéale. La taille et la courbure de la canule doivent être
adaptées à celles de la trachée et de l’orifice de trachéotomie,
c’est-à-dire d’un diamètre inférieur pour éviter une surpression
le long des parois. Une canule avec chemise interne doit être
préférée pour des raisons de sécurité.
La trachéotomie percutanée par dilatation a été développée
comme une alternative à la trachéotomie chirurgicale. Elle est
DOSSIER
23
La Lettre d’Oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale - no257 - novembre 2000
.../...

de réalisation facile une fois le savoir-faire spécifique acquis.
Cette technique est en cours d’évaluation, mais le taux de com-
plications immédiates paraît faible.
Atteintes modérées et tolérées de la filière respiratoire
Il faut favoriser un traitement médical et obtenir une stabilité des
lésions. Ce n’est que sur des lésions stabilisées qu’un bilan sous
anesthésie générale sera proposé, à côté de l’imagerie et des
épreuves fonctionnelles respiratoires, devant la persistance d’une
symptomatologie respiratoire ou phonatoire. Pourront alors se
discuter une résection-anastomose trachéale, le traitement d’une
synéchie interaryténoïdienne ou encore celui d’une immobilité
de(s) corde(s) vocale(s).
Désarticulation crico-aryténoïdienne et désinsertion
de la corde vocale
Ces lésions représentent une indication d’un traitement précoce
sous laryngoscopie au tube rigide soit pour réduire la luxation
aryténoïdienne, ce qui peut être efficace si la réduction est réali-
sée précocement, soit pour faire un parage d’une désinsertion de
la corde vocale, tout en limitant les exérèses tissulaires.
Fistule œsotrachéale
L’existence d’une fistule œsotrachéale nécessite fréquem-
ment une trachéotomie, pour réaliser les aspirations, voire pour
mettre, en cas de fausses routes salivaires importantes, une canule
à ballonnet. Cependant, la trachéotomie est une source d’aggra-
vation des lésions. Les soins locaux devront être particulièrement
attentifs et la hauteur du ballonnet devra être modifiée quoti-
diennement. L’alimentation se fera par l’intermédiaire d’une
sonde nasogastrique. Le traitement se fera secondairement, sur
des lésions stabilisées, après un bilan topographique lésionnel.
La mise en place d’une prothèse endotrachéale pourra parfois
être discutée sur une trachée fermée. En cas de fistule de petite
taille, la cicatrisation peut aboutir à la fermeture complète de
celle-ci, sans qu’il soit nécessaire de réaliser une trachéotomie.
Le problème de la trachéobronchomalacie
Chez les insuffisants respiratoires chroniques, les lésions de tra-
chéobronchomalacie s’aggravent après une intubation, surtout
lorsqu’elle est prolongée. Les décompensations surviennent et
conduisent à discuter de la mise en place d’une trachéotomie,
pour permettre de maintenir une filière respiratoire satisfaisante
grâce à une ventilation positive. Son sevrage est cependant excep-
tionnellement possible. La mise en place d’une prothèse expan-
sible de type Ultraflex®peut parfois être discutée, si la broncho-
malacie reste modérée, mais elle pose un problème en cas
d’intubation ultérieure.
LES ÉCHECS D’EXTUBATION
L’ORL est souvent amené à vérifier la filière laryngotrachéale,
lorsque, à l’extubation, des signes évocateurs de la présence
d’un obstacle apparaissent. Une fois éliminée l’éventualité d’une
autre origine à ces troubles, une réintubation est le plus souvent
pratiquée.
La prise en charge se discutera : nouvelle tentative d’extubation
au lit du malade, avec réalisation d’une nasofibroscopie laryn-
gotrachéale par l’ORL, ou bilan sous anesthésie générale. Une
nouvelle extubation au lit du patient sera décidée si la réintuba-
tion n’a pas été difficile, sans lésion visible au cours de l’expo-
sition laryngée laissant présager d’un obstacle majeur. Par contre,
devant de multiples échecs d’extubation, et dans les cas où le
réanimateur signale des lésions ou un obstacle, un bilan endo-
scopique au tube rigide sous anesthésie générale sera réalisé ; il
s’accompagnera le plus souvent d’une trachéotomie pour per-
mettre le sevrage de la ventilation, même si aucune lésion obs-
tructive n’est observée, cette absence laissant suspecter un trouble
important de la mobilité laryngée. Un examen dynamique sera
secondairement réalisé.
CONCLUSION
La prise en charge initiale des lésions laryngotrachéales post-
intubation chez l’adulte doit conduire à proposer un traitement
précoce des lésions pour lutter contre la constitution d’une sté-
nose. Celle-ci reste rare, mais est d’autant plus à craindre chez
les patients diabétiques ou présentant une défaillance circulatoire.
La première étape est d’obtenir une filière respiratoire satisfai-
sante et une stabilité des lésions, facteur indispensable pour adap-
ter un traitement ultérieur, si nécessaire. L’obtention d’un état
stable passe, dans certains cas, par un nettoyage des lésions et
des dilatations aux tubes rigides, voire par la réalisation d’une
trachéotomie. La nasofibroscopie au lit du patient constitue l’exa-
men essentiel guidant la prise en charge initiale.
■
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
1. Whited RE. A prospective study of laryngotracheal sequelae in long-term
intubation. Laryngoscope 1984 ; 94 : 367-77.
2. Lacau-Saint-Guily J. Traitement précoce des traumatismes iatrogènes de
l’axe laryngotrachéal de l’adulte. Les cahiers d’ORL 1998 ; 32 : 291-5.
3. Laccourreye H, Pech A, Piquet JJ et al. Les sténoses laryngo-trachéales de
l’adulte et de l’enfant. Rapport de la Société française d’oto-rhino-laryngolo-
gie et de pathologie cervico-faciale, Paris : Arnette, 1985.
4. Laccourreye L, Périé S, Monceaux G et al. Traumatismes iatrogènes du
larynx et de la trachée. Encycl Méd Chir (Elsevier, Paris), Oto-Rhino-Laryn-
gologie, 1998 ; 20-720-A-30 : 8 p.
5. Périé S, Lacau-Saint-Guily J. Complications de l’intubation prolongée :
point de vue de l’ORL. Prat An Réa 1999 ; 3 : 14-22.
6. Benjamin B. Prolonged intubation injuries of the larynx : endoscopic dia-
gnosis, classification and treatment. Ann Otol Rhinol Laryngol 1993 ;
160 (suppl.) : 1-15.
7. Thomas R, Kumar EV, Shamim A et al. Post intubation laryngeal sequelae
in an intensive care unit. J Laryngol Otol 1995 ; 109 : 313-6.
8. Vila J, Bosque MD, Garcia M et al. Endoscopic evaluation of laryngeal
injuries caused by translaryngeal intubation. Eur Arch Otorhinolaryngol
1997 ; 254 (suppl. 1) : 97-100.
9. Ellis SF, Pollack AC, Hanson DG et al. Videolaryngoscopic evaluation of
laryngeal intubation injury : incidence and predictive factors. Otolaryngol
Head Neck Surg 1996 ; 114 : 729-31.
10. Sofferman RA, Hubbell RN. Laryngeal complications of nasogastric tubes.
Ann Otol Rhinol Laryngol 1981 ; 90 : 465-8.
11. De Larminat V, Dureuil B, Montravers P, Desmonts JM. Altération du
réflexe de la déglutition après intubation prolongée. Ann Fr Anesth Reanim
1992 ; 11 : 17-21.
DOSSIER
24
La Lettre d’Oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale - no257 - novembre 2000
1
/
4
100%