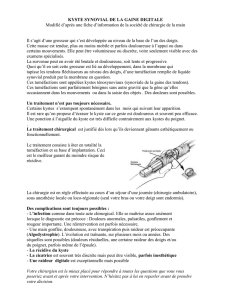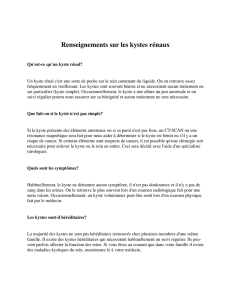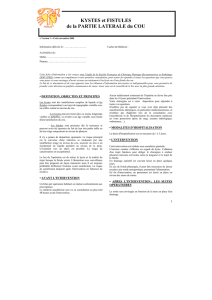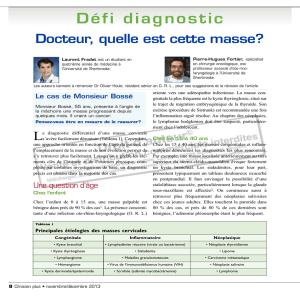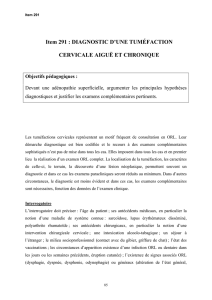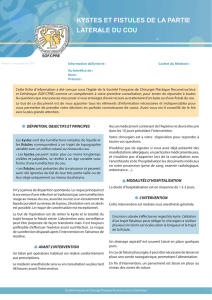Lire l'article complet

SUPPLÉMENT A LA LETTRE D’ORL
N°233 - MAI 1998
◆
Président : E.N. GARABÉDIAN
◆
Président honoraire : Ph. NARCY
◆
Secrétaires : P. AT TA L
S. BOBIN
Y. MANAC’H
M.J. PLOYER
◆
Trésorier : J.M.TRIGLIA
◆
Siège : Hôpital Robert-Debré,
Service ORL, 48, bd Sérurier,
75935 PARIS Cedex 19
◆
Conseillers scientifiques
pour la pédiatrie :
A. BOURRILLON (Paris),
J.M. GARNIER (Marseille)
◆
Comité de rédaction :
P.ATTAL, J.F. BELUS, Ph. CONTENCIN,
F. DENOYELLE, M. FRANÇOIS,
P. FROEHLICH, J.P. MARIE, M. MONDAIN,
M.P. MORISSEAU-DURAND, R. NICOLLAS,
M.J. PLOYET, G. ROGER
◆
AA
SSOCIATION
FF
RANÇAISE
D’
OO
RL
PP
ÉDIATRIQUE
Tuméfactions
cervicales
chez l’enfant
5eréunion annuelle de
l’AFOP
Président-directeur général et directeur de la publication : C. DAMOUR-TERRASSON
Directeur de clientèle : V. LEPAGE - Directeur commercial : S. NETCHEVITCH
Secrétaire de rédaction : S. HAÏLÉ-FIDA
Edimark S.A.
62/64, rue Jean-Jaurès - 92800 Puteaux.Tél. : 01 41 45 80 00 - Fax : 01 41 45 80 01
Commission paritaire n° 66 565 - ISSN 0754-7188

De l’anatomie au diagnos-
tic
S. Bobin, Le Kremlin-Bicêtre
La localisation d’une tuméfaction cervicale peut orienter le dia-
gnostic étiologique. En effet, s’il existe bien des lésions ubiqui-
taires, comme les angiomes plans ou les adénopathies, les patho-
logies d’organe ou d’origine embryonnaire ont une localisation
précise.
Le cou peut être divisé schématiquement en une région médiane,
deux régions latérales, deux régions sus-claviculaires et la nuque.
Les régions sous-maxillaires et parotidiennes, bien qu’elles ne
fassent pas partie du cou tel que le définissent les anatomistes
comme H. Rouvière, seront ici prises en compte du fait de l’ex-
pression de leur pathologie, bien souvent en continuité avec la
région cervicale.
La région médiane haute est limitée en bas par l’os hyoïde, laté-
ralement par les ventres antérieurs des muscles digastriques et en
profondeur par les muscles mylo-hyoïdiens. Les tuméfactions les
plus fréquentes dans cette localisation sont les kystes du tractus
thyréoglosse et les kystes dermoïdes adgéniens et adhyoïdiens. Il
peut aussi s’agir d’une adénopathie ou de la partie cervicale
d’une grenouillette en bissac d’origine sublinguale.
Les tuméfactions de la région médiane moyenne sont pratique-
ment toujours, chez l’enfant, des kystes du tractus thyréoglosse,
les tumeurs thyroïdiennes étant en effet exceptionnelles.
La plupart des tuméfactions présentes dans la région médiane et
basse du cou, au-dessus du manubrium sternal et en dessous du
niveau du cartilage cricoïde, sont des kystes dermoïdes. Il s’agit
plus rarement de kystes du tractus thyréoglosse, de tératomes ou
de kystes bronchogéniques.
La région latérale du cou est limitée par le relief, en surface, du
muscle sterno-cléido-mastoïdien. Elle répond en dedans au
paquet vasculonerveux jugulocarotidien. La plupart des tuméfac-
tions qui siègent dans sa partie haute, sus-omohyoïdienne, sont
des adénopathies. Mais c’est aussi le siège des kystes de la
deuxième fente branchiale, des tumeurs nerveuses et des chemo-
dectomes. Les kystes et fistules des 3eet 4efentes, les duplications
digestives, les tumeurs thyroïdiennes, les phlébectasies de la
jugulaire interne se manifestent plus volontiers au niveau de la
partie latérale basse. Le Fibromatosis colli peut siéger en n’importe
quel point du sterno-cléido-mastoïdien. Les lipomes et les lym-
phangiomes peuvent siéger en n’importe quel point de la partie laté-
rale du cou mais débordent volontiers sur les structures adjacentes.
La région susclaviculaire est limitée en bas par la clavicule, en
avant par le bord postérieur du muscle sterno-cléido-mastoïdien et
en arrière par le bord antérieur du muscle trapèze. Une tuméfaction
à ce niveau évoque un lymphangiome, un lipome,unkyste thy-
mique. Les adénopathies de siège sus-claviculaire sont souvent
malignes.
La région sous-maxillaire est le siège des adénopathies bacté-
riennes à cocci Gram positif, de la maladie des griffes du chat et
des mycobactéries atypiques. C’est aussi une localisation fréquente
des lymphangiomes et le siège exclusif, bien sûr, des sous-maxillites,
des tumeurs de la sous-maxillaire et des tumeurs mandibulaires.
La région parotidienne est le siège préférentiel des héman-
giomes et des lymphangiomes. Les adénopathies parotidiennes
doivent faire rechercher une mycobactérie atypique et une maladie
des griffes du chat. Une tuméfaction parotidienne chez l’enfant
peut aussi correspondre à un noyau de parotidite, une tumeur
glandulaire, un kyste de la première fente, un lymphome, un rhab-
domyosarcome.
Les tuméfactions
inflammatoires aiguës
M.J. Ployet, Tours
Les tuméfactions inflammatoires aiguës sont celles qui évoluent
depuis moins de trois semaines. Les étiologies sont fort nom-
breuses et il faudrait un livre pour les aborder toutes. L’exposé a
donc été centré autour de cinq situations cliniques.
■
Adénopathies cervicales inflammatoires évoluant depuis
moins de 3 semaines
Les signes cliniques associés peuvent évoquer la responsabilité
d’un virus particulier comme dans les syndromes à adénovirus.
Le syndrome FAPA, associant fièvre, aphtes géants, pharyngite et
adénite, bien que rare, est à connaître car il est volontiers récidi-
vant. Il débute en général avant 5 ans et ne guérit qu’à l’adoles-
cence. Les étiologies des adénopathies fébriles sont multiples et
bien connues : mononucléose infectieuse, toxoplasmose, tula-
rémie, brucellose. Leur diagnostic précis repose sur les sérologies.
Il est important de rappeler dans ce chapitre la maladie de
Kawasaki. Dans plus de la moitié des cas, les manifestations ini-
tiales du Kawasaki sont purement ORL avec une adénite, une
pharyngite et surtout une fièvre qui ne baisse pas, malgré les anti-
biotiques. Il n’existe pas de stigmate biologique spécifique de
cette affection redoutable dont le diagnostic est purement clinique
et dont le traitement doit être entrepris avant le dixième jour pour
éviter la formation d’anévrismes, en particulier coronariens, qui
font toute la gravité de cette affection (voir plus loin l’interven-
tion de N. Delapierre).
La découverte d’une porte d’entrée cutanée ou muqueuse évoque
certaines bactéries : les adénites dont la porte d’entrée est cutanée
sont a priori dues à Staphylococcus aureus ou à Streptococcus
pyogenes. Le traitement de première intention pour un enfant non
hospitalisé est l’oxacilline (50 à 100 mg/kg/j), l’association
amoxicilline-acide clavulanique ou la pristinamycine
(50 mg/kg/j). Les céphalosporines de deuxième ou de troisième
génération sont moins efficaces sur les streptocoques
(J.F. Lemeland). Les adénites dont la porte d’entrée est pharyngée
sont en général dues à Streptococcus pneumoniae ou à la flore de
Veillon ; les adénites dont la porte d’entrée est dentaire sont habi-
tuellement dues à des anaérobies. Ces adénites sont traitées ini-
tialement par antibiotiques ; malgré cela, certaines évolueront
vers l’adénophlegmon. La récidive de la tuméfaction remet en
cause le diagnostic d’adénite et fait rechercher un reliquat
embryonnaire. Les véritables récidives doivent faire évoquer une
pathologie de la phagocytose comme le syndrome de Buckley.
Les adénophlegmons sous-mandibulaires sont dus dans 80 % des
cas à une pathologie dentaire (deuxième ou troisième molaire) et
d’origine streptococcique.
2
AFOP

La sialadénite du nourrisson est au contraire d’origine staphylo-
coccique et impose une hospitalisation pour réhydratation et anti-
biothérapie par voie veineuse (en cas d’allaitement, rechercher un
abcès du sein maternel [M. François]).
Les phlegmons péripharyngés, en dehors du phlegmon péri-
amygdalien, peuvent poser des problèmes de diagnostic difficile,
qui seront souvent résolus par l’imagerie. Sur un cliché de profil,
une épaisseur des parties molles prévertébrales (en dehors des
cris) supérieure à 13 mm évoque un abcès rétropharyngé.
L’échographie cervicale ou intra-orale est un excellent outil de
diagnostic des abcès péripharyngés ; elle permet, de plus, de loca-
liser la collection par rapport à la peau, à la muqueuse et aux gros
vaisseaux. La voie de drainage (pharyngée ou cervicale) sera
choisie à partir de l’examen tomodensitométrique (figure 1). Ces
abcès sont actuellement dus au streptocoque, alors qu’il y a une
vingtaine d’années, ils étaient plus volontiers d’origine staphylo-
coccique.
Suivant la compliance de l’enfant, la ponction d’une adénite cervi-
cale se fait après anesthésie de contact par la crème Emla ou sous
anesthésie générale. Les ponctions des phlegmons périamygda-
liens et parapharyngés se font toujours sous anesthésie générale
chez l’enfant.
La conduite à tenir devant une adénopathie inflammatoire aiguë
isolée est résumée sur la figure 2.
■
Malformations congénitales du cou se manifestant par
une tuméfaction inflammatoire aiguë
Habituellement, la palpation permet de différencier un kyste
infecté (limites nettes) d’une adénite (limites floues du fait de la
périadénite). En cas de doute, l’échographie tranchera (voir plus
loin la communication de C. Garel).
■
Parotidites
L’étiologie la plus fréquente des parotidites était autrefois la paro-
tidite ourlienne. Celle-ci est devenue rare depuis la généralisation
de la vaccination. D’autres virus peuvent donner une parotidite :
le virus de la grippe, les virus Coxsackie. La preuve ne pourrait
en être apportée que par une sérologie qui, en pratique, n’est
jamais demandée. Ces parotidites guérissent spontanément.
Au cours d’une parotidite suppurée, le massage de la glande d’ar-
rière en avant fait sourdre un peu de pus au niveau de l’orifice du
canal de Sténon. Les germes les plus fréquemment retrouvés sont
les streptocoques.
Les abcès intraparotidiens sont rares, ils sont diagnostiqués à
l’échographie et réagissent bien en général à une antibiothérapie
parentérale associée à des ponctions.
Les parotidites lithiasiques sont exceptionnelles chez l’enfant.
Les parotidites chroniques récidivantes ne se voient pratiquement
que chez les enfants. L’évolution va se faire vers l’espacement
puis la disparition des poussées infectieuses dans 90 % des cas.
Certains enfants garderont comme séquelle un nodule résiduel ou
une hypertrophie parotidienne. Enfin, l’évolution peut se faire vers
un syndrome sec. Les poussées infectieuses sont traitées par la
spiramycine ou l’association amoxicilline-acide clavulanique.
Pour espacer les poussées, on a pu proposer des traitements “éco-
logiques” : favoriser la salivation par des chewing-gums, le
citron, l’orange amère, ou masser régulièrement la glande
(J. Andrieu-Guitrancourt). La sialographie aurait des vertus anti-
septiques (figure 3). L’injection intracanalaire de soframycine
(M. François, M.P. Morisseau-Durand) ou de tétracycline
permettrait d’espacer les poussées, peut-être en favorisant une
sclérose de la glande. Tous ces traitements comportent des échecs
et certains auteurs ont pu proposer pour les formes rebelles et
invalidantes des traitements chirurgicaux tels que la section du
nerf auriculo-temporal, la section de la corde du tympan, la liga-
ture du Sténon, voire la parotidectomie.
Les enfants sidéens ont, dans 30 % des cas, une infiltration lym-
phocytaire des parotides ou des kystes lymphoépithéliaux contre
laquelle on a proposé la tétracycline intracanalaire et intrakystique.
En période néonatale, une tuméfaction inflammatoire de la
région parotidienne doit faire rechercher une atteinte infectieuse
de l’articulation temporo-mandibulaire qui risque d’évoluer vers
une redoutable ankylose temporo-mandibulaire.
3
AFOP
Figure 1. Coupe sagittale
en IRM montrant une
tuméfaction considérable
des tissus prévertébraux,
avec une image claire en
leur centre évocatrice
d’abcès retropharyngé
collecté.
Figure 2. Diagramme décisionnel devant une adénopathie cervicale
inflammatoire aiguë isolée chez l’enfant.
partie basse du cou
< 15 mm
volume stable ou augmenté
exérèse pour
anatomopathologie
diminution de volume
pas de traitement
> 15 mm
+/- antibiotiques
ponction pour bactériologie
et cytologie
NFS VS sérologies
J15
Adénopathie inflammatoire aiguë

■
Cellulite cervicofaciale du nouveau-né
Il s’agit d’une affection grave qui débute brutalement par une
altération de l’état général et une rougeur limitée cervico-faciale.
Elle est souvent associée à une pneumopathie, une méningite, une
otite. L’hémoculture est positive dans la moitié des cas. Il est inté-
ressant, pour retrouver le germe responsable et pouvoir faire un
antibiogramme, de ponctionner la cellulite avec une aiguille fine
et d’envoyer la sérosité recueillie au laboratoire de microbiologie.
Trois germes peuvent être en cause : le streptocoque B, le
staphylocoque et Haemophilus. Le traitement repose sur une
antibiothérapie parentérale.
■
Thyroïdites aiguës
Les tuméfactions inflammatoires aiguës de la région thyroïdien-
ne se manifestent volontiers par une dysphagie et une limitation
de l’extension du cou. L’échographie cervicale, éventuellement
complétée par un examen tomodensitométrique, permettra de
rapporter cette tuméfaction à sa cause, qui est le plus souvent une
anomalie vestigiale. En effet, les thyroïdites auto-immunes et les
cancers indifférenciés de la thyroïde sont exceptionnels
chez l’enfant.
Les tuméfactions inflamma-
toires subaiguës et chroniques
J. Andrieu-Guitrancourt, J.F. Lemeland, Rouen
Il faut toujours être prudent devant une tuméfaction cervicale
inflammatoire d’évolution chronique car elle peut être le mode de
révélation d’un processus sous-jacent malformatif, tumoral ou
autre. Il est nécessaire de faire un examen très précis comportant,
entre autres, l’étude des paires crâniennes et l’examen des régions
avoisinantes. Il peut être utile de revoir l’enfant après un traite-
ment anti-infectieux d’épreuve, mais il faut s’abstenir de prescrire
des corticoïdes tant qu’un lymphome n’a pas pu être formellement
écarté. Des examens complémentaires pourront être demandés
en fonction des tableaux cliniques.
■
Adénopathie unique
L’étiologie la plus probable est celle d’une adénite à pyogène ou
d’une adénite spécifique ; l’étiologie tumorale vient en troisième
position.
Devant ce tableau, il faut tout d’abord rechercher une porte d’en-
trée infectieuse dans le territoire de drainage, puis faire un essai
thérapeutique avec des antibiotiques (pas de corticoïdes). Si la
masse ne régresse pas de manière satisfaisante, il faut demander
une échographie, puis proposer une ponction pour examen bacté-
riologique et cytologique, et demander des sérologies. Si l’en-
semble de ces examens ne permet pas d’aboutir au diagnostic, il
faut pratiquer l’exérèse chirurgicale de la masse pour examen
anatomo-pathologique.
Dans ce cadre, les orateurs ont insisté sur trois types de bactéries
susceptibles d’être à l’origine d’une adénite chronique : les myco-
bactéries atypiques, les Actinomyces et Bordetella henselae.
Les adénites à mycobactéries atypiques
Les mycobactéries, qu’elles soient typiques ou atypiques, sont des
bacilles acido-alcoolo-résistants, qui peuvent être mis en évidence
par une coloration spécifique : la coloration de Ziehl. Celle-ci n’est
en fait positive que dans la moitié des cas environ. De plus, elle ne
permet pas de différencier une tuberculose d’une mycobactérie aty-
pique, ce qui est fondamental pour la prise en charge, qui est très
différente dans les deux cas. Il est donc nécessaire de faire des cul-
tures sur des milieux spécifiques. La réponse pour une mycobacté-
rie atypique demande au minimum 10-15 jours. La PCR n’a pas
une sensibilité très supérieure à celle de la coloration de Ziehl dans
ces prélèvements par ponction ganglionnaire car le prélèvement
contient inéluctablement du sang. Cependant, si le Ziehl est positif,
il est intéressant de demander une étude par PCR car cela permettra
de différencier rapidement une tuberculose (Mycobacterium tuber-
culosis, M. bovis) d’une infection à mycobactérie atypique. Ces
mycobactéries atypiques sont très peu sensibles aux antibiotiques.
À la différence de la tuberculose, cette affection n’est pas conta-
gieuse, même lorsqu’il y a fistulisation cutanée. Les adénites à
mycobactéries atypiques surviennent presque exclusivement chez
les jeunes enfants et dans la région sous-maxillaire ou le long du
rebord mandibulaire. La guérison spontanée est fréquente mais peut
demander plusieurs mois. Le traitement antituberculeux commencé
en attendant les résultats de la culture sera arrêté dès que les résultats
seront disponibles, sauf chez les enfants ayant une déficience
immunitaire et chez les enfants infectés par M. kansasii (risque
d’infection pulmonaire). Dans les autres cas, on préférera un traite-
ment local avec des ponctions, éventuellement un curettage de
l’adénopathie, rarement une exérèse réglée (voir plus loin la com-
munication de C. Berges). Le résultat cosmétique en cas de
guérison spontanée est souvent bon, meilleur que celui que l’on
peut espérer après traitement chirurgical (N. Garabédian,
M. François). Celui-ci ne doit donc être proposé qu’avec circons-
pection pour des lésions désespérantes par leur chronicité.
Actinomyces
Chez l’enfant, l’actinomycose a essentiellement une expression
cervico-faciale et pour origine un foyer dentaire négligé. La
4
AFOP
Figure 3. Sialographie parotidienne montrant une image dite de pommier
en fleurs caractéristique des parotidites récidivantes de l’enfant.

lésion a volontiers un aspect pseudotumoral, sous-maxillaire ou
sus-hyoïdien. La technique de prélèvement doit être particulière
si l’on veut mettre en évidence des Actinomyces car ces germes
sont très fragiles, et en particulier sensibles à l’oxygène et à la
dessication. J.F. Lemeland conseille de faire une ponction à l’ai-
guille et d’ensemencer un milieu anaérobie. La ponction est évo-
catrice si elle retrouve des grains jaunes. À l’examen direct, les
Actinomyces se présentent comme des filaments à Gram positif.
La culture sur milieux usuels est lente (5 à 20 jours). Les images
à l’examen anatomo-pathologique sont aussi évocatrices et spéci-
fiques. L’actinomycose est très sensible à la pénicilline G.
La maladie des griffes du chat
Le prélèvement ne nécessite pas de précaution particulière, mais,
en fait, le diagnostic est rarement réalisé au laboratoire de micro-
biologie car la culture de l’agent de la maladie des griffes du chat,
Bordetella henselae, est difficile et lente ; quant à la PCR, elle
nécessite un laboratoire très spécialisé. Le diagnostic se fait par la
sérologie. Sur le plan thérapeutique, certains auteurs proposent
des macrolides, d’autres des fluoroquinolones. Nous avons peu
de données sur l’efficacité réelle des antibiotiques sur les adéno-
pathies de la maladie des griffes du chat.
■
Polyadénopathie uni- ou bilatérale
Les étiologies sont, par ordre décroissant de fréquence : la mono-
nucléose infectieuse, la toxoplasmose, le lymphome, les méta-
stases de cancer nasopharyngé ou thyroïdien. Cette liste n’est pas
limitative. Dans ce type de situation, après un examen général et
local, il faut demander des sérologies (MNI, toxoplasmose,
CMV). Si celles-ci sont négatives, il faut faire une ponction cyto-
logique. Dans 20 % des cas environ, il faudra aller jusqu’à l’adé-
nectomie et environ 5 % de ces ganglions s’avéreront être malins.
■
Une tuméfaction profonde et fixée
Ce tableau clinique peut correspondre à une adénopathie chro-
nique, à un adénophlegmon ligneux du cou, à l’extension d’une
infection profonde ou à une tumeur maligne.
Le bilan local sera suivi d’une échographie et d’un examen tomo-
densitométrique ou d’une IRM, puis éventuellement d’une ponc-
tion à visée cytologique et bactérienne. Si l’ensemble des exa-
mens précédents ne permet pas de faire le diagnostic, il faut pro-
poser une exploration chirurgicale.
■
Une tuméfaction inflammatoire parotidienne subaiguë ou
chronique
Le diagnostic le plus probable est celui d’une parotidite, mais il
peut s’agir d’une tumeur, salivaire ou non, ou de voisinage (man-
dibule, cavum).
L’examen locorégional sera complété par une échographie, éven-
tuellement une sialographie, puis, en fonction des résultats, une
ponction cytologique, un examen tomodensitométrique ou une
IRM avant d’envisager, suivant l’étiologie, un trai-
tement médical ou chirurgical.
Les hémopathies
S. Blanche, Paris
Une adénopathie cervicale peut être la première manifestation
d’un lymphome. Le lymphome est exceptionnel avant 2 ans. Le
diagnostic est parfois possible sur une ponction-cytologie qui per-
met aussi de faire l’étude cytogénétique (figure 4). En cas de
doute persistant, il faut faire l’exérèse d’un ganglion et envoyer ce
ganglion non fixé au laboratoire d’anatomo-pathologie. Là seront
effectuées des empreintes (pour la cytologie), une étude histolo-
gique sur un fragment fixé au formol ou au Bouin, une étude
immunohistochimique et en biologie moléculaire sur un fragment
congelé, et enfin une étude cytogénétique sur milieu de culture.
Le traitement repose sur une chimiothérapie et une irradiation
dont les modalités dépendent du siège et de l’extension des
lésions, ainsi que du typage du lymphome. Le pronostic est en
effet fonction des anomalies cytogénétiques constatées lors du
bilan initial et le traitement sera d’emblée plus lourd dans les
formes à mauvais pronostic. La survie est actuellement supérieu-
re à 85 % à 10 ans, ce qui pose le problème des séquelles à long
terme. Les cancers d’apparition secondaire observés dans le suivi
à long terme d’enfants traités pour lymphome ont conduit à envi-
sager une désescalade dans les traitements, dans l’hypothèse où il
s’agirait de complications d’un traitement trop poussé, mais il
pourrait s’agir de manifestations malignes sur terrain favorisant
(comme les localisations secondaires dans l’évolution des
patients traités pour un épithélioma des voies aérodigestives supé-
rieures).
Les lymphoproliférations malignes peuvent apparaître après
transplantation, chez des enfants traités par immunosuppresseur
pour éviter un rejet de greffe. Le risque est de 1 à 3 % après
greffe rénale, de 0,5 à 24 % après greffe médullaire, en fonction
de l’immunosuppression. Les manifestations les plus fréquentes
sont des adénopathies fébriles. Le diagnostic repose sur l’identi-
fication de la prolifération du lymphocyte B dans l’adénopathie
ou dans le sang. Le traitement repose sur la diminution de l’im-
munosuppression et l’exérèse de l’adénopathie. Un traitement
immunologique spécifique commence à pouvoir être proposé.
De nombreuses hémopathies bénignes ont été décrites chez l’en-
fant ; elles sont toutes exceptionnelles.
La maladie de Kimura associe une adénopathie, une hyperéosi-
5
AFOP
pus
doute cytologie
histologie
immunohistochimie
biologie moléculaire
cytogénétique
cytologie
cytogénétique
immunophénotype
bactériologie
métastase d'une tumeur solide
(thyroïde...)
exérèse d'un ganglion
lymphome
leucémie
ponction
Figure 4. Conduite à tenir devant une adénopathie subaiguë.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%