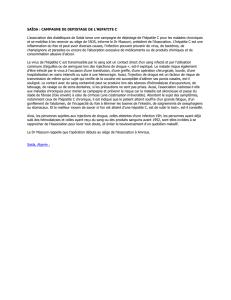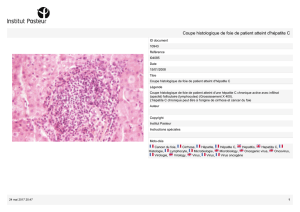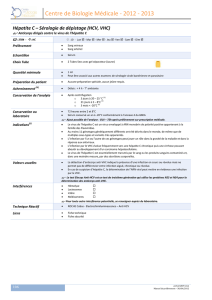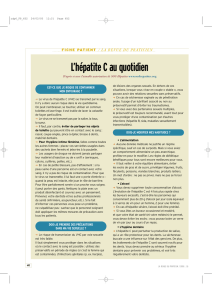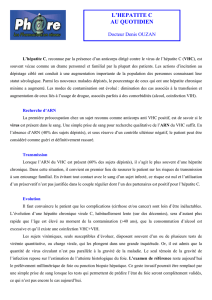Hépatite C : les différents examens biologiques

Dépistage, diagnostic, bilan et suivi des
traitements, la prise en charge de l’hépatite
C repose notamment sur différents examens
biologiques, le plus souvent réalisés à partir d’une
simple prise de sang.
Le test de dépistage
Lorsqu’une personne a été en contact avec le virus de l’hépa-
tite C (VHC), son système immunitaire fabrique des anticorps
spécifiques. Ce sont ces anticorps que le test de dépistage
détecte. Pour autant, un résultat positif ne signifie pas systé-
matiquement la présence d’une infection persistante. En effet,
environ 20 % des personnes éliminent spontanément le VHC.
Comme les anticorps spécifiques demeurent dans l’organisme,
ils sont quand même détectés. Dans tous les cas, un test positif
doit être confirmé à partir d’une nouvelle prise de sang et avec
une autre technique de dépistage.
Un résultat négatif indique qu’il n’y a pas eu de contact avec le
VHC au cours des 60 à 70 jours précédant la réalisation du test.
C’est en effet le délai nécessaire pour que l’organisme produise
des anticorps. En cas de doute sur une éventuelle contamina-
tion, il faut refaire un test passé ce délai.
Le test de diagnostic
Pour confirmer une infection persistante par le VHC, il est
nécessaire de rechercher directement la présence du virus dans
le sang. Pour cela, on utilise une technique d’amplification du
génome viral, appelée PCR, qui permet de détecter l’ARN du
VHC.
Si le résultat est positif, cela indique qu’une infection, aiguë
ou chronique, est présente et qu’il existe un risque de trans-
mission du virus en cas de contact avec le sang d’une autre
personne. Un résultat positif ne permet pas en revanche de
connaître le stade de la maladie et son évolution.
Si le résultat est négatif, cela peut signifier deux choses : soit
l’infection est très récente et le virus ne peut être encore dé-
tecté. Dans ce cas, il faudra renouveler la recherche de l’ARN
viral un à trois mois plus tard ; soit l’organisme s’est débarrassé
du virus et l’infection a disparu. Pour en être certain, il est
nécessaire de renouveler le test par PCR après plus de trois
mois d’intervalle. Deux résultats négatifs sont le signe d’une
guérison spontanée.
Les examens avant le traitement
Lorsque le diagnostic d’infection par le VHC est établi,
d’autres examens biologiques sont requis pour préciser les
caractéristiques de la maladie. Cela permet ensuite d’adapter la
prise en charge médicale.
- Le génotype viral. Il existe six formes différentes connues
(appelé génotypes) du virus de l’hépatite C. En France, le
Hépatite C :
les différents examens biologiques
Vous et l’hépatite C
génotype 1 est le plus fréquent puisqu’il est retrouvé dans en-
viron 60 % des cas. Viennent ensuite, par ordre de fréquence,
le génotype 3 (environ 20 % des cas), le 2 (environ 15 %) et
le 4. Il est important de connaître le génotype car les chances
de succès des traitements sont plus ou moins importantes en
fonction de ce dernier ; elles sont ainsi plus élevées avec les
génotypes 2 et 3.
- La charge virale. Elle correspond à la quantité de virus pré-
sent dans le sang d’une personne infectée par le VHC. Cepen-
dant, cette quantité n’a pas d’impact sur l’évolution de la mala-
die. La mesure de la charge virale sert uniquement lorsqu’un
traitement anti-hépatite C est envisagé afin de disposer d’un
point de comparaison. En la mesurant à nouveau pendant le
traitement, il est ainsi possible de savoir si le traitement est
efficace (si la charge virale baisse de façon importante) ou non
(si la charge virale baisse peu ou pas).
- L’évaluation de la fibrose. L’infection par le VHC se traduit
par une atteinte progressive du foie, ce que l’on appelle la
fibrose, qui peut conduire à la cirrhose. Avant de débuter un
traitement, il est nécessaire de connaître le degré de la fibrose
et l’activité de l’hépatite. L’examen classique pour cela consiste
à effectuer une ponction-biopsie hépatique, c’est-à-dire à pré-
lever un fragment du foie pour l’examiner ensuite au micros-
cope. Compte tenu du caractère invasif de cette intervention,
différentes techniques ont été développées ces dernières années
pour évaluer la fibrose à partir d’une prise de sang.
Les résultats de cette évaluation se présentent sous la forme
d’un score, appelé Métavir, qui comporte deux valeurs : A
indique l’activité de l’hépatite et est graduée de 0 (aucune
activité) à 3 (activité très importante), F représente le degré de
la fibrose, allant de 0 (absence de lésion) à 4 (présence d’une
cirrhose).

Cette fiche d’information vous est proposée par
- Le bilan hépatique. Ce bilan repose sur différents examens
sanguins qui permettent d’évaluer l’état du foie.
- Les transaminases (ALAT et ASAT). Ces enzymes ont
tendance à augmenter en présence de lésions hépatiques. Cette
augmentation n’est toutefois pas systématique. Ainsi, 25 %
environ des personnes atteintes d’hépatite C chronique ont des
ALAT normales.
- Les phosphatases alcalines (PAL). Il s’agit d’enzymes qui
sont excrétés par la bile produite par le foie. Leur mesure est
donc un indicateur de la fonction d’élimination assurée par le
foie. Leur niveau peut être normal à élevé (jusqu’à trois fois la
valeur normale) au cours d’une hépatite C chronique.
- Les gamma glutamyl transférases (gamma GT). Le taux de
ces enzymes augmente en cas de maladie du foie. Cet examen
complète la mesure des PAL pour évaluer les capacités d’élimi-
nation du foie.
- La bilirubine. La concentration de ce pigment jaune orangée,
présent dans la bile et issu de la dégradation naturelle de l’hé-
moglobine, augmente au cours des maladies du foie.
- Le taux de prothrombine (TP) ou temps de Quick. La
prothrombine est une protéine sanguine intervenant dans la
coagulation. Sa mesure est une indication de la capacité du
foie à produire certains facteurs impliqués dans la coagulation.
Chez les personnes atteintes d’hépatite C chronique, le taux de
TP est souvent perturbé.
- La numération formulation sanguine (NFS ou hémogram-
me) et la numération des plaquettes. Il s’agit d’examens usuels
qui renseignent sur l’état général. La numération des globules
rouges permet ainsi de détecter une éventuelle anémie. Celle
des globules blancs est un indicateur de la situation des défen-
ses immunitaires. Quant à la numération des plaquettes, elle
permet d’évaluer la capacité de coagulation du sang.
- Les autres examens. Différents examens complémentaires
peuvent être prescrits afin de rechercher d’autres maladies
ou des complications de l’hépatite. Il s’agit notamment de la
sérologie VIH et de l’hépatite B pour savoir si l’un et/ou l’autre
de ces deux infections ne sont pas associées à l’hépatite C
chronique. Le dosage de la TSH et la recherche d’auto-anti-
corps antithyroperoxydase visent à vérifier le fonctionnement
de la thyroïde. Un bilan lipidique pour évaluer les risques de
maladies cardiovasculaires peut être également prescrit. C’est
le cas aussi de la créatininémie et de la recherche de protéines
dans les urines afin de contrôler le fonctionnement des reins.
Enfin, pour les femmes, un test de grossesse est effectué car
les traitements anti-hépatite C présentent des risques pour le
fœtus.
Les examens pendant le traitement
Les différents examens prescrits pendant un traitement anti-
hépatite C visent, d’une part, à s’assurer de la bonne tolérance
du traitement, d’autre part, à évaluer l’efficacité de celui-ci.
- Le premier mois. Tous les quinze jours, il est nécessaire d’ef-
fectuer une numération formule sanguine, afin de contrôler
que le traitement n’induit pas d’effets indésirables hématologi-
ques trop importants.
- Tous les mois suivants. Toujours pour surveiller la tolérance
du traitement, il est nécessaire de réaliser une NFS mensuelle
pendant la durée de la prise des médicaments anti-hépa-
tite C. Parallèlement, un test de grossesse est effectué pour les
femmes sous traitement. Un tel test est également conseillé
pour les partenaires féminines des hommes traités.
- Tous les trois mois. En complément aux examens mensuels,
trois autres mesures sont réalisées selon un rythme trimestriel.
Il s’agit de la créatinine pour surveiller le fonctionnement des
reins, du taux de TSH pour contrôler l’absence d’anomalie de
la thyroïde. Enfin, comme un des médicaments fréquemment
prescrits contre l’hépatite C est susceptible d’augmenter l’acide
urique, celle-ci doit être également mesurée.
- L’évaluation de l’efficacité du traitement. Celle-ci s’effectue
après trois mois de prise des médicaments lorsque l’hépatite
C chronique est due à un virus de génotype 1, 4, 5 ou 6. Elle
consiste à mesurer la charge virale. Si celle-ci a baissé de façon
significative par rapport à ce qu’elle était avant le traitement,
cela signifie qu’il y a de bonnes chances pour que le traitement
soit efficace. Dans ce cas, il est poursuivi jusqu’à son terme.
Dans le cas contraire, il est soit interrompu (pour éviter l’expo-
sition inutile à des risques d’effets indésirables) ou allégé (pour
ralentir la progression des lésions du foie). La décision entre
ces deux options est
prise en concertation
par le médecin et
son patient.
Lorsque l’hépatite C
chronique est due à
un virus de génotype
2 ou 3, les chances de
guérison sont plus
élevées et le trai-
tement est de plus
courte durée. L’éva-
luation de l’efficacité
thérapeutique à trois
mois n’est alors pas
systématique.
Quand sait-on de façon définitive si le
traitement a été efficace ?
“”
LA QUESTION DE… Christophe F., 37 ans
L’évaluation de l’efficacité est effectuée six mois après
l’arrêt du traitement, par la mesure de la charge virale.
Si, à cette date, il n’y a pas d’ARN viral détectable, les
médecins considèrent que c’est une réponse virologique
prolongée qui correspond à une guérison. Une nouvelle
mesure de la charge virale peut être proposée 12 à 24
mois après l’arrêt des médicaments à titre de contrôle.
1
/
2
100%