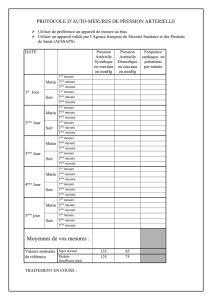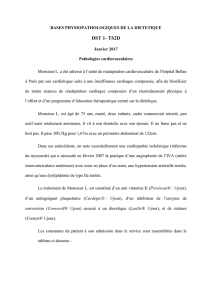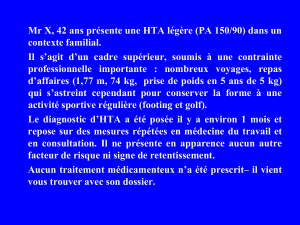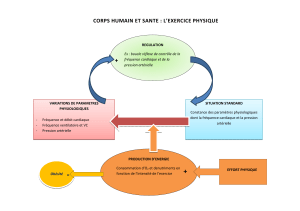R e v u e d e ... Valeur pronostique de la MAPA

294
Act. Méd. Int. - Hypertension (12), n° 1, janvier 2000
Revue de presse
Valeur pronostique de la MAPA
Depuis son introduction voilà trente ans,
peu d’études se sont intéressées à la
valeur pronostique de la mesure ambula-
toire de la pression artérielle. Six cent
quatre-vingt-huit patients londoniens,
hypertendus, âgés en moyenne de 51 ans,
ont été suivis sur 9 ans après la réalisation
d’un monitoring intra-artériel de la pres-
sion artérielle sur 24 heures, en ambula-
toire. Les deux intérêts particuliers de
cette étude sont la longueur du suivi et
l’utilisation d’une technique de mesure
invasive, intra-artérielle, permettant
d’évaluer la pression artérielle comme
une variable continue. Cent cinquante-
sept événements cardiovasculaires sont
survenus au cours du suivi. La valeur pro-
nostique des pressions moyennes ambula-
toires systoliques, diastoliques et pulsées
est nettement supérieure aux mêmes
variables lorsqu’elles sont mesurées en
consultation. Le meilleur modèle statis-
tique prédictif d’événement cardiovascu-
laire prend en compte la pression ambu-
latoire systolique (de même que l’âge, le
sexe et les autres facteurs de risque car-
diaque). La première conclusion de cette
étude est donc que la mesure ambulatoire
intra-artérielle de la pression artérielle est
un meilleur marqueur du risque cardio-
vasculaire que la pression artérielle mesu-
rée en consultation. Plus intéressantes
sont les relations retrouvées entre les
moyennes sur 24 heures des pressions
systoliques et diastoliques et la mortalité
extracardiaque, le taux d’accident vascu-
laire cérébral et d’événement coronarien.
Dans ce travail, la relation qui unit la
pression artérielle systolique “ambulatoi-
re” et la mortalité extracardiaque, le taux
d’accident vasculaire cérébral et d’événe-
ment coronarien est linéaire, soulignant
une fois de plus le rôle pronostique
majeur de la pression artérielle systo-
lique. La relation entre pression artérielle
diastolique “ambulatoire” et événement
coronarien et mortalité extracardiaque est
curvilinéaire. C’est-à-dire qu’il n’y a pas
de bénéfice à diminuer la pression arté-
rielle diastolique au-delà d’une valeur
seuil (ici 90 mmHg). En revanche, la rela-
tion entre pression diastolique et taux
d’accident vasculaire cérébral est à nou-
veau linéaire, suggérant un bénéfice pour
les pressions artérielles diastoliques les
plus basses en termes d’incidence des
accidents vasculaires cérébraux.
– R.S. Khattar et coll. Prediction of coronary
and cerebrovascular morbidity and mortality
by direct continuous ambulatory blood pres-
sure monitoring in essential hypertension.
Circulation 1999 ; 100 : 1071-6.
P.C.
Télévision et obésité de l’enfant
L’obésité est épidémique aux États-Unis.
Plus de 50 % de la population américaine
adulte est en surpoids (BMI > 25 kg/m2) et
22 % est obèse (BMI > 30 kg/m2). En par-
ticulier, des chiffres alarmants retrouvent
une augmentation de la prévalence de
l’obésité chez les enfants et les adoles-
cents. Il ne s’agit pas là d’une simple pré-
occupation esthétique, puisque 60 % de
ces enfants ont déjà un facteur de risque
cardiaque comme une dyslipidémie, une
hypertension artérielle ou une insulino-
résistance. Une fois installée, cette obési-
té est difficile à traiter, d’où la nécessité
d’insister sur les mesures préventives. Les
enfants américains passent plus de temps
à regarder la télévision ou à jouer à des
jeux vidéo qu’à autre chose, excepté dor-
mir. Dans la mesure où cette activité
consomme peu de calories mais permet
d’en absorber beaucoup, certains pédia-
tres américains ont supposé que réduire le
“temps d’exposition” pourrait être une
méthode préventive prometteuse. La plu-
part des études publiées sur le sujet n’ont
rien démontré. Deux écoles de San Jose
(Californie) ont été élues pour participer à
une étude randomisée. Les enfants de
l’une des deux écoles ont été soumis à un
programme d’enseignement destiné à
réduire le temps passé devant leur écran
de télévision ; les enfants de l’autre école
constituaient le groupe témoin. Deux cent
vingt-sept enfants d’âge moyen entre 8 et
9 ans ont ainsi été randomisés. Le contenu
dudit programme, assez mystérieux
consistait essentiellement en des cours
dispensés par les enseignants habituels et
destinés à transformer ces “télégobeurs”
en “spectateurs intelligents” capables de
contrôler eux-mêmes le temps passé
devant leur télévision. Aucune activité
alternative n’était proposée en remplace-
ment. L’objectif principal était la mesure
avant/après de l’indice de masse corpo-
relle (poids/taille au carré). Sept mois plus
tard, alors que le temps passé à regarder la
télévision et à manger devant avait
presque diminué de moitié (de 23 heures
par semaine à 14 heures) dans le groupe
expérimental, le BMI, l’épaisseur cutanée
tricipitale et le rapport taille/hanche
avaient augmenté significativement
moins dans ce même groupe comparé au
contrôle. L’effet sur la ration calorique
journalière et l’activité physique n’a pas
été très bien étudié dans cette étude. Ce
travail randomisé est le premier à retrou-
ver une diminution de l’adiposité secon-
daire à une diminution du temps passé a
regarder la télévision.
– T.N. Robinson. Reducing children’s televi-
sion viewing to prevent obesity. A randomized
controlled trial. JAMA 1999 ; 282 : 1561-7.
P.C.
Les recommandations britanniques
1999 pour la prise en charge de
l’hypertension
Malgré la publication de recommanda-
tions de l’OMS-ISH en 1999, les re-
commandations nationales continuent à
paraître. Le résumé de la British hyper-
tension society mérite une lecture, car
Patrice Colin, Xavier Girerd

295
un effort évident a été fait par les rédac-
teurs pour rendre ces recommandations
lisibles et applicables. En particulier, un
“résumé du résumé” indique en six
phrases les étapes les plus importantes
de la prise en charge :
– utilisation des mesures diététiques
chez tous les hypertendus ;
– débuter le traitement médicamenteux si
la pression artérielle est égale ou supé-
rieure à 160/100 mmHg ;
– dans l’hypertension de stade 1, débu-
ter un traitement si le risque coronarien
est supérieure à 15 % à 10 ans ;
– l’objectif tensionnel est inférieur à
140/85 mmHg ;
– en l’absence d’indication spécifique
un traitement doit être débuté par un
diurétiques thiazidique à faible dose ou
un bêtabloquant ;
– l’indication de l’aspirine et des statines
doit être discutée chez l’hypertendu.
Ces recommandations, qui sont issues
d’une analyse de la littérature compa-
rable à celle faite par les experts de
l’OMS-ISH, indiquent que les “preuves”
en médecine ne suffisent pas à standar-
diser les recommandations. Les nou-
velles recommandations françaises de
l’ANAES pour la prise en charge de
l’hypertension artérielle sont attendues
au premier semestre 2000. Elles confir-
meront peut-être une nouvelle fois cette
observation.
–Ramsay L.E. et coll. British hypertension
society guidelines for hypertension management
1999 : summary. BMJ 1999 ; 319 : 630-5.
X.G.
Traitement non chirurgical des
adénomes de Conn
Les hypertensions par hyperaldostéro-
nisme primaire (HAP) représentent
entre 0,05 et 2,2 % des étiologies des
hypertensions artérielles. Les adé-
nomes isolés surrénaliens, appelés adé-
nomes de Conn, sont à l’origine de
60 % des cas d’HAP, et une chirurgie
d’exérèse est classiquement réalisée
pour le traitement de cette anomalie.
Toutefois, chez certains patients, la chi-
rurgie n’est pas effectuée soit parce
qu’elle est estimée comme à risque du
fait du terrain du patient, soit parce
qu’elle est refusée par le patient. Dans
cette circonstance un traitement antihy-
pertenseur spécifique est prescrit
essentiellement fondé sur l’utilisation
de la spironolactone, des diurétiques et
des antagonistes calciques.
La Mayo clinique publie des données
sur le suivi de 24 patients hypertendus
porteurs d’un adénome de Conn libé-
rant de l’aldostérone. Ces sujets qui
n’ont pas été opérés ont été suivis au
minimum cinq années et en moyenne
huit ans après leur diagnostic. Le traite-
ment prescrit était un diurétique épar-
gneur du potassium (spironolactone ou
amiloride) en monothérapie chez 17 %
des patients, une bithérapie chez 54 %,
plus une trithérapie chez 29 %. Sous ces
traitements, la pression artérielle était en
moyenne de 129 ± 3/79 ± 2 mmHg et la
kaliémie de 4,3 ± 0,1 mmol/l. Les effets
secondaires observés étaient ceux de la
spironolactone et ceux de façon indé-
pendante de la dose prescrite, mais les
doses prescrites étaient élevées, entre
100 et 200 mg/jour. Au cours de la
période de suivi, aucune complication
cardiovasculaire n’a été observée. Des
dosages hormonaux et un bilan radiolo-
gique ont été effectués au cours du
suivi. Chez la grande majorité des
patients, la taille de l’adénome ne s’est
pas modifiée. Chez deux sujets une
augmentation de 0,5 cm a été observée,
chez trois sujets l’adénome, qui n’était
Cher confrère
J’ai lu avec attention et plaisir votre article “Mise au point”, dans la revue
Hypertension, consacré au cholestérol.
Je salue à la fois votre travail de recherche historique et votre vision de la préven-
tion secondaire quittant la pensée monolithique du monde médical.
Je suis effarée de constater que notre discours vis-à-vis de nos patients s’apparente
bien souvent à celui des intégristes religieux (que nous sommes prompts à dénon-
cer...) : sans nous rendre compte nous-mêmes que notre attitude, en particulier
dans la prévention secondaire cardiovasculaire, surtout touchant le problème du
cholestérol, est de nature intolérante et, sans nous affranchir des recommandations,
conclusions d’études publiées et financées par l’industrie pharmaceutique... qui
concerne toujours des populations ciblées, incluses sur des critères de volontariat,
dont les critères d’exclusion sont bien souvent ceux-la même que nous rencontrons
tous les jours dans notre pratique !
Merci de nous donner matière à réflexion.
Dr Anne-Yvonne Pasquier
Médecin de réadaptation,
responsable d’une unité de réadaptation cardiovasculaire,
centre de Kerpape 56 Ploemeur.
Courrier
des lecteurs

Revue de presse
Act. Méd. Int. - Hypertension (12), n° 1, janvier 2000 296
pas visible sur le premier scanner, était
mesurable sur le scanner de suivi. Le
profil hormonal de ces patients sous
spironolactone est une stimulation de
l’axe rénine-aldostérone avec une aug-
mentation de l’activité rénine plasma-
tique et de l’aldostérone.
La publication de cette série indique que
le traitement médical des adénomes de
Conn est possible et efficace avec les
inconvénients du traitement par la spiro-
nolactone lorsqu’elle est prescrite à forte
dose. Dans notre expérience, il est pos-
sible d’assurer un suivi tensionnel et bio-
logique satisfaisant des patients ayant un
HAP en prescrivant la spironolactone à
des doses inférieures à 75 mg/jour et en
y associant si besoin un diurétique thiazi-
dique et/ou un antagoniste calcique. Le
développement actuel de l’eplérenone, un
médicament antialdostérone sans effet
anti-androgène, devrait permettre d’avoir
une alternative thérapeutique à la spirono-
lactone pour le traitement des patients
avec une hypertension artérielle par HAP
ne pouvant pas bénéficier d’un traitement
chirurgical.
– Ghose R.P. et coll. Medical management of
aldosterone-producing adenomas. Ann.
Intern. Med. 1999 ; 131 105-108.
X.G.
Contrôle de l’hypertension artérielle
en consultation : faire mieux pour
la PAS
Évaluer la qualité des pratiques médi-
cales est un thème à la mode dans tous
les pays du monde. Pour l’hypertension
artérielle, estimer le nombre de patients
ayant en consultation une pression arté-
rielle < 140 mmHg pour la PAS et
<90mmHg pour la PAD est un moyen
grossier mais simple d’évaluation de la
qualité de la prise en charge des hyper-
tendus. Une enquête, réalisée dans un
réseau de soin de Californie, a étudié un
échantillon de 1 200 hypertendus suivis
au moins une année entre 1995 et 1996.
Le pourcentage de patients avec une
PAS < 140 et une PAD < 90 est de
30 %. Si seule la PAD < 90 mmHg est
prise en compte, il est noté un contrôle
chez 71 %, et si seule la PAS
<140 mmHg est considérée, le contrôle
est de 38 %. Ces pourcentages sont
comparables si l’on considère la
moyenne des chiffres tensionnels obte-
nue sur 50 % des consultations, sur
75 % des consultations, ou sur le chiffre
de la dernière consultation. Dans cette
population, 40 % des patients étaient
âgés de plus de 65 ans.
Ces données confirment donc qu’un
objectif tensionnel à 14/9 n’est pas atteint
chez plus de deux tiers des hypertendus
traités, mais que c’est sur le non-contrôle
de la PAS que se trouve la principale
explication de cet échec. L’amélioration
du contrôle tensionnel doit passer par une
information d’un objectif tensionnel à
140 pour la PAS et de l’utilisation de thé-
rapeutiques plus particulièrement actives
pour faire baisser la PAS.
– Alexander M. et coll. Evaluating hyperten-
sion control in a managed care setting. Arch.
Intern. Med. 1999 ; 159 : 2673-7.
X.G.
Altérations du système cardio-
vasculaire des “pseudo-normotendus”
Lorsqu’une MAPA ou une automesure
est réalisée chez un sujet et que les
chiffres de pression artérielle sont com-
parés (pour la période d’activité) à ceux
mesurés à la consultation, quatre situa-
tions peuvent se rencontrer :
- le sujet est normotendu pour les deux
méthodes de mesure ; il s’agit d’un
“vrai normotendu” ;
– le sujet est hypertendu pour les deux
méthodes de mesure ; il s’agit d’un
“vrai hypertendu” ;
– le sujet est hypertendu en consulta-
tion et normotendu en dehors de la
consultation ; il s’agit d’une “hyperten-
sion blouse blanche” ;
– le sujet est normotendu en consulta-
tion mais hypertendu en dehors de la
consultation ; il s’agit d’un “pseudo-
normotendu”.
Cette dernière situation n’est pas excep-
tionnelle car, dans une cohorte de 295
sujets normotendus en consultation, une
“pseudo-normotension” a été observée
chez 21 % des sujets en prenant comme
définition une pression artérielle < 140/
90 mmHg en consultation et > 134/
90 mmHgà la MAPA pour la période
d’activité. Chez ces sujets et chez des
“vrais hypertendus”, l’équipe du Pr Deve-
reux à New York a mesuré les paramètres
structuraux cardiaques et vasculaires sur la
carotide primitive. Les résultats indiquent
que les “pseudo-normotendus” sont plus
fréquemment les sujets plus âgés, de sexe
masculin. Le niveau des facteurs de risque
biologique (glycémie, cholestérol) était
plus proche de ceux des “vrais hyperten-
dus” que de celui des “vrais normotendus”.
Enfin, une augmentation des paramètres
de structure du cœur (masse VG) et de la
carotide primitive (épaisseur carotidienne
relative) était observée chez les “pseudo-
normotendus”, par comparaison avec les
“vrais normotendus”, et le niveau moyen
était comparable à celui observé chez les
“vrais hypertendus”.
Ce travail indique que chez près de 20 %
des sujets normotendus en consultation,
il existe les mêmes modifications du
système cardiovasculaire que celles
observées chez des hypertendus.
Comme c’est le niveau de la pression
artérielle évalué en dehors de la consul-
tation par MAPA qui semble associé à
ces modifications structurales, ce travail
pose l’importante question de savoir si,
pour détecter ces patients “pseudo-nor-
motendus”, il est justifié de proposer
une mesure tensionnelle en dehors du
cabinet médical (MAPA ou automesure)
ou une évaluation du retentissement car-
diaque ou vasculaire chez tous les
hommes normotendus de plus de 50 ans.
– Liu J.E. et coll. Cardiac and arterila target
organ damage in adults with elevated ambu-
latory and normal office blood pressure. Ann.
Intern. Med. 1999 ; 131 : 564-72. X.G.
1
/
3
100%