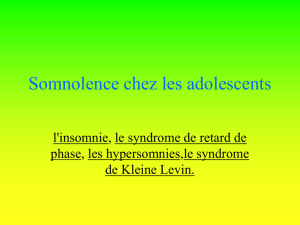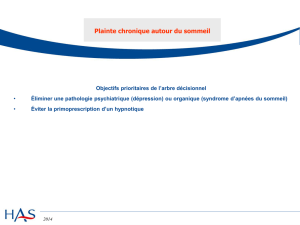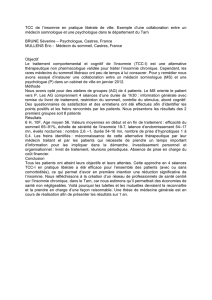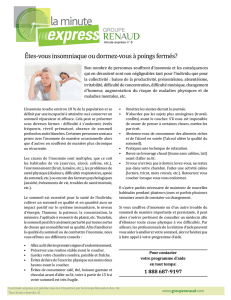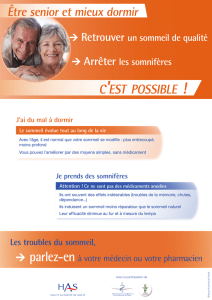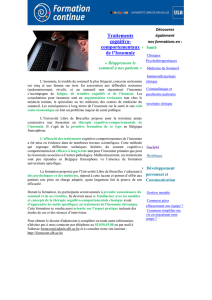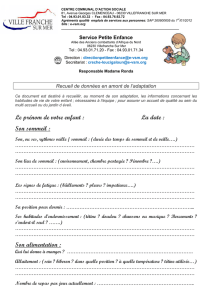Q
uelques statistiques de-
vraient alerter : les patients
insomniaques ont 2 à 3 f o i s
plus d’accidents de voiture que la
population générale et les patients
somnolents (syndrome d’apnées du
sommeil, narcolepsie, syndrome des
jambes sans repos...) en ont 3 à 7 fois
plus. Les insomniaques ont égale-
ment 40 fois plus de risques de
dépression que les bons dormeurs
sans toutefois déterminer si la dépres-
sion est conséquence ou cause de
l ’ i n s o m n i e . Quant au risque de sui-
cide, il est multiplié par 4.
Quels troubles ?
L’insomnie est certes le plus fréquent
des troubles du sommeil. Elle peut
être plus ou moins sévère, chronique
ou associée à un événement pertur-
bant (problème familial, de santé ou
professionnel). Elle est plus fréquente
chez la femme surtout à partir de la
p u b e r té et jusqu’à 65 ans. Elle sur-
vient souvent après 40 ans et aug-
mente avec l’âge. L’insomnie est pré-
sente dans de nombreuses maladies
comme les troubles cardiaques, les
douleurs, les maladies cancéreuses. Il
n’est pas simple pour le clinicien de
détecter ce qui se cache derrière ce
trouble du sommeil et le risque de
passer à côté d’une dépression n’est
pas négligeable.
Quelle insomnie ?
L’insomnie peut être transitoire ou
c h r o n i q u e . Elle est transitoire quand
elle dure 2 à 3 jours, voire moins de
3 semaines. Elle est, la plupart du
temps, situationnelle, c’est-à-dire due
à un simple changement d’environ-
nement (bruits, température trop éle-
vée), à la prise d’excitants centraux
(café) ou de toxiques (amphéta-
mines, anorexigènes, antidépres-
seurs, alcool) ou encore à des fac-
teurs psychiques, (stress, événement
inhabituel, difficultés professionnelles
ou familiales). Cependant, tout évé-
nement à forte composante émotion-
nelle (deuil, divorce) peut induire,
certes, une insomnie transitoire mais
peut être également le point de
d é p a r t d’une insomnie chronique.
L’arrêt brusque de certains hypno-
tiques, même après une seule prise,
produisant une insomnie de rebond.
Le danger réside alors en une théra-
peutique inappropriée qui peut ame-
ner la personne à une consommation
de médicaments dont le sevrage sera
difficile et qui peut causer plus de
troubles que l’insomnie initiale. Les
insomnies de longue durée ou in-
somnies chroniques durent, elles,
souvent plusieurs mois, voire plu-
sieurs années. Leur origine est soit
psychophysiologique, soit secondaire
à une pathologie psychiatrique ou
organique.
L’insomnie psychopathologi q u e
Dans la forme la plus classique, la per-
sonne s’endort assez bien, dort pen-
dant 3 ou 4 heures puis se réveille
sans raison apparente. Suit alors une
période d’insomnie ou un sommeil
léger entrecoupé d’éveils. Ces insom-
niaques peuvent s’endormir lorsqu’ils
ne le désirent pas (devant la télévi-
sion), alors qu’ils ne parviennent pas à
s’endormir quand ils le décident. Ces
patients se plaignent de fatigue, de
manque de concentration, parfois de
difficultés mnésiques mais rarement
de somnolence diurne excessive.
Professions Santé Infirmier Infirmière N° 56 • juin-juillet 2004
C e r taines études n’ont montré au-
cune différence entre ces insomnia-
ques et les bons dormeurs, appariés
par âge et par sexe, pour ce qui est de
la somnolence diurne (subjective ou
objective) ou des tests psychomo-
teurs (mesures d’attention, de vigi-
lance, d’apprentissage, de mémoire).
Souvent même, loin d’être plus som-
nolents que les bons dormeurs, ils
sont plus vigilants. Leur fatigue, accu-
mulée du fait de leur mauvais som-
meil, est compensée par un état
d ’ h y
per-éveil constant, contribuant cer-
tainement au malaise chronique, dont
se plaint l’insomniaque. Cette activa-
tion centrale excessive est liée à un
sommeil instable et de moins bonne
qualité. L’hyper-éveil des insomnia-
ques dans la journée, la brièveté de
leur endormissement, la similitude de
leur sommeil avec celui d’un bon dor-
meur qui aurait trop bu de café,
conduisent à penser que leur trouble
résulte plus d’une pression d’éveil
excessive que d’une déficience des
mécanismes hypnogènes. Mais, il faut
savoir que cette insomnie n’est sou-
vent que la partie visible d’une som-
me de problèmes cachés.
Affections psychiatriques
L’insomnie, secondaire à des affections
psychiatriques, est un symptôme fré-
quent. Ainsi, l’insomnie des états
dépressifs se caractérise notamment
par une augmentation du nombre
d’éveils intra-sommeil, qui conduit à
une fragmentation du sommeil. Dans la
dépression, la latence de la première
phase de sommeil paradoxal est sou-
vent inférieure à 40 minutes (60 à
120 minutes pour le sujet normal) ou
n’être que de quelques minutes seule-
ment. Le premier épisode de sommeil
paradoxal survient trop tôt et il est éga-
lement beaucoup plus long que chez le
sujet normal, avec la survenue de mou-
vements oculaires plus nombreux que
dans les phases ultérieures. Ce raccour-
Soins Libéra ux
3 8
Insomnie
Repérer les causes
Un Français sur cinq déclare ne pas être satisfait de la qualité ou de
la quantité de son sommeil. Les troubles du sommeil nécessitent une
prise en charge adaptée. Ils doivent faire l’objet d’investigations
sérieuses.
Focus
...
Classification
internationale
L'insuffisance du
sommeil est classée
parmi les troubles
extrinsèques du
sommeil. Elle est
définie comme “un
trouble qui se produit
chez un individu qui,
de façon persistante,
n'obtient pas un
temps de sommeil
suffisant pour
permettre un niveau
d'éveil normal le jour.
L'individu se livre à
une privation
chronique de
sommeil, volontaire
mais non
intentionnelle.”

cissement de la latence de la première
phase de sommeil paradoxal n’est
certes pas un signe pathognomonique,
mais peut être une indication précieuse
dans le cadre d’une dépression clini-
quement confirmée. Les antidépres-
seurs inhibent le sommeil paradoxal et
allongent sa latence de survenue.
Dans les états maniaques, les altéra-
tions du sommeil sont assez sem-
blables à celles observées dans la
dépression. Les malades, au cours d’un
épisode maniaque, ont une insomnie
massive et on a pu même observer
une brusque augmentation de l’insom-
nie dans les 2 ou 3 jours précédant la
survenue de l’accès maniaque.
Les schizophrènes présentent égale-
ment une insomnie très marquée,
supérieure même à celle des dépres-
sions graves. Leur sommeil est très
fragmenté et l’éveil intra-sommeil très
augmenté, le sommeil paradoxal res-
tant, par contre, relativement normal.
Atteinte du système nerveux
C h e z les patients souffrant d’insomnie
secondaire à une atteinte du système
nerveux, on note des altérations du
sommeil lent et du sommeil paradoxal.
Le sommeil lent est le plus gr a v e m e n t
p e rturbé, les différents stades de som-
meil perdant leurs caractéristiques
é l e c t r o e n c é p h a l o g raphiques propres.
Les fuseaux de sommeil sont ralentis
et peu nombreux. Les complexes K
sont atypiques. Les ondes lentes du
sommeil lent profond manquent d’am-
plitude. La durée totale du sommeil
peut être diminuée et il en existe tou-
jours une fragmentation, d’autant plus
i m p o rtante que l’atteinte organique est
plus grave, quelle qu’en soit son ori-
gine. La durée et l’organisation tempo-
relle du sommeil paradoxal au cours
de la nuit sont perturbées. Dans ces
formes organiques, on observe une
déficience des mécanismes hypno-
gènes physiologiques, part i c u l i è r e m e n t
marquée dans les cas de lésions de
l’hypothalamus et du tronc cérébral.
Mais des lésions corticales diffuses
peuvent également entraîner des
désorganisations importantes dans le
processus du sommeil.
La maladie d’Alzheimer s’accom-
pagne d’une insomnie majeure,
avec une latence de sommeil très
allongée et une diminution de son
index d’efficacité. Le sommeil lent
léger est très perturbé avec une
grande rareté, voire une absence
des fuseaux de sommeil et un
aspect pathologique des complexes
K de faible voltage. Le sommeil lent
profond est très diminué, surtout le
stade 4. Le sommeil paradoxal sur-
vient de façon anarchique en cours
épisodes, très fragmentés.
La maladie de Parkinson s’accom-
pagne également de troubles du
sommeil.
Il existe une maladie heureusement
très rare : l’insomnie fatale familiale,
qui se traduit par l’association d’une
insomnie rebelle (avec rêves et hal-
lucinations), de troubles végétatifs
(disparition des rythmes circadiens,
hyperactivité sympathique, troubles
sphinctériens), de difficultés mo-
trices et d’une démence (pouvant
être tardive). Les myoclonies sont
rares. La durée de la maladie varie
entre 6 et 32 mois. Les lésions
neuropathologiques sont limitées à
une atrophie sélective de cert a i n s
noyaux du thalamus, avec atteinte
dominante dans les noyaux dorso-
médian et antérieur du thalamus, la
spongiose est discrète et il n’y a pas
de plaques amyloïdes. Cette mala-
die est due à une mutation d’un
gène localisé sur le chromosome
20 et codant pour une protéine
impliquée dans les encéphalopa-
thies spongiformes, caractérisées
par une dégénérescence neuronale
plus ou moins localisée et pouvant
apparaître soit dans un contexte
familial soit dans un contexte infec-
tieux (maladie de Creutzfeld-
Jacob). L’EEG de veille est perturbé
mais non périodique. L’ E EG de
sommeil note une disparition pro-
gressive de l’activité delta, des
fuseaux de sommeil et des com-
plexes K. Il existe des phases anor-
males de sommeil paradoxal.
L’insomnie fatale familiale a été
décrite d’abord en Italie mais il
existe plusieurs familles qui en sont
atteintes en France.
Affections somatiques
Un grand nombre d’affections soma-
tiques peuvent provoquer une
insomnie dont le traitement et l’évo-
lution dépendent de la maladie cau-
sale. Quand un organisme est en
souffrance physiologique, l’éveil est
une réaction d’alert e . Or les hypno-
tiques suppriment cette réaction
d’éveil, d’où une certaine méfiance
quant à leur prescription.
Les douleurs chroniques sont parmi
les causes les plus fréquentes d’in-
s o m n i e .
Dans l’alcoolisme chronique, le som-
meil est fragmenté par de nombreux
éveils et comporte un sommeil para-
doxal très instable.
Le syndrome d’impatience des jambes
se traduit par une sensation désa-
gréable dans les membres inférieurs,
forçant le malade à bouger les jambes
et survenant uniquement au repos, en
p a r ticulier au lit. Cette sensation est
calmée par la marche, surtout sur une
s u r face froide. Les symptômes sont
plus marqués le soir et surviennent par
épisodes de plusieurs semaines, voire
de plusieurs mois. Ce trouble, retrouvé
c h e z 3 à 5 % des adultes, survient sur-
tout après la cinquantaine. Il peut
induire une insomnie sévère et une
difficulté à s’endormir. Le syndrome
d’impatience des jambes comme les
mouvements périodiques sont fré-
quemment rencontrés chez les
malades éthyliques chroniques com-
me chez les insuffisants rénaux, hépa-
tiques ou respiratoires.
La plupart des insomnies répondent
à un traitement associant une théra-
pie comportementale à la prise d’un
traitement hypnotique de soutien de
c o u r te durée. Dans tous les cas, il
faut faire comprendre au patient les
recommandations utiles à une bon-
ne hygiène du sommeil.
Andrée-Lucie Pissondes
Pour information : Site internet de la SFRS
(Société française de recherche sur le som-
meil) : www[email protected]
Professions Santé Infirmier Infirmière N° 56 • juin-juillet 2004
Soins Libéra ux
3 9
1
/
2
100%