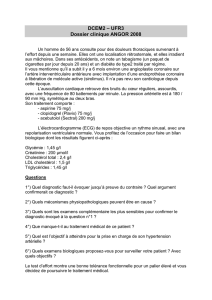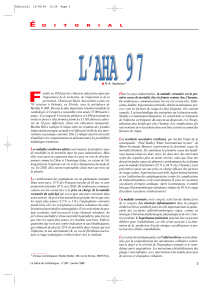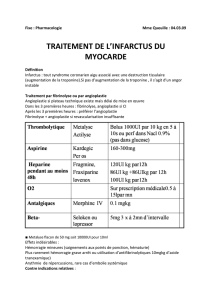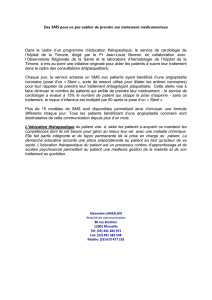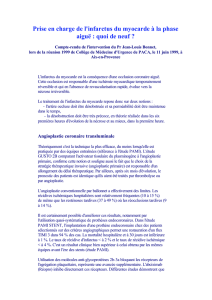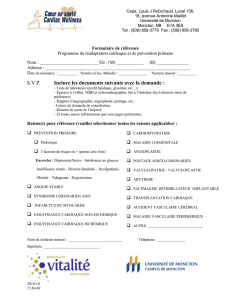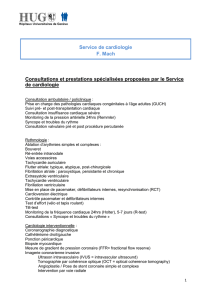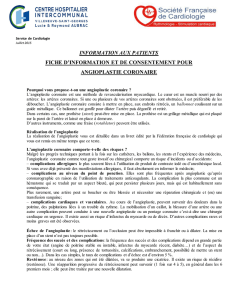Lire l'article complet

La Lettre du Cardiologue - n° 295 - mai 1998
12
INSUFFISANCE CORONAIRE
INFARCTUS AIGU DU MYOCARDE
Thrombolyse ou angioplastie ?
L’analyse des données à un an du sous-groupe angioplastie pri-
maire (n = 62) versus t-PA (n = 61) de l’étude GUSTO IIb, pré-
sentée par M. Masotti (Barcelone), montre une réduction signi-
ficative des événements cliniques et des paramètres
angiographiques dans le groupe angioplastie (tableau I).
Le suivi à long terme des patients traités par thrombolyse
(n = 307) ou angioplastie primaire dans les 24 premières heures
d’un infarctus du myocarde a été rapporté par M. Ishihara (Hiro-
shima). La survie post-hospitalière étudiée à 1, 3, 5 et 10 ans est
respectivement de 98 %, 93 %, 89 % et 79 % dans le groupe
angioplastie versus 97 %, 90 %, 84 %, et 63 % dans le groupe
thrombolyse. L’angioplastie apparaît comme un facteur indé-
pendamment corrélé à la survie à long terme (OR = 0,632,
p = 0,02).
Les données de l’étude PACT (n = 606), étudiant la compatibi-
lité de la thrombolyse (t-PA en double bolus de 50 mg) et l’an-
gioplastie dans l’infarctus du myocarde ont été présentées par
A.M. Ross (Washington). Les patients étaient randomisés en deux
groupes : thrombolyse ou APC primaire. Une coronarographie
était réalisée chez tous les patients à la phase aiguë (après le pre-
mier bolus de t-PA ou placebo), et une semaine plus tard. Les
patients du groupe t-PA avec un flux TIMI 0 à 2 bénéficiaient
d’une angioplastie de sauvetage. Les taux de succès s’avèrent
comparables entre l’angioplastie primaire et l’angioplastie de sau-
vetage en cas d’échec de la thrombolyse (95 % dans les deux
groupes avec flux TIMI 3 obtenu dans 79 et 77 % des cas res-
pectivement). Les principaux résultats de cette étude concernant
les événements hospitaliers à 30 jours et l’ischémie détectée par
l’épreuve d’effort à 6 semaines sont résumés dans le tableau II.
Insuffisance coronaire
Cardiologie interventionnelle
●
Dr F. Beygui*
■Le suivi à long terme des patients traités pour infarctus
aigu du myocarde par thrombolyse ou angioplastie primaire
plaide en faveur d’un meilleur pronostic chez les patients
traités par angioplastie.
■Les taux de récurrence ischémique et de nouvelle revas-
cularisation à 30 jours sont réduits par l’implantation d’en-
doprothèses à la phase aiguë de l’infarctus du myocarde par
rapport au ballon seul (étude randomisée PAMI-Stent). Ces
résultats se maintiennent à 6 mois selon d’autres études.
■Dans l’angioplastie coronaire élective, un résultat “stent-
like” rigoureux obtenu avec le ballon seul est équivalent au
stenting en termes d’événements à un an.
■
Le type de resténose intrastent est un facteur de risque de
récidive de resténose à un an (par ordre croissant de gravité :
sténose focale, diffuse, proliférative et occlusion complète).
■L’irradiation intracoronaire est faisable et efficace en tant
que traitement préventif de la resténose intrastent. De larges
séries de patients devraient être incluses dans des études cli-
niques pour évaluer l’efficacité et la tolérance de cette nou-
velle technique.
POINTS FORTS
POINTS FORTS
* Clinique cardiologique (Pr Vacheron), Hôpital Necker, 149, rue de Sèvres,
75015 Paris.
t-PA Angioplastie p
Décès 8 8 ns
Réinfarctus 3 1 ns
Revascularisation 18 7 0,01
Total événements 26 (43 %) 15 (24 %) 0,03
% de sténose 82 ± 34 33 ± 31 0,001
Flux TIMI 3 (%) 47,5 88 0,001
Fraction d’éjection (%) 52 ± 13 59 ± 12 0,03
Tableau I. Résultats à un an du sous-groupe angioplastie primaire ver-
sus thrombolyse de l’étude GUSTO IIb.
Chapitre II - Insuf. coronaire 4/05/04 12:39 Page 12

La Lettre du Cardiologue - n° 295 - mai 1998
13
ANGIOPLASTIE CONVENTIONNELLE OU IMPLANTATION
D’ENDOPROTHÈSE ?
Les résultats à 30 jours de l’étude randomisée multicentrique
PAMI-Stent (n = 900), comparant l’angioplastie primaire au
ballon seul et l’implantation d’endoprothèses héparinées de Pal-
maz-Schatz, à la phase aiguë de l’infarctus du myocarde, ont été
présentés par C.I. Grines (Royal Oak). Le taux de “cross-over”
du groupe ballon vers le groupe stent était de 15,1 %. Par ailleurs,
1,3 % des patients du groupe stent n’ont pas eu d’endoprothèse
par décision de l’opérateur. Dans 1,3 % des cas, l’implantation
de l’endoprothèse s’est soldée par un échec. Dans les suites de la
procédure, les patients du groupe angioplastie recevaient de l’hé-
parine intraveineuse pendant 48 heures alors que l’héparine était
déconseillée dans le groupe stent.
Les principaux résultats de cette étude, résumés dans le tableau III,
montrent des taux de succès très élevés et de complications très
faibles dans les deux groupes, sans différence statistiquement
significative. Seules la récurrence ischémique et la nécessité d’une
revascularisation étaient significativement diminuées dans le
groupe stent. Il est à noter que le principal critère de jugement (le
taux d’événements à 6 mois) n’est pas encore connu.
Ces résultats sont confirmés par l’étude randomisée GRAMI,
comparant l’implantation d’endoprothèses GR II à l’angioplas-
tie au ballon seul à la phase aiguë de l’infarctus du myocarde.
Cette étude, présentée par A.E. Rodriguez (Buenos Aires), montre
une réduction significative des événements pendant la phase hos-
pitalière et à un an dans le groupe de patients traités par endo-
prothèses.
La comparaison des données cliniques entre l’angioplastie au
ballon seul avec des résultats “stent-like” (sténose résiduelle
≤30 %) et l’implantation d’une endoprothèse à la phase aiguë
de l’infarctus du myocarde, rapportée par G. Eid-Lidt (Mexico
City), ne montre pas de différence significative concernant les
complications à la phase hospitalière entre les deux groupes. En
revanche, à 6 mois, les récidives ischémiques (angor ou isché-
mie silencieuse) étaient plus fréquentes dans le groupe ballon seul
(43,1 % versus 18 %, p = 0,006), de même que les nouvelles
angioplasties (5,8 % versus 0 %, p = 0,08). Le décès d’origine
cardiaque, de 3,5 % et 3,9 % durant l’hospitalisation pour les
groupes “stent-like” et stent respectivement, était de 0 % à 6 mois
dans les deux groupes.
L’intérêt de l’implantation d’endoprothèses coronaires à la
phase aiguë de l’infarctus chez les patients en choc cardiogé-
nique a été présenté par Y. Nakawaga (Kitayushu). Cette étude
rétrospective (n = 2 099) montre une réduction plus importante
des échecs de reperfusion, de la réocclusion et de la mortalité pré-
coce par le stenting chez les patients en choc cardiogénique, par
rapport à ceux hémodynamiquement stables. Les taux de succès
de l’implantation d’endoprothèses étaient comparables entre les
deux groupes (100 % versus 98 %).
ENDOPROTHÈSES
Angioplastie coronaire élective : stents ou résultats “stent-
like” ?
D’après le travail présenté par R. Siegel (Phoenix), sur 608 patients
traités par angioplastie conventionnelle (n = 465) ou par endo-
prothèse (n = 143) pour resténose, avec des taux de succès immé-
diat comparables (95,5 % et 97,9 % pour l’angioplastie et le sten-
ting, respectivement), les résultats tardifs plaident en faveur du
stenting, avec des taux de survie sans événement de 90,9 % ver-
sus 82,6 % (p = 0,04). Ces résultats s’expliquent essentiellement
par un taux de nouvelle angioplastie significativement plus faible
dans le groupe de patients traités par stent (5,6 % versus 8,4 %,
p = 0,03). Cependant, cette étude n’était pas randomisée et les
deux groupes étaient très hétérogènes.
Dans un autre travail, présenté par S.J. Melby (Rochester) et
comportant
trois groupes de patients appariés (n = 44 dans chaque
groupe) traités par stent (groupe 1) ou par angioplastie conven-
tionnelle avec des sténoses résiduelles de moins de 20 %
Tableau II. Résultats de l’étude PACT (aucune différence significative).
Angioplastie primaire Thrombolyse
Transfusions 13 % 13 %
AVC 0,7 % 0,7 %
Revascularisation
en urgence 7,4 % 7,4 %
Décès hospitaliers < 4 % < 4 %
Décès à 30 jours < 4 % < 4 %
Récurrence ischémique 13,5 % 18,5 %
Pontage en urgence 4,7 % 2 %
Épreuve d’effort positive
à 6 semaines 10,4 % 9,3 %
Stent Angioplastie p
(n = 452) (n = 448)
Résultats immédiats
Succès angiographique (%) 99,8 99,1 ns
TIMI 3 (%) 96,4 92,3 ns
MLD post-procédure (mm) 2,55 2,11 0,001
Sténose résiduelle (%) 4,4 15,5 0,0001
Résultats hospitaliers
Décès (%) 3,1 1,8 ns
Réinfarctus (%) 0,2 0,7 ns
Thrombose subaiguë (%) 0,7 2,0 ns
Réélévation des CPK (%) 0,2 0,9 ns
Récidive ischémique (%) 2,9 4,7 ns
Revascularisation (%) 0,6 2,5 0,006
Total événements (%) 3,5 4,9 ns
Hémorragies sévères (%) 5,1 3,8 ns
Résultats à un mois
Décès (%) 3,5 1,8 ns
Réinfarctus (%) 0,4 1,1 ns
Revascularisation (%) 0,9 3,5 0,006
Total événements (%) 4,2 5,4 ns
Tableau III. Résultats hospitaliers et à un mois de l’étude PAMI-Stent.
Chapitre II - Insuf. coronaire 4/05/04 12:39 Page 13

La Lettre du Cardiologue - n° 295 - mai 1998
14
INSUFFISANCE CORONAIRE
(groupe 2) ou de 20 à 30 % (groupe 3), les résultats à un an mon-
trent moins de décès, d’infarctus, d’angor et de revascularisation
dans les groupes 1 et 2 comparés au groupe 3. Il découle de ce
travail qu’un résultat stent-like rigoureux est équivalent au
stenting. Cependant, une limite assez importante de cette étude
est l’analyse visuelle des résultats sans angiographie quantitative.
Implantation d’endoprothèses : cas particuliers
Les résultats de l’étude randomisée multicentrique canadienne
TOSCA comparant l’angioplastie au ballon seul et l’implanta-
tion d’endoprothèses Palmaz-Schatz héparinées chez 410 patients
avec une occlusion coronaire “chronique” (TIMI 0 ou 1, de plus
de 72 heures, durée moyenne d’occlusion : 10 semaines) ont été
présentés par V. Dzavik (Vancouver). Cette étude montre la supé-
riorité de l’endoprothèse au ballon seul avec un taux de flux
TIMI 3, à 6 mois, de 89,1 % vs 80,5 % (p = 0,024) et une dimi-
nution du risque de réocclusion de 44 % par le stenting. Cepen-
dant, les taux de resténose angiographique restent très importants
dans les deux groupes (56 % versus 70 %). Les taux de “cross-
over” ballon vers stent et stent vers ballon étaient de 10 et 4 %
respectivement. Le nombre de stents utilisés par artère était supé-
rieur ou égal à 3 dans 25 % des cas.
Les résultats à court et long terme (3 ans) de l’implantation de
stents sur les greffons mammaires internes chez 28 patients
ont été comparés à ceux de l’angioplastie conventionnelle chez
117 patients par M. Tebeica (Washington). Malgré un excellent
taux de succès angiographique (96,4 % versus 82 %), les résul-
tats tardifs ne sont pas très encourageants, avec notamment un
taux de mortalité élevé (9,5 % versus 3,9 %) que les auteurs expli-
quent par une maladie coronaire très sévère chez les deux patients
décédés et la nécessité d’un pontage aorto-coronaire chez l’un
d’entre eux.
Les résultats de l’angioplastie avec implantation d’endoprothèse
du tronc commun coronaire gauche non protégé, présentés par
R. Cortina (Toulouse), incitent à la prudence dans cette indi-
cation du stenting. En effet, malgré un taux de succès angiogra-
phique élevé (100 %) chez les 67 patients traités, les taux de mor-
talité hospitalière et à 6 mois sont importants (5,9 % et 9,5 %
respectivement). Une analyse plus détaillée montre un taux de
mortalité globale très élevé chez les patients à haut risque chi-
rurgical (20,5 %) et plus acceptable chez les patients à faible
risque (7 %).
Les facteurs prédictifs de mortalité ou de complication après
angioplastie coronaire
L’analyse de 58 714 procédures interventionnelles coronaires réa-
lisées aux États-Unis (National Cardiovascular Network Data-
base) dans 19 centres et sur trois ans a permis de distinguer 11 fac-
teurs de risque pré-procédure indépendants. Ces facteurs,
présentés par E.D. Paterson, sont rapportés dans le tableau IV.
Un antécédent de revascularisation coronaire semble être un fac-
teur de bon pronostic (OR = 0,6).
Dans le même domaine, D.R. Holmes (Rochester) a présenté le
suivi à long terme de 1 709 patients consécutifs traités par endo-
prothèse coronaire. Le taux de survie à 8 ans était très bon
(90 %), mais moins bon lorsqu’on s’intéressait à la survie sans
événement (50 %), l’événement étant défini par un décès, un pon-
tage, une nouvelle angioplastie ou un infarctus du myocarde. Les
facteurs de risque pré-procédure de survenue d’un événement
étaient un antécédent de pontage aorto-coronaire, l’insuffisance
cardiaque, l’atteinte multitronculaire, le diabète et l’atteinte de
l’interventriculaire antérieure.
Les facteurs associés à un échec d’implantation d’endopro-
thèse, étudiés sur 3 815 procédures dont 1,8 % d’échec, présen-
tés par H. Schühlen (Munich), sont la petite taille de l’artère, la
sévérité de la sténose, la longueur de la sténose et l’expérience
de l’opérateur.
Les facteurs de risque de thrombose d’endoprothèse au cours du
premier mois, étudiés sur 2 833 procédures et rapportés par
A. Schömig (Munich), sont la persistance d’une dissection non
recouverte (OR = 10,2), un chevauchement d’endoprothèses
(OR = 1,9) et, évidemment, l’absence de traitement par la ticlo-
pidine (OR = 5,2).
Resténose intrastent
La resténose intrastent a probablement été le thème dominant de
la cardiologie interventionnelle du congrès de l’ACC 1998.
R. Mehran (Washington) a présenté un travail sur le suivi à un an
de 152 patients traités (166 lésions) pour resténose intrastent clas-
sés en quatre groupes (tableau V). Les taux de récidive de resté-
nose intrastent sont significativement associés au type de
resténose (OR = 7,7) et aux antécédents de resténose intra-
stent (OR = 11,9), quelle que soit la méthode interventionnelle
utilisée dans le traitement de ces lésions. Ces résultats ont été
confirmés par d’autres études.
Les facteurs de risque de resténose intrastent, analysés par
M. Haude (Essen) chez 130 patients traités par 166 stents de Pal-
maz-Schatz, implantés à faible pression d’inflation (inférieure à
Facteur de risque Odds-ratio Facteur de risque Odds-ratio
Choc cardiogénique 12,5
Diabète 1,3
Angioplastie primaire 2,7 Atteinte multitronculaire 1,3
Maladies rénales 2,3 IVA proximale 1,3
Âge 1,6 Hospitalisation pour IDM 1,3
Contrepulsion intra-aortique 1,6 Surface corporelle faible 1,2
Fraction d’éjection VG 1,5
Tableau IV. Facteurs de risque de mortalité avant angioplastie coronaire.
Type Définition Taux de
de resténose revascularisation
Focal < 10 mm 19 %
Diffus > 10 mm, ne dépassant pas la longueur du stent 35 %
Prolifératif > 10 mm, dépassant la longueur du stent 50 %
Occlusion totale 83 %
Tableau V. Nouvelle revascularisation pour récidive de resténose
intrastent.
Chapitre II - Insuf. coronaire 4/05/04 12:39 Page 14

15
16 Atm), sont le “multistenting”, un diamètre de référence de
moins de 2,75 mm, une sténose longue (supérieure à 10 mm) et
une sténose résiduelle supérieure à 10 %.
Dans le groupe de patients traités par le même type de stent
(n = 150, 249 stents) implantés à forte pression d’inflation, les
seuls facteurs associés à la resténose sont le diamètre de réfé-
rence inférieur à 2,75 mm et la sténose résiduelle supérieure à
10 %.
Plusieurs travaux comparant les stents de nouvelle génération au
stent de référence, le Palmaz-Schatz, montrent que les taux de
succès et de resténose sont vraisemblablement indépendants
du type de stent implanté.
L’évolution naturelle de la resténose intrastent asymptoma-
tique chez 122 patients consécutifs, avec suivi angiographique à
6 mois et à un an (50 % des patients), rapportée par N. Nibler
(Munich), montre une réduction “spontanée” et significative de
la sévérité de la sténose entre 6 et 12 mois, une survie sans évé-
nement à un an de 98,4 %, et un taux de nouvelle revascularisa-
tion à un an de 5 %. Il est à noter qu’aucune des lésions ne dépas-
sait un pourcentage de sténose en diamètre de 75 %.
De nombreuses techniques interventionnelles ont été étudiées
dans le traitement de la resténose intrastent.
❏La technique la plus largement présentée, bien que toujours
assez expérimentale, était l’irradiation intracoronaire, par
rayons bêta ou gamma. De ces nombreuses présentations portant
sur des études randomisées ou non, sur la resténose intrastent ou
après ballon seul, délivrés par sonde, stents radioactifs ou ballons
remplis de produit radioactif, on peut retenir quelques faits. Les
rayons bêta sont plus maniables que les rayons gamma car moins
pénétrants (2 mm), mais parfois insuffisants pour atteindre les
couches profondes de la média. Quel que soit le type de rayon-
nement utilisé, l’irradiation inhibe l’hyperplasie intimale et pro-
bablement la constriction adventitielle. Les études présentées,
avec de faibles effectifs, montrent toutes une faisabilité accep-
table et des taux de resténose réduits. La complication la plus fré-
quente de l’irradiation intracoronaire semble être la survenue
d’anévrismes coronaires.
❏L’athérectomie rotationnelle suivie d’une angioplastie au bal-
lon seul à faible pression semble assez intéressante dans le trai-
tement de la resténose intrastent diffuse, d’après les résultats pré-
sentés par H.J. Büttner (Bad Korzingen). Cette technique assurait
un succès immédiat de 100 %, un taux de resténose angiogra-
phique à 6 mois de 56 % et un taux de nouvelle revascularisation
de 33 %. La supériorité de cette technique par rapport au ballon
seul a été aussi démontrée dans l’étude randomisée ROSTER,
présentée par S.K. Sharma (New York).
❏Enfin, l’intérêt de l’angioplastie laser dans le traitement de la
resténose intrastent reste discuté, avec des taux de nouvelle resté-
nose de 26 à 68 % selon les études.
Faux négatifs graves
de la scintigraphie myocardique
Signer un compte-rendu rassurant
devant une scintigraphie myocardique
normale, alors que le patient est porteur
d’une lésion sévère (sténose du tronc
commun, de l’IVA proximale ou
lésions tritronculaires), est la hantise
des cardiologues nucléaires.
Un travail présenté par J.A. Diamond
(Mount Sinai Center, New York)
devrait les rassurer, au moins en
partie : en 5 ans et sur plus de
9 000 épreuves, cette éventualité ne
s’est présentée que 8 fois et,
dans 7 cas,
il y avait une discordance manifeste
entre l’apparente normalité de
la scintigraphie et les signes de gravité
observés durant l’épreuve d’effort
(fixation pulmonaire du traceur accrue,
dilatation cavitaire transitoire, baisse
tensionnelle à l’effort, etc.).
P. P.
Valeur localisatrice
de la scintigraphie myocardique
À partir de l’étude par tomoscintigraphie
myocardique de 100 patients
monotronculaires sans infarctus,
l’équipe de Germano et Berman
(Los Angeles) nous livre une cartogra-
phie
réactualisée des segments
les plus fréquemment hypofixants,
selon l’artère lésée. Ce travail confirme
que si l’atteinte d’une IVA peut être
aisément identifiée, il existe une
superposition importante des territoires
de la coronaire droite et de
la circonflexe, selon la distribution
coronaire. Ainsi, les trois segments
purement inférieurs sont hypofixants
dans 66 à 83 % des sténoses
de la coronaire droite, mais aussi
dans 42 à 54 % des sténoses
de la circonflexe.
P. P.
Traitement
des cardiopathies congénitales
Au nom des équipes de Necker et de
Laennec, D. Bonnet a présenté les
premiers résultats obtenus avec un
matériau absorbable (polydioxanone)
permettant de réaliser un cerclage
temporaire de l’artère pulmonaire.
Ce procédé a été utilisé chez 9 nouveau-
nés porteurs d’une coarctation aortique
associée à une CIV responsable d’une
HTAP sévère. Le cerclage était fait
dans le même temps et par la même
voie d’abord que la cure de la coarcta-
tion, en moyenne à 3 semaines de vie.
Le cerclage s’est résorbé totalement en
3 à 5,5 mois, un délai suffisant pour
que 8/9 des CIV s’occluent totalement
(2) ou partiellement (6). À condition de
le réserver à des CIV susceptibles, par
leur taille et leur localisation, d’une
réduction au moins partielle,
ce procédé apparaît particulièrement
séduisant, évitant une réintervention
pour démontage d’un “banding”
devenu inutile.
P. P.
Nouvelles brèves
Chapitre II - Insuf. coronaire 4/05/04 12:39 Page 15

La Lettre du Cardiologue - n° 295 - mai 1998
16
INSUFFISANCE CORONAIRE
LES INHIBITEURS DE LA GPIIb/IIIa
Les nouveaux agents antiplaquettaires ont fait l’objet de très nom-
breuses études à l’origine de présentations encore plus nom-
breuses. Quelques résultats de certaines de ces études sont résu-
més dans les tableaux VI et VII.
L’abciximab
L’étude randomisée comparant l’abciximab au placebo (étude
RAPPORT) dans l’angioplastie primaire pour infarctus du
myocarde, présentée par S.J. Brener (Cleveland), montre une
diminution des taux à 30 jours de réinfarctus (2,3 % versus 4,7 %,
p = 0,02), de revascularisation de l’artère responsable de l’in-
farctus (1,8 % versus 7,9 %, p = 0,003) et du critère combiné
décès/infarctus/revascularisation (4,6 % versus 12 %, p = 0,03),
indépendamment des résultats angiographiques initiaux. L’im-
plantation d’endoprothèses dans cette étude était déconseillée et
le taux de stenting était de 11,9 % dans le groupe abciximab et
de 20,4 % dans le groupe placebo (figures 1 et 2, voir page 18).
L’étude rétrospective d’une cohorte de 292 patients de la Mayo
Clinic, traités par angioplastie primaire pour infarctus aigu du
myocarde, montre des taux de complications hospitalières plus
bas chez les patients recevant de l’abciximab avant l’angioplas-
tie (n = 52) comparés à ceux n’en recevant pas (n = 240). La dif-
férence entre ces taux n’était pas statistiquement significative. En
revanche, à un an, les taux de mortalité (5,8 % versus 17,1 %) et
du critère combiné décès/réinfarctus/pontage (5,8 % versus
28,8 %) étaient significativement (p < 0,05) plus bas dans le
groupe abciximab.
Les facteurs prédictifs indépendants de la reperfusion coronaire
par l’abciximab à la phase aiguë de l’infarctus du myocarde,
rapportés chez 24 patients par N.A. Mahdi (Boston), sont le délai
court (< 4 heures) séparant le début de la douleur et l’adminis-
tration du produit et l’absence de tabagisme.
L’analyse des 529 patients traités par implantation d’endopro-
thèse, sur les 5 364 patients inclus dans les études EPIC, EPI-
LOG et CAPTURE, comparant l’abciximab au placebo dans
l’angioplastie coronaire, montre une complémentarité de l’ab-
ciximab et du stenting non programmé. En effet, l’analyse pré-
sentée par D.Kereiakes (Cincinnati) révèle une réduction signi-
ficative de tous les événements étudiés (décès, intervention en
urgence, revascularisation et critères combinés) à 30 jours.
Cette
réduction se maintient à 6 mois en ce qui concerne l’intervention
en urgence et les critères combinés. Ce travail est cependant limité
par l’hétérogénéité des traitements en post-procédure (antivita-
mines K dans 40 % des cas, association ticlopidine-aspirine dans
60 % des cas, association des trois dans 12 % des cas) et par l’in-
dication de l’endoprothèse, qui était non programmée et rendue
nécessaire par une complication ou un résultat incomplet.
L’utilisation de l’abciximab dans les situations de “bail-out”
pendant l’angioplastie coronaire – indication hors AMM mais
probablement la plus fréquente – chez 37 patients comparée à son
utilisation prophylactique chez 58 patients montre des taux de
succès (100 % dans les deux groupes) et de complications car-
diaques hospitalières (5,4 % versus 3,4 %) comparables entre les
deux groupes. Les taux de mortalité étaient de 0 % à 30 jours et
de 2,7 % (un patient) à un an chez les patients traités pour “bail-
Traitements antithrombotiques
■L’abciximab associé à l’angioplastie primaire sans
implantation d’endoprothèse à la phase aiguë de l’infarctus
du myocarde diminue, en comparaison au placebo, les taux
de réinfarctus et de nouvelle revascularisation à 30 jours
(étude randomisée RAPPORT).
■L’analyse des sous-groupes de patients traités par endo-
prothèses dans les études EPIC, EPILOGUE et CAPTURE
montre une complémentarité entre l’abciximab et le sten-
ting, avec diminution des événements à 30 jours et à 6 mois.
■L’administration de l’abciximab, chez les patients déjà
traités par ce produit, n’augmente pas les risques de throm-
bopénie, même en présence d’anticorps antichimériques.
■Le rapport coût-efficacité de l’abciximab en complément
du stenting reste discutable. Avec le coût actuel, le produit
n’est “rentable” que chez les patients à haut risque.
■Un traitement de plus de 3 jours par ticlopidine, précé-
dant l’implantation d’endoprothèses, diminue le taux d’in-
farctus sans onde Q après la procédure.
■L’arrêt précoce de la ticlopidine 15 jours après l’implan-
tation d’une endoprothèse pourrait diminuer les risques de
neutropénie sans augmenter les risques de thrombose sub-
aiguë de stent.
POINTS FORTS
POINTS FORTS
Chapitre II - Insuf. coronaire 4/05/04 12:39 Page 16
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%