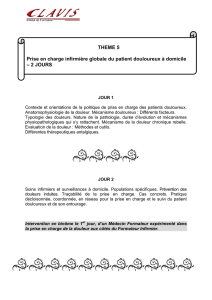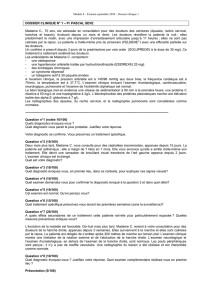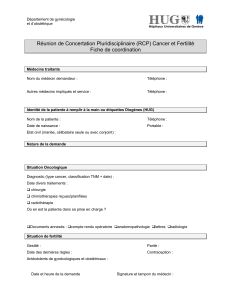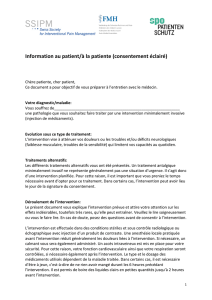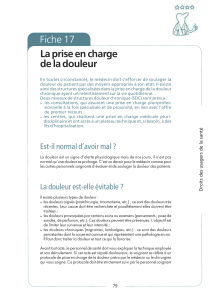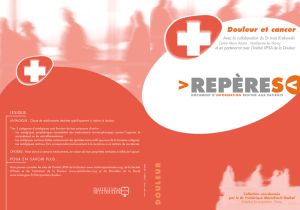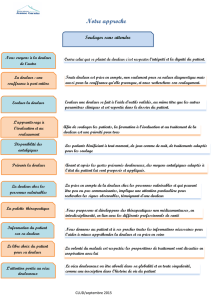GYNÉCOLOGIE ET SOCIÉTÉ
10
La Lettre du Gynécologue - n° 255 - octobre 2000
ifférentes théories ont été mises en avant pour
expliquer les pelvialgies chroniques, théories qui
vont être privilégiées par tel ou tel clinicien ou
chercheur en fonction de sa formation et de sa place. Le gyné-
cologue aura une autre “grille de lecture” que le psychiatre ou
le psychothérapeute, et le biologiste se distinguera de l’étho-
logue ou de l’anthropologue... Toutes ces théories apportent
leur contribution à l’édifice de compréhension. Elles sont donc
toutes utiles, mais il ne nous faut pas perdre de vue que le but
premier du clinicien est de ne pas oublier la femme qui est
“derrière” la douleur.
Quelle écoute pour la douleur ?
Le médecin est en général partagé entre la recherche rigou-
reuse de la moindre lésion microscopique qui aurait pu passer
inaperçue jusqu’alors et la tentation de qualifier de psychogène
la douleur de cette femme. Il est logique et légitime que,
devant une pelvialgie chronique, le praticien recherche, dans
l’arbre diagnostique, une infection génitale chronique, une
dystrophie ovarienne ou des kystes de l’ovaire, une endomé-
triose, des varices pelviennes, un cancer génital infecté ou à un
stade avancé. Dans la zone pelvienne, il peut y avoir aussi des
lésions d’organes non gynécologiques (douleurs vésicales,
digestives ou rhumatologiques). Quand le médecin se place du
côté du chercheur biologique, il ne peut étudier que l’objecti-
vité du phénomène, en ignorant la subjectivité et l’état de
conscience qui en résulte.
LA FEMME ET SES DOULEURS
La sphère gynécologique a une tonalité affective et émotion-
nelle qui dépasse largement les causes médicales. Cette zone
est chargée de mystère et de fantasmes. C’est le lieu des rap-
ports sexuels, de la conception, du développement du fœtus.
L’utérus a, dans l’esprit des femmes, une place sans commune
mesure avec sa taille réelle, et chacun sait par ailleurs que
l’angoisse peut avoir des effets douloureux sur le corps. De
fait, il y a des sens qui nous échappent. Même s’il est logique
et légitime que, devant une plainte douloureuse de la sphère
gynécologique, le praticien recherche dans l’arbre diagnos-
tique l’étiologie de cette douleur, il ne faut pas oublier la tona-
lité affective et émotionnelle.
Très schématiquement, ce qui semble prédisposer à la douleur
génitale chronique, c’est la concordance dans le temps entre
une lésion initiale et une tension émotionnelle due à un autre
événement (rupture sentimentale, deuil...) ; de ce fait, la
patiente peut intimement lier ces deux événements. À chaque
tension inexprimable, cet organe (devenu cible) risque de se
manifester à nouveau par des douleurs.
Toute douleur chronique a deux composantes : l’une, objec-
tive, qui correspond à l’étiologie médicale, et l’autre, affective.
Quand elle touche la zone génitale, la part relationnelle de
l’algie est souvent au premier plan. L’agressivité vis-à-vis du
partenaire, le refus, voire la culpabilité vis-à-vis du plaisir
sexuel sont fréquemment les premières causes immédiates,
“superficielles” de ces douleurs. Même si l’angoisse n’a pas
participé à l’installation de la douleur, il est évident qu’elle est
un des facteurs importants du maintien de sa chronicité. Sur un
autre plan, il semblerait ressortir de nombreuses études socio-
psychologiques (9) que les femmes qui ont subi des abus
sexuels dans l’enfance souffrent beaucoup plus fréquemment
que les autres de douleurs gynécologiques (surtout de douleurs
pelviennes).
On peut insister sur la distinction entre douleur et souffrance,
la souffrance se caractérisant habituellement par une peur de
l’inconnu, par le pessimisme, la culpabilité, l’impression que
la souffrance n’aura pas de fin, etc. De fait, la réponse émo-
tionnelle qui accompagne la douleur est modulée en fonction
des significations qui lui sont liées. C’est pourquoi il nous
semble important de nous poser quelques questions concernant
la place que le symptôme douloureux occupe dans l’économie
psychique du sujet et ce qu’il adviendrait s’il était supprimé.
On a pu dire, par exemple, que derrière la douleur sans sub-
stratum anatomique il y avait souvent un bénéfice secondaire.
En fait, quand il existe, il est rarement évident (repos, corvées
en moins...) et beaucoup plus souvent inconscient (par
exemple, douleur physique “réparant” une souffrance morale
culpabilisatrice). Mais quoi qu’il en soit, lors de la mise en
place du projet thérapeutique, il est bon de chercher à savoir si
la vie de la patiente ne sera pas perturbée par une perte signifi-
cative des bénéfices secondaires qu’elle tirait de sa maladie.
Le rôle qu’une douleur invalidante peut parfois prendre dans la
vie d’un patient et dans celle de son entourage familial n’est
souvent pas apprécié à sa juste valeur.
Il est bon aussi de souligner que, pour certaines personnes, la
douleur est le seul moyen d’entrer en contact avec les autres.
Ce peut être un moyen inconscient d’instaurer un contact
humain (avec le médecin par exemple). Mais le risque iatro-
gène est toujours possible. Avec le chirurgien, la relation peut
Réflexions psychosomatiques sur les pelvialgies chroniques
●S. Mimoun*
D
* Unité de gynécologie psychosomatique, service de gynécologie obstétrique,
hôpital Robert-Debré, 48, boulevard Sérurier, 75935 Paris Cedex 19.
.../...

être un peu plus problématique encore. Comme l’ont souligné
Demière et al., cités par E. Ferragut (3), la douleur iatrogène
d’origine chirurgicale est d’autant plus grave que, souvent, on
ne peut plus rien pour ces patientes. Il vaut toujours mieux voir
ces patientes avant la chirurgie qu’après. Dans la iatrogénie, il
y a aussi des paroles malheureuses qui enlèvent tout espoir à la
patiente : “ça fait trop longtemps que vous avez mal”, dit-on à
une patiente, “pour que l’on puisse faire quelque chose pour
vous”. Dans un cas comme celui-ci, non seulement on ne se
sert pas de l’effet placebo, mais l’on majore nettement l’effet
nocebo.
De nombreuses publications traitant d’algologie font référence
à l’utilisation de tests psychologiques et médicaux pour tenter
d’évaluer les composantes psychogènes et organiques du
symptôme douleur. Précisons d’emblée, avec F. Lorin (6), que
le test, quel qu’il soit, ne saurait se substituer à l’évaluation cli-
nique et au colloque singulier de la relation médecin-malade.
À côté de ces tests psychologiques, il en est deux qui ont une
visée diagnostique et thérapeutique : ce sont les tests médica-
menteux, ou “traitements d’épreuve”, avec la prescription
d’antalgiques périphériques ou centraux, d’anticomitiaux,
d’anxiolytiques, d’antidépresseurs... Mais de nombreux biais
existent du fait même de l’effet placebo... En conclusion,
aucun test d’organicité n’est totalement fiable.
LES DIFFICULTÉS DU MÉDECIN
Certains confrères n’auront qu’un activisme technique,
d’autres s’abstiendront de toute thérapeutique, voire rejetteront
la patiente en considérant qu’il ne s’agit “que” de douleurs
psychogènes. Soulignons que pour la malade, la douleur psy-
chogène est un non-sens (5), elle n’existe pas. Elle a mal dans
son corps, donc elle vient consulter un médecin pour qu’il
l’aide à vaincre cette douleur. Si la douleur est qualifiée de
psychogène, la patiente le vit comme une “non-validation”,
une non-acceptation de sa plainte, d’autant que ce diagnostic
est souvent accompagné d’un renvoi (plutôt que d’un envoi)
chez le psychiatre ou le psychothérapeute. Si une femme n’a
pas de lésion organique et qu’elle manifeste son mal-être par
des douleurs physiques, c’est sur ce terrain qu’il sera plus
facile de l’accompagner. Et si elle a des lésions organiques,
cela ne signifie pas qu’il ne puisse pas y avoir une implication
psychologique de cette douleur dans son histoire. Souvent, la
femme s’accroche de manière “vitale” à son symptôme. Il lui
sert en fait de “carte d’identité” et elle supporte très mal que
l’on soit autre chose qu’un technicien. Elle réclame que l’on
reconnaisse qu’elle souffre de son corps. Certaines femmes
consultent un médecin pour déposer leur corps dans le cabinet
médical afin qu’il le répare, comme si elles-mêmes n’étaient
pas concernées. Chez ces femmes, il y a comme une distance
entre leur corps, objet de la consultation, et elles-mêmes, sujets
consultants. Elles semblent tout attendre du savoir et du pou-
voir qu’elles prêtent pour un temps au médecin. Et s’il y a un
“échec”, cela les rend d’autant plus agressives qu’elles ne se
sentent pas en cause dans ce qui leur arrive. Comme l’a fait
remarquer E. Ferragut (3), à la différence des douleurs aiguës,
la différenciation entre une étiologie organique et une étiologie
psychogène n’est plus opérationnelle avec la chronicisation.
Pour F. Bourreau aussi (2), “la fonction protectrice admise
pour la douleur aiguë, par exemple, devient moins évidente au
stade chronique”. On peut penser en même temps que les
répercussions psychologiques d’une douleur d’étiologie orga-
nique et les douleurs d’étiologie psychogène (même s’il existe
une épine irritative locale) ne peuvent être confondues : les
mécanismes psychopathologiques sont différents. Pour E. Fer-
ragut comme pour nous, il faudra pour chaque patiente déco-
der le sens du message et le lien spécifique en relation à la psy-
chopathologie sous-jacente. Elle propose alors de différencier,
parmi les syndromes douloureux chroniques (SDC), les SDC à
composantes organiques dominantes et les SDC à composantes
psychiques dominantes. Dans le cas de la composante orga-
nique dominante, “il faudra savoir évaluer où se situe la
demande et ne pas répondre systématiquement par une pres-
cription d’antalgiques sous prétexte que la maladie causale est
organique”. Si la douleur organique est correctement évaluée
et traitée, la dimension psychologique qui l’accompagne
(anxiété, dépression...) peut être mieux entendue, et la patiente
peut être calmée parfois avec des doses médicamenteuses
diminuées. Dans le SDC à composantes psychiques domi-
nantes, ce n’est plus la douleur qui est au devant de la scène,
mais la façon dont la patiente en parle et nous la présente.
E. Ferragut distingue deux types de population de patientes
(3) : celles ayant des douleurs “centrifuges” (la douleur est
destinée à autrui, à l’environnement, à la famille...) et celles
ayant des douleurs centripètes, qui sont surtout une “façon
d’être au monde dans une dynamique de repli narcissique”. La
douleur vient ici atténuer la souffrance indiscible d’un manque
à être, et aide à survivre.
Pour C. Merceron (7), la douleur chronique protège d’une
décompensation plus grave. Pour P. Guex (4), la douleur peut
avoir un rôle d’étayage existentiel et sert à médiatiser la rela-
tion aux autres. La douleur aurait ici un rôle anti-souffrance
(3). D’autres auteurs, comme D. Anzieu (1), soulignent que
s’infliger soi-même une enveloppe réelle de souffrance est une
tentative de restituer la fonction de peau contenante non exer-
cée par la mère ou l’entourage : “je souffre donc je suis”.
Précisons, avec E. Ferragut, que, bien que le rôle du médecin
et de tout soignant soit de soulager la douleur, il ne faut pas
perdre de vue que la douleur chronique assure parfois une
fonction de défense ayant une réelle valeur protectrice pour le
sujet. Il faut donc être prudent et ne pas chercher à la faire dis-
paraître à n’importe quel prix. Et revoyons les bénéfices
secondaires classifiés par cet auteur (3) :
– obtenir des gratifications informulables (vis-à-vis de la
dépendance affective) ;
– donner une excuse honorable à des manques et à des
demandes inacceptables consciemment ;
– s’aménager un espace vital hors de l’envahissement de
l’autre ;
– lâcher le masque social sans faillir ;
– permettre un évitement (le handicap soustrait le sujet à cer-
taines situations qu’il ne peut pas assumer).
Il existe aussi des traits communs :
– une demande d’attention jamais satisfaite ;
– une immaturité et une dépendance excessive vis-à-vis de
GYNÉCOLOGIE ET SOCIÉTÉ
13
La Lettre du Gynécologue - n° 255 - octobre 2000
.../...

GYNÉCOLOGIE ET SOCIÉTÉ
14
La Lettre du Gynécologue - n° 255 - octobre 2000
l’entourage, même si ce besoin régressif est parfois miné ; la
douleur est alors “la cause” qui explique tout ;
– une agressivité sous-jacente qui peut être importante ;
– une fréquence particulière d’angoisses de séparation, la pré-
sence de failles narcissiques, où la douleur fait office
d’étayage personnel et relationnel chez les patients fragiles.
La notion de carence affective précoce est également retrouvée
en proportion élevée dans la population des malades doulou-
reux chroniques lors d’enquêtes épidémiologiques, ainsi que
des antécédents de violence sur le corps, que ce soit par acci-
dent ou maltraitance, un manque de gratification physique et
de sensations agréables génératrices de plaisir.
L’APPROCHE MÉDICALE ET PSYCHOLOGIQUE
C’est ainsi que l’investigation de la douleur ne devra pas se
faire selon un modèle linéaire de compréhension. Selon
E. Ferragut (3), “il sera nécessaire d’aborder à la fois :
– la dimension synchronique recherchant dans la situation
actuelle les facteurs déclenchants et les facteurs d’aggrava-
tion ;
– la dimension diachronique recherchant dans l’histoire du
sujet les facteurs de vulnérabilité.
En conséquence, l’abord de la douleur chronique, toujours au
confluent d’une sommation de problèmes, devra prendre en
compte :
– les facteurs somatiques : réels ou simple épine irritative sur
lesquels se décharge l’angoisse ;
– les facteurs psychologiques tenant à la personnalité du
malade, à son histoire ainsi qu’au conflit intrapsychique à
l’œuvre et aux défenses mises en jeu ;
– les facteurs d’ordre événementiel qui déstabilisent le sujet
lorsque ses défenses sont débordées ;
– les bénéfices primaires ou secondaires quels qu’ils soient,
psychologiques, sociologiques ou pécuniaires.”
Le rôle du gynécologue sensible à l’abord psychologique pour-
rait être :
– d’éviter les surenchères médicales tant diagnostiques que
thérapeutiques, ainsi que le risque iatrogène ;
– d’écouter la plainte et de contenir l’angoisse ;
– de mettre en évidence les principaux facteurs au devant de la
scène ;
– de pouvoir assurer l’accompagnement psychologique des
malades organiques par “une bonne” relation médecin-
patiente.
Le rôle du médecin n’est pas d’“expliquer” à la malade, par
des interprétations simplistes et réductrices, les facteurs psy-
chologiques qui peuvent interférer avec ce qu’elle ressent.
“C’est notre ‘tolérance à entendre’ qui aidera le malade dou-
loureux à dire sa souffrance plutôt qu’à montrer sa douleur”
(3). C’est pourquoi notre objectif n’est pas d’apposer une “éti-
quette” psychologique, voire psychiatrique, à côté du diagnos-
tic médical. Ce n’est pas non plus remplir un questionnaire
d’évaluation, car cela n’aiderait pas la patiente. Il nous semble
que, lors des premières consultations, pour éviter de rompre la
relation, il vaut mieux partir du symptôme douleur, qui est le
motif de la consultation, et tourner autour en spirale, afin de
connaître le vécu de la patiente, son histoire, ses émotions.
Chemin faisant, le temps de la maladie prend un autre sens
pour elle. Elle comprend mieux nos interventions, elle y parti-
cipe, elle se met moins en dehors de la consultation, en attente
passive et irresponsable de tout ce qu’on peut lui proposer. La
prise en charge thérapeutique que nous avons décrite par
ailleurs (8) en sera largement facilitée. ■
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
1. Anzieu D. Une peau pour les pensées. Paris : Apsygée 1991.
2. Bourreau F. Pratique du traitement de la douleur. Paris : Diom 1988.
3. Ferragut E. La dimension de la souffrance chez le malade douloureux chro-
nique. Paris : Masson 1995.
4. Guex P. Approche thérapeutique du syndrome douloureux chronique. Psy-
chologie Médicale 1990 ; 22 : 687-9.
5. Jallade S. Le corps prodigieux. Rev Med Psychosom 1988 ; 16 : 19-28.
6. Lorin F. Évaluation de la dimension psychologique de la douleur et traite-
ment par chimiothérapie. In : Ferragut E. La dimension de la souffrance chez le
malade douloureux chronique. Paris : Masson 1995.
7. Merceron C, Rossel F, Matthey ML. La plainte douloureuse chronique et son
approche psychologique à travers les techniques projectives. Psychologie Médi-
cale 1990 ; 22 : 681-6.
8. Mimoun S. Traité de gynécologie obstétrique psychosomatique. Paris : Flam-
marion Médecine Sciences 1999.
9. Walling MK, O’Hara MW, Reiter RC et al. Abuse history and chronic pelvic
pain in women : II. A multivariate analysis of abuse and psychological morbi-
dity. Obstet Gynecol 1994 ; 84 (2) : 200-6.
Renseignements et inscriptions :
Jeanne Catala, 209, rue de l’Université, 75007 Paris.
Tél. : 01 44 18 66 55. Fax : 01 44 18 66 51.
E-mail : [email protected]
XXXXIIeessJJoouurrnnééeess ddee ll’’AAFFEEMM
(Association Française pour
l’Étude de la Ménopause)
PPaarriiss,, 2233--2255 nnoovveemmbbrree 22000000
XXXXIIeessJJoouurrnnééeess ddee ll’’AAFFEEMM
(Association Française pour
l’Étude de la Ménopause)
PPaarriiss,, 2233--2255 nnoovveemmbbrree 22000000
1
/
3
100%