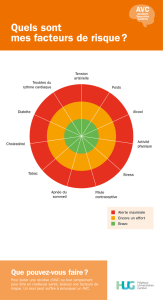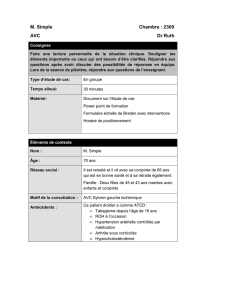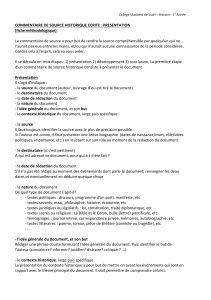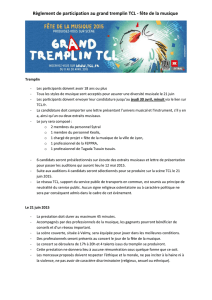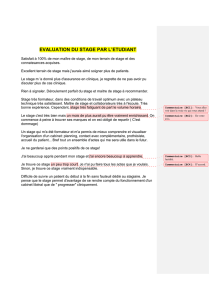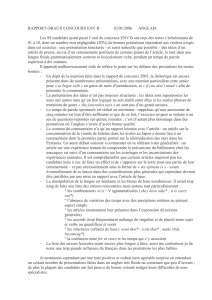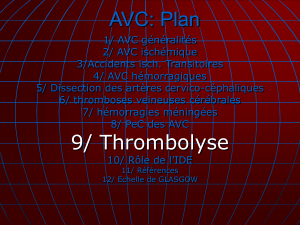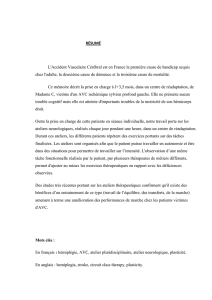■ R E V

La Lettre du Neurologue - n° 4 - vol. VII - avril 2003 127
REVUE DE PRESSE
Réorganisation cérébrale
après rééducation motrice
■
Cet article présente une étude des
modifications de l’activation cérébrale,
étudiée en IRM fonctionnelle (IRMf), lors
de la rééducation de l’hémiplégie vasculaire.
Sept patients ont été inclus, qui avaient tous
été victimes, au minimum six mois plus tôt,
d’un accident vasculaire cérébral ichémique
respectant les régions motrices de la main.
Les patients ont été évalués avant puis
après un programme de deux semaines de
rééducation utilisant les principes de la
contrainte induite du membre supérieur.
Cette technique repose sur une immobili-
sation du membre supérieur sain, de façon
à forcer le patient à utiliser les capacités
résiduelles de son membre supérieur paré-
tique. Les tâches utilisées en IRMf étaient
des mouvements de flexion-extension du
poignet. Des corrélations significatives ont
été constatées entre l’amélioration de la
motricité du membre supérieur et des aug-
mentations de l’activitation en IRMf. Les
régions concernées étaient les suivantes: le
cervelet (de façon bilatérale), le cortex
somatosensoriel secondaire et le cortex pré-
moteur dorsal (du côté controlatéral à la
main parétique).
Commentaire. La neuro-imagerie fonc-
tionnelle est un outil d’évaluation très inté-
ressant pour étudier la réorganisation céré-
brale postlésionnelle et les mécanismes de
récupération après accident vasculaire céré-
bral. Cette étude est une des premières
ayant cherché à étudier les modifications
d’activité associées à un programme de
rééducation spécifique, la contrainte induite
du membre supérieur. La démonstration
d’une corrélation entre récupération clinique
et activation cérébrale est un résultat tout à
fait original et intéressant. Ces résultats
suggèrent que l’efficacité de la rééducation
est en rapport avec une augmentation du
recrutement des régions sensorimotrices
secondaires.
P. Azouvi,
service de rééducation neurologique,
hôpital Raymond-Poincaré, Garches.
Une batterie d’évaluation
de la négligence spatiale
■
Les auteurs présentent les résultats
d’une étude francophone multicen-
trique cherchant à valider une échelle d’éva-
luation clinique de la négligence unilatérale.
Un groupe de 206 patients ayant été vic-
times d’un accident vasculaire cérébral
hémisphérique droit a été inclus. Les patients
étaient pour la plupart en phase subaiguë,
dans un service de rééducation. Leur perfor-
mance a été comparée à celle d’un groupe
de sujets contrôles étudiés préalablement
(Rousseaux et al. Revue Neurologique
2001 ; 157 : 1385-400). Les résultats ont
montré que la sensibilité des tests était
très variable. Individuellement, la mesure
la plus sensible était le point de départ dans
un test de barrage (les sujets négligents
ayant tendance à commencer systémati-
quement par la droite, alors que les sujets
contrôles ont tendance à utiliser une stra-
tégie de balayage de la gauche vers la
droite). Toutefois, la combinaison de plu-
sieurs tests était plus sensible que chaque
test pris isolément. En dehors des tests
“papier-crayon” traditionnels, les auteurs ont
utilisé une échelle d’évaluation écologique,
l’échelle Catherine Bergego, reposant sur
l’observation du comportement de négli-
gence dans des situations standardisées de
la vie quotidienne (habillage, toilette, dépla-
cements…). Cette échelle s’est révélée plus
sensible que les tests “papier-crayon”. Glo-
balement, 36 % des patients présentaient
une négligence cliniquement significative,
retentissant sur la vie quotidienne.
Commentaire. Ce travail propose la pre-
mière batterie d’évaluation de la négligence
validée en langue française. Il montre que
la négligence est un problème fréquent
dans les suites d’un accident vasculaire
hémisphérique droit. Il permet également
de souligner l’intérêt d’une évaluation éco-
logique qui, dans ce domaine comme dans
d’autres en neuropsychologie, apparaît
souvent plus sensible que les évaluations
“papier-crayon” de bureau.
P. Azouvi
Activation cérébrale et
syndrome postcommotionnel
■
Cinq patients présentant des plaintes
persistantes dans les suites d’un trauma-
tisme crânien léger (TCL) ont été étudiés par
tomographie à émission de positons (TEP)
au repos et lors de la réalisation d’une tâche
de mémoire de travail spatiale. La perte de
connaissance était d’une durée maximale de
deux minutes, l’amnésie post-traumatique
inférieure ou égale à trois heures. Aucun
patient ne présentait de lésion anatomique
sur le scanner ou l’IRM. Le délai depuis le
TCL variait de cinq à trente-cinq mois.
Toutefois, lors de la tâche de mémoire de
travail, les patients TCL présentaient, com-
parativement aux contrôles, une moindre
augmentation du débit sanguin dans la
région préfrontale droite (bien que leurs
performances à cette tâche ne différât pas
significativement de celle des contrôles).
Commentaire. Le TCL continue d’être
matière à débat, avec des enjeux à la fois
scientifiques et médico-légaux. Certains
prétendent qu’il n’existe pas de déficit
organique persistant après un TCL, et que
les plaintes résiduelles du syndrome post-
commotionnel sont avant tout réaction-
nelles (classique “syndrome subjectif”). À
l’inverse, d’autres auteurs pensent que le
TCL s’accompagne de réels dysfonction-
nements cérébraux, comparables, bien que
moins importants, à ceux qui sont observés
après un TC sévère. Ce travail va dans le
sens de plusieurs autres études récentes en
TEP ou en IRM fonctionnelle. Il suggère
qu’il existe des perturbations de l’activation
cérébrale persistantes au moins chez cer-
tains blessés dans les suites d’un TCL. Ces
dysfonctionnements ne seraient pas détec-
tables au repos mais apparaîtraient lors de
la réalisation d’une tâche cognitive même
relativement simple. Toutefois, il faut rester
prudent dans l’interprétation de ces résultats.
Il est difficile de dire si ces modifications
sont la cause ou la conséquence des plaintes
subjectives. Leur spécificité et leur signifi-
cation clinique restent à évaluer.
P. Azouvi
Quels sont les facteurs
prédictifs du syndrome
postcommotionnel ?
■
L’objectif de ce travail est de chercher
les facteurs prédictifs de la persistance
de symptômes six mois après un trauma-
✔
Johansen-Berg H, Dawes H, Guy C et al.
Correlation between motor improvement and
altered fMRI activity after rehabilitative therapy.
Brain 2002 ; 125 : 2731-42.
✔
Sensitivity of clinical and behavioural tests of
spatial neglect after right hemisphere stroke.
Azouvi P et al., for the French collaborative study
group on assessment of unilateral neglect
(GEREN-GRECO) J Neurol, Neurosurg Psychiatry
2002 ; 73 : 160-6.
✔
Chen SHA, Kareken DA, Fastenau PS et al. A
study of persistent post-concussion symptoms in
mild head trauma using positron emission tomo-
graphy. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2003 ; 74 :
326-32.
Dirigée par le Pr P. Amarenco

La Lettre du Neurologue - n° 4 - vol. VII - avril 2003
128
REVUE DE PRESSE
Dirigée par le Pr P. Amarenco
tisme crânien léger (TCL). Les auteurs ont
étudié de façon prospective 79 patients après
un TCL (perte de connaissance de moins de
quinze minutes, amnésie post-traumatique
de moins d’une heure). Les patients étaient
évalués à leur arrivée aux urgences de l’hô-
pital, avec recherche de leurs symptômes
cliniques (céphalées, vertiges, nausées…)
ainsi que des modifications biochimiques
(dosage de deux marqueurs sériques évoca-
teurs d’un dommage cellulaire : la neurone
specific enolase – NSE – et le marqueur
sérique S-100B) dans les six heures suivant
le traumatisme. Six mois après l’accident,
28 % des blessés présentaient une ou plu-
sieurs plaintes persistantes. La présence à
la phase aiguë de céphalées, de sensations
vertigineuses ou de nausées, ainsi qu’une
élévation des marqueurs biochimiques étaient
statistiquement fortement prédictifs de la
persistance de symptômes à six mois. Les
blessés ne présentant aucun de ces symp-
tômes cliniques et un chiffre normal des
marqueurs biologiques avaient tous une
excellente récupération à six mois.
Commentaire. Ce travail permet d’identi-
fier les patients qui ont le plus de risque de
présenter des difficultés persistantes dans
les suites d’un TCL. Il confirme des études
précédentes ayant montré que la présence
et la sévérité des symptômes cliniques et
biologiques à la phase initiale ont une
valeur prédictive du devenir. Il peut donc
permettre de mieux cibler les actions de
prévention et de prise en charge des syn-
dromes postcommotionnels.
P. Azouvi
Pergolide (Célance®)
et traitement des tics
■
Les auteurs ont étudié l’efficacité du
pergolide par un essai en double insu
versus placebo, chez 57 enfants et adoles-
cents américains (7 à 17 ans) souffrant de
tics invalidants et évalués par différentes
échelles adaptées, y compris par une obser-
vation des patients par eux-mêmes ou de
l’enfant par les parents. Après une période
d’arrêt des différents traitements préalables
(washout) de deux semaines, les patients
étaient traités pendant huit semaines soit
par placebo (un tiers) soit par pergolide (deux
tiers) à doses très lentement progressives,
sans dépasser 0,15 mg x 3, puis de nouveau
évalués cliniquement et par vidéo. L’étude
permit de montrer une supériorité signifi-
cative (échelle YGTSS) du pergolide sur
le placebo et une tendance à la supériorité
(non significative) pour les échelles d’obser-
vation du patient ou des parents, au prix de
peu d’effets secondaires hormis davantage
de signes cutanés et une insomnie légère.
Commentaire. Cette petite étude confirme
que, chez l’enfant tiqueur, le pergolide est
un traitement bien toléré et actif, quoique
modérément, et qu’il mérite donc d’être
proposé tôt. Traitement de la maladie de
Parkinson (AMM) ou du syndrome des
jambes sans repos, cet agoniste dopaminer-
gique est déjà proposé – toujours à petites
doses – par nombre d’équipes aux patients
concernés, enfants ou adultes, et semble
avoir un meilleur rapport efficacité/incon-
vénients que les neuroleptiques atypiques,
l’halopéridol ou la clonidine. Il aurait égale-
ment une action favorable sur les syndromes
d’hyperactivité, parfois associés aux tics.
Quant au mécanisme exact de son action, il
reste très discuté.
J. d’Anglejan-Chatillon, Versailles.
Les sartans arrivent
dans le traitement de fond
de la migraine
■
Une récente méta-analyse portant sur
12 000 patients recevant quotidien-
nement des inhibiteurs de l’angiotensine II
pour une raison autre que la migraine ont vu
la fréquence de leur céphalée diminuer de
30 %. Cela a conduit les auteurs à envisager
un essai thérapeutique dans la migraine
avec le candésartan. Soixante patients ont
été randomisés (double aveugle, cross
over). Le nombre moyen de jours avec
céphalées (critère de jugement primaire) a
été de 18,5 dans le groupe placebo versus
13,6 dans le groupe candésartan (p = 0,001).
Parmi les critères secondaires, il y a eu
significativement moins de jours avec
migraine, moins d’heures de céphalée ou
de migraine, un index de sévérité de la
céphalée moins élevé et un nombre de jours
d’arrêt de travail moins important dans le
groupe candésartan. Les effets secondaires
furent similaires dans le groupe placebo et
dans le groupe candésartan.
Commentaire. Les auteurs ont utilisé
un critère d’efficacité primaire inhabituel
(nombre de jours de céphalée) et non le
nombre de crises de migraine, comme cela
est habituellement le cas. Ils ont estimé ce
critère plus fiable. Ce choix aurait dû faire
l’objet d’une explication plus fournie, en
définissant mieux les types de céphalées
répertoriés dans cette appellation. On aurait
également aimé avoir un échantillon un peu
plus large de patients que cette cohorte de
57 sujets. Le mécanisme d’action du candé-
sartan serait lié à une réduction de l’effet
vasoconstricteur de l’angiotensine II, de
l’activation du système sympathique, de la
sécrétion d’adrénaline et des catéchola-
mines, voire à un effet modulateur sur le
débit sanguin cérébral ainsi que sur la
sécrétion des neurotransmetteurs impliqués
dans le processus migraineux (dopamine,
sérotonine, NO).
J.M. Visy, Reims.
L’entrée en résistance
■
Cette étude avait pour objectif d’étu-
dier l’histoire naturelle des épilepsies
réfractaires. Trois cent trente-trois patients
souffrant d’une épilepsie partielle phar-
macorésistante ont été inclus. Tous ont été
recrutés lors de leur inclusion dans un bilan
préchirurgical dans un centre spécialisé
d’épileptologie. Chez ces patients, l’inter-
valle moyen entre le début de l’épilepsie et
l’échec d’un second traitement médica-
menteux était de 9,1 ans (0-48 ans). Fait
important, 26 % des patients avaient pré-
senté une période de rémission de leurs
crises d’au moins un an et 8,5 % avaient
même eu une période de rémission de plus
de cinq ans. Un âge de début précoce de
l’épilepsie était associé à une haute proba-
bilité de rémission et à un intervalle libre
plus long avant échec du traitement.
Commentaire. La pharmacorésistance
demeure un mystère : mystère physio-
pathologique et mystère quant à son évo-
lution naturelle. Cette étude démontre que
la pharmacorésistance n’apparaît pas tou-
jours d’emblée et qu’une longue période de
pharmacosensibilité peut précéder l’échec
✔
De Kruik JR, Leffers P, Menheere PPCA et al.
Prediction of post-traumatic complaints after
mild traumatic brain injury : early symptoms
and biochemical markers. J Neurol Neurosurg
Psychiatry 2002 ; 73 : 727-32.
✔
Gilbert DL et al. Tic reduction with pergolide
in a randomized controlled trial in children.
Neurology 2003 ; 60 : 606-11.
✔
E. Tronvik et al. Prophylactic treatment of
migraine with an angiotensin II receptor blocker.
JAMA 2003 ; 289 : 65-69.

La Lettre du Neurologue - n° 4 - vol. VII - avril 2003 129
médicamenteux secondaire. Il existe donc
une fenêtre temporelle pendant laquelle
on pourrait agir efficacement et prévenir
la survenue de la pharmacorésistance, à
condition d’en connaître les mécanismes.
Par ailleurs, fait moins réjouissant, le
contrôle initial facile d’une épilepsie par-
tielle ne préjuge pas d’une bonne évolution
à long terme. D’autres facteurs pronostiques
sont alors à considérer lors de l’initiation
du traitement et du message à délivrer au
patient, notamment l’existence d’une lésion
de type sclérose hippocampique, qui est en
soi synonyme de pharmacorésistance à plus
ou moins long terme.
S. Dupont,
hôpital de la Salpêtrière, Paris.
Traiter ou ne pas traiter ?
■
Cet article rapporte les conclusions
d’une conférence de consensus ayant
réuni les commissions neurologiques et
pédiatriques américaines. Le but était de
répertorier et commenter les données de la
littérature concernant l’instauration d’un
traitement antiépileptique après une pre-
mière crise non situationnelle chez l’enfant
ou l’adolescent. Les questions suivantes ont
été abordées :
•Quel est le risque de récidive ? Il est très
variable selon les études, entre 14 et 65 %
de récidive dans la première année. En
revanche, le risque d’entrer dans une
épilepsie active (plus de dix crises) est rela-
tivement faible : de l’ordre de 10 %.
•Traiter diminue-t-il le risque de récidive ?
Plusieurs études semblent montrer que le
fait de traiter après une première crise
réduit le risque de récurrence ; mais aucune
de ces études n’est vraiment satisfaisante
sur un plan méthodologique.
•Quels sont les risques potentiels en cas
de survenue d’une seconde crise si l’on ne
traite pas? Les modèles animaux indiquent
que des crises prolongées et récurrentes
peuvent induire des lésions neuronales et
une épilepsie secondaire. Néanmoins, il
n’existe aucune évidence clinique que des
crises prolongées (hors situation de l’état
de mal) puissent induire des lésions céré-
brales. Donc, à ce jour, le seul risque poten-
tiel à prendre en compte est celui de bles-
sures physiques ou de décès subits liés
à des crises. Aucune étude n’a jusqu’ici
déterminé si le fait de traiter après une pre-
mière crise diminuait de façon significative
le risque de blessure ou de décès.
•Le fait de traiter change-t-il le pronostic
à long terme ? Non, le fait d’instaurer un
traitement après une première crise ou de le
différer à la seconde crise ne modifie pas le
pourcentage de rémission.
•Quels sont les principaux effets secon-
daires des médicaments antiépileptiques à
redouter chez l’enfant ? Essentiellement
cognitifs et comportementaux.
Commentaire. Une nouvelle fois, aucune
recommandation générale ne ressort de
cette étude. La décision de traiter est à
prendre au cas par cas en fonction du
rapport risque/bénéfice. Néanmoins, il est
important de bien connaître les résultats
des principales études de la littérature avant
de prendre la décision d’instaurer ou non
un traitement, et ces résultats inciteraient
plutôt chez l’enfant à une attitude plus
attentiste que chez l’adulte.
SD
DHEA
contre maladie d’Alzheimer
■
Les auteurs ont comparé les perfor-
mances cognitives de 58 patients
atteints de la maladie d’Alzheimer (MA)
traités en double insu soit par placebo, soit
par 100 mg/jour de DHEA (déhydroépian-
drostérone), pendant une période de 6 mois.
Il s’agissait de patients hommes et femmes
âgés de 75 à 77 ans en moyenne, avec un
MMS de 22/30 environ (exclusion si MMS
< 8/30), sans autres traitements sympto-
matiques (anticholinestérasiques = IACE).
Les échelles utilisées étaient celles habituel-
lement recommandées dans ce type d’essai
(ADAS Cog et non Cog, CIBIC plus, etc.),
mais aucune ne démontra de modification
significative ni à 3, ni à 6 mois. Il n’y eut pas
d’effets secondaires graves, biologiques ou
cliniques, mais une tendance vers davan-
tage de confusion/agitation ou idées déli-
rantes sous DHEA.
Commentaire. En se fondant sur un
ensemble d’arguments biologiques presque
convaincants tels que ses effets neuro-
trophiques, les dosages de la DHEA chez
des patients déments ou son action chez
l’animal, il était tentant, logique, et finale-
ment nécessaire d’essayer la DHEA dans la
MA. Mais, premièrement, l’étude en cause
a une puissance statistique limitée (peu de
patients) ; deuxièmement, une forte propor-
tion (30-50 %) des malades abandonnèrent
l’essai dans les deux groupes traitement
comme placebo ; troisièmement, on pourrait
argumenter que la DHEA ou n’importe quel
autre traitement symptomatique de la MA
devrait être ajouté à un traitement de réfé-
rence par IACE et ne devrait pas être utilisé
seul. Malgré ces réserves, ce travail donne
une raison de plus de justifier la prudence
des médecins français à l’égard de la DHEA
qui reste à ce jour un simple complément
alimentaire et non un médicament. En atten-
dant d’éventuels résultats contradictoires
dans des situations voisines (MCI, etc.)!
JAC
ASCOT-LLA : oh la la !
■
En prévention primaire chez les
patients avec une hypercholestérolé-
mie élevée (WOOSCOP) ou modérée
(AFCAPS/TexCAPS), la pravastatine et la
lovastatine ont montré une réduction des
événements coronaires majeurs. Mais
qu’en est-il chez les sujets ayant d’autres
facteurs de risque ? HPS, avec la simvasta-
tine, avait commencé à montrer un effet
positif dans ses sous-groupes d’hyperten-
dus et de diabétiques. Effet non observé
avec la pravastatine dans le bras lipidique
de la population d’hypertendus de ALL-
HAT (mais cette étude avait deux fois
moins de puissance que celle planifiée
avant le début de l’étude).
Voici maintenant un autre méga-essai qui a
évalué l’effet de l’atorvastatine 10 mg/jour
contre placebo chez 10 305 patients ayant
un cholestérol total inférieur à 2,30 g/dl
(bras lipidique de l’étude ASCOT) parmi
une population totale de 19 342 patients
hypertendus à risque (> 160/100 si non
traités, > 140/90 si déjà traités). Il s’agissait
✔
Berg et al. How long does it take for partial
epilepsy to become intractable ? Neurology 2003 ;
60 : 186-90.
✔
Hirtz et al. Practice parameter : treatment of the
child with a first unprovoked seizure : report of the
quality standards subcommittee of the American
Academy of Neurology and the Practice Committee
of the Child Neurology Society. Neurology 2003 ;
60 : 166-75.
✔
D. Knopman et al. DHEA for Alzheimer’s
disease : a modest showing by a super hormone.
Neurology 2003 ; 60 : 1060-1.
✔
OM Wolkowitz et al. DHEA treatment of
Alzheimer’s disease : a randomized, double-blind,
placebo-controlled study. Neurology 2003 ; 60 :
1071-6.

La Lettre du Neurologue - n° 4 - vol. VII - avril 2003
130
REVUE DE PRESSE
Dirigée par le Pr P. Amarenco
d’un plan factoriel, car l’objectif initial
dans la population entière d’ASCOT était
d’évaluer l’effet de l’amlodipine versus
énalapril sur une durée de 5 ans.
Après un suivi de 3,3 ans, l’étude a été
arrêtée prématurément car il a été observé
une réduction relative de l’incidence des
infarctus du myocarde de 36 % (17 à 50 %,
p = 0,0005), des AVC de 27 % (4 à 44 %,
p = 0,0236 ; soit 89 [1,7 %] AVC versus
121 [2,4 %]) et de tout événement cardio-
vasculaire de 21 % (10 à 31 %, p = 0,0005);
il n’a pas été observé d’effet sur la morta-
lité, ni dans le groupe des diabétiques.
Commentaire. Ces résultats sont une
avancée majeure en prévention des maladies
cardiovasculaires car ils établissent le bien-
fondé de stratégies thérapeutiques prenant
en compte le risque cardiovasculaire global
de l’individu. En d’autres termes, chez un
hypertendu avec d’autres facteurs de risque,
il ne faut pas seulement s’occuper de sa
pression artérielle, mais il faut aussi faire
baisser son cholestérol, même s’il est peu
élevé.
P. Amarenco,
service de neurologie et centre d’ATAC,
hôpital Bichat, Paris
Traitement des anévrismes
intracrâniens par stent
■
Les auteurs rapportent trois observa-
tions de traitement d’anévrisme intra-
crânien, à collet large, par utilisation exclu-
sive d’un stent non couvert. Chez 2 patients,
âgés de 57 et 44 ans, il s’agissait d’ané-
vrismes rompus, l’un de l’artère basilaire,
l’autre de l’artère carotide interne. Chez le
troisième patient, âgé de 39 ans, le double
sac de l’artère carotide interne supracaver-
neuse n’était pas responsable de l’hémor-
ragie sous-arachnoïdienne. Le traitement
endovasculaire a été fait au décours de
l’accident hémorragique ou à distance de
celui-ci (2 mois et 10 mois après). De façon
systématique, un traitement antiagrégant
a été instauré après l’embolisation. Les
contrôles angiographiques à distance (2 ans
pour l’un des patients) ont montré la throm-
bose du sac anévrismal.
Commentaire. L’utilisation d’endopro-
thèse pour le traitement des anévrismes
intracrâniens est relativement récente ; il
permet en général la mise en place, plus
sûre, de spires métalliques au sein d’un
anévrisme à collet large. Les observations
rapportées par R. Vanninen et al. sont inté-
ressantes parce qu’elles montrent qu’une
thrombose progressive du sac anévrismal
peut être obtenue par la mise en place par
le seul stenting. Cette technique relative-
ment simple ouvre des perspectives nou-
velles pour le traitement des anévrismes à
large collet. Les risques du traitement anti-
agrégant restent toutefois à évaluer, en
particulier en cas d’anévrisme traité à la
période hémorragique.
J.F. Méder,
service de neuroradiologie,
hôpital Sainte-Anne, Paris
L’étude ANBP2 : les IEC
en avaient bien besoin !
■
Depuis les résultats de l’étude CAPPP
(captopril versus diurétique dans le
traitement de l’HTA) qui montraient un
surcroît d’AVC dans le groupe captopril, il
existait un doute sur l’effet potentiellement
négatif des inhibiteurs de l’ACE sur la
survenue des AVC. Ce doute a été depuis
renforcé par l’absence d’efficacité du périn-
dopril dans l’étude PROGRESS à diminuer
la récidive d’AVC lorsqu’il était utilisé en
monothérapie, puis par le plus grand nombre
d’AVC dans le groupe énalapril de l’étude
ALLHAT comparativement aux diurétiques.
Des explications très justifiées, tenant au
design de ces études, permettaient de garder
entière confiance dans les IEC en prévention
de l’AVC. Mais le doute restait là.
Dans cette nouvelle étude australienne,
6083 sujets hypertendus (PAS > 160 mmHg
ou PAD > 90 mmHg) de 65 à 84 ans ont été
randomisés en ouvert en milieu de médecine
générale, entre inhibiteur de l’ACE et diu-
rétique. L’objectif assigné aux médecins de
famille qui ont été responsables du traite-
ment durant toute l’étude a été de diminuer
la PAS de 20 mmHg au moins au-dessous
de 160 mmHg et moins de 140 mmHg de
PAS si cela était bien toléré, et une diminu-
tion de 10 mmHg pour la PAD qui devait
baisser au moins au-dessous de 90 mmHg
et si cela était bien toléré au-dessous de 80
mmHg. Pour ce faire, on pouvait associer
au traitement des bêtabloquants des inhibi-
teurs calciques ou des alphabloquants dans
les deux groupes.
À 5 ans, la PA a baissé de 26/12 mmHg
dans les deux groupes. Après 4,1 années de
suivi en moyenne, il y a eu une réduction
significative des événements cardiovascu-
laires et des décès toutes causes dans le
groupe IEC de 11 % (0 à 29 %, p = 0,05),
sauf dans le groupe des femmes dans lequel
il n’y a eu aucune réduction (interaction
significative). Il y a eu le même nombre
d’AVC dans les deux groupes.
Commentaire. Cette étude, qui contraire-
ment aux autres a l’avantage d’avoir obtenu
la même baisse de pression artérielle dans
les deux groupes, rassure sur l’efficacité
des IEC en prévention des événements
cérébrovasculaires et vient contredire de
façon convaincante ALLHAT, CAPPP et
PROGRESS. Néanmoins, si les IEC font
aussi bien que les diurétiques (gold stan-
dard),ils ne font pas mieux, à l’inverse des
inhibiteurs calciques, qui eux ont toujours
fait mieux que les diurétiques en prévention
de l’AVC. À quand une étude IEC plus diu-
rétiques versus ICC plus diurétique en pré-
vention secondaire de l’AVC ?
P. Amarenco
✔
PS Sever. Prevention of coronary and stroke
events with atorvastatin in hypertensive patients
who have average or lower-than-average choles-
terol concentrations, in the Anglo-Scandinavian
Cardiac Outcomes Trial-Lipid Lowering Arm
(ASCOT-LLA) : a multicentre randomised control-
led trial. Lancet 2003 ; 361.
✔
Vanninen R, Manninen H, Ronkainen A. Broad-
based intracranial aneurysms : thrombosis induced
by stent placement. AJNR 2003 ; 24 : 263-6.
✔
Wing et al. A comparison of outrepasses with
angiotensin-converting-enzyme inhibitors and
diuretiques for hypertension in the elderly. N
Engl J Med 2003 ; 348 : 583-92.
1
/
4
100%