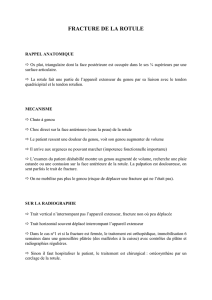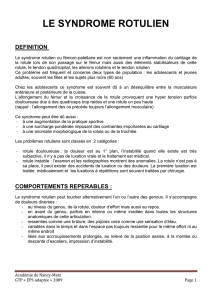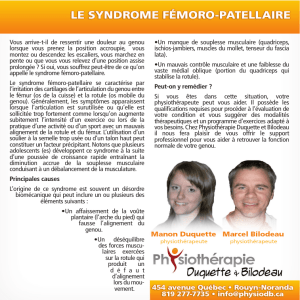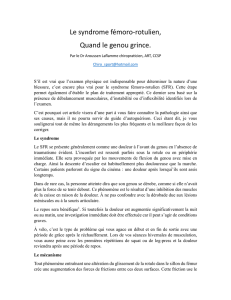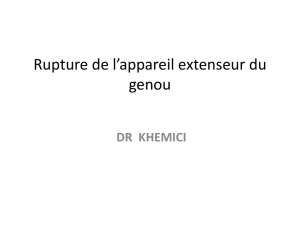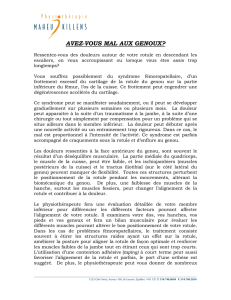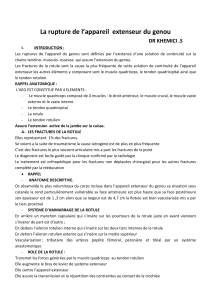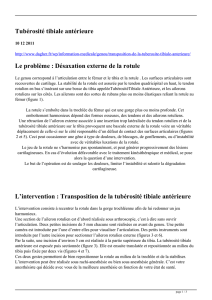L M P o i n t s f o...

MISE AU POINT
■
Les syndromes rotuliens s’expriment cliniquement par une
douleur de la face antérieure du genou. La radio standard
est souvent normale, et la prise en charge difficile.
■
On distingue deux grands groupes de syndromes rotu-
liens : rotules essentiellement douloureuses, centrées à la
radio et pouvant s’accompagner d’une instabilité subjective,
et rotules douloureuses instables ou potentiellement ins-
tables, souvent associées à des signes radiographiques de
dysplasie.
■
Pour évaluer cliniquement une rotule instable, le test de
Smilie apparaît comme le plus fiable pour reproduire la situa-
tion d’appréhension du patient.
■
La radio standard est incontournable dans les syndromes
rotuliens, notamment le cliché de profil, qui recherche le signe
du croisement et qui apprécie la situation en hauteur de la
rotule.
■
Les syndromes rotuliens douloureux purs relèvent toujours
du traitement médical, basé essentiellement sur la rééducation,
voire sur l’éducation du patient.
■
Les rotules douloureuses s’accompagnant de critères objec-
tifs cliniques et radiographiques d’instabilité peuvent faire
l’objet d’un traitement chirurgical.
Mots-clés :
Syndromes rotuliens - Douleur - Instabilité.
Keywords:
Patellofemoral syndrome - Pain - Instability.
Points forts
* Praticien attaché, rhumatologue, médecin du sport, service de rhumato-
logie et de chirurgie orthopédique, hôpital Ambroise-Paré, Boulogne.
** Praticien universitaire et hospitalier, chirurgien des hôpitaux, hôpital
Ambroise-Paré, Boulogne, CHU Paris Île-de-France Ouest.
L
es syndromes rotuliens sont un motif fréquent de consul-
tation, aussi bien en rhumatologie qu’en médecine sportive
et en chirurgie orthopédique. Dans bon nombre de cas, la
radiologie standard est normale, ce qui pose un problème au prati-
cien, qui se trouve démuni face à la prise en charge de ces patients.
Le démembrement clinique et l’approche thérapeutique de ces syn-
dromes passent par la distinction de deux grandes entités, douleur
et instabilité, qui peuvent coexister. On distingue ainsi :
–les atteintes de l’appareil extenseur du genou pour lesquelles la
douleur est l’élément essentiel et prédomine sur l’instabilité. Le
traitement dans ce contexte est avant tout médical, et les indica-
tions chirurgicales sont rares ;
–les atteintes pour lesquelles l’instabilité l’emporte sur la douleur,
et où le recours à la solution chirurgicale est possible.
Dans la littérature (1),le syndrome rotulien douloureux, appelé
“patellofemoral pain syndrome”,se présente cliniquement comme
une douleur située topographiquement à la face antérieure du
genou dont l’horaire est mécanique. Ce syndrome, encore appelé
“anterior knee pain syndrome” par les Anglo-Saxons, s’inscrit dans
le cadre d’un dysfonctionnement global du compartiment fémoro-
patellaire et fait intervenir l’ensemble de l’appareil extenseur du
genou, que ce soit les structures articulaires ou les éléments tendino-
musculaires. Si l’on exclut les arthropathies de diverses étiologies,
les tendinopathies et bursites de l’appareil extenseur, les ostéo-
chondroses et ostéochondrites, on est confronté à des patients ayant
des douleurs mécaniques pour lesquelles il existe trois types pos-
sibles de facteurs favorisants :
–mauvais alignement de l’appareil extenseur, malposition de la
rotule ;
–déséquilibre musculaire, avec notamment hypotrophie du vaste
interne ;
–surcharge excessive de travail du compartiment fémoro-patellaire.
Rappelons qu’au plan biomécanique la rotule est attirée dans le
plan frontal vers l’extérieur, et que cette tendance à la bascule
externe est équilibrée par trois éléments : le chef du vaste interne
du quadriceps, la berge externe plus haute de la trochlée et les
rotateurs internes du squelette jambier (patte d’oie). En ce qui
concerne le plan sagittal, la synergie des groupes musculaires
antérieurs (quadriceps) et postérieurs (ischio-jambiers) module la
pression fémoro-patellaire. Ainsi, pour un même travail quadri-
cipital, cette pression est plus importante en cas de déficience des
plans postérieurs.
La Lettre du Rhumatologue - n° 315 - octobre 2005
29
Démembrement clinique et approche thérapeutique
des syndromes rotuliens
Clinical analysis and treatment of the patellofemoral syndromes
●P. Le Goux*, P. Hardy**

MISE AU POINT
La classification de H. Dejour (2) a le mérite d’être simple pour
une pathologie compliquée. Elle met ainsi en évidence deux grands
groupes de rotules :
–la rotule douloureuse qui peut s’associer à une instabilité mais
qui reste subjective, et sans épisode de luxation objective. La radio,
dans ce contexte, montre une rotule centrée et sans caractère dys-
plasique. Ce type de syndrome rotulien doit toujours être traité
médicalement ;
–la rotule essentiellement instable : soit instable vraie, avec d’au-
thentiques épisodes de luxation et assez rapidement confiée au
chirurgien, soit potentiellement instable, sans luxation vraie mais
avec des signes radiologiques de dysplasie et/ou d’instabilité. Ces
rotules potentiellement instables peuvent faire l’objet d’un trai-
tement chirurgical après échec du traitement médical bien conduit,
en particulier de la rééducation.
EXAMEN CLINIQUE
L’examen clinique, devant un syndrome rotulien, est primordial :
il s’appuie sur un examen physique performant et un bilan radio-
graphique standard spécifique, centré en particulier sur la recherche
de signes dysplasiques de la trochlée et/ou de la rotule et sur la
mise en évidence d’une malposition de la rotule, aussi bien en hau-
teur que dans le plan frontal. Il faut avoir présent à l’esprit l’objec-
tif principal de l’examen : déterminer, parmi les rotules doulou-
reuses pour lesquelles le rhumatologue est consulté, celles qui ont
un caractère instable et qui feront éventuellement l’objet d’un
traitement chirurgical. Il doit également répondre à certaines
questions :
–en premier lieu, il doit éliminer toute douleur projetée (crural-
gie, coxopathie) et confirmer la souffrance fémoro-patellaire, la
localiser précisément par rapport aux autres compartiments du
genou, en particulier par rapport aux douleurs de l’interligne (lésion
méniscale, par exemple) ;
–dans un certain nombre de cas, il doit essayer de faire la part
des choses entre une chondropathie et une tendinopathie rotulienne,
notamment la tendinite de la pointe de la rotule dans le cadre d’une
pratique sportive, pathologies qui peuvent avoir des implications
thérapeutiques différentes.
On recherchera à l’interrogatoire les éléments qui confirment la
souffrance rotulienne. La douleur, initialement unilatérale, peut se
bilatéraliser aux deux genoux. Sa localisation est souvent antérieure,
parfois médiale, simulant une pathologie méniscale, et plus rare-
ment postérieure, par projection. Dans certains cas, la topographie
est imprécise et mal définie par le patient, qui exprime une sensa-
tion d’étau ou de gonflement de son genou. Classiquement, la dou-
leur est provoquée par l’accroupissement, la position assise pro-
longée ou par le fait de se relever d’un fauteuil. Les escaliers sont
pénibles à monter et surtout à descendre, avec parfois une sensa-
tion d’instabilité et de dérobement de la jambe, en rapport avec un
dysfonctionnement quadricipital. Il faut absolument différencier
cette instabilité subjective, constatée dans les rotules douloureuses,
d’une instabilité vraie avec de véritables épisodes de subluxation
rotulienne ou encore de l’instabilité ligamentaire objective de type
rotatoire en rapport avec les séquelles de rupture du pivot central
du genou (LCA). Néanmoins, la recherche, dans les antécédents,
d’épisodes d’entorse avec luxation ou subluxation rotulienne doit
être systématique. La notion de blocage est souvent présente dans
le cadre des rotules douloureuses potentiellement instables : ce
pseudo-blocage sans limitation de l’extension correspond le plus
souvent à un défaut d’engagement de la rotule, et peut être accom-
pagné d’un claquement ou d’un ressaut.
À l’examen,on évaluera le morphotype des axes des membres
inférieurs en recherchant un genu valgum, et notamment un aspect
en “baïonnette” (figure 1)de l’appareil extenseur, évocateur d’une
bascule externe et d’une instabilité de la rotule. De même, la posi-
tion en hauteur de celle-ci doit être évaluée, à la recherche d’une
dysplasie. On appréciera la trophicité du vaste interne (amyotrophie
éventuelle) et la présence ou non d’un
épanchement pouvant évoquer une
chondropathie. Les différents élé-
ments rotuliens doivent être palpés,
en particulier les ailerons (l’externe
peut être rétracté), les facettes et la
pointe de la rotule, qui peut faire
l’objet d’une pathologie d’insertion
tendineuse. Une douleur est fré-
quemment retrouvée sur les bords
externe et interne du tendon rotulien,
en rapport avec une souffrance du
paquet adipeux de Hoffa. Puis l’ap-
pareil extenseur est testé contre ré-
sistance de la flexion complète à
l’extension, à la recherche d’un arc
douloureux (tendinopathie, chondro-
pathie). In fine, au terme de l’exa-
men d’un syndrome rotulien, le test
jugé le plus fiable en matière d’ins-
tabilité rotulienne est le test de Smi-
lie (figure 2). Il permet de reproduire
précisément l’appréhension ressen-
tie par le patient : le genou est placé
au départ en extension ; l’examina-
teur subluxe la rotule en dehors et
demande dans le même temps au
patient de fléchir progressivement
le genou. Le test de Smilie est posi-
tif quand le patient retrouve sa sen-
sation d’instabilité dans les 30 pre-
miers degrés de flexion.
EXAMEN RADIOGRAPHIQUE
L’examen radiologique standard est incontournable, et d’une
importance fondamentale dans le cadre de la pathologie fémoro-
patellaire, pour rechercher d’une part des signes de dysplasie de
la rotule et/ou de la trochlée et, d’autre part, des anomalies posi-
tionnelles de la rotule par rapport à la trochlée. Le bilan radiolo-
gique doit comporter un cliché de face et surtout un cliché de profil
(3) en faible flexion pour mettre en évidence des aspects dyspla-
siques de la trochlée (trop plate), reconnaissables au signe du croi-
sement (figure 3) :lorsque au moins l’une des deux lignes des berges
La Lettre du Rhumatologue - n° 315 - octobre 2005
30
Figure 1.Aspect en baïonnette.
Figure 2. Test de Smilie.

MISE AU POINT
vient croiser la ligne de fond de la trochlée, le signe du croisement
est présent, et plus les lignes se croisent bas, plus la dysplasie est
importante. Le cliché de profil permet également d’apprécier la
situation en hauteur de la rotule (figure 4) par la mesure de l’in-
dice de Caton-Deschamps (4). Ce rapport compare la hauteur de
la rotule cartilagineuse à la distance entre la partie antérieure du
plateau tibial et le point inférieur de la rotule, et doit être proche
de 1 en l’absence de malposition. Dans un plan tangentiel, les défi-
lés fémoro-patellaires comparatifs à 30° de flexion (5)permettent
de détecter une bascule ou hyperpression externe de la rotule, voire
une subluxation. En pratique, les clichés axiaux à 30° sont de réa-
lisation délicate, et, lorsque le degré de flexion est plus important,
l’instabilité ne peut être mise en évidence, d’où l’intérêt du cliché
de profil en faible flexion précédemment décrit, réalisé au début
de l’engagement de la rotule, à 30°.
D’autres examens peuvent également être pratiqués :
–le scanner, à visée préopératoire essentiellement (avec mesure
de la distance TAGT) ;
–l’arthroscanner, qui permet d’explorer le cartilage rotulien et
trochléen (fissure, ulcération, ostéochondrite) et de diagnostiquer
certaines rotules douloureuses avec blocages, par exemple un cla-
pet cartilagineux (figure 5) dans le contexte d’une pathologie
post-traumatique, voire une plica (seules les plicae internes et
médio-patellaires sont pathogènes) ;
–l’arthroscopie, de façon exceptionnelle, à titre diagnostique et
thérapeutique dans le cadre de ces lésions focales cartilagineuses
symptomatiques du compartiment fémoro-patellaire (blocage
douloureux, accrochage rotulien).
Aspects particuliers
des syndromes rotuliens
On peut ainsi décrire cliniquement un certain nombre de rotules
douloureuses par insuffisance musculaire du quadriceps, par sur-
charge mécanique liée à un excès pondéral, par hypersollicitation
professionnelle. Les douleurs antérieures du genou (6) survenant
lors de la pratique de sports comportant des sauts et des récep-
tions genoux fléchis en charge illustrent bien la surcharge de
travail dynamique excentrique de l’appareil extenseur et les
contraintes importantes exercées sur le compartiment antérieur
du genou. Il est parfois difficile de différencier dans ce cadre une
tendinopathie de la pointe de la rotule d’une atteinte cartilagi-
neuse fémoro-patellaire (chondropathie de la rotule et/ou de la
trochlée).
Les examens complémentaires, notamment la radio, permettent
d’affiner le diagnostic, en particulier en cas de rotule douloureuse
et instable. Certains syndromes rotuliens, notamment les chondro-
pathies fémoro-patellaires rencontrées en milieu sportif ou post-
traumatiques – faisant suite à une contusion – peuvent être explorés,
on l’a vu, par arthroscanner, et exceptionnellement sous arthro-
scopie. C’est le cas également des douleurs rotuliennes associées
à un conflit mécanique, avec présence d’un clapet cartilagineux,
d’une plica, etc. Dans les tendinopathies de l’appareil extenseur,
l’imagerie par résonance magnétique (IRM) peut apporter des
précisions diagnostiques. Enfin, dans bon nombre de situations,
notamment décrites chez des patientes jeunes, on est face à des
rotules douloureuses pures ou “essentielles” sans étiologie évidente
et pour lesquelles les explorations sont négatives…
La Lettre du Rhumatologue - n° 315 - octobre 2005
31
Figure 3. Signe du croisement. F : fond de la trochlée ; BE : berge externe ;
BI : berge interne.
Figure 4. Mesure de la hauteur de la rotule. AT : distance entre rotule et
rebord antéro-supérieur tibia ; AP : longueur face articulaire de la rotule.
Figure 5. Clapet cartilagineux à l’arthroscanner.

MISE AU POINT
TRAITEMENT
Le traitement des syndromes rotuliens fait souvent appel à la
rééducation.
Si les rotules douloureuses potentiellement instables doivent faire
l’objet, avant toute indication chirurgicale, d’une rééducation clas-
sique, laquelle passe souvent par un renforcement en isométrique
du vaste interne, le traitement des souffrances de l’appareil exten-
seur sur rotule centrée, qu’il s’agisse d’une chondropathie ou d’une
tendinopathie rotulienne, semble plus délicat.
Actuellement, dans les douleurs antérieures du genou, il semble
admis que les exercices musculaires dynamiques en chaîne ciné-
tique ouverte et les exercices en chaîne cinétique fermée (30 pre-
miers degrés de flexion) donnent des résultats tout à fait comparables
et équivalents à long terme (7). Dans les atteintes de type chondro-
pathie, la rééducation doit être prudente et bien adaptée, en dosant
bien les exercices de renforcement du quadriceps en statique et en
dynamique, et en pratiquant des étirements de la chaîne musculaire
antérieure. Dans les tendinopathies en contexte sportif, on insistera
également sur les postures d’étirement, mais on aura plus volontiers
recours à un travail de renforcement excentrique (protocole de
Stanish).
Il est donc primordial d’évaluer correctement chaque patient avant
d’entreprendre une rééducation, celle-ci devant être la plus adaptée
possible. Il faut faire la part entre la gêne fonctionnelle liée à la dou-
leur et le caractère instable de la rotule, avec dysfonctionnement
avéré de l’appareil extenseur. Il est ainsi nécessaire de prendre en
considération les éléments suivants pour orienter la rééducation :
défaut d’engagement rotulien, insuffisance musculaire du qua-
driceps et notamment du vaste interne, aspect rétracté du droit anté-
rieur ou des ischio-jambiers, rétraction ou au contraire laxité
d’un aileron rotulien avec hypermobilité de la rotule, etc., toutes
anomalies accessibles aux techniques de rééducation. Ces tech-
niques de rééducation seront le plus souvent combinées, dans
ces syndromes rotuliens, pour apporter une réelle efficacité théra-
peutique.
L’ordonnance de rééducation pourrait alors se concevoir de
la façon suivante :
–massage relaxant du quadriceps et physiothérapie antal-
gique (ultrasons, ionisations) sur les ailerons et/ou le tendon
rotulien ;
–travail équilibré d’étirement des chaînes musculaires (droit
antérieur et ischio-jambiers) ;
–renforcement musculaire du quadriceps contre résistance, avec
travail statique puis travail dynamique contre résistance, de façon
progressive, à partir d’un secteur d’amplitude protégé ne dépas-
sant pas 30° au départ (proche de l’extension) ;
–renforcement des ischio-jambiers entre 0° et 60° pour faciliter
et soulager le travail du quadriceps ;
–reprogrammation neuromusculaire du genou avec travail de
contrôle du vaste interne et des rotateurs internes jambiers (réédu-
cation proprioceptive pour lutter contre la tendance à l’instabilité
rotulienne).
Enfin, le traitement des rotules douloureuses chroniques sans fac-
teur étiologique clairement identifié reste délicat. Il paraît davan-
tage basé sur l’autorééducation et l’éducation du patient que sur
la rééducation, qui peut être mal tolérée. Un concept développé
assez récemment (8)parle de douleurs par surutilisation des struc-
tures fémoro-patellaires anatomiquement normales et de dépas-
sement de la “charge de travail compatible”, avec franchissement
d’un seuil au-delà de “l’équilibre homéostasique” pouvant induire
l’apparition de lésions cartilagineuses ; ce qui implique sur le plan
thérapeutique l’application du principe de restauration de “l’en-
veloppe de fonction” conforme aux possibilités fonctionnelles
articulaires du sujet. Ce dernier doit apprendre à effectuer les acti-
vités quotidiennes sollicitant son appareil extenseur sans surmener
son genou, en adaptant la charge de travail et en connaissant les
limites à ne pas dépasser. Ces limites varient d’un sujet à l’autre
et en fonction du type d’activité sportive pratiquée. Aux activités
sportives peuvent être schématiquement attribués différents niveaux
de risque selon le type d’activité pratiquée, sa durée et son inten-
sité : sport avec sauts et impulsions à forte charge excentrique et
contraignant pour l’appareil extenseur ; sport intermédiaire comme
le vélo, qui ne semble pas délétère quand il est pratiqué de façon
dosée ; enfin, la marche, qui peut être pratiquée sur une durée plus
importante en terrain plat sans causer aucune surcharge de travail
pour l’appareil extenseur.
Le traitement chirurgical des rotules douloureuses doit rester
exceptionnel.
Les interventions arthroscopiques de shaving cartilagineux
(débridement) n’ont qu’un effet “cosmétique” sur le cartilage, et
leur efficacité n’a pas été mise en évidence ; en revanche, les
suites douloureuses et les algoneurodystrophies sont fréquentes.
Les seules indications reconnues sont les résections de clapets
cartilagineux, dont la preuve doit être faite sur l’imagerie pré-
opératoire (arthroscanner, voire arthro-IRM). Les ostéochon-
drites fémoro-patellaires peuvent, elles aussi, bénéficier d’un trai-
tement arthroscopique, à condition que l’imagerie préopératoire
montre une lésion ouverte en intra-articulaire avec effraction du
cartilage. Les interventions de réparation cartilagineuse ont
donné des résultats décevants pour l’articulation fémoro-
patellaire, qu’il s’agisse de greffe ostéochondrale ou de culture
de chondrocyte.
Les rotules douloureuses associées à des critères objectifs cliniques
et radiographiques d’instabilité peuvent faire l’objet d’un traite-
ment chirurgical. Le bilan radiographique préopératoire, et en par-
ticulier l’incidence fémoro-patellaire, doit rechercher subluxation
et bascule rotulienne. Ces deux déformations peuvent être isolées
ou coexister. Les sections d’aileron externe ne doivent être pro-
posées que dans les bascules isolées sans subluxation, et après échec
du traitement conservateur. Les rotules douloureuses et instables
peuvent dans de rares cas bénéficier d’un traitement chirurgical.
Nous préférons les gestes isolés sur l’appareil extenseur associant
recentrage tibial (TTTA) et abaissement rotulien plutôt que les
gestes de recreusement trochléen, dont la iatrogénie arthrosique
nous semble trop élevée.
Dans les instabilités objectives (luxations et subluxations récidi-
vantes), notre préférence va là encore aux gestes de recentrage de
l’appareil extenseur ;il est probable que la réparation de l’aileron
rotulien interne dès le premier accident permette, en cas de trauma-
tisme inaugural chez un sujet jeune, de prévenir l’évolution vers la
chronicité.
La Lettre du Rhumatologue - n° 315 - octobre 2005
32

MISE AU POINT
En conclusion, le rhumatologue, dans sa pratique courante, face
à un syndrome rotulien douloureux, doit essayer d’apprécier le
caractère potentiellement instable de la rotule et évaluer par un
examen clinique ciblé et des clichés standard adaptés les éléments
pouvant faire évoquer une dysplasie rotulienne ou trochléenne.
Dans ce cadre, l’indication chirurgicale est possible, mais dans de
très nombreux cas le traitement reste médical et basé sur la réédu-
cation la plus appropriée possible. Il ne faut pas méconnaître cer-
taines lésions plus rares responsables de blocage ou d’instabilité,
comme le clapet cartilagineux ou les ostéochondrites de la rotule,
qui peuvent être explorées notamment par arthroscanner et qui
peuvent faire l’objet d’un traitement sous arthroscopie. Enfin, dans
les nombreuses situations où l’on a affaire à une rotule centrée dou-
loureuse sans cause évidente, sinon une charge de travail excessive
de l’appareil extenseur, l’attitude doit être strictement médicale,
consistant à éduquer le patient et à lui indiquer des exercices per-
mettant de diminuer les contraintes sur son compartiment fémoro-
patellaire.
■
Bibliographie
1. Thomee R, Augustsson J, Karlsson J. Patellofemoral pain syndrome, a review
of current issues. Sports Med 1999;245-62.
2. Dejour H. 8es Journées lyonnaises de chirurgie du genou, avril 1995.
3. Maldague B, Malghem J. Apport du profil de genou dans le dépistage des insta-
bilités rotuliennes. Rev Chir Ortho 1985;71(Suppl. 2):5-13.
4. Caton J, Deschamps G, Chambat P, Lerat JL, Dejour H. Les rotules basses : à
propos de 128 observations. Rev Chir Ortho 1982;68:317-25.
5. Davies AP, Bayer J, Owen-Johnson S et al. The optimum knee flexion angle for
skyline radiography is thirty degrees. Clin Orthop 2004;423:166-71.
6. Le Goux P, Hardy P. Démembrement des douleurs antérieures du genou.
Synoviale 2003;118:29-34.
7. Witvrouw E, Danneels L, van Tiggelen D et al. Open versus closed kinetic chain
exercises in patellofemoral pain: a 5 year prospective randomised study. Am J
Sports Med 2004;32:1122-30.
8. Dye SF. Patellofemoral pain: current concepts, an overview. Sports Med Arthr
Review 2001;9:264-72.
La Lettre du Rhumatologue - n° 315 - octobre 2005
33
Les articles publiés dans “La Lettre du Rhumatologue” le sont sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction par tous procédés réservés pour tous pays.
EDIMARK SAS © mai 1983
Imprimé en France - Differdange SA - 95110 Sannois - Dépôt légal : à parution
Le supplément “Les nouvelles des rhumatismes inflammatoires” (12 pages) est routé avec ce numéro.
L’index 2004 (8 pages) est routé aux abonnés payants.
1
/
5
100%