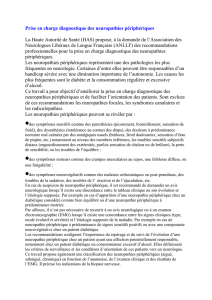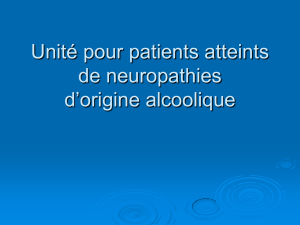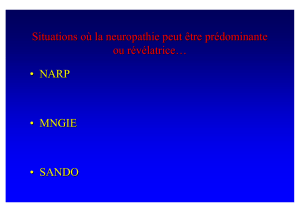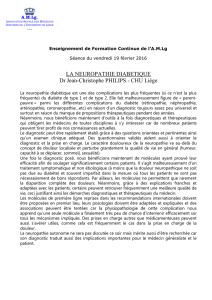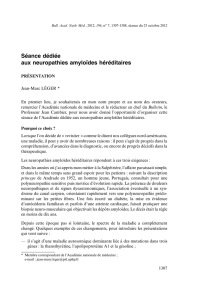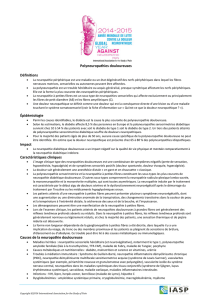Lire l'article complet

REVUE DE PRESSE
Dirigée par le Pr P. Amarenco
205
La Lettre du Neurologue - vol. IX - n° 6 - juin 2005
Risque hémorragique
de malformations artério-
veineuses traitées
par radiochirurgie
et considérées
comme traitées : attention !
■La radiochirurgie est un traitement
de référence des malformations arté-
rio-veineuses (MAV). Le succès de cette
thérapeutique est jugé sur l’oblitération
angiographique, considérée comme élimi-
nant tout risque de saignements. Ces
auteurs japonais ont repris les cas de
236 patients porteurs de MAV traités avec
succès par radiochirurgie, c’est-à-dire par
une oblitération angiographique, avec un
recul moyen de plus de 6 ans.
Ils ont identifié 4patients qui ont eu un
accident hémorragique entre 16 et 51 mois
après l’oblitération angiographique, avec
peu de conséquences neurologiques
(2 aggravations d’un déficit préexistant).
L’analyse histologique des pièces opéra-
toires a montré la persistance de résidu de
MAV. Le risque hémorragique annuel a été
de 0,6 %, avec un risque cumulatif de
2,2 % sur une période de 10 ans. La persis-
tance d’une prise de contraste au scanner
ou à l’IRM a été le seul facteur associé de
façon statistiquement positive au risque
hémorragique.
La conclusion de ce travail est limitée par
le nombre réduit de cas. Néanmoins, il sou-
ligne l’impossibilité de conclure de façon
certaine à l’absence de risque hémorra-
gique d’une MAV traitée avec oblitération
angiographique prouvée, surtout en cas de
persistance d’une prise de contraste sur
l’IRM ou le scanner. Un suivi prolongé est
donc recommandé par les auteurs.
Commentaire. Les auteurs ont prouvé
qu’il existait un risque hémorragique pour
une MAV traitée par radiochirurgie avec
oblitération artériographique totale. Ce
risque est faible, plus faible que le risque
hémorragique d’une MAV non traitée. Par
ailleurs, il semble, au vu de ces 4 cas, que
la conséquence clinique du saignement soit
limitée. Le fait qu’il existe une corrélation
significative entre la persistance d’une
prise de contraste du nidus au scanner ou à
l’IRM et le risque hémorragique pourrait
faire discuter la résection “préventive”,
chez un patient jeune et en bonne santé, de
cette lésion située en zone non éloquente.
M. Kalamarides, service de neurochirurgie,
hôpital Beaujon, Paris.
Faire taire un gène
pour traiter la SLA
■L’interférence ARN est considérée
comme une innovation thérapeu-
tique majeure. Son principe consiste à uti-
liser un mécanisme cellulaire ancestral de
régulation de la production d’ARN pour
“éteindre” un gène délétère. Les ARN
interférents (ARNi) sont des petits brins
d’ARN double brin d’une vingtaine de
nucléotides. Ils ne sont pas traduits et diri-
gent le clivage de l’ARNm du gène cible
via un complexe enzymatique, produisant
un silence apparent du gène. Deux études,
publiées simultanément dans Nature
Medicine,ont conclu à l’efficacité de cette
approche, couplée à la thérapie génique,
chez les souris transgéniques mutantes
pour la SOD1, un modèle animal de SLA
familiale. L’équipe de l’université
d’Oxford (1) a testé l’injection intramus-
culaire d’un Lentivirus contenant un ARNi
spécifique de la SOD1, profitant du trans-
port rétrograde de ce virus dans les moto-
neurones à partir de leur cible musculaire.
L’injection, réalisée chez des souris de
7jours, ciblait préférentiellement les
pattes arrière, la face, la langue et le dia-
phragme, qui a un rôle déterminant dans
l’aggravation de la SLA. Une prolongation
spectaculaire de 80 % de l’espérance de
vie était observée. L’apparition des signes
cliniques, évaluée au moyen d’un rotarod
test,était retardée de 115 %. L’équipe
suisse de P.Aebischer (2) a utilisé l’injec-
tion des Lentivirus porteurs de l’ARNi
directement dans la moelle lombaire chez
des souris plus âgées (40 jours). L’effet
thérapeutique était moins impressionnant,
l’apparition des signes moteurs et le décès
étant retardés de 20 jours.
Commentaire. L’effet de l’approche par
thérapie génique musculaire est majeur, et
va bien au-delà de tout ce qui a été rap-
porté jusqu’à maintenant dans le modèle
SOD1. Cela constitue un argument en
faveur de l’ARNi, par rapport à l’approche
“anti-sens” concurrente. Il est utile d’insis-
ter sur le fait que ces stratégies ne concer-
nent que les formes liées à la mutation
SOD1, qui ne représentent que 1 à 2 % des
cas de SLA.
P.F. Pradat, service de neurologie,
hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris.
Facteurs de risque
cardiovasculaire
dans les occlusions
rétiniennes veineuses
et artérielles
■Les occlusions vasculaires réti-
niennes artérielles et veineuses sont
fréquentes dans la population de plus de
50 ans, et sont associées à un risque plus
élevé d’accident vasculaire cérébral (AVC)
et de mortalité cardiovasculaire. Cette
étude a pour but d’évaluer l’association
entre les maladies cardiovasculaires et les
occlusions vasculaires rétiniennes arté-
rielles et veineuses chez un grand nombre
de sujets (caucasiens et noirs américains)
vivant aux États-Unis. Les participants ont
été recrutés à partir des études ARIC
(Atherosclerosis Risk in Communities Study;
n=12642; âge moyen: 60ans) et CHS
(Cardiovascular Health Study ; n=2824;
âge moyen : 79 ans). Les occlusions
vascu-
laires rétiniennes artérielles et veineuses
ont été diagnostiquées sur une photogra-
phie du fond d’œil prise lors de l’inclusion
dans les deux études. La présence d’un
signe du croisement artérioveineux et d’un
retrécissement artériolaire localisé a égale-
ment été recherchée. Tous les participants
ont bénéficié d’une étude détaillée des fac-
❶
Ralph GS, Radcliffe PA, Day DM et al. Silencing
mutant SOD1 using RNAi protects against neuro-
degeneration and extends survival in an ALS
model. Nat Med 2005;11:429-33.
❷
Raoul C, Abbas-Terki T, Bensadoun JC et al.
Lentiviral-mediated silencing of SOD1 through
RNA interference retards disease onset and pro-
gression in a mouse model of ALS. Nat Med
2005;11:423-8.
✔
Shin M, Kawahra N, Maryuma K et al. Risk of
hemorrhage from an arteriovenous malforma-
tion confirmed to have been obliterated on
angiography after streotactic radiosurgery.
J Neurosurg 2004;102:842-6.

206
REVUE DE PRESSE
Dirigée par le Pr P. Amarenco
La Lettre du Neurologue - vol. IX - n° 6 - juin 2005
teurs de risque cardiovasculaire, y compris
un écho-Doppler carotidien. Les préva-
lences respectives des occlusions réti-
niennes veineuses et artérielles étaient de
0,3 % (n = 39 cas) et 0,2 % (n = 34 cas).
Après ajustement sur l’âge, les occlusions
veineuses rétiniennes étaient associées à
l’hypertension artérielle (odds-ratio [OR] :
2,96 ; IC
95
:1,43-6,14), à la pression artérielle
systolique (OR : 4,12 ; IC
95
:1,40-12,16), à la
pression artérielle diastolique (OR : 2,64 ;
IC
95
:1,07-6,46), à la présence d’une plaque
athéromateuse carotidienne (OR : 5,62 ;
IC
95
:2,60-12,16), à l’indice de masse corpo-
relle (OR : 3,88 ; IC
95
:1,23-12,18), au fibri-
nogène plasmatique (OR : 3,29 ; IC
95
:1,08-
10,02), à un signe du croisement
artérioveineux rétinien (OR : 4,09 ; IC
95
:
2,00-8,36) et à un rétrécissement artériel réti-
nien localisé (OR : 5,17 ; IC
95
:2,59-10,29).
Après ajustement sur l’âge, les emboles
artériolaires rétiniens étaient associés à
l’hypertension artérielle (OR : 3,14 ; IC95 :
1,44-6,84), à la pression artérielle systo-
lique (OR : 3,46 ; IC95 :1,13-10,65), à la
maladie coronarienne (OR : 2,33 ; IC95 :
1,01-5,42), à la présence d’une plaque
carotidienne (OR : 4,62 ; IC95 :1,85-
11,57), à la lipoprotéine A) plasmatique
(OR : 3,69 ; IC95 :1,20-11,41), au fibrino-
gène plasmatique (OR : 3,09 ; IC95 :0,98-
9,76) et au tabagisme (OR : 3,08 ; IC95 :
1,47-6,47). Environ un quart des sujets
ayant une occlusion veineuse et une occlu-
sion artérielle avaient une plaque caroti-
dienne athéromateuse sur l’écho-Doppler.
Commentaire. Cette étude confirme que
les occlusions veineuses et artériolaires
rétiniennes sont associées à l’athérome
carotidien, à l’hypertension artérielle
et à d’autres facteurs de risque cardio-
vasculaire. Néanmoins, la présence d’une
sténose carotidienne chez ces patients est
souvent le simple reflet de la maladie athé-
romateuse, et l’endartérectomie caroti-
dienne est le plus souvent non indiquée.
V. Biousse, Emory University, Atlanta, GA.
Fenestration de la gaine
du nerf optique en pédiatrie
■La décision de traiter chirurgicale-
ment des enfants présentant un syn-
drome d’hypertension intracrânienne idio-
pathique est fondée sur la sévérité des
céphalées et de l’atteinte de la fonction
visuelle. Comme il est souvent difficile
d’évaluer la fonction visuelle des jeunes
enfants, le traitement chirurgical est en
général réalisé précocement, afin de préve-
nir l’atteinte visuelle. Les dérivations du
liquide cérébrospinal sont populaires chez
les enfants, mais les fenestrations de la
gaine du nerf optique sont également
utiles. Elles sont souvent réalisées par les
ophtalmologistes américains, bien qu’il y
ait peu de données sur ce sujet dans la lit-
térature.
Cet article présente les résultats de la
fenestration du nerf optique réalisée chez
12 enfants (17 yeux) âgés de moins de
16 ans ayant une hypertension intracrâ-
nienne chronique (11 avec le syndrome
d’hypertension intracrânienne idiopa-
thique et un avec une méningite chro-
nique). Tous les patients avaient un œdème
papillaire et étaient traités par acétazola-
mide sans amélioration notable. L’âge
moyen des enfants était de 10,1 ans
(extrêmes de 5,1 à 16 ans). Le suivi moyen
était de 39,6 mois. Les céphalées consti-
tuaient le symptôme le plus fréquent.
L’œdème papillaire s’est amélioré chez
tous les patients. L’acuité visuelle soit
s’est améliorée, soit est restée stable, pour
tous les yeux opérés. Une dérivation lom-
bopéritonéale a été nécessaire chez un
patient, et deux patients ont été maintenus
sous acétazolamide. Aucun patient n’a eu
d’infection postopératoire, de baisse
visuelle ou de diplopie. Chez cinq patients,
une fenestration controlatérale a été néces-
saire.
Commentaire. Cette étude rétrospective
confirme que la réalisation d’une fenestra-
tion de la gaine du nerf optique est pos-
sible chez les enfants ayant un syndrome
d’hypertension intracrânienne idiopa-
thique. Les résultats sont comparables à
ceux observés chez les adultes. Cette
approche permet d’éviter une dérivation
du liquide cérébrospinal, qui n’est pas sans
complications chez les enfants.
VB
Chirurgie carotide
et coronaire combinée :
quel risque ?
■Les auteurs ont étudié, via le PMSI
canadien (1992-2001), les risques
d’une chirurgie simultanée – ou quasi
simultanée, durant la même hospitalisa-
tion – associant endartérectomie (EA)
carotide et pontage aorto-coronaire (PAC)
[n = 669]. Ils ont comparé les risques
observés à ceux de la chirurgie caroti-
dienne seule (n = 131 762). Après ajuste-
ment, la mortalité (4,9 % versus 3,3 %)
n’était pas plus importante dans le groupe
EA + PAC que dans le groupe PAC seul,
mais le risque d’infarctus cérébral passait
de 1,8 % en cas de chirurgie coronaire
seule à 6,8 % en cas de double interven-
tion, soit un risque combiné de décès +
infarctus cérébral de 13 % significative-
ment plus élevé dans le groupe EA+ PAC
(RR : 2,67).
Commentaire. De ce travail, les auteurs,
prudents, ne tirent pas d’enseignement
particulier, et suggèrent bien sûr une
étude prospective et randomisée. Ils notent
en effet que, au fil des ans, la proportion
de patients ayant subi une double opé-
ration (EA + PAC) augmente globale-
ment, avec des différences selon les
régions du pays, ce qui reflète bien l’ab-
sence de consensus clair sur cette ques-
tion. Aux États-Unis, ce sont près de
2,1 % des patients qui sont opérés simul-
tanément, avec un taux combiné de
décès + infarctus cérébral de 17,7 %. En
France ou en Europe, on peut regretter
l’absence de données publiées sur ce
sujet de santé publique, car, finalement, la
question d’une chirurgie combinée se
pose plus souvent qu’on ne le croit : on
estime que 22 % des patients opérés des
coronaires ont une sténose carotide supé-
✔
Wong TY, Larsen EK, Klein R et al.
Cardiovascular risk factors for retinal vein occlu-
sion and arteriolar emboli: the Atherosclerosis
Risk in Communities and Cardiovascular Health
studies. Ophthalmology 2005;112:540-7.
✔
Thuente DD, Buckley EG. Pediatric optic nerve
sheath decompression. Ophthalmology 2005;
112:724-7.

207
La Lettre du Neurologue - vol. IX - n° 6 - juin 2005
rieure à 50 %, et que 30 % des patients
candidats à l’endartérectomie carotide ont
des lésions coronaires susceptibles d’être
pontées. Enfin, l’angioplastie, associée ou
non à un stenting carotidien et proposée
pour des malades à haut risque, mérite
également une mention parmi les options
proposées, et aurait sa place dans une
étude comparative. Actuellement, et à
défaut de résultats consensuels, la décision
est prise au cas par cas en fonction des
équipes hospitalières et des techniques
localement disponibles.
J. d’Anglejan-Chatillon, Versailles.
Biopsie de l’artère temporale
dans les dissections
■Les auteurs ont analysé et comparé
des biopsies d’artères temporales
chez 9 patients âgés d’environ 40ans et
ayant souffert d’une dissection d’une ou
de plusieurs artères cervicales à la phase
semi-précoce (1 à 11 semaines des pre-
miers symptômes) et chez des témoins
vivants (2 contrôles) ou à partir de prélève-
ments autopsiques. Les coupes furent exa-
minées en microscopie optique et électro-
nique par des anatomo-pathologistes non
informés des données cliniques. La princi-
pale donnée de cette étude est la présence
d’hématies et de quelques cellules immuno-
compétentes dans les couches externes des
artères chez les patients biopsiés, mais
aussi d’une faiblesse relative (amincisse-
ment) à la jonction entre la limitante élas-
tique externe et l’adventice de l’artère.
Commentaire. Ce travail est certes impar-
fait,
les deux populations comparées étant
un peu différentes et l’effectif réduit. Il
permet cependant d’aborder, via la mor-
phologie artérielle, la question de la phy-
siopathologie des dissections artérielles
cervicales : pourquoi existe-t-il une corré-
lation à certaines saisons, à des épisodes
viraux ? Pourquoi des cas de dissections
multiples ou récidivantes ? Y aurait-il chez
certains patients des maladies du tissu
conjonctif a minima – en dehors des cas
(rares) de maladies du tissu
conjonctif
(Marfan, Ehlers-Danlos type IV)?
Enfin, où
siège le défaut initial : déchirure de l’in-
tima, saignement des vasa vasorum dans
la paroi de l’artère ? Les données publiées
suggèrent qu’il existerait peut-être à la
phase précoce des dissections une artério-
pathie généralisée, avec une fragilité par-
ticulière des couches les plus externes de
l’artère. Il reste à confirmer ces travaux
par d’autres études portant sur de plus
grandes séries, peut-être par des méthodes
moins invasives que la biopsie, et à voir
s’il en découle des pistes intéressantes en
termes de traitement.
JAC
La Lp-PLA2, nouveau candidat
comme facteur de risque
cardiovasculaire
■La phospholipase Lp-PLA2 (lipopro-
tein-associated phospholipase A2) est
un marqueur de l’inflammation vasculaire.
L’enzyme circulante, liée au LDL-cholesté-
rol, favorise, par l’hydrolyse des phospholi-
pides, la production de lysophosphatidyl-
choline et d’acides gras oxydés. Son action
anti-inflammatoire résulte de l’hydrolyse du
PAF (platelet activating factor).
La Rotterdan Study, étude de cohorte
comprenant 7 983 sujets âgés d’au moins
55 ans, a analysé 418 événements isché-
miques (308 coronaires et 110 cas vascu-
laires cérébraux) et les a comparés à
1820 témoins choisis au hasard. L’analyse
multivariée, après ajustement sur l’âge, le
sexe, l’index de masse corporelle, la pres-
sion artérielle systolique, le cholestérol
total et le HDL-cholestérol, le diabète, la
consommation de tabac ou d’alcool, le
traitement hypolipémiant, le taux de leu-
cocytes et la CRP, met en évidence une
relation significative entre maladie coro-
naire, accident vasculaire cérébral isché-
mique (AVCI) et taux de Lp-PLA2. La
comparaison selon les quartiles de Lp-PLA2,
montre que le risque de survenue d’une
maladie coronaire et d’AVCI augmente
selon le quartile de Lp-PLA2 avec un
risque relatif de 1,39, 1,97 et 1,99 respec-
tivement dans les second, troisième et der-
nier quartiles comparativement au premier
quartile pour l’événement coronaire, et de
1,08, 1,58 et 1,97 pour l’événement vascu-
laire cérébral.
Commentaire. La Lp-PLA2 aurait ainsi
une valeur prédictive sur le risque de sur-
venue de maladie coronaire et d’AVCI
dans une population générale. Il reste à
démontrer, pour qu’elle puisse être consi-
dérée comme un facteur de risque, que sa
diminution est associée à une réduction de
l’incidence de ces mêmes événements.
P.J. Touboul, Paris.
Stimulation de l’aire cingulaire
subgénuale dans la dépression
réfractaire
■L’équipe de H. Mayberg a montré en
imagerie chez des malades dépressifs
une hyperactivité métabolique de l’aire cin-
gulaire subgénuale, ou aire 25 de Brodman
(Cg25). Cette hyperactivité se normalise
sous traitement antidépresseur efficace.
Partant de cette observation, Mayberg
(département de neurologie, université de
Toronto, maintenant Emory University,
Atlanta) et Lozano (département de neuro-
chirurgie, université de Toronto) ont fait le
pari de stimuler la substance blanche adja-
cente à l’aire Cg25 pour voir si cette tech-
nique permettait de modifier conjointement
l’humeur et l’activité métabolique de cette
aire chez des malades dépressifs. Six
malades remplissant les critères DSM IV
d’une dépression majeure résistante aux trai-
tements avec un épisode dépressif sévère
(score > 20 sur l’échelle de Hamilton) depuis
au moins un an ont participé à l’étude. La sti-
mulation bilatérale (paramètres moyens 4V,
60µs, 130Hz) a entraîné un effet bénéfique
sur l’humeur, en aigu, dès la mise en route ;
et un arrêt en aveugle était suivi d’une perte
✔
Lipoprotein-associated phospholipase A2 acti-
vity is associated with risk of coronary heart
disease and ischemic stroke. The Rotterdam
Study. Circulation 2005;111:570-5.
✔
Mill MD, Shrive FM, Kennedy J et al.
Simultaneous carotid endarterectomy and coro-
nary bypass surgery in Canada. Neurology 2005;
64(8):1435-7.
✔
Völker W, Besselmann M, Dittrich R et al.
Generalized arteriopathy in patients with cervical
artery dissection. Neurology 2005;64:1508-13.

La Lettre du Neurologue - vol. IX - n° 6 - juin 2005
208
REVUE DE PRESSE
d’efficacité. Une amélioration du score de
dépression supérieure à 50% a été constatée
pour 4 des 6malades après 6mois de stimu-
lation. Tous les malades avaient une hyper-
activité de l’aire Cg25, et l’amélioration cli-
nique s’est accompagnée d’une diminution
importante du métabolisme de l’aire Cg25,
mesurée en TEP.
Commentaire. Dans vingt ans, cette étude
sera citée comme ayant inauguré le renou-
veau de la psychochirurgie. En effet, les
dépressions rebelles au traitement représen-
tent un challenge majeur pour la psychiatrie.
Certes, ces résultats devront être confirmés
par une étude portant sur un plus grand
nombre de malades et utilisant un protocole
en double aveugle. La valeur de la présente
étude réside dans le fait qu’elle part d’une
hypothèse physiopathologique et qu’elle
apporte la preuve de l’implication d’une
toute petite aire frontale dans la mélancolie.
Dans cette localisation, la stimulation céré-
brale est plus un outil physiopathologique
que thérapeutique. Une mini-ablation d’une
seule aire corticale avec des méthodes peu
invasives, comme par exemple le gamma
knife, pourrait à l’avenir guérir des dépres-
sions rebelles, ce qui changerait le quotidien
du psychiatre.
P. Krack, département de neurologie,
CHU de Grenoble.
Réserve cognitive :
l’épilepsie aussi !
■
Les auteurs ont cherché à détermi-
ner si la notion de réserve cognitive
développée dans le cadre de la maladie
d’Alzheimer pouvait également s’appli-
quer aux troubles cognitifs décrits dans
l’épilepsie. Pour cela, ils ont étudié l’im-
pact du niveau d’éducation de patients
épileptiques sur les troubles cognitifs
qu’ils pouvaient présenter. Soixante-
quatre patients épileptiques souffrant
d’épilepsie partielle (59 cas) ou générali-
sée (5 cas) ont été recrutés et ont bénéfi-
cié de deux évaluations neuropsycholo-
giques complètes à un an d’intervalle.
Trente et un patients présentaient un haut
niveau d’éducation, et 33 un bas niveau.
Les deux groupes étaient similaires en
termes de répartition épilepsie générali-
sée/partielle, en termes d’étiologies et de
réponse aux médicaments. Seul l’âge de
début différait (significativement plus bas
dans le groupe présentant un haut niveau
d’éducation). L’évaluation initiale a mon-
tré que de nombreux domaines cognitifs
étaient déficitaires dans les deux
groupes : mémoire immédiate et à long
terme, orientation, navigation et manipu-
lation mentale, langage, attention, pensée
abstraite. Le niveau d’éducation influen-
çait significativement les performances
cognitives (meilleures performances dans
le groupe présentant un haut niveau
d’éducation), à l’exception de deux
domaines : la mémoire à long terme et
l’orientation. L’évaluation à un an ne
montrait pas de modifications significa-
tives, le délai de réévaluation étant proba-
blement trop court pour mettre en évi-
dence des modifications notables.
Commentaire. Le concept de réserve
cognitive semble donc également s’appli-
quer aux troubles cognitifs de l’épilepsie,
ce qui semble logique. Néanmoins, l’épi-
lepsie n’est pas complètement compa-
rable à la maladie d’Alzheimer, et les
troubles cognitifs de l’épilepsie sont sou-
vent multifactoriels et influencés par dif-
férents facteurs déjà répertoriés dans des
études précédentes, tels que la durée
d’évolution de l’épilepsie, la localisation
lobaire en cas d’épilepsie partielle, l’étio-
logie, le nombre de crises secondairement
généralisées et enfin, bien entendu, le
nombre et le type de médicaments anti-
épileptiques administrés. Or, dans cette
étude, on ignore quelle est la répartition
lobaire des épilepsies partielles dans les
deux groupes, ainsi que le nombre et la
nature des médicaments administrés.
S. Dupont, unité d’épileptologie, hôpital de
la Pitié-Salpêtrière, Paris, et unité
INSERM 0224 Cortex et épilepsie.
De nouvelles causes
de neuropathie périphérique ?
Les maladies inflammatoires
digestives (maladie de Crohn
et RCH)
■Après avoir proposé la maladie
cœliaque il y a un peu plus d’un an
(Chin et al., 2003),le Centre des neuropa-
thies périphériques de New York (équipe
de Norman Latov) a mené une très large
étude rétrospective, à partir d’un fichier
informatisé, sur la survenue et les types de
neuropathie périphérique au cours des
maladies digestives inflammatoires (mala-
die de Crohn [MC] et rectocolite hémorra-
gique [RCH]). Après avoir éliminé tous les
patients ayant une autre cause évidente de
neuropathie, ils ont obtenu 18 patients
avec une neuropathie périphérique au
cours de la MC et 15 patients pour la RCH.
Il existe une prédominance masculine
importante chez ces patients (autour de
75 %), alors que ces maladies touchent
normalement les deux sexes de façon
égale. L’âge de début est en moyenne de
52 ans. Le type de neuropathie observé est
très variable: à peu près un tiers de neuro-
pathies démyélinisantes, un tiers de neuro-
pathies sensitives pures et un
tiers de poly-
neuropathies sensitivo-motrices
axonales.
Plus précisément, les auteurs ont observé,
pour la MC 3 CIDP, 2 neuropathies multi-
focales motrices à blocs de conduction,
11 polyneuropathies axonales (7 sensitivo-
motrices, 4 sensitives pures) et 2 neuropa-
thies sensitives des petites fibres, et, pour
la RCH, 4 CIDP, 7 polyneuropa
thies axo-
nales sensitivo-motrices et 4 neuro
pathies
des petites fibres. L’apparition de la neuro-
pathie après le début de la maladie diges-
tive est extrêmement variable, mais l’inter-
valle est surtout important pour les
neuropathies démyélinisantes, où il existe
d’ailleurs une prédominance féminine. Les
neuropathies sensitives, voire sensitives pu-
res
des petites fibres, surviennent signifi-
cativement plus tôt au cours de la maladie.
Le rôle d’une exposition au Flagyl®ou à
une carence vitaminique (B12) a été parti-
culièrement analysé. Certains patients
avaient bien sûr été traités, mais la neuro-
pathie a continué de progresser malgré
l’arrêt du traitement. Sur le plan thérapeu-
tique, les 9 patients avec une neuropathie
Dirigée par le Pr P. Amarenco
✔
Mayberg HS et al. Deep brain stimulation for
treatment-resistant depression. Neuron 2005;45:
651-60.
✔
Pai MC, Tsai JJ. Cognitive reserve and epilepsy.
Epilepsia 2005;46(Suppl.1):7-10.

La Lettre du Neurologue - vol. IX - n° 6 - juin 2005 209
démyélinisante ont répondu très favorable-
ment aux traitements immunomodula-
teurs. Mais,
point important, 11 patients
(5 MC et 6 RCH)
avec une axonopathie ont
été traités par Cortancyl®et/ou Ig i.v., avec
une efficacité faible ou modérée dans
9cas. Pour les auteurs, la survenue d’une
neuropathie périphérique, même axonale,
au cours de la MC ou de la RCH ne serait
pas une simple coïncidence, mais bien une
complication extradigestive à médiation
immunitaire de ces maladies.
Commentaire. Il s’agit effectivement de
la plus grande série publiée de neuropa-
thie au cours des maladies inflammatoires
digestives, avec une revue exhaustive de
la
littérature. Ce texte, accepté en 24 heures
(!)
par Brain et qui a pu bénéficier d’une
publication accélérée, n’est toutefois pas
indemne de critiques. On connaît la pré-
valence de la MC (20-40/100 000) et de la
RCH (70-150/100 000), mais les auteurs
ne précisent nulle part la prévalence de la
neuropathie au cours de leur série. Les
neuropathies au Flagyl®sont analysées à
travers la littérature, mais ne semblent pas
présentes dans leur cohorte. Elles doivent
pourtant être évoquées devant des neuro-
pathies très sensitives et douloureuses,
parfois très invalidantes et ataxiantes chez
des patients ayant reçu, en général, de
fortes doses (plusieurs dizaines, voire cen-
taines de grammes). Il y a également eu
des cas de neuropathie dysautonomique,
même s’ils ne sont pas observés dans cette
étude. Le point faible est, comme souvent
dans ce type d’étude rétrospective, l’utili-
sation d’une amélioration très discutable
et subjective des neuropathies axonales
chroniques sous traitements immunomo-
dulateurs comme argument pour en faire
des neuropathies liées à ces maladies
digestives par une médiation immunitaire.
Toutefois, on ne peut nier (et cela dès les
premières études) la survenue fréquente
de
neuropathies démyélinisantes aiguës
comme
chroniques au cours de ces mala-
dies. Comme pour le diabète, on peut
imaginer un facteur favorisant immuni-
taire. Pour les neuropathies axonales sen-
sitivo-motrices ou sensitives pures
“petites fibres”, une
ap
proche thérapeu-
tique immunitaire pourra
se discuter en
cas d’évolutivité nette, mais après élimi-
nation attentive des causes toxiques,
carentielles, et si possible avec une
meilleure caractérisation, en particulier
par une biopsie neuro-musculaire, ce der-
nier point n’ayant pas du tout été analysé
dans cette étude…
T. Maisonobe, fédération
de neurophysiologie clinique,
hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris.
✔
Gondim FA, Brannagan TH, Sander HW et al.
Peripheral neuropathy in patients with inflamma-
tory bowel disease. Brain 2005; 128:867-79.
La Lettre du Neurologue
vous souhaite un bel été et vous remercie
de la fidélité de votre engagement.
Le prochain numéro paraîtra en septembre 2005
1
/
5
100%