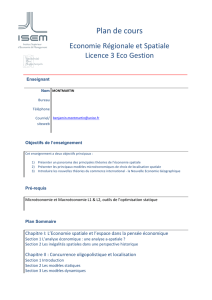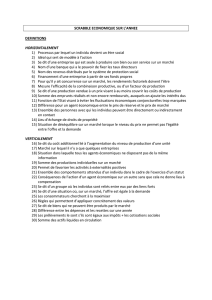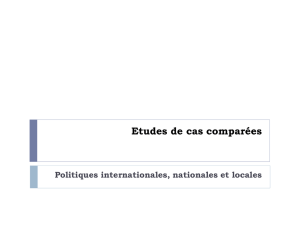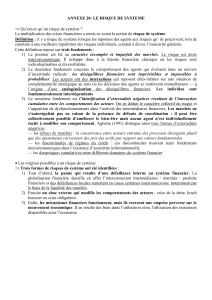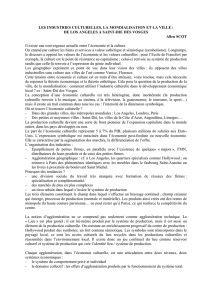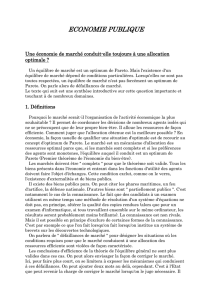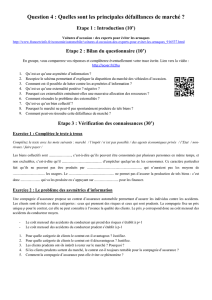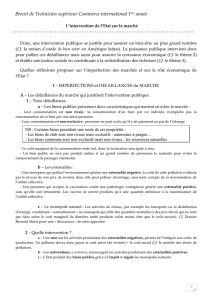SEMINAIRE D’ECONOMIE & FINANCE INTERNATIONALE Université d’Orléans Année universitaire

Université d’Orléans Année universitaire
2001-2002
Faculté de Droit , d’Economie et de Gestion
SEMINAIRE D’ECONOMIE & FINANCE INTERNATIONALE
DABOUSSI NOUREDDINE DEA ECONOMIE &FINANCE

2
Notre premier sujet porte sur « LA THEORIE DE LA GEOGRAPHIE
ECONOMIQUE », c’est un élément dont il convient de discuter autour de cette
table ronde.
Tout dabord: Quelles sont les principales raisons qui expliquent
l’agglomération des entreprises ou des ménages ? C’est précisément la première
question à laquelle nous devons réfléchir.
Le but est d’expliquer les trois raisons suivantes :
I/ Les externalités dans le cadre de la concurrence parfaite ;
II/ Les rendements croissants en situation de concurrence monopolistique ;
III/ Les interactions stratégiques associés à la concurrence spatiale.
Ensuite : Pourquoi certaines activités choisissent de se localiser en des endroits
particuliers que d’autres ? Et quels impacts, ces multiples décisions ont sur
l’organisation territoriale de l’économie ?
Le but est de savoir comment la distribution spatiale des activités économiques
change avec l’intégration des régions et des pays ; et aussi d’expliquer
l’existence où la formation des zones économiques. Ainsi, il s’agit de
comprendre comment les entreprises se répartissent sur les zones économiques
et comment vont se localiser les investissements.
De plus: Pourquoi les régions et les villes se spécialisent-elles dans des
activités différentes ?
En outre : Quels sont les éléments remis en cause par la Nouvelle Géographie
Economique (NGE) ?
La question concerne en général les avantages de la géographie économique la
plus ancienne et aux démarches « traditionnelles ».
Et enfin : Quelles sont les différentes approches traitant la Nouvelle
Géographie Economique (NGE) ?

3
INTRODUCTION :
La géographie économique, décrit, compare et explique l’organisation des activités au
sein des différents territoires concrets.
Krugman (1991) a définit « la géographie économique » comme étant « la
localisation spatiale de la production ». Beaucoup de littératures sur la localisation
industrielle, en particulier, ont ignoré le problème de la structure du marché.
Quelle est donc, la caractéristique la plus frappante de l’activité de la géographie
économique ? La réponse selon Krugman est bien sûre la concentration.
La concentration géographique de la production est une évidence claire de l’influence
générale de quelques types de rendements croissants.
L’observation de la localisation forte des industries n’est pas une chose nouvelle.
Vraiment, elle était comme une caractéristique frappante du processus de
l’industrialisation qui a attirée l’attention de tout le monde au 19éme siècle.
La littérature sur la localisation industrielle est beaucoup trop extensive. Il s’agit de
citer quelques exemples durant les années tels que Hoover [1948], Lichtenberg
[1960], et récemment, Porter [1990]. Il y a aussi un chevauchement considérable
entre le sujet de la localisation industrielle et l’économie urbaine ; des travaux
empiriques peuvent être trouvé comme les travaux de Bairoch [1988] , Jacobs
[1969] et [1984] et Henderson [1988].
Alfred Marshall [1920] a identifié trois raisons distinctes pour la localisation à
savoir :
•La concentration d’un nombre de firmes dans l’industrie dans la même place,
un centre industriel nous permet d’avoir un marché groupé pour les travailleurs
avec des compétences spécialisées ;
•Un centre industriel permet une provision spécifique à l’industrie dans une
grande variété et le plus bas coût ;
•Parce que l’information circule plus facilement au niveau locale que pour des
longues distances, un centre industriel génère ce qu’on appelle spillovers
technologique.
Selon Fujita et Thisse [1998], presque la moitié de la population mondiale et ¾ de
l’ensemble de l’occident vivent dans des grandes villes. Ainsi, la question
fondamentale qui se pose : pourquoi les activités économiques se localisent dans des
petites places (typiquement les grandes villes) ?
La configuration de l’équilibre spatial de l’activité économique peut être vue comme
le résultat d’un processus qui provoque deux types de forces, qui sont, les forces
d’agglomération (ou centripète) et les forces de dispersions (ou centrifuge).
Ainsi, il est intéressant que l’étude des modèles sur la géographie économique doit
inclure à la fois des forces centrifuges et des forces centripètes.

4
Parmi les questions essentielles qui sont examinées dans la littérature, les questions
principales sont :
(i) pourquoi existe t-il des forces poussant à l’agglomération ou à la dispersion des
activités économiques ?
(ii) pourquoi observe-t-on des regroupements formés d’agents différents ?
(iii) pourquoi les régions et les villes se spécialisent- elles dans des activités
différentes?

5
L’explication de l’agglomération et de dispersion :
Il est claire que le concept d’agglomération utilisé dans le papier de Fujita et Thisse
[1998] doit se référer aux différents phénomènes du monde réel. Par exemple, un type
d’agglomération apparaît lorsque les restaurants, le mouvement des théâtres ou les
magasins de vente, de même les produits sont groupés au sein du même quartier de
ville.
Autres types d’agglomérations peuvent être trouvé à travers l’existence des disparités
régionales fortes au sein du même pays, dans la formation des villes qui peuvent avoir
différentes tailles, ou dans l’émergence des régions industrielles où les firmes ont des
technologies puissantes.
La concentration géographique des activités économiques en certains lieux donne
naissance à un effet de boule de neige (Lecoq [1995]). De même, l’installation de
nouvelles entreprises incite des nouveaux travailleurs à émigrer car ils espèrent trouver
un mieux emploi et un salaire plus élevé .C’est ce qui crée des dispersions larges entre
les régions et entre même les travailleurs.
Ainsi, Puga [1996 b] a montré que l’agglomération est stimulée par le fait que le
travail se dirige vers les localisations où les salaires sont plus élevés. En effet, il
suggère que la faible motivation des travailleurs européens à migrer joue un rôle
important dans le fait que l’emploi non agricole est moins concentré
géographiquement en Europe qu’aux Etats-Unis , et les disparités de revenu plus
élevées entre régions européennes qu’au sein des Etats –Unis .
Venables a remarqué que lorsque les coûts de transactions sont nuls, les firmes ne
trouvent pas d’avantages à se localiser à proximité du reste de l’industrie, et se
localisent dans des régions où les salaires sont les plus faibles.
Helpman a modélisé une alternative intéressante en utilisant le modèle de Krugman
[1991 b], il a trouvé le résultat inverse de celui de Krugman : la réduction des coûts de
transaction réduit l’agglomération, et améliore la disponibilité des produits
manufacturés dans les zones les moins favorables, où les travailleurs migrent pour
limiter les coûts du logement.
On trouve des agglomérations de petite échelle dans des secteurs définis de manière
précise. L’industrie de production de tapis de la ville de Dalton en Georgie
( Krugman, [1991a ]), et l’industrie italienne du textile dans la ville de Prato ( Pyke,
Becattini & Sengenberger,[ 1990 ] ; Porter, [ 1990 ] )sont parmi les exemples les
plus célèbres de ce type de secteurs industriels fortement spécialisés .
De même, se trouvent des agglomérations de grande échelle qui dépassent les
frontières des Etats, comme la « ceinture industrielle » américaine et la « banane
chaude » européenne (espace compris entre Milan et Londres incluant l’Italie du nord,
l’Allemagne du sud, le sud-est de la France, la Ruhr, l’Ile-de-France la Belgique, les
Pays –Bas, et le sud-est de l’Angleterre).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%