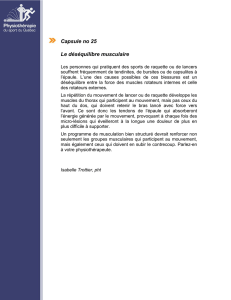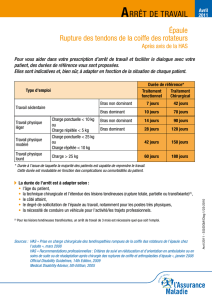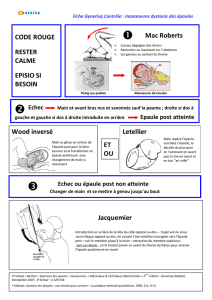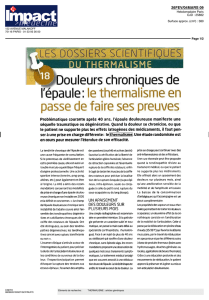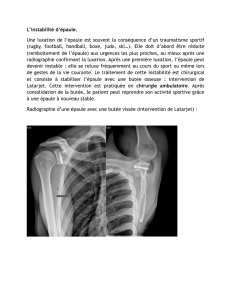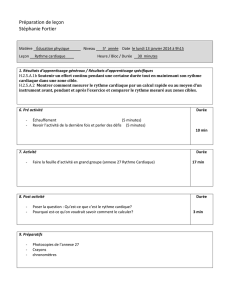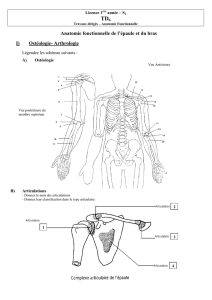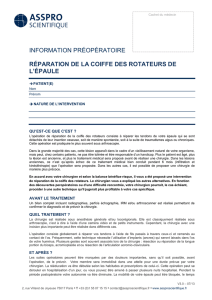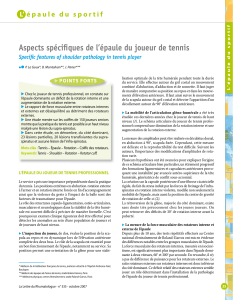n° 6 L Les présentations cliniques de l’épaule chez le tennisman

FICHE À DÉTACHER
Figure 1. Examen du conflit sous-acromial : tests de Hawkins et de Yocum.
© Photos P. Le Goux
Figure 2. Examen du conflit postéro-supérieur à l’armer.
© Photo P. Le Goux
La Lettre du Rhumatologue • No 360 - mars 2010 | 33
fiche
médecine du sport
Sous la responsabilité de son auteur P. Le Goux*
n° 6
Les présentations cliniques de l’épaule
chez le tennisman
* Rhumatologue médecin du sport, praticien attaché de l’hôpital Ambroise-Paré,
Boulogne-Billancourt ; médecin de la Fédération française de tennis,
consultant à l’Institut national du sport et de l’éducation physique (INSEP).
Les tendinopathies et conflits mécaniques sont fréquents chez
le tennisman au membre supérieur dominant, notamment à
l’épaule, qui symbolise l’articulation impliquée dans le geste
du lancer. L’examen clinique de l’épaule cible diverses pathologies
propres au joueur de tennis en fonction de son âge et de son niveau
de jeu. Cet examen programmé donnera une orientation intéressante
vis-à-vis des examens complémentaires d’imagerie, qui pourront être
demandés en première intention comme la radiographie standard
et l’échographie des tendons de la coiffe, ou en deuxième ligne
comme l’IRM et l’arthroscanner, afin d’effectuer un bilan lésionnel
plus précis.
On dissociera l’examen de l’épaule du joueur senior (figures1 et2),
qui a sollicité son épaule au travers de nombreux matches, et celui
de l’épaule du jeune joueur de haut niveau, qui présente les carac-
téristiques spécifiques encore plus marquées d’une épaule de lanceur.
•
L’épaule du tennisman senior, de 35ans et plus, peut être doulou-
reuse par atteinte des tendons de la coiffe et présenter des conflits
(extra- ou intra-articulaires), plus rarement être instable. Comme dans
tout sport de lancer, la pathologie neurologique de type microtrauma-
tique (nerf sus-scapularis, nerf grand dentelé) attestée par EMG peut
s’associer à ces diverses atteintes. Le service est bien sûr le geste qui
sollicite le plus les différentes structures anatomiques de l’épaule et
peut être le facteur déclenchant de ces diverses pathologies. Ainsi, les
conflits douloureux sont d’une grande fréquence chez le tennisman
senior et sont liés à un dysfonctionnement de l’épaule
(1)
:
– en premier lieu, le conflit sous-acromial ou antéro-supérieur, favo-
risé par la distension du plan capsulo-ligamentaire antérieur et la
pseudo-instabilité antérieure de la tête humérale lors du service.
Les douleurs se situent à la face antérieure ou supéro-latérale de
l’épaule (espace sous-acromial, articulation acromio-claviculaire). Ce
conflit, décrit initialement par Neer, peut également se manifester
lorsque le bras est en élévation et rotation interne au moment de
la frappe de la balle ;
– un autre conflit par impingement intra-articulaire
(2)
, dû aux forces
compressives engendrées à la partie postérieure de l’épaule par
l’hyper rotation externe sur le labrum postéro-supérieur. Des lésions
de la face articulaire de la coiffe (supra-spinatus, infra-spinatus)
peuvent s’associer à ce conflit, mais elles seraient la conséquence
de l’hyper-sollicitation de la coiffe lors du mouvement de rotation
interne forcée à la fin du service.

FICHE À DÉTACHER
Figure 4. Frappe avec pronation de
l’avant-bras : mise en jeu des rotateurs
internes et travail excentrique des rota-
teurs externes.
© Photo FFT
Figure 3.
Armer : mise en jeu des rotateurs
externes et des fixateurs de la scapula.
© Photo FFT
34 | La Lettre du Rhumatologue • No 360 - mars 2010
fiche médecine du sport n°6
•
Chez le joueur de tennis de la cinquantaine et plus, on observe, sur
le plan épidémiologique, une augmentation progressive de la fréquence
de la pathologie de coiffe liée à la fois à une hyperutilisation et à une
dégénérescence tendino-musculaire (lésions partielles ou transfixiantes).
Les lésions transfixiantes, dont la fréquence augmente significativement
à partir de 55ans, ne sont pas toutes symptomatiques et ne répondent
pas nécessairement à un parallélisme anatomo-clinique. Ainsi, une étude
échoclinique
(3,4)
, ouverte, menée comparativement sur les coiffes de
150joueurs seniors âgés de35 à 77ans (85joueurs et 65joueuses âgés
en moyenne de 57ans et 52ans respectivement) a permis de préciser
certains aspects spécifiques rencontrés chez le tennisman :
– à l’examen clinique, une douleur est retrouvée 10fois plus souvent à
l’épaule dominante, et le service est le coup le plus douloureux dans 55 %
des cas ;
– on note à9reprises une amyotrophie de la fosse infra- ou supra-spinatus,
témoin de l’atteinte du nerf sus-scapularis. Le décollement de l’omoplate
en relation avec l’atteinte du nerf de Charles Bell est retrouvé à 26reprises
du côté dominant, contre7 du côté opposé ;
– on retrouve, au bras dominant, une limitation significative de l’ampli tude
en rotation interne rétropulsion par rapport au côté opposé ;
– l’échographie montre 43lésions du supra-spinatus du côté dominant
(20transfixiantes et 23partielles, réparties sur les 2versants de la coiffe),
contre 16lésions (3complètes et 13partielles) du côté non dominant ;
– seules 3ruptures partielles du sub-scapularis sont retrouvées du côté
dominant, et aucune lésion du tendon infra-spinatus n’est constatée ;
– on note 8cas de rupture du tendon long biceps, tous du côté dominant ;
– l’épaississement de la bourse séreuse sous-acromiale (20 % des joueurs)
est 3fois plus fréquent du côté dominant ;
– le test de Jobe a une valeur prédictive assez faible dans la détection de
ces lésions (35 %), tandis que le test de rotation isométrique en position
RE1, habituellement utilisé pour tester l’infra-spinatus, semble donner ici
un résultat plus intéressant (50 %) ;
– les lésions constatées au bras dominant, malgré la présence d’une douleur
à l’examen chez 22 % des joueurs ou d’un antécédent douloureux chez
33 % d’entre eux, n’empêchent aucunement la pratique du tennis de
compétition ;
– les lésions transfixiantes, qui touchent 13 % des joueurs, sont excep-
tionnelles avant 45ans et augmentent après 55ans (18 %) pour atteindre
30 % à partir de 65ans, ce qui est comparable à la population générale.
• Chez le joueur de tennis de haut niveau ou le joueur professionnel, les
données de l’examen sont typiquement celles d’une épaule de lanceur :
on constate sur l’épaule dominante, comparativement au côté opposé, un
déficit de mobilité en rotation interne et une augmentation de la rotation
externe
(5)
.
Le rapport de force musculaire entre rotateurs internes et externes est en
revanche déséquilibré, au détriment des rotateurs externes sur l’épaule domi-
nante, d’où les risques de blessure. Les positions extrêmes lors du service
(abduction rotation externe à l’armer), la violence à l’impact de la balle,
la fin de geste en rotation interne forcée sont des facteurs traumatisants
pour l’épaule, notamment pour les structures intra- et extra-articulaires,
capsulo-ligamentaires, osseuses, musculaires ou encore neurologiques.
L’inspection du joueur, de dos, évalue la position de la scapula au repos et
de façon dynamique, lors de l’élévation antérieure complète des 2bras. Le
rôle de la scapula est essentiel pour un bon fonctionnement de l’épaule,
notamment au service. Sa position permet une orientation de la glène,
avec une stabilisation optimale de la tête humérale pendant toute la durée
du service. À l’examen, il faut juger de manière comparative sa position
au repos puis à l’effort et détecter un décollement autour de 90degrés
d’élévation du bras.
La mobilité de l’articulation gléno-humérale donne le schéma suivant chez
le joueur de tennis de haut niveau : diminution de la rotation interne,
augmentation de la rotation externe, mais diminution globale de l’arc de
rotation de l’épaule. La reproductibilité de ces mesures reste néanmoins
difficile et l’importance de ces modifications peut varier selon les cas.
Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer notamment le déficit
de rotation interne au bras dominant chez le tennisman professionnel :
Références bibliographiques
1. Van der Hoeven H, Kibler WB. Shoulder injuries in tennis
players. Br J Sports Med 2006;40:435-40.
2. Budoff JE, Nirschl RP, Ilahi OA, Rodin DM. Internal impingement
in the etiology of rotator cuff tendinosis revisited. Arthroscopy
2003;19(8):810-4.
3. Montalvan B, Parier J, Brasseur JL et al. Confrontation des
données cliniques et constatations échographiques de l’épaule
du tennisman vétéran. JTraumatol Sport 2002;19:197-207.
4. Brasseur JL, Lucidarme O, Tardieu M et al. Ultrasonic rotator
cuff changes in veteran tennis players: the effect of hand and
dominance and comparison with clinical findings. Eur Radiol
2004;14(5):857-64.
5. Kibler WB, Chandler TJ. Effect of age and years of tournament
play. Am JSports Med 1996;24:279-85.
6. Burkhart SS, Morgan CD, Kibler WB. The disabled throwing
shoulder: spectrum of pathology. PartII. Arthroscopy 2003;19.
– les mouvements répétitifs de l’armer (figure3) étirent progressivement
les formations ligamentaires et capsulaires antérieures, ce qui provoque une
instabilité par avancée antéro-supérieure de la tête humérale, génératrice
de conflit sous-acromial ;
– pour certains auteurs
(6)
, la capsule postérieure est le siège de forces
de distraction lors de la fin du mouvement de service. Le muscle infra-
spinatus, qui travaille essentiellement en excentrique dans cette phase,
freine la rotation interne (figure4). Il se crée alors, sur cette partie
postérieure de la coiffe, un stress anatomique à sa face profonde qui
aboutit à une fibrose cicatricielle rigide modifiant la mobilité de l’épaule
en rotation interne
(6)
.
La mesure comparative de la force musculaire des rotateurs interne et
externe de chaque épaule au moyen de tests répétitifs montre que celle-ci
est significativement plus importante à l’épaule dominante pour les rotateurs
internes, alors qu’il n’y a pas de différence de puissance pour les rotateurs
externes. On retrouve une différence significative concernant le rapport rota-
tion externe sur rotation interne, au détriment du côté dominant. Ce déficit
des rotateurs externes semble être à l’origine de la pathologie de l’épaule
du joueur de tennis de haut niveau. Dans le mouvement de service, à la fin
du service, après le “fouetté”, vers la fin de la rotation interne effectuée
de façon violente, le muscle infra-spinatus travaille en excentrique pour
freiner celle-ci et semble alors vulnérable dans ce travail. La prévention des
blessures chez ces joueurs de haut niveau passe certainement par l’entretien
de la mobilité articulaire et la restauration de la force des rotateurs externes.
Le travail des fixateurs de la scapula est également primordial. ■
1
/
2
100%