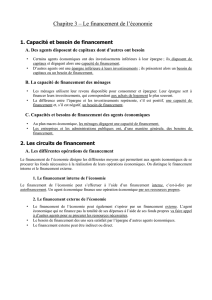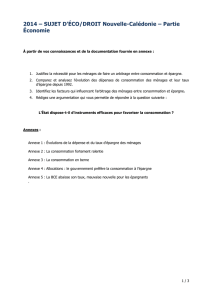emploi - Le Monde

Le Japon va mieux,
les Japonais moins bien
bSPÉCIAL COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES. Le 86econgrès
des maires de France, du 18 au 20 novembre
à Paris, s’intéressera notamment à
la décentralisation en matière de politique
de l’emploi. Une responsabilité
que revendiquent de plus en plus les élus
p. VII
FOCUS EMPLOI
F
ort de la majorité qu’a
conservée la coalition
gouvernementale aux
élections du 9 novem-
bre, et en dépit du recul
de sa formation politi-
que, le Parti libéral démocrate
(PLD), le premier ministre Junichiro
Koizumi a annoncé qu’il poursui-
vrait sa politique de « réformes
structurelles ». La montée de l’oppo-
sition et les divergences apparues
au sein de sa formation indiquent
pourtant que ce n’est pas ce qu’at-
tend une bonne partie de l’opinion.
Une discordance révélatrice de la
situation économique et sociale
contrastée du Japon. Depuis l’été,
celui-ci, rompant avec une décennie
de dépression, a renoué avec la
croissance et devrait voir son pro-
duit intérieur brut croître de 2,5 %
sur l’ensemble de l’année, plaçant
l’archipel parmi les économies mon-
diales en expansion. Une performan-
ce qui atténue l’annonce par Sony
de la suppression de 20 000 emplois
sur trois ans. La plupart des entrepri-
ses cotées en bourse ont enregistré
des profits en 2002, et l’indice Nik-
kei a bondi de 30 % en bourse, dopé
par les achats des investisseurs
étrangers. « Make no mistake : Japan
is back » (Ne vous y trompez pas ; le
Japon est de retour), estime Jesper
Koll, économiste en chef chez Mer-
rill Lynch. Assurément. Et pourtant,
selon les sondages, l’incertitude
pour l’avenir tenaille l’opinion et
chaque jour la presse se fait l’écho
de petits drames qui témoignent de
cette anxiété diffuse. En pendant au
Japon qui recouvre son dynamisme
industriel, celui des poches de luxe
ostentatoire et de la consommation
frénétique des marques, existe un
autre Japon où la sortie de crise ne
se mesure pas au redressement des
indices et à l’augmentation du nom-
bre des faillites.
La reprise est réelle, mais contras-
tée. Elle est moins due à la politique
réformiste de M. Koizumi qu’aux
restructurations (délocalisations,
réduction des effectifs, plus grande
flexibilité de l’emploi par l’augmen-
tation du travail précaire) auxquel-
les a procédé le secteur privé qui
ont permis à la plupart des grandes
entreprises de renouer avec les pro-
fits. Une reprise qui repose sur des
bases plus solides qu’un éphémère
rebond provoqué, comme précé-
demment, par des plans de relance
et l’injection de fonds publics. Mais
c’est une reprise en « peau de léo-
pard » : des îlots de prospérité émer-
gent, phares de la croissance pour
les marchés, dans une mer étale. Les
entreprises qui font des profits
n’emploient que 10 % du salariat
total et contribuent à seulement
19 % du produit intérieur brut.
Au-delà du débat sur la fragilité
d’une reprise tirée par les exporta-
tions et vulnérable par conséquent
àl’évolution de marchés porteurs
(Etats-Unis et Chine), la question
qui préoccupe les Japonais est la
détérioration des équilibres sociaux
sur la toile de fond d’un vieillisse-
ment qui pèse sur l’avenir des retrai-
tes. A une plus grande précarité de
l’emploi, à l’aggravation des inégali-
tés sociales en termes de revenus,
mais aussi en fonction de l’âge, du
sexe ou du niveau d’éducation
s’ajoutent les disparités entre les
régions. Le taux de chômage régres-
se (5,1 % en septembre contre 5,5 %
en début d’année), mais il se double
d’une destruction nette d’emplois.
« Réformes » est le slogan du pre-
mier ministre qui a mué en « forces
de résistance » ceux qui s’y oppo-
sent ou critiquent ses priorités. De
quelles réformes s’agit-il ? De la pri-
vatisation de l’épargne postale et
des régies des autoroutes. Non seu-
lement ces réformes n’ont pas pro-
gressé en deux ans, mais elles sont
sans effet sur la situation économi-
que. La politique d’assainissement
du système bancaire très endetté,
est loin d’être cohérente : vouloir
privatiser les postes lorsqu’on natio-
nalise de fait les banques en difficul-
té par des injections de fonds
publics n’a pas grand sens. Selon un
sondage préélectoral du quotidien
Asahi Shimbun, 60 % des personnes
interrogées n’étaient pas favorables
àces réformes et la progression de
l’opposition aux élections du
9novembre est un avertissement :
le gouvernement Koizumi néglige le
coût social de la crise.
La mondialisation, l’éclatement
de la bulle spéculative et les res-
tructurations ont bouleversé le
compromis social de la période de
Haute Croissance (décennies
1960-1980). Le passage du Japon à
l’ère post-industrielle impose des
réformes pour rendre le marché
plus transparent et enrayer le gas-
pillage des fonds publics qui a
ruiné l’Etat : tous les partis sont
d’accord sur le diagnostic. Mais ils
divergent entre eux (et en leur
sein) sur les méthodes : « En se
focalisant sur le marché, on accroît
les disparités et, à terme, on entame
la cohésion sociale. Les réformes doi-
vent au contraire contribuer à com-
penser les effets négatifs du marché
par la mise en place d’une société
équitable afin d’éviter les phénomè-
nes d’exclusion », observe l’écono-
miste Takamitsu Sawa. Le secteur
tertiaire est-il capable d’absorber le
surplus de main-d’œuvre rejeté par
le secteur manufacturier ? Vraisem-
blement non, poursuit-il, annon-
çant une reprise sans emplois. Une
des causes de la stagnation serait l’in-
suffisance de demande, fait-il valoir,
mais ne s’agit-il pas plutôt d’une ina-
déquation de l’offre à une demande
sociale qui n’est pas satisfaite en ter-
mes de bien-être et de protection
sociale ? « Le petit commerce ferme,
mais les hôpitaux sont surchargés »,
constate une autre économiste,
Sawako Takeuchi. L’incapacité – ou
l’absence de volonté politique – du
gouvernement de procéder aux arbi-
trages sociaux qu’impose le passage
àl’ère postindustrielle est une sour-
ce d’anxiété supplémentaire.
Dix « années perdues », se lamen-
tent les productivistes. Certaine-
ment pas. La crise a fait sauter le car-
can de la Haute Croissance qui
pesait sur une société arc-boutée
sur la production. Par sa lenteur, la
crise s’est traduite en une période
d’incubation sans rupture du lien
social vers d’autres équilibres. La
société est devenue plus diversifiée,
plus ouverte, plus mobile, avec des
effets positifs et négatifs : regain
d’initiatives et accroissement des
disparités. Mais le politique est à la
traîne de ces mutations : de nou-
veaux relais démocratiques sont
apparus au niveau local, mais ils ne
peuvent assumer la mission régula-
trice de l’Etat de redéployer l’offre
vers une demande sociale en contri-
buant à rétablir une confiance dont
dépend la consommation.
Philippe Pons
BOUSSOLE OFFRES
D’EMPLOI
Les Français ne cessent
de faire grossir
leur bas de laine.
Le taux d’épargne
des ménages a atteint
17 %, en hausse
de 2 points depuis
le début de l’année p. V
reconduit
au pouvoir,
junichiro koizumi
promet des
mesures libérales
qui inquiètent
le pays
L’Inde renoue
avec une croissance
record cette année.
Progressivement,
le sous-continent
s’intègre à l’économie
mondiale et attire
les investisseurs p. IV
bDirigeantsbFinance, administration,
juridique, RH bBanque, assurance
bConseil, auditbMarketing, commer-
cial, communication bSanté bIndus-
tries et technologies bCarrières inter-
nationales bMultipostes bCollectivi-
tés territoriales p. IX à XIV
UNE PUISSANCE AFFIRMÉE
Source : Banque mondiale *prévisions
3
4
5
6
7
8
94 9698 00 02 03*
Evolution annuelle duPIB, en %
7
4,9
4,4
« Les réformes doivent contribuer
à compenser les effets négatifs du marché
par la mise en place d’une société équitable
afin d’éviter les phénomènes d’exclusion »
,
Consommation en volume, glissementannuel, en %
...MAIS LES MÉNAGES RESTENT PRUDENTS
Sources:Datastream, Buba,CabinetOffice
-4
-2
0
2
4
6
8
9091 929394 95 969798 99 00 0102 03
Production industrielle, en points
DEPUIS SEPTEMBRE,L'ACTIVITÉ REPREND...
Source : Bloomberg
86
88
90
92
94
96
98
100
104
102
98 99 00 0102 03
UNE REPRISE FRAGILE
CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX
7
€
ECONOMIE
MARDI 18 NOVEMBRE 2003

Les petits boulots séduisent les jeunes bohèmes
TOKYO
correspondance
, le bureau de l’Agence
nationale pour l’emploi nipponne réservé aux moins
de trente ans, tout est fait pour séduire une popula-
tion qui n’a pas vraiment l’habitude de pointer au
chômage : mobilier neuf, ordinateurs et guichets de
consultation tranchent avec les locaux plus ternes
des autres locaux.
Créée il y a deux ans, l’agence de Tokyo, l’une des
quatre du pays, est située à Shibuya, quartier jeune
par excellence, juste en face du magasin de disques
Tower Records, et reçoit environ 500 visiteurs par
jour, dont la grande majorité a entre 23 et 25 ans. Le
tiers seulement a déjà un emploi, et, deux fois sur
trois, il s’agit d’un arubaïto (de l’allemand Arbeit, tra-
vail), ces petits boulots qui sont légion dans le sec-
teur des services et qui servent d’amortisseur aux
ravages de la crise. « Le but de l’agence, justement,
c’est d’essayer d’apporter des solutions alternatives
aux petits boulots, on s’est aperçu qu’il n’était pas vrai-
ment souhaitable qu’il y ait trop de freeters », recon-
naît Hirotaka Nakazato, de Young Hello Work.
Les freeters (de free et arubaïter) désignent les jeu-
nes qui vivent intégralement de petits boulots, deve-
nus le passeport pour un mode de vie alternatif. Syno-
nyme de zapping et de mobilité, la culture de l’aru-
baïto fait partie intégrante de la vie des jeunes Nip-
pons, qu’ils y aient recours pour gagner de l’argent de
poche tout en poursuivant leurs études, qu’il s’agisse
de repousser l’entrée dans la vie active de quelques
années, ou simplement de gagner de quoi vivre tout
en s’adonnant à une passion, sportive ou artistique.
« ’ ’ »
Bible du petit boulot, l’hebdomadaire Arubaïto
News va jusqu’à classer les offres d’arubaïto en des
dizaines de rubriques différentes : « Jobs où l’on
s’amuse », « Jobs où l’on ne fait pas grand-chose »,
« Jobs où on gagne bien », « Jobs pour travailler le
week-end », etc. La perspective de passer une gran-
de partie de sa vie dans la même entreprise et la
rigidité du monde du travail rebutent toute une
catégorie de jeunes, qui se reconnaissent de moins
en moins dans le modèle du salarié victime de res-
tructurations en fin de carrière.
Le prolongement de la récession a toutefois ren-
du plus réalistes les candidats à la bohème. Fou-
lard noir autour du front, pieds nus dans des espa-
drilles multicolores, Naoki, 25 ans, est inscrit dans
une agence d’intérim pour petits boulots : « On
donne un coup de fil la veille, on nous dit où aller.
Hier, on était trois pour vider un appartement. On
est payé 800 yens de l’heure, ça fait dans les
6000 yens (50 euros) la journée », raconte-t-il. Sor-
ti d’un IUT d’informatique, il a travaillé cinq ans
dans une entreprise, mais enchaîne les petits bou-
lots depuis six mois.
En cassant le mythe de l’emploi à vie, la crise a
rendu toute relative la sacro-sainte loyauté de l’em-
ployé vis-à-vis de l’entreprise. Ryo, 26 ans, a fait
des études d’assistant social, mais cherche à tra-
vailler dans la publicité. En deux ans, il a changé six
fois d’employeur. « Mon objectif est d’acquérir des
compétences, je veux pouvoir me spécialiser afin de
mieux me protéger des plans sociaux », dit-il, prag-
matique. Les rêves d’enrichissement de leurs aînés
ont laissé place à d’autres aspirations. Après l’uni-
versité, Yoshimichi, 23 ans, est parti voyager trois
mois en Asie avec l’argent de ses arubaïto. Venu de
province, il loue à Tokyo un studio pour
50 000 yens et cherche, depuis un mois, un emploi
stable dans la publicité. « Il y a le problème des assu-
rances sociales. Et il faut aussi s’occuper des parents.
Mais, à côté de ça, je veux faire du bénévolat dans
une organisation non gouvernementale… » dit-il.
Brice Pedroletti
L
esystème japonais des
retraites est complexe. Il
comporte un régime de
base universel, un régi-
me complémentaire
obligatoire pour les sala-
riés du privé et des régimes spé-
ciaux pour la fonction publique.
Pour la capitalisation d’entreprise,
les pécules de fin de carrière sont
très répandus et les grandes entre-
prises ont, en plus, mis en place
des fonds de pension.
Le système n’a plus très bonne
réputation : 92 % de Japonais se
disent inquiets. Les régimes d’Etat
qui disposent de réserves sont
saufs. Mais la capitalisation d’en-
treprise (pécules et fonds de pen-
sion) garantissant, au yen près, la
prestation future est, elle, en plein
marasme. Une situation intenable
après treize ans d’instabilité bour-
sière, de croissance atone et de
départs en retraite plus fréquents.
Des dizaines de milliards d’euros
partent en fumée pour boucher le
trou creusé par le postulat : « le
marché paiera » !
Rien que pour les fonds de pen-
sion, le constat est sévère :
entre 1996 et 2002, le nombre de
fonds est passé de 1 883 à 1 651 et
les salariés affiliés de 12 à 10,8 mil-
lions. De 1999 à 2001, les actifs ont
baissé de 62 200 milliards de yens
à57 000 milliards de yens. Tout
cela au passif de la bulle financière
des années 1980 et de son implo-
sion : les fonds d’Etat rapportaient
alors 8 % contre 3 % désormais
(1 % il y a encore six mois), et l’indi-
ce Nikkei a été divisé par quatre !
Aentendre François Fillon,
ministre des affaires sociales, du
travail et de la solidarité, venu pré-
senter, fin octobre, sa réforme à la
Maison franco-japonaise de
Tokyo, le projet français d’un ren-
dez-vous quinquennal pour révi-
ser les régimes s’inspire du Japon.
Le Conseil d’orientation des retrai-
tes (COR) créé en 1999 présente,
d’ailleurs, un air de famille avec
les Comités consultatifs (shingi-
kai), rouage essentiel des réformes
dans l’Archipel, associant hauts
fonctionnaires, parties intéressées
et monde académique. Des élé-
ments centraux de la réforme des
retraites au Japon qui ont été au
cœur du débat des élections du
9novembre se retrouvent dans la
réforme Fillon : pas d’augmenta-
tion importante du taux de cotisa-
tion ; confirmation du rôle de la
répartition ; maintien du pouvoir
d’achat des pensions par indexa-
tion sur les prix (et non plus sur les
salaires). Au calendrier franco-
japonais figure d’ailleurs le projet
de convention bilatérale de Sécuri-
té sociale, annoncée pour début
2004.
Ala différence de la France,
cependant, la répartition au
Japon n’exclut pas la constitu-
tion de réserves : celles-ci excè-
dent 1 000 milliards d’euros, soit
deux fois les actifs de la capitali-
sation privée. Et le paritarisme
ne concerne que les fonds de pen-
sion, alors que les régimes d’Etat
sont gérés directement par des
fonctionnaires. On note, aussi, la
convergence du traitement des
salariés du secteur privé et de la
fonction publique, alors qu’en
France ce sujet très délicat n’a pu
être qu’ébauché. Enfin, la réfor-
me de 2004 devrait relever la part
du budget de l’Etat dans le finan-
cement de la retraite de base,
d’un tiers à la moitié. Ce qui
rebondit sur le débat fiscal…
Mais c’est l’expérience pratique
de la réforme qui distingue le
mieux l’Archipel de l’Hexagone.
Réussir la première grande réfor-
me des retraites en France est un
exploit ; au Japon, celle-ci est per-
manente. La révision est quinquen-
nale : même dans l’Archipel, il faut
bien cinq ans pour concocter,
négocier, rédiger, faire voter et
mettre en place une réforme des
retraites. La mouture 2004 intro-
duit une rupture conceptuelle
importante. Jusqu’à la réforme de
1999 comprise, l’objectif était de
maintenir le montant des réserves.
Quand on ne pouvait plus augmen-
ter le taux de cotisation, on rédui-
sait les prestations par les leviers
classiques : allongement de la
durée de cotisation et augmenta-
tion de l’âge de départ, avec retrai-
te à taux plein.
Mais le dogme du maintien des
réserves vient de tomber car on ne
peut impunément leur sacrifier les
prestations. Entrent alors en scène
les « bébés Yamazaki », du nom
de Nobuhiko Yamazaki, leur
concepteur – intellectuel –, appar-
tenant à l’équipe des actuaires du
ministère des affaires sociales.
L’idée est simple : on s’assure pour
chaque année que les bébés
viennent au monde avec un systè-
me de retraite équilibré pour les
quatre-vingt-quinze prochaines
années. Et on joint un ajustement
glissant d’« équilibre automati-
que » qui, chaque année, recalcule
l’équilibre nécessaire pour les
quatre-vingt-quinze prochaines
années. On ajuste, alors, en fonc-
tion de paramètres constatés tels
que la natalité, la mortalité et la
survie, l’évolution des salaires
pour l’assiette et des prix pour la
prestation, modulant l’évolution
démographique et la croissance
économique. Si nécessaire, on
puise dans les réserves : en quatre-
vingt-quinze ans, celles-ci
devraient passer de cinq ans à une
année de prestations, tout en
maintenant une hausse très pro-
gressive des cotisations, qui, à
13,58 % actuellement, seront à
20 % en… 2099 !
Si cet « équilibre automatique »
ne pouvait plus garantir l’avenir
des retraites, l’ensemble du systè-
me sera remis en cause et un nou-
veau paradigme sera construit.
Sans geindre sur le « vieillisse-
ment de la population », ni parier
sur la « croissance miracle », le
Japon introduit avec créativité et
pragmatisme un système lucide et
flexible.
Jean-François Estienne,
Président de l’Association
franco-japonaise pour l’étude
des retraites
Les « bébés Yamazaki » donnent naissance à une réforme des retraites
La capitalisation
d’entreprise
est en plein
marasme
TOKYO
de notre correspondant
R
écemment, à Nagoya,
grande ville industriel-
le du centre du Hons-
hu, un contractuel de
52 ans, qui avait pris
en otage des
employés de l’entreprise de trans-
port pour laquelle il travaillait, a
provoqué une explosion, faisant
trois morts et trente-quatre bles-
sés. Il réclamait le paiement de
trois mois de salaire non versé.
Déséquilibré, il l’était assurément.
Son acte n’en est pas moins révéla-
teur des zones d’ombre du corps
social : le monde des gagne-petit,
dont beaucoup tirent le diable par
la queue, jusqu’au moment où cer-
tains craquent. Le contractuel de
Nagoya faisait partie de cette
armée d’anonymes, broyés par
une crise qui tend à faire de la sol-
vabilité le seul critère de reconnais-
sance sociale.
Longtemps, l’étranger et le dis-
cours officiel national ont fait des
équilibres sociaux des années
1960-1980 des invariants culturels.
Et se sont forgés les grands
«mythes » de Japan Inc. : société
consensuelle et appartenance de la
majorité des Japonais à la classe
moyenne. Le compromis social de
l’époque était le fruit de l’histoire
particulière de l’industrialisation
dans l’Archipel, mais il reposait aus-
si sur une redistribution relative-
ment égalitaire des fruits de la pros-
périté, aiguillonnée par de puis-
sants contrepoids (syndicats, mou-
vements sociaux, etc.) au pouvoir
économique. Avec certes des inéga-
lités, chacun voyait son niveau de
vie s’améliorer. La majorité se sen-
tait portée par le même courant et
est né, à l’époque, le sentiment d’ap-
partenir à une vaste classe moyen-
ne moins définie en termes de reve-
nus que de participation à la
consommation de la société de mas-
se naissante et d’adoption des
modèles culturels qu’elle véhiculait.
Depuis la bulle spéculative des
années 1980, marquée par l’appari-
tion d’une ostentation dans le luxe
inconnue auparavant, puis son écla-
tement au début de la décennie sui-
vante, c’est le partage des eaux.
L’écart entre gagnants et perdants
se creuse.
La crise sociale a progressé à un
rythme plus lent que la crise écono-
mique mais elle se fait davantage
sentir aujourd’hui sur les plus fai-
bles, même si le lien social est main-
tenu. Derrière une façade paisible,
les inégalités se sont accrues et,
avec elles, des symptômes de malai-
se : le nombre des suicides, dont
beaucoup sont dus à des facteurs
économiques (faillites, pertes d’em-
ploi), sont en augmentation (30 000
par an) ; la petite criminalité se déve-
loppe et, bien que l’Archipel reste
un des pays les plus sûrs du monde,
les braquages, cambriolages avec
violence et vols à la tire progressent
à un rythme inquiétant.
Le taux de chômage (5,5 %), en
légère régression, est enviable pour
d’autres pays, mais il donne une
image partielle de la situation de
l’emploi. Dans les grandes agglomé-
rations, une pléthore de petits bou-
lots permet à beaucoup de se
débrouiller et de ne pas émarger
sur les statistiques du chômage. En
province, la situation est plus diffici-
le. Partout, la précarisation de l’em-
ploi s’accroît et le nombre des sala-
riés ayant un statut permanent
diminue. Les employés non régu-
liers (contrat périodiquement
renouvelable ou temps partiel)
représentent désormais un quart
du salariat, soit 14,5 millions de per-
sonnes en 2002 (un nombre qui a
doublé par rapport à 1987). Les fem-
mes, qui constituent le gros contin-
gent des employées à temps partiel,
reçoivent un salaire équivalent à
60 % de celui d’une employée à sta-
tut permanent. Un diplôme n’est
plus le passeport pour un emploi.
Autre disparité : alors que les
hauts revenus ne sont pas, ou peu,
touchés par la crise, celui des ména-
ges à statut intermédiaire diminue.
Selon une enquête de l’agence
nationale de la fiscalité, en 2002 le
salaire annuel moyen d’un salarié
du secteur privé se chiffrait à
4478 000 yens (35 180 euros), soit
62 000 yens de moins que l’année
précédente (cinquième baisse d’affi-
lée depuis 1997). Beaucoup de sala-
riés en fin de carrière, qui se
croyaient protégés par l’emploi à
vie, ont été laminés par les restruc-
turations et ont vu leur revenu dras-
tiquement réduit en perdant leur
travail. Cette baisse généralisée du
revenu disponible engendre un phé-
nomène nouveau : la désépargne.
Les Japonais ont longtemps eu la
réputation d’être de gros épar-
gnants. Le montant de l’épargne
reste considérable : 1 400 000 mil-
liards de yens en mars 2002, mais il
adiminué de 2 % par rapport à l’an-
née précédente. La déflation pallie
partiellement cette diminution du
revenu mais le taux d’épargne des
ménages n’en est pas moins en bais-
se : il est passé de 11 % en 1998 à
6,6 % en mars 2002. La diminution
du revenu disponible conduit les
Japonais à puiser dans leurs écono-
mies pour maintenir leur niveau de
vie.
Conjuguées aux inquiétudes
pour les retraites en raison du
vieillissement rapide de la popula-
tion, ces nouvelles disparités enta-
ment le compromis social qui a pré-
valu au cours de la période de pros-
périté. Chaque jour se pose de
manière plus aiguë au Japon le
dilemme équité-efficacité.
Philippe Pons
1
Le redressement
de l’économie
est-il assuré ?
Le Japon, deuxième économie
mondiale forte de 127 millions
d’habitants, devrait afficher cet-
te année un taux de croissance
de 2,5 %, après 0,2 % seulement
en 2002 et 0,4 % au cours des
douze mois précédents.
Si l’on met de côté le court rebond
de l’année 2000 lorsque le pro-
duit intérieur brut (PIB) nippon
avait augmenté, de façon éphémè-
re de 2 %, il faut remonter à 1996
pour enregistrer un pareil redé-
marrage qui, cette fois, pourrait
mettre un terme à treize ans de
dépression – consécutive à l’écla-
tement de la bulle immobilière
spéculative – et à la quasi-faillite
du système bancaire pour cause
de créances douteuses. Cette repri-
se, marquée par une hausse excep-
tionnelle de 3,9 % au deuxième tri-
mestre, est tirée en grande partie
par les exportations (selon le
Fonds monétaire international
[FMI] elles devraient croître de
7,7 % cette année) qui, délaissant
un temps les Etats-Unis, se sont
réorientées vers la zone asiatique,
en particulier vers la Chine.
Mais la bonne performance de l’in-
vestissement privé (+ 6,2 % en
base annuelle) est aussi à signa-
ler, preuve que les entreprises
japonaises ont repris leurs investis-
sements productifs alors que la
consommation privée ne devrait
croître que de 1,1 % cette année,
après une augmentation de 1,4 %
en 2002.
Autre bonne nouvelle, le redres-
sement de la Bourse. Depuis le
mois d’avril, l’indice Nikkei de
225 valeurs a progressé de plus
de 30 %, l’une des meilleures per-
formances à l’échelon mondial.
Celle-ci s’accompagne d’un net
redressement des marges bénéfi-
ciaires des entreprises nippones
qui, pour nombre d’entre elles,
revoient à la hausse leurs pers-
pectives de résultats.
L’automobile japonaise redresse
la tête jusqu’à vendre davanta-
ge aux Etats-Unis que quelques-
uns des constructeurs locaux
comme Chrysler. L’électronique
affiche également de belles per-
formances. En revanche, cer-
tains fleurons baissent la garde.
C’est le cas de Sony qui, après
avoir accusé une baisse de 25 %
de ses résultats trimestriels, a
décidé la suppression de
20 000 emplois (13 % de ces
effectifs mondiaux) en trois ans,
dont 7 000 au Japon.
2
Quels sont
les points noirs
qui demeurent ?
La principale préoccupation rési-
de dans le taux de chômage qui
refuse de descendre au-dessous
de 5 % (il devrait être de 5,5 %
cette année, contre 5,4 % en
2002), signe que la reprise s’ef-
fectue encore sans véritable
création d’emplois. Comparé
aux taux de chômage que
connaît l’Europe (près du dou-
ble), celui du Japon peut paraî-
tre faible mais, outre que le
pays a été longtemps habitué à
un taux historiquement beau-
coup plus bas, il faut aussi tenir
compte d’un chômage potentiel
caché, résultant de multiples
emplois non productifs encore
préservés pour des raisons de
cohésion sociale.
Longtemps considéré comme un
impératif, le nettoyage des
bilans bancaires a été entrepris
depuis plusieurs années. Mais
de l’avis des spécialistes, beau-
coup reste à faire. Au cours de
l’exercice 2002-2003, les créan-
ces douteuses du secteur bancai-
re ont été ramenées à l’équiva-
lent de 220 milliards d’euros. Un
mieux, certes, mais le chiffre res-
te impressionnant. Prudente,
l’agence de notation Fitch se
contente de prendre acte de l’en-
gagement de retour à la rentabi-
lité pris par les grands établisse-
ments bancaires.
3
Quelles sont
les conséquences
de « l’effet yen » ?
Le yen fort – il se négocie actuel-
lement autour de 108 yens pour
un dollar – commence à handica-
per les entreprises exportatrices
nippones. Si ce raffermissement
devait se poursuivre, jusqu’à
voir la monnaie japonaise grim-
per à 105 yens pour un dollar,
l’impact – négatif – sur la crois-
sance pourrait atteindre 0,5 %,
estime la firme Daiwa. Certains
spécialistes considèrent cepen-
dant que le véritable seuil d’aler-
te se situe à 100 yens pour un
dollar.
les salariés en fin
de carrière qui
se croyaient
protégés par
l’emploi à vie ont
été laminés par les
restructurations
QUESTIONS-RÉPONSES
Conjoncture
DOSSIER
L’écart entre gagnants et perdants
de l’économie nipponne se creuse
On s’assure pour chaque année que les bébés
viennent au monde avec un système de
retraite équilibré pour les quatre-vingt-quinze
prochaines années. Et on joint un ajustement
glissant d’« équilibre automatique »
Evolution des résultats nets des
principalesbanquesjaponaises,
en milliardsde yens
PRÉVISIONS OPTIMISTES
Source : Fitch *Prévisions 2004/2003
89/9093/94 97/98 01/02
2 000
0
-2000
- 4000
-6000
700*
II/LE MONDE/MARDI 18 NOVEMBRE 2003

Même si l’archipel nippon
connaît une reprise conjonctu-
relle qui se traduit par l’améliora-
tion des résultats de quelques
grandes entreprises et de meilleu-
res performances à l’exportation,
rien n’a fondamentalement chan-
gé dans la situation économique
japonaise. Comment expliquez-
vous, alors, le regain d’intérêt
actuel des investisseurs étrangers
pour le pays ?
En réalité, tout dépend de l’analy-
se à court terme, ou à long terme,
qui est faite de la situation.
Si on se place dans le long terme,
les pays avancés sont entrés dans
une période de chute de la croissan-
ce depuis les crises pétrolières du
début des années 1970. Cette baisse
se conjugue à une libéralisation du
secteur financier qui incite les capi-
taux excédentaires à chercher des
profits rapides (Bourses, bons
d’Etat, immobilier…). La volatilité
des marchés s’explique par ces
déplacements de fonds et par la
bulle économique américaine. De
crise financière en crise financière,
l’économie américaine chevauche
les « bulles » et leur éclatement grâ-
ce au jeu habile du président de la
Réserve fédérale américaine, Alan
Greenspan, sur les taux d’intérêt.
Les Etats-Unis ayant asséché les
autres marchés, nous assistons à un
retour des investisseurs vers le
Japon qui entraîne un rebond de la
Bourse. Pour autant, tout optimis-
me sur la santé de l’économie japo-
naise me paraît prématuré.
Acourt terme, la reprise actuelle
est favorisée par l’essor du marché
chinois et le rebond américain. Mais
cette éclaircie risque d’être éphémè-
re : l’euphorie actuelle pourrait dis-
paraître dès l’année prochaine.
Les Etats-Unis pratiquent, en
effet, une politique de double défi-
cit, commercial et budgétaire. Cette
situation risque de forcer l’adminis-
tration Bush à une dévalorisation
abrupte du dollar qui mettra l’éco-
nomie japonaise en grave difficulté.
Outre les effets négatifs sur les
exportations à destination des Etats-
Unis, la baisse du billet vert entraî-
nera celle du yuan chinois (les deux
monnaies sont liées) qui pèsera, à
son tour, sur les exportations japo-
naises sur le continent. L’embellie
conjoncturelle que connaît le Japon
est dépendante de l’étranger et les
problèmes internes de l’économie
ne sont pas résolus pour autant.
Le gouvernement de Junichiro
Koizumi essaye néanmoins de
remédier aux problèmes des
mauvaises créances des banques
qui « plombent » toute reprise
durable…
Il existe, à l’étranger, un grand
malentendu sur la politique financiè-
re du cabinet Koizumi et de son
ministre de l’économie et des servi-
ces financiers, Heizo Takenaka. Il ne
fait guère de doute que l’apurement
des mauvaises créances des banques
est essentiel. Mais la politique actuel-
le manque de cohérence et de trans-
parence. Beaucoup d’éléments sont
délibérément cachés par les autori-
tés financières. En mai, par exemple,
le gouvernement a décidé d’injecter
2000 milliards de yens (15,7 mil-
liards d’euros) pour recapitaliser la
banque Resona. Pourquoi Resona
alors que Mitsui Trust est dans une
situation bien pire ? Et pourquoi un
montant aussi colossal ? Vraisembla-
blement – mais cela n’a pas été dit –
parce que l’évaluation de la situation
comptable de Resona réalisée deux
mois auparavant par les autorités
financières avait été largement sous-
estimée.
La politique financière menée
montre que le gouvernement cher-
che à protéger les dirigeants des
banques, en cachant l’ampleur des
mauvaises créances. D’un côté, il
sauve des banques en les nationali-
sant de facto par des injections de
fonds publics (comme dans le cas
de Resona) et, de l’autre, il annonce
son intention de privatiser les pos-
tes, c’est-à-dire l’énorme « pacto-
le » de l’épargne postale. C’est un
peu contradictoire.
Le Japon s’engage-t-il sur la
voie du néolibéralisme prônée
par les Anglo-Saxons ?
Depuis les années 1980, les écono-
mistes formés aux Etats-Unis domi-
nent la scène, au Japon comme en
Corée du Sud. Leur qualité est jugée
au nombre d’articles qu’ils publient
dans les revues américaines.
Les thèses néolibérales ont été
importées ici sans le moindre esprit
critique – en particulier par l’actuel-
le équipe au pouvoir –, et encensées
simplement parce qu’elles étaient
d’origine américaine. La solution
miracle à tous les problèmes est la
privatisation. Par exemple celle des
régies des autoroutes, l’un des che-
vaux de bataille du cabinet de Juni-
chiro Koizumi. Il vaudrait mieux, à
mon sens, examiner les mécanis-
mes de corruption qui ont conduit à
leur énorme déficit et y remédier
plutôt que de les privatiser.
Le néolibéralisme au Japon est
une combinaison du culte du
«tout-marché » et de la « diplo-
matie des faucons », qui dans les
deux cas emboîtent le pas aux
néoconservateurs américains. Le
problème actuel du Japon est
qu’il ne parvient pas à concilier le
marché et une forme de social-
démocratie. Cet écartèlement est
àl’origine des fortes tensions qui
traversent aussi bien la majorité
libérale-démocrate que l’opposi-
tion démocrate.
La crise que traverse le Japon
depuis plus d’une décennie a eu
pour effets d’aggraver les inégali-
tés sociales. Qu’en pensez-vous ?
Les inégalités sociales sont la
conséquence la plus préoccupante
de la crise actuelle. Mais c’est aus-
si une question qui est largement
passée sous silence : 20 % des
ménages n’ont aucune épargne, il
y a 3,3 millions de chômeurs, 2 mil-
lions de travailleurs précaires âgés
de 15 à 20 ans et, si on ajoute à ce
chiffre les femmes, on arrive à
plus de 10 millions de travailleurs
précarisés !
Plus encore que la question de
l’écart des revenus, c’est celle des
inégalités croissantes entre les
tranches d’âge, les sexes et l’édu-
cation qui est grave. Il apparaît au
Japon une fragmentation sociale
qui fait que les intérêts indivi-
duels ne parviennent plus à
converger vers des revendications
communes. Le rôle des corps
intermédiaires (syndicats, coopé-
ratives, associations, etc.) s’ame-
nuise, tandis que les médias pré-
sentent une image schématisée
de la réalité, réduite à quelques
dichotomies simplifiées.
Les classes moyennes sont sur la
défensive et ce sentiment d’inquié-
tude se diffuse, nourrissant un
«petit nationalisme » qui est à l’ori-
gine de réactions émotionnelles.
Prenez l’exemple de l’enlèvement
de Japonais par la Corée du Nord.
L’opinion applaudit au durcisse-
ment de l’attitude du gouverne-
ment vis-à-vis de Pyongyang ou
lorsque tombent des têtes de
bureaucrates. Mais personne ne
propose une véritable politique de
rechange tenant compte de la crise
sociale et fondée sur un projet de
bien-être social.
Propos recueillis par
Philippe Pons
S
il’on veut prendre la
mesure des menaces qui
pèsent sur les mécanis-
mes de solidarité et de
protection sociale japo-
nais, il est nécessaire de
revenir sur une idée reçue selon
laquelle la politique industrielle
menée avec succès par l’Etat japo-
nais ne fut pas contrebalancée
par une politique sociale digne de
ce nom. Si la crise financière se
double de sérieux doutes sur la
viabilité du système de développe-
ment économique du pays, c’est
parce qu’un certain type de politi-
que sociale est aujourd’hui remis
en cause.
Cette politique sociale, le Parti
libéral démocrate (PLD) au pou-
voir l’avait élaborée dès 1979,
avec la formule de « société de
bien-être à la japonaise ». En uti-
lisant le terme de « société de
bien-être », il évitait de parler
d’« Etat providence » et, en préci-
sant « à la japonaise », le pays
affirmait qu’il ne voulait pas suivre
le chemin de la social-démocratie
européenne.
La priorité fut donnée à la solida-
rité au sein de la famille et de l’en-
treprise. Pour compenser les insuf-
fisances de cette solidarité commu-
nautaire, le citoyen a été invité à
s’en remettre aux assurances pri-
vées, la protection sociale publi-
que n’étant pensée que comme un
recours ultime. La tentation est
grande de voir dans cette insistan-
ce sur la solidarité communautai-
re soit l’expression d’un simple
conservatisme social soit le résul-
tat du poids politique des organisa-
tions patronales, soucieuses de
contenir le niveau des prélève-
ments obligatoires. Elle reflète un
compromis social ancien qui est
remis en cause sans qu’une solu-
tion de rechange n’apparaisse.
Dès les années 1920, les élites
commencèrent à promouvoir
l’idéologie du « familialisme »
dans l’entreprise qui offrait un
mode d’intégration sociale fon-
dée sur les corps intermédiaires, à
savoir l’entreprise et la famille.
Ce mode d’intégration se révéla
être une réponse viable et de long
terme à la question sociale et un
fondement solide pour le dévelop-
pement économique du pays, en
répondant à des besoins essen-
tiels des acteurs de la société
industrielle. Ainsi, pour les entre-
prises, l’élaboration de systèmes
de rémunération et de promotion
récompensant l’engagement à
long terme du salarié permit de
créer des liens de dépendance qui
se trouvèrent être un mode de
rationalisation du travail particu-
lièrement efficace. Pour le tra-
vailleur, elle offrait une certaine
sécurité financière et un statut res-
pectable dans la société.
Jusqu’à ces dernières années,
l’Etat favorisa ce mode d’intégra-
tion sociale afin de compenser les
insuffisances d’un filet de sécurité
sociale public qui n’a jamais
atteint les niveaux européens,
tout en cherchant à garantir le
plein emploi par des investisse-
ments massifs dans les travaux
publics, des incitations financiè-
res à l’embauche et au maintien
de l’emploi, conjugué à une pro-
tection des petites et moyennes
entreprises (PME).
Apartir des années 1950, l’urba-
nisation et la quasi-disparition en
ville de la famille de trois généra-
tions, conjuguées au recul de la
norme de la femme au foyer
depuis une vingtaine d’années,
ont progressivement sapé les
bases idéologiques et matérielles
de cet édifice. Surtout, depuis
l’éclatement de la bulle financière
au début des années 1990, les
grandes entreprises ont commen-
cé à nourrir des doutes sur la vali-
dité de la « gestion à la japonai-
se » et ont eu tendance à rompre
les termes du compromis social,
ouvrant une crise, non seulement
dans les mécanismes de solidari-
té, mais plus largement dans les
modes d’intégration sociale.
Aujourd’hui, l’Etat ne semble
pas avoir une politique cohéren-
te et à la hauteur des enjeux de
ce qu’il faut bien appeler une
«nouvelle question sociale ».
L’importance des déficits publics,
le vieillissement de la population
et l’effondrement de l’opposi-
tion socialiste dissuadent le gou-
vernement d’aller plus loin dans
le développement d’un Etat pro-
vidence, destiné à prendre le
relais de corps intermédiaires
déficients.
En s’en remettant à une politi-
que de dérégulation et en voulant
augmenter la part des assurances
privées et des fonds de pension,
le premier ministre Junichiro Koi-
zumi affirme sa foi en un marché
autorégulateur. Dans le même
temps, il donne des gages aux
politiciens qui, soucieux de main-
tenir leurs réseaux de finance-
ment, poussent à un soutien de
l’emploi par des subventions et
des investissements publics et à
un renflouement du système ban-
caire, qui contribuent à aggraver
les déficits des finances publiques
et à désorienter encore davanta-
ge l’opinion.
Bernard Thomann,
chercheur à la Maison
franco-japonaise et chercheur
invité à l’Institut des sciences
sociales de l’université de Tokyo
CHRONIQUE
Dites 35 !
l’état n’est pas
prêt à développer
une politique
sociale
cohérente
Masaru Kaneko, professeur d’économie à l’université Keio de Tokyo
«Le gouvernement protège les banquiers,
en cachant l’ampleur des mauvaises créances »
fSpécialiste des finances publiques,
Masaru Kanako, né en 1952,
est professeur d'économie à l'université
Keio à Tokyo.
fConnu comme un critique
de la politique du gouvernement
de Junichiro Koizumi,
il est l'auteur de plusieurs ouvrages
récents à succès :
Antiglobalisation, la stagnation
à long terme (tiré à 75 000 exemplaires)
et La Grande Transformation économique,
(publié en octobre et déjà vendu
à 35 000 exemplaires), non disponibles
en France.
MASARU KANAKO
Menaces sur la « société de bien-être à la japonaise »
par Serge Marti
DOSSIER
«Le problème actuel de l’Archipel est qu’il
ne parvient pas à concilier le marché et une
forme de social-démocratie. Cet écartèlement
est à l’origine des fortes tensions
qui traversent aussi bien la majorité libérale-
démocrate que l’opposition démocrate »
17 , dernier
jour pour payer la taxe d’habita-
tion, une facture qui s’est alour-
die pour les impôts locaux dans
l’ensemble de l’Hexagone
(+ 2,2 % en moyenne) avec des
pics de hausse bien supérieurs
dans certains départements tels
que le Gers (+ 21 %) ou encore les
Alpes-de-Haute-Provence
(+ 15 %). La raison de cette envo-
lée ? En partie, bien sûr, le trans-
fert des charges de l’Etat vers les
collectivités locales, induit par la
décentralisation. Mais Patrick
Devedjian, le ministre délégué
aux libertés locales, a trouvé une
autre explication à laquelle on
n’avait pas encore songé. C’est la
faute des 35 heures, « responsa-
bles, à elles seules, de 45 % de
l’augmentation », affirme-t-il
dans un entretien au quotidien
France-Soir.
La responsabilité, selon lui,
incombe « aux transferts non
financés de l’Etat vers les collecti-
vités locales, effectués sous le gou-
vernement précédent, et non à la
décentralisation, qui n’est pas
encore mise en œuvre », assu-
re-t-il. Toujours les 35 heures,
pauvre Martine Aubry ! Il y a quel-
ques semaines, au plus fort de la
vive offensive lancée par une par-
tie de la majorité parlementaire
contre la réduction du temps de
travail (RTT), l’essayiste Nicolas
Baverez estimait, au détour d’un
entretien consacré à son best-sel-
ler sur le « déclinisme », à savoir
La France qui tombe (Perrin), que
la réduction du temps de travail
était, en partie, responsable de…
l’augmentation de l’alcoolisme
et des violences domestiques ! Le
propos a été ultérieurement
démenti par l’intéressé. En revan-
che, dans la bouche d’un ancien
conseiller spécial d’un ministre
ministre délégué, l’accusation,
fortement polémique, a une
autre signification.
C’est le moment – involontaire
–choisi par les économistes de
la Caisse des dépôts et consigna-
tions (CDC-Ixis) pour publier une
étude sur le sujet prudemment
titrée : « Un essai d’analyse sans
apriori des effets des 35 heures
en France ». De ce document, il
ressort que « les lois de Marti-
ne » ont constitué « une politique
contracyclique assez puissante »
qui a généré la création de quel-
que 310 000 emplois pour la seu-
le période 1999 à 2001 inclus,
«financés par l’argent public »
d’une manière « assez coûteuse »
puisque le coût d’un emploi créé
«est de l’ordre de grandeur du
salaire par tête ».
Estimant « qu’en aucun cas » le
passage aux 35 heures « ne peut
avoir provoqué la crise cyclique
présente », ce qui n’exclut pas,
cependant, un effet « appauvris-
sant » dans la perspective du
vieillissement de la population,
les auteurs de l’étude considè-
rent qu’il s’agit là d’un mécanis-
me qui va réduire de 2,5 %, envi-
ron, le niveau de production
(mais pas la croissance potentiel-
le) à partir de la date de retour
du taux de chômage à son
niveau d’équilibre.
Dans le détail, on relève que la
réduction effective du travail en
France (de 7,5 % entre le début
1999 et la fin de 2001) a débou-
ché sur « une absence de freinage
visible du rapport salaire réel/tête
mais sur un accroissement de la
productivité horaire de cinq
points environ, par rapport à la
tendance générale, avec, en paral-
lèle, une réduction de 2,5 points
environ de la productivité par
tête. Il en résulte que, grâce aux
gains de productivité horaire,
environ les deux tiers des effets
dus à la baisse de la durée du tra-
vail ont été compensés par une
hausse de la productivité horai-
re ».
Admettant que la RTT est
«une politique chère », au
même titre que toutes les politi-
ques de soutien de l’emploi par
la baisse des charges sociales,
les rédacteurs de ce document
«sans a priori » concluent sur
trois remarques. D’abord, le pas-
sage aux 35 heures étant, de fait,
une politique « violemment
contracyclique de créations d’em-
ploi », il était « adapté aux situa-
tions de recul conjoncturel de l’ac-
tivité » de ces dernières années.
Ensuite, que le nombre d’heures
travaillées « est devenu beau-
coup plus faible en France qu’au
Japon et dans les pays anglo-
saxons », un élément qui vient
s’ajouter à un départ à la retrai-
te plus précoce qu’ailleurs dans
notre pays.
Enfin, pour ce qui est de l’ave-
nir, « le problème avec les 35 heu-
res est leur irréversibilité », admet-
tent-ils, expliquant que « lors-
qu’on passe d’une situation de
sous-emploi (2001-2004) à celle,
escomptée, du plein emploi (à par-
tir de 2008 ?), on voudrait être
capable d’accroître l’offre de tra-
vail alors que les 35 heures l’ont
irrémédiablement réduite ».
Une série de constatations,
non polémiques, qu’il faudrait
exporter en Allemagne, où le
débat sur le temps de travail a
pris une vigueur particulière ces
derniers jours, non seulement
entre économistes et personnel
politique, mais aussi entre les
industriels favorables à une
réduction destinée à préserver
l’emploi (c’est le cas du construc-
teur automobile Opel, qui est pas-
sé aux 30 heures) et la majorité
des chefs d’entreprise qui, au
contraire, voudraient l’allonger
jusqu’à 43 ou 45 heures par
semaine. Un détail : personne n’a
pensé à interroger Martine sur le
sujet.
LE MONDE/MARDI 18 NOVEMBRE 2003/III

europe
Derniermois
connu
LES INDICATEURS FRANÇAIS
Source : Insee, Douanes
*Solde de réponses,CVS, en %** en glissement
Consommation desménages
Taux d'épargne
Pouvoird'achatdesménages
(en millionsd'euros)
Créationsd'entreprises
16 %
(T2/03)
Variation
sur unan
+ 3,4 %
(sept. 03)
+ 3,9 %
–0,5 %
(T2/03 -T3/02)
2949
(mai03)
+5,9 %**
26 635
(sept. 03)
+ 2,4 %**
756
(août 03)
– 12,1 %
0,9
%
(T2/03)
0,8 %
(T2/03 -T3/02)
Enquête mensuelle sur le moral
desménages*–29
(oct. 03)
– 12
Enquête mensuelle dansl'industrie
*
Opinion deschefsd'entreprise
sur les perspectivesgénéralesde production
–21
(oct. 03)
–37 %
(entreavril 03
etoct. 03)
Défaillancesd'entreprises
pardate de publication
Commerce extérieur
L
’échec de la cinquième
conférence ministérielle
de l’Organisation mon-
diale du commerce
(OMC), tenue à Cancun
(Mexique) en septem-
bre, a flatté le sentiment national
indien. Depuis la précédente confé-
rence de Doha (Qatar), en 2001,
New Delhi avait clairement choisi
de sortir de son habituel isolement.
C’est donc logiquement qu’à Can-
cun elle s’est retrouvée parmi le
groupe des 21 – composé du Brésil,
de la Chine, de l’Afrique du Sud, et
de dix-sept autres pays –, pour
dénoncer les subventions aux agri-
culteurs de l’Union européenne
(UE) et des Etats-Unis, et s’opposer
aux « questions de Singapour »
portant sur les investissements, la
politique de la concurrence, la facili-
tation des échanges et la transpa-
rence des marchés publics.
En jouant la carte de la rupture à
Cancun, l’Inde a signifié qu’elle pré-
férait un échec momentané à un
mauvais compromis. Pourtant, à
long terme, le pays entend moins
affaiblir l’institution genevoise que
d’y modifier les rapports de force.
Mettre en cause les négociations
commerciales en cours ne l’empê-
che pas, dans le même temps, de
chercher à attirer les investisse-
ments étrangers. En visite officielle
en France, début novembre, le
ministre du commerce et de l’indus-
trie, Arun Jaitley – très en pointe de
la fronde à Cancun –, a vanté aux
industriels français les atouts de
son pays : croissance, confiance,
réformes, opportunités.
Alors que les échéances électora-
les se rapprochent, le plébiscite des
investisseurs étrangers représente
un enjeu essentiel pour la croissance
et l’emploi. Début décembre, quatre
Etats de l’Union indienne iront aux
urnes, et 2004 verra les élections
générales, au terme du mandat du
gouvernement d’Atal Bihari Vaj-
payee. Pour quel bilan ?
Côté croissance, les indicateurs
sont positifs. Après le ralentisse-
ment enregistré ces dernières
années, le pays s’apprête, avec une
croissance de l’ordre de 7 % cette
année selon les dernières prévi-
sions, à renouer avec ses records
du milieu des années 1990. L’infla-
tion, de l’ordre de 4 % en 2003,
demeure maîtrisée et les réserves
de devises atteignent près de 90 mil-
liards de dollars pour un revenu
national qui a franchi la barre des
500 milliards de dollars. Après des
années de sécheresse, la bonne
mousson de 2003 devrait relancer
fortement la production agricole,
tirant elle-même la production
industrielle, tandis que les services
–industries du logiciel, délocalisa-
tions de services informatisés de
multinationales – poursuivent leur
montée en puissance. Les investis-
sements étrangers sont aussi à la
hausse : longtemps voisins de 2 mil-
liards l’an, ils étaient de 4 milliards
en 2002 (6 milliards avec les inves-
tissements de portefeuille).
Reste à confirmer les prévisions
dans la durée. Deux points restent
inquiétants. D’une part, la dette
publique totale équivaut au pro-
duit national brut (PNB), et les défi-
cits publics s’aggravent. En corollai-
re, les investissements publics conti-
nuent de baisser, malgré de grands
équipements routiers en cours.
En dépit des avancées mises en
lumière par les autorités, nombre
d’analystes indiens et étrangers
soulignent les lenteurs des « réfor-
mes de seconde génération », les
plus sensibles politiquement. Les
privatisations (partielles le plus sou-
vent) ont rapporté 3 milliards de
dollars depuis 2000, avec en tête les
cessions de VSNL (télécoms), Maru-
ti (automobile), IPCL (produits
pétroliers), Balco (aluminium). Les
critiques soulignent moins les opé-
rations conclues que les atermoie-
ments ou les obstacles dans la pour-
suite du processus. Ainsi, la déci-
sion de la Cour suprême de ren-
voyer devant le Parlement les priva-
tisations des sociétés Hindustan
Petroleum et Bharat Petroleum,
pourrait bien bloquer toute nouvel-
le avancée. Il n’existe, en effet,
aucun consensus sur les privatisa-
tions, pas même au sein de la coali-
tion au pouvoir, dominée par le Par-
ti du peuple indien du premier
ministre Atal Bihari Vajpayee.
En fait, la reprise de la croissance
indienne illustre les limites du libé-
ralisme que prône le dernier rap-
port de la Banque mondiale sur
l’Inde en souhaitant confiner le
rôle du gouvernement à deux
tâches essentielles : une bonne poli-
tique fiscale et la modernisation
des infrastructures de base, comp-
tant pour le reste sur les investis-
seurs privés, étrangers inclus. C’est
omettre que, dans un régime démo-
cratique, les logiques économiques
doivent s’accommoder d’impéra-
tifs politiques voire électoralistes.
Contre l’option ultralibérale, jugée
socialement trop risquée, le gou-
vernement choisit une voie moyen-
ne. Il repousse à plus tard la réfor-
me du droit du travail et rejette
l’élargissement de l’assiette de l’im-
pôt, tout en soulignant certaines
avancées structurelles : baisse de la
pauvreté (de 36 % à 28 % en dix
ans), hausse tendancielle du reve-
nu national, hausse de la produc-
tion industrielle (+ 67 % en neuf
ans), ouverture accrue à l’écono-
mie mondiale, nouvelle confiance
face à la Chine.
Contre les analystes qui ne
jugent le pays qu’au crible de critè-
res comme les privatisations ou les
investissements étrangers, mais
aussi contre les opposants alter-
mondialistes, qui animeront le
Forum social mondial de Bombay
en janvier 2004, le gouvernement
indien avance à son rythme. Les
électeurs en jugeront bientôt. Il
n’est pas sûr qu’une autre coalition
politique bouleverse vraiment une
stratégie qui, depuis 1991, combi-
ne changements irréversibles et
prudence politique.
Jean-Luc Racine,
directeur de recherche au CNRS,
centre d’études de l’Inde
et de l’Asie du Sud
UE 15
Production industrielle
(août 2003, en %) :
PIB en volume
(2etrimestre2003, en %) :sur unan
sur troismois
Prixàlaconsommation
(septembre2003, en %) :sur unan
sur un mois
EURO 12ALL.BELG.ESPAGNE FRANCE ITALIE PAYS-BAS ROY.-UNI É.U.JAPON
sur unan
sur un mois
Solde budgétaire(en %)
2002
Dettepublique/PIB (en %)
2002
LES INDICATEURS ÉCONOMIQUES INTERNATIONAUX «LE MONDE »/EUROSTAT
Investissement (FBCF)
(2etrimestre2003, en % ) :
sur troismois
Solde commercial
extracommunautaire
(en milliardsd'euros,
août 2003)
*provisoire, **estimations
2,1*1,1 1,7 3,0 2,3*3,0*2,2*1,4 2,3–0,5
0,3*–0,2 0,2 0,2 0,5*0,8*n.d. 0,30,30,0
0,1 – 1,2– 4,0
– 1,7
0,4 – 1,9 1,7–0,7– 1,3n.d.
–0,4 – 2,1 – 0,7–0,9 0,1 3,5 – 0,9 n.d.
n.d.
n.d.
0,2–0,2 0,8 2,3–0,3 0,4 – 1,2 2,0 2,5 3,0
–0,1 – 0,1 – 0,1 0,7–0,3–0,1 – 0,6 0,6 0,8 1,0
–2,2–3,5 0,1 0,1 – 3,1 – 2,3– 1,6– 1,5 – 3,2**
6960,8 105,8 53,8 59 106,752,4 38,5 60,3**
141,9**
6,5 14,2 0,4 – 3,71,6 2,7 2,4 – 5,043,5 3,8
–0,1 0,2 2,7 0,8 0,0– 1,5 – 0,4 1,21,8 2,6
(avril 03) (avril 03)
– 8,0**
1,9*
0,3*
–0,1
–0,4
0,5
0,0
– 1,9
62,3
1,3
–0,2
(1ertrimestre
2003)
(juillet 03)(juillet 03) (juillet 03) (juin 03) (juillet 03) (juillet 03)
(août)
pays en transition
Nombre de bateaux en 2002 etévolution par rapport à1997 (en %)
FORTE RÉDUCTION DE LA FLOTTE DE PÊCHE DE L'UNION
Source : Eurostat
-4
-15
-17
-8
-8
-13
-15
-10
-4
-20
+12
-10
-12
Grèce
Italie
Espagne
Portugal
France
Royaume-Uni
Danemark
Finlande
Allemagne
Suède
Irlande
Pays-Bas
Belgique
19 747
16 045
14 887
10427
8088
7 379
3874
3571
2 247
1 820
1 448
932
130
le pays s’intègre
à son rythme,
à l’économie
mondiale
et attire
les investisseurs
innovation
UN CHIFFRE
+6,9
c’est la hausse,
en points,
du baromètre
conjoncturel zew
en allemagne,
en novembre
aEN 2002, on dénombrait 91 000 bateaux de pêche dans les Etats membres
de l’Union européenne (UE), soit 11 % de moins que les 102 000 bateaux
recensés en 1997.
aLA GRÈCE compte le plus grand nombre de bâtiments de pêche (19 747),
mais, en termes de puissance (calculée en kilowatt), ce sont l'Italie (1,3 mil-
lion de KW), l'Espagne (1,3 million) et la France (1,1 million) qui viennent
en tête. Le nombre de bateaux a le plus chuté en Suède, puis en Espagne, au
Danemark et en Italie. L'Italie, l'Espagne et la Finlande ont enregistré les
diminutions les plus notables en termes de puissance (– 15 % chacun).
aL'IRLANDE se distingue des Etats membres de l'UE, en enregistrant une
augmentation de la dimension de sa flotte au cours de la période tant en
nombre de bâtiments (+ 12 %) qu’en puissance (+ 8 %).
Le baromètre allemand
ZEW, qui mesure les prévisions
de conjoncture à horizon de six
mois dans le secteur financier,
afortement rebondi en novem-
bre, à son plus haut niveau
depuis juillet 2002. L’indice a
augmenté de 6,9 points, à
67,2 points. Une progression
plus importante que prévu par
les analystes, qui tablaient sur
une avancée de 4,7 points, à
65 points, selon une étude
publiée par la banque UBS.
L’optimisme retrouvé du sec-
teur financier « est nourri sur-
tout par l’ampleur surprenante
de la progression des entrées de
commandes industrielles en sep-
tembre », après deux mois de
stagnation, a commenté l’insti-
tut de conjoncture dans un
communiqué. « Le récent
rebond des marchés boursiers et
un euro affaibli » ont égale-
ment dopé l’indice, poursuit le
ZEW.
La hausse du baromètre de
conjoncture semble confirmer
le redémarrage de l’économie
allemande, qui devrait avoir
enregistré à nouveau une légè-
re croissance de juillet à fin
septembre.
LES PAYS DE L'EST COMMERCENT DAVANTAGE ENTRE EUX
Source : FMI
75
70
65
60
55
50
16
14
12
10
8
6
4
Part de l'UE, en %
(échelle de gauche)
Exportationsen milliardsde dollars
(échelle de droite)
95 969798 99 00 0102 03
L’Inde renoue avec une croissance record
Contribution desfondationsàlarecherche, en pourcentage duPIB
LA FONDATION POUR LA RECHERCHE,UN OUTIL NÉGLIGÉ
Source : ministère de larecherche
0,24
0,16
0,11
0,10
0,04
Japon
Suède
Etats-Unis
Grande-Bretagne
France
BOUSSOLE
aLA CROISSANCE DES PAYS DE L’EST, futurs membres de l’Union européenne
(UE), ne souffre pas trop du ralentissement en Europe de l’Ouest : le pro-
duit intérieur brut (PIB) devrait augmenter en moyenne de 3,5 % en 2003
et en 2004. Ce dynamisme s’explique, outre le maintien de la demande
intérieure, par la vigueur des exportations.
aLES EXPORTATIONS se font pour les deux tiers à destination de l’UE. Mais
le retour des flux internes à la zone (13 % du total aujourd’hui) est un
bon signe pour la région, qui a su également, depuis un an, tirer parti de
la reprise aux Etats-Unis – presque 5 % des exportations (CDC-Ixis).
Après des années de sécheresse, la bonne
mousson de 2003 devrait relancer fortement
la production agricole, tirant elle-même
la production industrielle…
UNE PUISSANCE COMMERCIALE DE PLUS EN PLUS AFFIRMÉE
Source : Banque mondiale *prévisions
3
4
5
6
7
8
94 9694 95 969798 99 00 020198 00 02 03*
Evolution annuelle duPIB,
en pourcentage
Volume desexportations,
en milliardsde dollars
7
4,9 4,4
257
293
384
412
386
399
571
461
593
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
aDANS DE NOMBREUX PAYS, la recherche, et en particulier la recherche
médicale, canalise des fonds privés de particuliers ou d’entreprises par le
biais de fondations.
aEN FRANCE, l’Institut Pasteur, l’Institut Curie ou l’Association française
contre les myopathies (AFM) suivent ce modèle, mais cette forme juridique
est encore peu développée. La loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux
associations et aux fondations étend les avantages fiscaux des fondations et
de leurs donateurs, tandis qu’un « statut type » de « fondation à caractère
scientifique » ou de « fondation de recherche » est créé.
IV/LE MONDE/MARDI 18 NOVEMBRE 2003

SUVA (Fidji)
de notre envoyé spécial
L
es grues encombrent à
nouveau le ciel de Suva,
la capitale de Fidji. « En
deux ans, le visage de la vil-
le a changé, explique un
diplomate. On voit des
bureaux, des résidences et des com-
merces apparaître ici et là. Un centre
commercial va bientôt ouvrir ses por-
tes. » Le nombre de permis de
construire a augmenté de 29 %
entre 2001 et 2002. Ce boom immo-
bilier s’explique en partie par l’essor
du tourisme. La première pierre
d’un hôtel Four Seasons de
800 chambres devrait être prochai-
nement posée. Le nombre de visi-
teurs étrangers devrait approcher
cette année le record enregistré en
1999. « Le coup d’Etat de mai 2000 a
stoppé net l’arrivée de touristes, se
souvient Patrick-Antoine Decloitre,
un Français qui diffuse sur Internet
un bulletin quotidien d’information
intitulé Flash d’Océanie.Mais les Fid-
jiens se sont mis au boulot et ont
remonté la pente. »
Le tourisme est aujourd’hui le pre-
mier pourvoyeur de devises, avec
285 millions d’euros en 2002 contre
190 millions huit ans plus tôt. Aus-
traliens et Néo-Zélandais viennent
toujours en masse dans ce superbe
pays perdu au milieu du Pacifique
sud, où les habitants sont parmi les
plus accueillants de la planète, mais
le nombre de visiteurs asiatiques,
américains et européens est égale-
ment en hausse constante. Tirée par
l’immobilier et le tourisme, la crois-
sance du produit intérieur brut
(PIB) devrait atteindre cette année
5,1 %, et près de 4 % ces deux pro-
chaines années. Des chiffres à faire
pâlir d’envie de nombreux pays
européens…
« Le pays est parti de tellement bas
après le coup d’Etat qu’il ne lui était
pas bien difficile de vite décoller »,
souligne Philippe Liege, conseiller
de coopération et d’action culturel-
le à l’ambassade de France à Suva.
Parce que le coup d’Etat visait à écar-
ter du pouvoir le premier ministre
d’origine indienne Mahendra
Chaudhry, la plupart des membres
de cette « minorité », qui représen-
te en fait 40 % des 830 000 habitants
du pays, ont longtemps refusé d’in-
vestir par peur de se voir une nouvel-
le fois menacés d’expulsion. « Les
coffres des banques débordent de
liquidités, déclare Amraiya Naidu,
l’ambassadeur itinérant du premier
ministre, Laisenia Qarase. Mais
l’amélioration du climat politique a
ramené la confiance et commence à
débloquer l’investissement. »
La bonne santé de l’économie fid-
jienne s’explique également par la
croissance des transferts de fonds
d’émigrés partis nombreux tenter
leur chance à l’étranger : 110 mil-
lions d’euros en 2003, quatre fois
plus qu’en 1994. Une grande partie
de cette somme est versée par des
militaires en mission sous le casque
bleu de l’Organisation des Nations
unies (ONU), et par les joueurs de
rugby recrutés en Australie, en Nou-
velle-Zélande et en Europe.
Mais plusieurs écueils menacent
la bonne santé de l’économie fidjien-
ne. Pour éponger son déficit budgé-
taire, l’Etat a emprunté 470 millions
d’euros au Fonds de pension natio-
nal auquel les salariés sont obligés
de cotiser, le Fiji National Provident
Fund. « Il sera incapable de rembour-
ser ses obligations lorsqu’elles vien-
dront à échéance d’ici cinq à huit
ans », prévient un professeur de
l’Université du Pacifique sud (USP).
Par ailleurs, les entreprises étrangè-
res restent réticentes à investir dans
ce pays politiquement instable. « Les
investissements étrangers ne représen-
tent même pas 10 % du PIB », relève
un diplomate en poste à Suva. L’atti-
tude assez « désinvolte » de nom-
breux salariés effraie aussi les
employeurs potentiels. « Un de mes
amis dirige une société de 200
employés qui fabrique des chaussures,
raconte Philippe Liege. Chaque
semaine, la moitié d’entre eux dispa-
raissent dans la nature après avoir tou-
ché leur salaire hebdomadaire, et
reviennent après avoir tout dépensé.
Reste que, tous les lundis, il faut recru-
ter cent nouveaux salariés ! »
L’industrie textile traverse égale-
ment une période difficile après plu-
sieurs années d’embellie qui ont vu
son chiffre d’affaires passer de 77 à
133 millions d’euros entre 1994 et
2002. « L’Etat a attiré beaucoup de
sociétés étrangères en leur promettant
de ne pas payer d’impôt pendant trei-
ze ans, explique Joni Madraiwiwi, un
des plus grands avocats de Suva. Cet
abattement atteint aujourd’hui son
terme, et de plus en plus d’usines fer-
ment leurs portes. »
La crise de l’industrie sucrière reste
toutefois le plus grave danger qui
menace le développement du pays.
Près d’un quart de la population vit
de la culture de la canne à sucre, dont
la production représente une valeur
de 116 millions d’euros en 2003. Or la
productivité de cette activité ne cesse
de chuter. « Au début des années
1980, nous étions parmi les plus pro-
ductifs au monde, avec un rendement
de 8 tonnes à l’hectare. Ce chiffre est
aujourd’hui de 4,9 tonnes…, se lamen-
te Charles Walker, le président du
comité de réforme sur le sucre mis en
place par le gouvernement. Les plan-
teurs reçoivent de l’Union européenne
des subventions en fonction du poids
de canne produit, et non pas de sa
teneur en sucre. Ils ne cherchent donc
pas à cultiver des plantes de bonne
qualité. » Ce système, qui coûte 1 mil-
lion d’euros par semaine à Bruxelles,
devrait prendre fin en 2007. « D’ici là,
nous devons absolument devenir com-
pétitifs », prévient M. Walker.
Un objectif qui sera difficile à rem-
plir sans une réforme du droit fon-
cier. La terre appartient en effet aux
Fidjiens de souche, qui louent leurs
champs à des planteurs presque
tous d’origine indienne. Mais une
majorité des baux ne sont pas
renouvelés, les propriétaires préfé-
rant laisser leurs terres en friche. Le
poids du sucre dans l’économie ne
cesse ainsi de chuter. La volonté du
gouvernement de développer le
cinéma (le tournage d’Anaconda II
vient de se terminer sur l’île de Viti
Levu) ou le commerce d’acajou (Fid-
ji possède la plus grande forêt de
cette essence au monde) ne pourra
jamais compenser la disparition de
l’industrie sucrière, qui aurait des
conséquences sociales catastrophi-
ques. De sombres nuages pour-
raient bientôt apparaître au-dessus
des plages de sable fin…
Frédéric Therin
HISTOIRE ÉCONOMIQUE
Trente ans après
le choc pétrolier
le tourisme
est aujourd’hui
le premier
pourvoyeur
de devises,
avec 285 millions
d’euros en 2002
L
aFrance va mal, la Fran-
ce tombe », lançait il y a
quelques jours, dans le
quotidien Les Echos, l’an-
cien ministre de l’écono-
mie et des finances,
Dominique Strauss-Kahn. « Le gou-
vernement ponctionne les classes
moyennes qui consomment, pour
redistribuer aux contribuables aisés,
qui ont tendance à davantage épar-
gner. Résultat mécanique : la
consommation baisse en France,
pour la première fois depuis plus de
dix ans, et le taux d’épargne s’élève
à des niveaux jamais atteints depuis
1974. » Rapporté au revenu dispo-
nible brut, le taux d’épargne des
Français s’établit juste au-dessus
de 17 %, ce qui le situerait parmi
les plus élevés des grands pays
industrialisés. Il ne faudrait pas
chercher plus loin l’origine des
maux de l’économie française et
de ses contre-performances en
matière de croissance : déficit de
consommation et excédent d’épar-
gne. Les Français seraient trop
fourmis et pas assez cigales. Le
contraire des Américains.
Sauf que ce taux de 17 %, et plus
encore sa comparaison avec celui
d’autres grandes nations, doit être,
selon les économistes, considéré
avec prudence. Comme le notent
les experts de l’Insee dans une étu-
de consacrée au taux d’épargne
des ménages français, « les chiffres
officiels, publiés directement par les
instituts nationaux de statistique,
font apparaître une très forte hétéro-
généité des taux d’épargne entre
pays. Toutefois, une analyse appro-
fondie de la mesure du taux d’épar-
gne montre que la lecture n’est pas
simple. D’une part, plusieurs mesu-
res coexistent, d’autre part, elles peu-
vent être fortement conditionnées
par les règles institutionnelles des
pays ». C’est le taux d’épargne bru-
te qui fait référence en France,
mais c’est le taux d’épargne nette
(c’est-à-dire diminuée de l’amortis-
sement du capital fixe des ména-
ges) qui est retenu aux Etats-Unis
ou en Allemagne.
La façon dont on intègre ou pas
les dépenses de protection sociale
au revenu disponible induit, aussi,
d’importantes différences. « Si les
transferts sociaux en nature sont
inclus dans le revenu, rappelle
l’Insee, celui-ci est plus élevé mais
l’épargne reste inchangée car la
consommation des ménages est éga-
lement augmentée des mêmes mon-
tants : le taux d’épargne est donc
révisé à la baisse. » Patrick Artus,
chef économiste chez CDC-Ixis,
estime pour sa part qu’il y a « un
biais statistique qui réduit la mesu-
re du taux d’épargne des ménages
dans les pays où une partie impor-
tante des dépenses de santé et
d’éducation est privée et réellement
à la charge des ménages ».
Au total, selon l’Insee, « en adop-
tant une mesure unique, commune
àtous les pays et retenue pour être
la plus robuste, le taux français
occuperait une position médiane au
sein du groupe des grands pays
industrialisés ». En 2001, selon l’Or-
ganisation de coopération et de
développement économiques
(OCDE), le taux d’épargne des
ménages français s’inscrivait à
11,4 %, un niveau nettement supé-
rieur à celui des Etats-Unis (2,3 %),
mais comparable à celui de la plu-
part des autres pays européens
(10,1 % en Allemagne, 11,2 % aux
Pays-Bas). Par conséquent, il n’y
aurait pas, en matière d’épargne,
d’exception française, et donc d’in-
quiétude particulière à avoir sur
son niveau général. En revanche,
son évolution récente – avec près
de deux points de hausse depuis le
début de l’année – serait plus pré-
occupante.
Pour expliquer cette progres-
sion, plusieurs pistes sont évo-
quées. La première est celle de la
détérioration de la situation écono-
mique, notamment sur le front de
l’emploi. Celle-ci inciterait les
ménages à augmenter leur épar-
gne de précaution. « La confiance
des ménages s’est effondrée au pre-
mier semestre, soulignent les écono-
mistes du Crédit commercial de
France (CCF). Elle reste affaiblie
par la mauvaise santé du marché
du travail. » Ce phénomène serait
d’autant plus fort que le chômage
aurait commencé à toucher des
catégories plus aisées, dont la capa-
cité d’épargne est plus grande.
S’ajouterait à cela le manque de
lisibilité de la politique économi-
que gouvernementale, notam-
ment en matière fiscale. « Les
signaux envoyés par le gouverne-
ment sont contradictoires », expli-
que-t-on au CCF. Conjointement
aux baisses d’impôts, une augmen-
tation de certaines taxes (tabac,
essence) est annoncée. Ce brouilla-
ge peut retarder le retour de la
confiance, indispensable pour un
rebond de la consommation. Le
maintien d’une épargne de précau-
tion élevée risque d’être privilégié,
d’autant que les incertitudes struc-
turelles (retraites, financement
des déficits) n’ont pas disparu.
L’analyse est à peu près la
même à l’Observatoire français
des conjonctures économiques
(OFCE), qui évoque une « France
emmêlée » et souligne « la faible
confiance des ménages, un marché
du travail dégradé et des politiques
restrictives et confuses ».« Il n’est
pas sûr que la politique fiscale de
diminution d’impôts sur le revenu
redonne confiance aux ménages et
les incite à consommer, insiste
l’OFCE. La baisse de 3 % sur le
revenu va profiter surtout aux
ménages les plus aisés qui, comme
en 2002, l’utiliseront majoritaire-
ment pour gonfler leur épargne. »
Le maintien d’un niveau d’infla-
tion relativement élevé (+ 2,2 % en
septembre) – et surtout le senti-
ment vécu par les ménages d’une
progression des prix bien plus rapi-
de encore, en raison notamment
du passage à l’euro – contribuerait
àla remontée du taux d’épargne.
«Une inflation forte pousse à épar-
gner davantage pour compenser la
perte de valeur réelle des actifs déte-
nus non indexés sur l’inflation »,
rappelle M. Artus.
Enfin, des économistes évo-
quent l’effet d’« équivalence ricar-
dienne » : les dérapages budgétai-
res et le non-respect par la France
du Pacte de stabilité inciteraient
les ménages à augmenter leur
épargne en prévision de la hausse
future des impôts destinée à épon-
ger les déficits actuels. Même si
elles sont difficiles à évaluer préci-
sément, les raisons d’épargner ne
manqueraient pas.
Pierre-Antoine Delhommais
en hausse
de deux points
depuis le début
de l’année,
le taux
d’épargne
des ménages
a atteint 17 %
L’économie de Fidji au beau fixe… pour l’instant
FOCUS
1973, les membres de l’Organi-
sation des pays exportateurs de
pétrole (OPEP) provoquaient une
crise dont, aujourd’hui encore, on
adu mal à mesurer les conséquen-
ces. La forte hausse du prix du
brut, le 16 octobre de cette année-
là, mettait subitement fin à la pros-
périté des « trente glorieuses ». Ce
n’était que le révélateur d’une cri-
se plus profonde.
A l’époque, les pays occidentaux
connaissent pourtant une croissan-
ce soutenue depuis 1945. La France
est entrée dans la société de
consommation. Le paysage indus-
triel, social et démographique a
changé radicalement. Les condi-
tions de vie s’améliorent avec l’aug-
mentation des revenus et la diffu-
sion des innovations. Chaque foyer
se trouve équipé en matériels élec-
troménagers dernier cri. En trente
ans, le nombre de voitures circu-
lant sur les routes de France a été
multiplié par quinze et demi.
Cette croissance, généralisée à
tous les pays développés, s’accom-
pagne d’un boom sans précédent
de la demande d’énergie. Le char-
bon cède la place au pétrole, dont
la consommation est multipliée
par six durant cette période. Les
produits dérivés comme le plasti-
que, les engrais et les détergents
sont plébiscités. L’industrie et le
consommateur deviennent tribu-
taires de l’or noir. La croissance est
telle que la production américaine
de pétrole, pourtant la première
au monde, ne répond plus aux
besoins domestiques dès 1948.
Du côté de l’offre, le marché est
contrôlé par sept multinationales,
les « sept sœurs » : BP, Chevron,
Esso, Gulf, Mobil, Royal Dutch Shell
et Texaco. Dès 1928, elles avaient
décidé de figer leur position dans
le monde et de maîtriser les prix.
Cette entente avait pour but d’évi-
ter les luttes fratricides, ainsi que
l’arrivée de nouveaux concurrents.
Les majors maintenaient leur
contrôle du puits à la pompe. C’est
un modèle parfait d’intégration
verticale.
Jusqu’en octobre 1973, les prix
–bas – sont fixés par les compa-
gnies au départ du port de charge-
ment. Les pays producteurs sont
délibérément exclus de ce scéna-
rio, même s’ils réussissent à obte-
nir le partage équitable des bénéfi-
ces de l’extraction de pétrole en
guise de royalties, à partir de 1950.
Malgré la forte croissance de la
demande, la découverte de nou-
veaux champs de pétrole permet
de stabiliser les prix. Le Nigeria
voit ainsi sa production passer de
1million à 113 millions de tonnes
par an entre 1960 et 1974. Alors
que la première goutte de pétrole
n’est découverte qu’en 1959 en
Libye, la production atteint déjà
160 millions de tonnes en 1970.
Les exportations de ces nouveaux
venus vont compenser la forte
hausse de la demande, pour le
plus grand bonheur des pays
industriels.
L’offre s’organise. L’OPEP naît dis-
crètement en 1960 et réunit cinq
pays : le Venezuela, l’Arabie saoudi-
te, l’Iran, l’Irak et le Koweït. Ils
représentent alors 40 % de la pro-
duction mondiale d’or noir. L’objec-
tif est de s’affranchir des compa-
gnies étrangères pour contrôler
pleinement la rente pétrolière.
Les conflits du Moyen-Orient
vont permettre à l’Organisation de
montrer sa capacité d’action. Le
pétrole devient une arme politi-
que. En 1971, le cartel exige et
obtient une hausse des royalties. Il
renouvelle ses exigences à la suite
des dévaluations du dollar de 1971
et de 1973. Mais le sommet sera
atteint lors de la guerre du Kip-
pour.
Le 6 octobre 1973, les armées
égyptiennes et syriennes lancent
une attaque surprise contre Israël.
Deux jours plus tard, les pays de
l’OPEP demandent aux compa-
gnies un doublement du prix du
pétrole. Malgré leur refus, les Etats
du Golfe imposent cette hausse,
dès le 16 octobre. Ils seront suivis
par l’ensemble des pays produc-
teurs d’or noir. On assiste, alors, à
un renversement de situation : les
pays pétroliers sont désormais en
mesure d’imposer leur prix. Le bras
de fer tourne à leur avantage.
L’OPEP maîtrise une arme qui s’avè-
re être redoutable. Le temps béni
du pétrole bon marché a rendu les
pays occidentaux fortement dépen-
dants de cette source d’énergie.
La fin du conflit armé le 26 octo-
bre 1973 ne signifie pas pour
autant un retour à la situation
antérieure. Si l’embargo décrété
envers les pays qui soutiennent
Israël ne dure que quelques semai-
nes, l’OPEP profite de la situation
pour doubler à nouveau le prix du
pétrole le 23 décembre.
En deux mois, l’or noir est passé
de 3 à 12 dollars le baril. Les pays
industriels découvrent alors que
l’énergie a un prix… La page des
«trente glorieuses » se tourne
brusquement. Dès 1974, les failli-
tes augmentent de 17 % en France,
la production baisse, l’inflation
atteint 15 % et le chômage massif
fait une brusque apparition. Le
choc est aussi psychologique. On
s’aperçoit que les ressources natu-
relles ne sont pas inépuisables, il
va falloir faire des économies.
Mais le pétrole ne doit pas pour
autant occulter des problèmes
plus profonds. La société de
consommation est, en effet, pro-
che de la saturation, la demande
s’essouffle. Les équipements indus-
triels, trop voraces en énergie et en
main-d’œuvre, ont subitement
pris un coup de vieux. Cette pério-
de marque en même temps la fin
de la stabilité monétaire, avec les
deux dévaluations du dollar
en 1971 et 1973. On entre désor-
mais dans une ère d’instabilité de
l’emploi, des prix et des monnaies.
Le monde du travail en paiera le
plus lourd tribut.
Jacques-Marie Vaslin est maître
de conférences à l’IAE d’Amiens
et chercheur au Centre de recher-
che sur l’industrie, les institutions
et les systèmes économiques
d’Amiens (Criisea).
par Jacques-Marie Vaslin
Les multiples raisons qui incitent
les Français à grossir leur bas de laine
DES COMPARAISONS TROMPEUSES
Source : Datastream, Insee comptes trimestriels,CDC Ixis
Taux d'épargne desménages, en %du revenudisponible brut (RDB)
9294 9698 020088 908284 861980
0
4
12
8
16
20
Allemagne (net)Etats-Unis(net) France (brut)
« Dès 1974, les faillites
augmentent de 17 % en France,
la production baisse, l’inflation
atteint 15 % et le chômage
massif fait une brusque
apparition. Le choc est aussi
psychologique »
LE MONDE/MARDI 18 NOVEMBRE 2003/V
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%


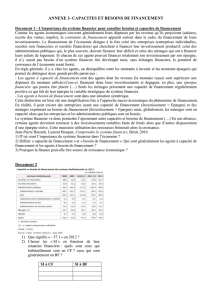
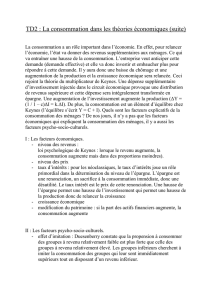
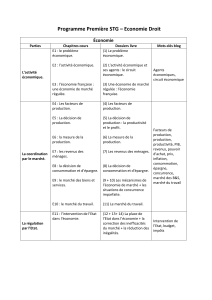
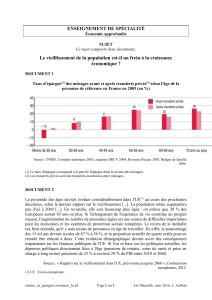
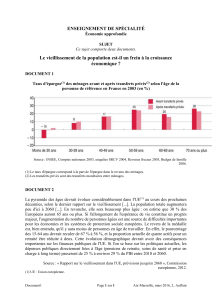
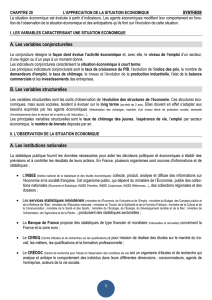
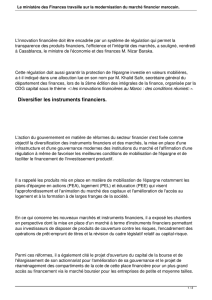
![[…] Il est demandé au candidat de répondre à la question](http://s1.studylibfr.com/store/data/005782290_1-4e0a9f168370a43f95ede41383956fb9-300x300.png)