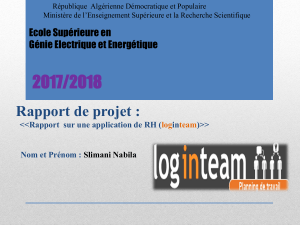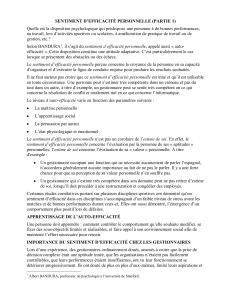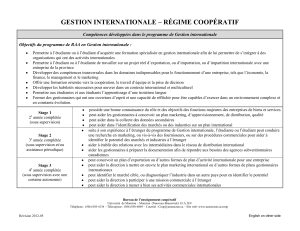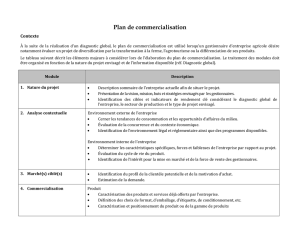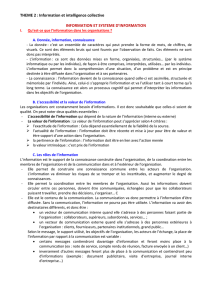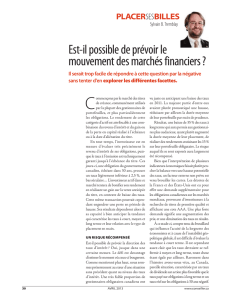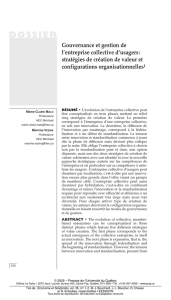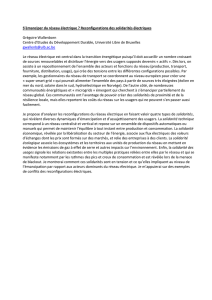entre les valeurs et l`enracinement

© 2005 – Presses de l’Université du Québec
Édifice Le Delta I, 2875, boul. Laurier, bureau 450, Sainte-Foy, Québec G1V 2M2 • Tél.: (418) 657-4399 – www.puq.ca
Tiré de: Économie et Solidarités, vol. 35, nos 1-2, M. J. Bouchard, J. L. Boucher, R. Chaves
et R. Schediwy, responsables • EES3501N
Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés
DOSSIER
65
RÉSUMÉ • Les gestionnaires d’entreprises de l’éco-
nomie sociale jouent un rôle clé dans la gouvernance
de ces entreprises : ce sont eux qui orientent leurs
trajectoires. Cet article dégage les éléments théoriques
sous-jacents au rôle central des gestionnaires dans les
organisations de l’économie sociale et analyse la nature
de ces ressources humaines stratégiques, particulière-
ment les variables qui influencent leur comportement.
Il étudie également leur capacité de déterminer des
trajectoires qui vont soit consolider, soit banaliser
l’identité propre à l’économie sociale. Enfin, il analyse,
d’un point de vue normatif, les avantages et les limites
de diverses options de sélection et de contrôle.
ABSTRACT • Managers play a key role in social
economy corporate governance, and can determine
the path that these companies will take. This article
analyses the theoretical aspects underlying the central
role of managers in social economy companies, the
nature of these strategic human resources, particularly
the variables that influence their behaviour, and their
ability to shape courses that strengthen or denatu-
ralise the social economy identity of these companies.
Finally, taking a prescriptive approach, it examines the
advantages and limitations of different management
selection and control options.
RESUMEN • En el teatro del gobierno de las empre-
sas de economía social los directivos juegan un papel
protagonista capaz de orientar las trayectorias de
aquellas. En el presente artículo analizamos los ele-
mentos teóricos subyacentes a la centralidad de estos
directivos en las empresas de economía social, la
naturaleza de estos recursos humanos estratégicos, en
especial las variables que guían su comportamiento, y
Les gestionnaires de l’économie
sociale : entre les valeurs
et l’enracinement*
RAFAEL CHAVES
Directeur
CIRIEC-España et Institut
universitaire d’économie sociale
et coopérative (IUDESCOOP)
Université de Valencia
Rafael.Chaves@uv.es
ANTONIA SAJARDO-MORENO
Professeure
IUDESCOOP
Université de Valencia
Antonia.Sajardo@uv.es

© 2005 – Presses de l’Université du Québec
Édifice Le Delta I, 2875, boul. Laurier, bureau 450, Sainte-Foy, Québec G1V 2M2 • Tél.: (418) 657-4399 – www.puq.ca
Tiré de: Économie et Solidarités, vol. 35, nos 1-2, M. J. Bouchard, J. L. Boucher, R. Chaves
et R. Schediwy, responsables • EES3501N
Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés
66 Économie et Solidarités, volume 35, numéros 1-2, 2004
su capacidad para orientar trayectorias de reforzamiento o de desnaturalización
de la identidad de economía social de estas empresas. Finalmente, desde una pers-
pectiva prescriptiva, analizamos las posibilidades y limitaciones de las diferentes
modalidades de control y selección del directivo.
— • —
INTRODUCTION
Les entreprises de l’économie sociale ont la prétention de poursuivre leurs
activités commerciales tout en préservant une identité qui diffère sensible-
ment de celle des entreprises capitalistes privées ou de l’économie publique.
Elles ont toujours eu à faire face simultanément au défi économique et au défi
de conserver leur identité distincte.
Pour relever le défi économique, les entreprises de l’économie sociale
sont obligées d’accroître leur capacité de planifier leur développement, d’inno-
ver, d’améliorer leur efficacité à moyen terme et de devenir plus compétitives.
Pour cela, elles ont besoin, entre autres, d’une structure professionnelle et de
ressources humaines stratégiques, lesquelles peuvent toutefois altérer leur
identité.
Cet article étudie deux questions. Il analyse en premier lieu les ges-
tionnaires, ressources humaines stratégiques, et la capacité de ces derniers
de brouiller l’identité de leur entreprise. En d’autres mots, il adopte une
approche heuristique pour tenter de jeter les bases d’une théorie de la gestion
des entreprises de l’économie sociale. Il explore ensuite des mesures norma-
tives pour préserver l’identité de l’économie sociale, mesures guidées par les
valeurs de démocratie, de distribution équitable et de liberté.
Il part de l’hypothèse que l’orientation du développement économique
et organisationnel des entreprises de l’économie sociale est influencée par la
nature et la marge de manœuvre de leurs gestionnaires. Donc, d’un point de
vue normatif, si ces entreprises veulent préserver leur identité, elles doivent
non seulement choisir judicieusement leurs ressources humaines stratégiques,
mais également clairement définir leur marge de manœuvre.
Cet article définit d’abord le rôle central des gestionnaires dans la
gouvernance des entreprises. Il analyse ensuite la nature des gestionnaires,
en particulier les variables qui influencent leur comportement, ainsi que les
conséquences de ce comportement sur les entreprises de l’économie sociale.
L’orientation des entreprises est influencée par les gestionnaires ; en effet, ce
sont eux qui définissent la direction que prend l’entreprise et, par conséquent,
renforcent ou sapent l’identité des entreprises (Chaves et Monzón, 2001). La
logique sous-jacente à ce phénomène est examinée dans la quatrième partie.

© 2005 – Presses de l’Université du Québec
Édifice Le Delta I, 2875, boul. Laurier, bureau 450, Sainte-Foy, Québec G1V 2M2 • Tél.: (418) 657-4399 – www.puq.ca
Tiré de: Économie et Solidarités, vol. 35, nos 1-2, M. J. Bouchard, J. L. Boucher, R. Chaves
et R. Schediwy, responsables • EES3501N
Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés
Économie et Solidarités, volume 35, numéros 1-2, 2004 67
En dernier lieu, la question de la surveillance des gestionnaires et toutes
les difficultés et limites de ce genre de contrôle sont explorées, ainsi que les
options normatives du processus de sélection.
L’ESSOR INÉVITA BLE DU POUVOIR DES GESTIONNAIRES
Des recherches empiriques (p. ex. Berle et Means, 1932) ont révélé que lorsqu’une
entreprise se développe et se consolide sur le plan économique, un agent éco-
nomique particulier distinct du propriétaire de l’entreprise, le gestionnaire,
devient le pivot de sa gouvernance. La propagation de ce phénomène, autant
dans les entreprises capitalistes que dans celles de l’économie sociale, fragilise
leur nature même et mène à une transformation, voire à une dénaturation de
leur identité. Ces entreprises deviennent des « entreprises de gestion ». Nous
allons examiner ici les principales théories de dégénérescence : la théorie clas-
sique du contrôle de la direction, ou la théorie du contrôle interne, qui porte
sur les entreprises capitalistes, mais qui peut être extrapolée à l’économie
sociale, et les théories classiques de changement au sein des entreprises de
l’économie sociale.
La théorie classique du contrôle interne
Depuis Adam Smith, les écrits économiques conventionnels ont postulé que
dans le milieu d’affaires capitalistes, c’est le propriétaire capitaliste (c’est-à-
dire l’actionnaire) qui est le mieux placé pour s’occuper de ses intérêts et gérer
ses affaires de façon efficace. C’est le seul et unique moyen de garantir que
l’entreprise capitaliste se développera dans l’intérêt de cet agent économique.
La direction de l’entreprise doit toujours être subordonnée et sous le contrôle
de cet agent économique central.
Cette approche demeure prédominante. Elle n’a pas non plus été remise
en question par l’alternative théorique la plus répandue, soit l’économie poli-
tique marxiste, pour qui les gestionnaires ont très peu d’importance. Selon
ce point de vue, le rôle de ces nouveaux acteurs est subordonné à celui des
propriétaires capitalistes et leur présence n’est attribuable qu’à une division
de fonctions pour des raisons techniques et organisationnelles.
Les travaux des vingt dernières années sur la tradition théorique de
l’agence ont en commun la quête pour des formes et des structures de gouver-
nance efficaces pour créer de la valeur pour le propriétaire (l’actionnaire). Ces
travaux ont implicitement démontré les éléments suivants : premièrement,
l’essor inexorable du gestionnaire, dépossédant les propriétaires capitalistes
des rênes du pouvoir ; deuxièmement, une tendance opportuniste, même
prédatrice, parmi les gestionnaires, de s’approprier les revenus qui, selon la
théorie économique traditionnelle au moins, appartiennent au propriétaire

© 2005 – Presses de l’Université du Québec
Édifice Le Delta I, 2875, boul. Laurier, bureau 450, Sainte-Foy, Québec G1V 2M2 • Tél.: (418) 657-4399 – www.puq.ca
Tiré de: Économie et Solidarités, vol. 35, nos 1-2, M. J. Bouchard, J. L. Boucher, R. Chaves
et R. Schediwy, responsables • EES3501N
Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés
68 Économie et Solidarités, volume 35, numéros 1-2, 2004
« légitime » ; enfin, le respect manifeste des auteurs pour le postulat capitaliste
dont il a été question ci-dessus, puisque l’ignorer reviendrait à reconnaître la
tendance dégénérative de l’entreprise capitaliste classique et la fin du système
capitaliste traditionnel, bien que pour des raisons autres que celles envisagées
par Marx.
Un autre courant considère les grandes entreprises modernes à partir
de deux principes : il questionne le postulat capitaliste et tient ensuite pour
acquis que l’organisation institutionnelle des grandes entreprises a changé de
deux façons. La première modification repose sur la séparation entre l’agent
qui contrôle l’entreprise et l’agent qui en est le propriétaire. La deuxième rap-
pelle que l’agent qui le contrôle est la haute direction (et non pas des action-
naires). Ce courant s’est manifesté au début du xxe siècle avec les travaux des
institutionnalistes Tawney (1921) et Veblen (1921), qui ont tôt fait de décrire le
processus de séparation du propriétaire de l’agent contrôlant dans les grandes
entreprises capitalistes, la transformation des propriétaires en « fainéants
absentéistes », le conflit latent, mais grandissant entre les gestionnaires et les
propriétaires et l’augmentation du pouvoir des gestionnaires.
Cette perspective a été élaborée par d’autres économistes comme Berle
et Means (1932), Galbraith (1967) et Chandler (1990). Ne se contentant pas
d’élaborer des structures théoriques pour ce qu’on peut nommer l’économie
de gestion, ils ont aussi fourni des preuves empiriques solides pour appuyer
leurs théories. Selon ces auteurs, le processus de transformation de l’économie
capitaliste en économie managériale est irréversible, parce que l’omnipré-
sence croissante d’un nouvel agent économique et social, le gestionnaire, est
une nécessité objective pour les grandes entreprises qui dominent l’économie.
Les raisons expliquant l’essor du pouvoir des gestionnaires sont de deux
types : techniques et organisationnelles. Les premières surgissent du dévelop-
pement de l’activité des entreprises, qui exigent de plus en plus de compé-
tences professionnelles et de savoir-faire de la part des ressources humaines.
La dispersion croissante des actionnaires et la fragmentation des intérêts
(holdings) entre plusieurs petits actionnaires sont autant de raisons organisa-
tionnelles menant à la manifestation de ce phénomène. Le comportement de
ces propriétaires envers l’entreprise est particulier, car ils ne s’intéressent ni
aux activités de l’entreprise, ni à sa gestion, mais uniquement à la répartition
des dividendes et à la valeur des actions. Comme groupe, ils ont perdu le
contrôle direct de la gestion de l’entreprise.
Toutefois, ces propriétaires détiennent toujours un certain contrôle, dit
négatif, sur l’entreprise. Ils peuvent en effet définir les critères de sélection et
limiter la marge de manœuvre des gestionnaires, variables qui influencent la
qualité et le comportement des gestionnaires. Comme Galbraith l’a indiqué,

© 2005 – Presses de l’Université du Québec
Édifice Le Delta I, 2875, boul. Laurier, bureau 450, Sainte-Foy, Québec G1V 2M2 • Tél.: (418) 657-4399 – www.puq.ca
Tiré de: Économie et Solidarités, vol. 35, nos 1-2, M. J. Bouchard, J. L. Boucher, R. Chaves
et R. Schediwy, responsables • EES3501N
Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés
Économie et Solidarités, volume 35, numéros 1-2, 2004 69
la théorie de gestion exige l’approbation ou le consentement passif des pro-
priétaires, lui-même influencé par la distribution de bénéfices acceptables.
Cette dernière exigence est la principale limite de la marge de manœuvre des
gestionnaires.
L’autre limite, selon la théorie de la gestion, découle des conséquences
de la nouvelle logique de distribution des actionnaires. Une telle logique,
empreinte d’une perspective à court terme, peut compromettre la viabilité
de l’entreprise dans le moyen et long terme, car elle sous-estime des mesures
telles que l’investissement et les modifications organisationnelles et tech-
niques, changements nécessaires, mais non rémunérateurs dans l’immédiat.
Une autre approche qui ressort de la littérature souligne l’importance du pou-
voir technocratique en ce qui concerne la viabilité à moyen terme de l’entre-
prise (p. ex. Castanias et Helfat, 1992 ; Charreaux, 1996 ; voir aussi la troisième
partie de l’article).
Les théories managériales et l’économie sociale
Les entreprises de l’économie sociale sont gérées selon le principe classique de
la prise de décision démocratique (Defourny et Monzón, 1992). Ici, les théories
managériales ou de « contrôle interne » renvoient à une banalisation démocra-
tique qui favorise une minorité, à savoir les gestionnaires (voir Stryjan, 1994 ;
Cornforth, 1995). Deux principales théories ont été avancées.
La théorie classique de Michels (1911), également appelée « la loi de
fer de l’oligarchie », met l’accent sur les organisations démocratiques (le cher-
cheur a étudié les syndicats et les partis politiques socialistes). Selon cette
théorie, la démocratie appelle nécessairement une organisation ; c’est dire
qu’une démocratie sans organisation est impensable. Or, toute organisation
tend vers l’oligarchie.
Deux prémisses sous-tendent cette théorie. Selon la première, les compé-
tences de leadership social et professionnel sont distribuées inégalement
parmi les membres d’une organisation démocratique : une minorité a plus de
capacités de leadership dans ces deux sphères. Selon la seconde, la complexité
et la croissance des organisations démocratiques exigent une plus grande sta-
bilité du personnel dans les postes de leadership et de gestion. À partir de ces
prémisses, Michels conclut que la division du travail et l’expansion de l’orga-
nisation nécessitent des « leaders professionnels » (professionnal leaders). Ces
derniers accumuleront les pouvoirs de décision au sein de l’organisation. La
consolidation de cette oligarchie « démocratique » sera renforcée par l’attitude
conformiste des gens de la base (et conséquemment leur acceptation passive
d’un transfert d’une plus grande marge de manœuvre à la direction) et le
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%