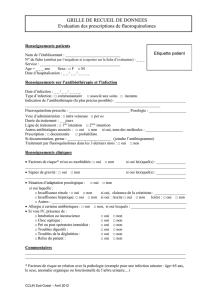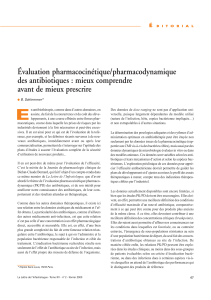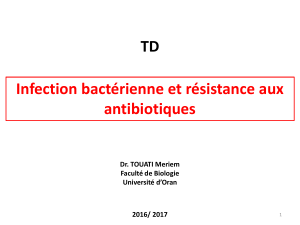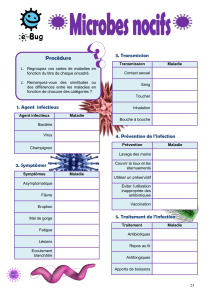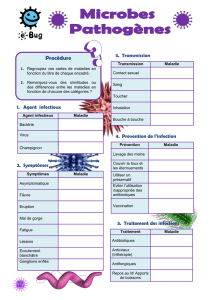258
La Lettre de l’Infectiologue - Tome XVI - nos 8-9 - octobre-novembre 2001
TRIBUNE
es maladies infectieuses représentent un des domaines
dont l’importance va croissant dans le monde hospi-
talier. Ces dernières années ont vu fleurir à la fois de
nouvelles pathologies, telles que les infections à bactéries multi-
résistantes, l’émergence de nouvelles pathologies infectieuses,
mais aussi une prise de conscience aiguë des phénomènes épi-
démiques nosocomiaux. Parallèlement, d’une part, on a assisté
au développement de nouveaux médicaments anti-infectieux
dans certains domaines, tels que la virologie, et, d’autre part,
force est de constater une certaine carence dans le développe-
ment de nouveaux agents antibactériens. Dans ce contexte, la
place prise par les infections nosocomiales, leur impact dans la
vie hospitalière et le frein qu’elles peuvent représenter à l’ex-
pansion des nouvelles technologies médicales sont à l’origine
d’une réflexion sur la prise en charge de ces problèmes au
niveau local (hôpital) en premier lieu, mais aussi au niveau
national et international.
RÔLE DES INFECTIOLOGUES ET DES MICROBIOLOGISTES
La prise en charge optimale des infections au niveau hospita-
lier ne peut se concevoir sans intégration du diagnostic micro-
biologique et clinique et de l’approche thérapeutique. Les
microbiologistes jouent un rôle central dans l’optimisation des
analyses biologiques et la délivrance rapide d’informations
utiles au clinicien. Munis des informations cliniques perti-
nentes, les microbiologistes sont les plus à même d’adapter les
examens à la question posée par le clinicien, d’interpréter les
résultats ainsi obtenus et de contribuer à leur exploitation maxi-
male, sous réserve que le clinicien ne se contente pas d’utiliser
le laboratoire comme un outil rigide communiquant à sens
unique. Le bénéfice potentiel que peuvent en retirer les patients
est illustré par l’impact que peuvent avoir l’identification rapide
des bactéries et la détermination de leur sensibilité aux anti-
biotiques, à la fois sur le pronostic du patient et sur les coûts
de la prise en charge (1).
Le rôle des microbiologistes peut bien évidemment s’étendre
au conseil en antibiothérapie sur la base des résultats qu’ils
génèrent. Cependant, il est réducteur de limiter la spécificité de
la prise en charge d’un patient présentant un état infectieux à
la simple prescription d’une antibiothérapie uniquement basée
sur les résultats microbiologiques, en particulier quand il s’agit
d’un état clinique précaire associé éventuellement à des
comorbidités qui requièrent l’aptitude à établir un diagnostic
différentiel, tant infectieux que non infectieux. Ainsi, plusieurs
travaux ont montré l’importance d’un traitement antibiotique
efficace et précoce sur la mortalité des infections sévères telles
que les septicémies ou les pneumonies (2-5).D’autres travaux ont
mis en lumière l’apport de l’infectiologue consultant pour opti-
miser cette prise en charge initiale (4, 6). L’intervention pré-
coce de l’infectiologue permet en effet d’améliorer l’efficacité
du traitement empirique ou basé sur des résultats bactériolo-
giques encore partiels, qui se traduit par un pronostic plus favo-
rable de l’épisode infectieux. De plus, le bénéfice de la consul-
tation de l’infectiologue s’étend également à une meilleure
utilisation des ressources diagnostiques et thérapeutiques au
sens le plus large (6, 7). La meilleure performance résultant de
l’intervention d’un infectiologue semble notamment liée à une
meilleure appréhension des facteurs de risque d’infection et à
une meilleure prédiction des pathogènes de sensibilité réduite
aux antibiotiques. Cette meilleure appréhension est condition-
née par la parfaite connaissance de l’épidémiologie locale, fruit
de la collaboration entre le microbiologiste, l’infectiologue et
l’épidémiologiste hospitalier. Seule une approche intégrée de
la part du microbiologiste et de l’infectiologue est donc à même
d’exploiter de façon optimale les compétences spécifiques de
chacun d’entre eux. De même qu’il a été montré que la seule
communication écrite par le laboratoire de résultats de prélè-
vements microbiologiques aussi précieux que des hémocultures
Pour l’approche intégrée du microbiologiste
et de l’infectiologue dans la prise en charge
hospitalière des infections
!
B. Byl*, M.J. Struelens**
*Clinique des maladies infectieuses et unité d’épidémiologie et d’hygiène
hospitalière, **service de microbiologie, hôpital Érasme, université libre de
Bruxelles, 1070 Bruxelles, Belgique.
L

La Lettre de l’Infectiologue - Tome XVI - nos 8-9 - octobre-novembre 2001
259
TRIBUNE
n’entraînait pas une adaptation adéquate de l’antibiothérapie
dans tous les cas où elle se justifiait pourtant (8-10), que fau-
drait-il penser d’un infectiologue travaillant de façon indépen-
dante du laboratoire de microbiologie, si ce n’est qu’à défaut
d’être tout à fait aveugle, il serait au moins borgne ? La dis-
cussion quotidienne entre infectiologues et microbiologistes
des prélèvements importants et des cas cliniques difficiles est
devenue systématique depuis des années dans notre institution.
De même, une consultation très étendue des infectiologues cou-
vrant l’ensemble de notre institution combinée à une collabo-
ration avec les microbiologistes a permis de développer une
activité appréciée de tous les services cliniques spécialisés.
Cette situation nous a conduits à proposer une consultation com-
mune des infectiologues et des microbiologistes dans certaines
unités d’hospitalisation, dont tous les protagonistes se plaisent
à reconnaître le côté performant et enrichissant.
Le mode d’organisation des activités des microbiologistes et
des infectiologues dans les différents pays soulève suffisam-
ment d’intérêt pour avoir récemment fait l’objet d’un “work-
shop” de l’European Society of Clinical Microbiology and
Infectious Diseases (11). Comme on pouvait s’y attendre, l’or-
ganisation de l’activité microbiologique et infectiologique est
extrêmement variable d’institution à institution. Cependant,
l’importance d’une intégration de ces deux secteurs y est sou-
lignée. Celle-ci passe également par une réflexion sur la for-
mation dans ces deux spécialités. Au minimum, les programmes
de formation doivent permettre l’acquisition d’une formation
approfondie en infectiologie pour les microbiologistes et vice
versa. Certains pays, comme le Royaume-Uni, vont plus loin,
et proposent une formation tout à fait intégrée de ces deux
disciplines (12).
PRESCRIPTION DES ANTIBIOTIQUES
La problématique de l’usage des antibiotiques à l’échelle d’une
institution représente une autre opportunité de convergence de
l’activité des microbiologistes et des infectiologues (13). De
nombreuses études ont en effet mis en évidence le fait que les
médecins hospitaliers prescrivent trop d’antibiotiques et, de
surcroît, les utilisent de façon souvent inappropriée. Plusieurs
facteurs contribuent à cette utilisation inadéquate, tels que la
confusion devant le vaste choix de molécules disponibles, l’uti-
lisation passionnelle des antibiotiques, le poids de l’industrie
pharmaceutique ou le manque de formation dans le domaine
des maladies infectieuses au cours de la formation médicale.
Ces divers motifs ont entraîné une explosion de la consomma-
tion des agents anti-infectieux, dont la pertinence doit être
remise en question. Ainsi, en Belgique, de 1991 à 1997, l’usage
d’agents anti-infectieux en milieu hospitalier a crû de plus de
30 % en coût (Institut national d’assurance maladie-invalidité).
Face à ce constat, de nombreuses voix se sont élevées pour pro-
mouvoir une approche rationnelle de ce problème tout à fait
crucial pour l’avenir. Parmi les éléments clés de cette approche,
figure le développement d’une approche multidisciplinaire.
Dans notre institution, un groupe informel (groupe antibiothé-
rapie) réunit depuis dix ans infectiologues et microbiologistes,
mais aussi pharmaciens et épidémiologistes hospitaliers,
afin de proposer aux cliniciens une politique cohérente
dans l’utilisation des antibiotiques. Ce groupe fonctionne
comme une sous-commission de la Commission médico-
pharmaceutique locale, et a profondément contribué à mode-
ler le paysage antibiotique de l’institution. Tous les aspects rela-
tifs à l’utilisation des antibiotiques y sont abordés : la compo-
sition du formulaire thérapeutique reprenant les seules
spécialités admises à l’hôpital, le choix des présentations,
l’information au prescripteur, l’analyse des consommations, la
relation entre la consommation et l’évolution de la résistance,
ainsi que l’évaluation de la qualité de l’usage et de l’adéqua-
tion de celui-ci aux recommandations du groupe. Cette
approche a certainement contribué à une meilleure utilisation
des ressources antibiotiques.
Au niveau national, de nombreux pays ont progressivement
développé des dispositions particulières relatives à la prescrip-
tion des antibiotiques à l’hôpital. En France, l’Agence natio-
nale pour le développement de l’évaluation médicale a récem-
ment précisé les missions du Comité du médicament et des
autres acteurs hospitaliers dans ce domaine (14). En Belgique,
une Commission de coordination de la politique antibiotique
(CCPA) a récemment été constituée au niveau ministériel pour
développer une stratégie à long terme de gestion rationnelle de
l’usage des antibiotiques (15).Au niveau national, des mesures
financières ont été proposées pour ne limiter le remboursement
des antibiotiques en prophylaxie chirurgicale qu’aux produits
et doses recommandés dans la littérature ; ceci a conduit à une
importante diminution de l’usage inadéquat dans cette indica-
tion. La CCPA a confié à un groupe d’experts pluridisciplinaires
l’élaboration de recommandations thérapeutiques basées sur la
méthodologie de l’evidence-based medicine. Elle conduit des
analyses comparatives de la consommation hospitalière des
antibiotiques et les diffuse auprès des praticiens, et détermine
les priorités de financement de programmes de surveillance de
la résistance aux antibiotiques. De plus, cette commission a
entrepris une campagne d’information des praticiens et du
public sur l’usage prudent des antibiotiques, et a défini un pro-
gramme national de formation de troisième cycle en gestion de
l’antibiothérapie accessible aux microbiologistes, aux infec-
tiologues et aux pharmaciens. Cette commission a également
proposé l’établissement d’une structure pluridisciplinaire au
niveau hospitalier chargée de la gestion de l’antibiothérapie au
sein de la Commission médico-pharmaceutique et du Comité
d’hygiène hospitalière, ainsi que le financement d’un médecin
ou d’un pharmacien délégué à la gestion de l’antibiothérapie.
À l’heure où les gestionnaires des institutions de soins se trou-
vent face à des choix de plus en plus délicats dans les priorités
d’investissement, le développement d’une approche intégrée
entre microbiologistes et infectiologues peut aussi se révéler
une source d’économie, comme l’ont montré plusieurs travaux
(16). Le développement d’une politique intégrée et multidisci-
plinaire de l’usage des antibiotiques pourrait, en outre, contri-
buer à la préservation de l’épidémiologie locale et à la dimi-
nution de la transmission de bactéries multirésistantes.

260
La Lettre de l’Infectiologue - Tome XVI - nos 8-9 - octobre-novembre 2001
TRIBUNE
CONCLUSION
Les défis permanents que sont les développements de la tech-
nologie médicale et la gestion des complications infectieuses
qui s’y rapportent ainsi que l’émergence de bactéries résistantes
aux antibiotiques nécessitent une collaboration étroite et struc-
turelle entre microbiologistes et infectiologues, tant dans
la prise en charge quotidienne des patients infectés que dans
l’élaboration avec les autres acteurs hospitaliers de la politique
de soins et de son évaluation permanente. "
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
1. Barenfanger J, Drake C, Kacich G. Clinical and financial benefits of rapid
bacterial identification and antimicrobial susceptibility testing. J Clin Microbiol
1999 ; 37 : 1415-8.
2. Setia U, Gross PA. Bacteremia in a community hospital : spectrum and mor-
tality. Arch Intern Med 1977 ; 137 : 1698-701.
3. Leibovici L, Konisberger H, Pitlik SD, Samra Z, Drucker M. Patients at risk
for inappropriate antibiotic treatment of bacteraemia. J Intern Med 1992 ;
231 : 371-4.
4. Byl B, Clevenbergh P, Jacobs F et al. Impact of infectious diseases specialists
and microbiological data on the appropriateness of antimicrobial therapy for
bacteremia. Clin Infect Dis 1999 ; 29 : 60-6.
5. Luna CM, Vujacich P, Niederman MS et al. Impact of BAL data on the therapy
and outcome of ventilator-associated pneumonia. Chest 1997 ; 111 : 676-85.
6. Fowler VG Jr, Sanders LL, Sexton DJ et al. Outcome of Staphylococcus
aureus bacteremia according to compliance with recommendations of infectious
diseases specialists: experience with 244 patients. Clin Infect Dis 1998 ;
27 : 478-86.
7. Nathwani D, Davey P, France AJ, Phillips G, Orange G, Parratt D. Impact of
an infection consultation service for bacteraemia on clinical management and use
of resources. QJM 1996 ; 89 : 789-97.
8. Dunagan WC, Woodward RS, Medoff G et al. Antimicrobial misuse in patients
with positive blood cultures. Am J Med 1989 ; 87 : 253-9.
9. Rintala E, Kairisto V, Eerola E, Nikoskelainen J, Lehtonen OP. Antimicrobial
therapy of septicemic patients in intensive care units before and after blood
culture reporting. Scand J Infect Dis 1991 ; 23 : 341-6.
10. Elhanan G, Sarhat M, Raz R. Empiric antibiotic treatment and the misuse of
culture results and antibiotic sensitivities in patients with community-acquired
bacteraemia due to urinary tract infection. J Infect Dis 1997 ; 35 : 283-8.
11. Finch R, Beeching N, Phillips I. I-Meeting the challenges in clinical micro-
biology and infectious diseases. Clin Microbiol Infect 2000 ; 6 : 401.
12. Cohen J. Training in infectious diseases-looking to the future. Clin Microbiol
Infect 2000 ; 6 : 449-52.
13. Struelens MJ, Peetermans WE. The antimicrobial resistance crisis in hospi-
tals calls for multidisciplinary mobilization. Acta Clin Belg 1999 ; 54 : 2-6.
14. ANDEM. Recommandations pour la pratique clinique : le bon usage des
antibiotiques à l'hôpital, recommandations pour maîtriser la résistance bacté-
rienne. La Lettre de l'Infectiologue 1997 ; 12 : 77-82.
15. Nagler J, Peetermans W, Goossens H, Struelens M. National Committee for
the Coordination of Antibiotic Policy in Belgium : the next step in the fight against
antimicrobial resistance. Acta Clin Belg 1999 ; 54 : 319-20.
16. John JF Jr, Fishman NO. Programmatic role of the infectious diseases phy-
sician in controlling antimicrobial costs in the hospital. Clin Infect Dis 1997 ;
24 : 471-85.
Tarif 2001
POUR RECEVOIR LA RELIURE
#70 F avec un abonnement ou un réabonnement (10,67 €, 13 $)
MODE DE PAIEMENT
#
par carte Visa
N°
ou
Eurocard Mastercard
Signature : Date d’expiration
#
par virement bancaire à réception de facture (réservé aux collectivités)
#
par chèque
(à établir à l'ordre de La Lettre de l’Infectiologue)
EDIMARK - 62-64, rue Jean-Jaurès - 92800 Puteaux
Tél. : 01 41 45 80 00 - Fax : 01 41 45 80 25 - E-mail : [email protected]
Votre abonnement prendra effet dans un délai de 3 à 6 semaines à réception de votre ordre.
Un justificatif de votre règlement vous sera adressé quelques semaines après son enregistre
ment.
Merci d’écrire nom et adresse en lettres majuscules
$Collectivité.................................................................................
à l’attention de..............................................................................
$Particulier ou étudiant
Dr, M., Mme, Mlle...........................................................................
Prénom..........................................................................................
Pratique : $hospitalière $libérale $autre..........................
Adresse..........................................................................................
......................................................................................................
Code postal...................................................................................
Ville................................................................................................
Pays................................................................................................
Tél..................................................................................................
Avez-vous une adresse E-mail : oui $non $
Si oui, laquelle :.............................................................................
Sinon, êtes-vous intéressé(e) par une adresse E-mail : oui $non $
Merci de joindre votre dernière étiquette-adresse en cas de réabonnement,
changement d’adresse ou demande de renseignements.
1 abonnement = 26 revues “On line”
ÉTRANGER (autre qu’Europe)
FRANCE / DOM-TOM / Europe
#
700 F collectivités (127 $)
#
580 F particuliers (105 $)
#
410 F étudiants (75 $)
#
580 F collectivités (88,42 €)
#
460 F particuliers (70,12 €)
#
290 F étudiants (44,21 €)
joindre la photocopie de la carte
LI TOME XVI - Nos 8-9
%À découper ou à photocopier
1
/
3
100%