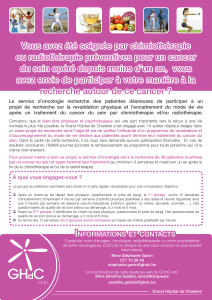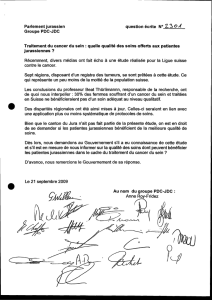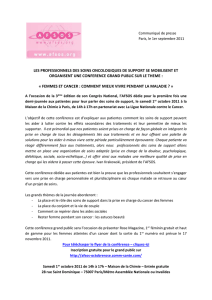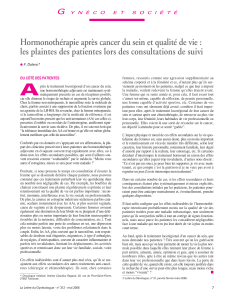Étude du taux d’envahisse-

Étude du taux d’envahisse-
ment ganglionnaire résiduel
après radio-chimiothérapie
pour un cancer du col localisé
Houvenaeghel G. Residual pelvic lymph node invol-
vement after concomitant chemoradiation for
locally advanced cervical cancer. Gynecol Oncol 2006(in press).
Cette étude, rétrospective, est la seule ayant analysé le taux d’atteinte
ganglionnaire chez des patientes ayant une radio-chimiothérapie pel-
vienne pour un cancer du col localement avancé. Les patientes ont
été opérées entre 1988 et 2004 et ont bénéficié d’une radio-chimio-
thérapie pelvienne première associée à du cisplatine seul ou du cis-
platine + 5FU. La curiethérapie intravaginale a été réalisée quand
cela était techniquement possible. Il y a eu un surdosage latéro-pel-
vien dans les stades IIB, III et IVA chez les patientes ayant un enva-
hissement latéropelvien et/ou des envahissements ganglionnaires
visibles à l’imagerie initiale.
Cent douze patientes ont bénéficié d’une chirurgie de complément
de la tumeur cervicale. Cinquante-cinq n’avaient pas d’envahisse-
ment tumoral résiduel au niveau du col. Toutes les patientes ont eu
une chirurgie ganglionnaire pelvienne associée à un curage lombo-
aortique pour 85 d’entre elles. Le stade FIGO initial de la tumeur
était 1B2 dans 17 % des cas, II dans 44 % des cas, III dans 21 %
des cas et IV dans 16 % des cas. Le nombre moyen de ganglions
réséqués a été de 11,5 au niveau pelvien et 7,5 au niveau lombo-
aortique.
Un envahissement ganglionnaire après radio-chimiothérapie pel-
vienne a été observé chez 15,9 % des patientes. Chez 11 de ces 18
patientes, un seul ganglion était positif. Un envahissement ganglion-
naire lombo-aortique a été retrouvé chez 10 des 85 patientes (11,7
%) ayant bénéficié d’un curage lombo-aortique. Il existe un taux de
corrélation significatif entre la présence d’un reliquat cervical et une
atteinte ganglionnaire concomitante. En effet, une atteinte ganglion-
naire pelvienne a été observée chez 6,3 % des patientes n’ayant pas
de résidu cervical versus 26 % des patientes ayant un reliquat tumo-
ral cervical (p = 0,003). En revanche, la réalisation d’un surdosage
latéro-pelvien ne semble pas influencer le taux d’atteinte ganglion-
naire (11,25 % en cas de surdosage latéro-pelvien et 9,5 % en
l’absence de surdosage latéro-pelvien). Néanmoins, comme le souli-
gnent les auteurs, cette conclusion est criticable, car la plupart des
patientes ayant eu un surdosage latéro-pelvien avaient une atteinte
ganglionnaire initiale lors de l’imagerie. Le taux de complications
postopératoires était important (25,6%) mais attendu, étant donné le
type de chirurgie réalisée après radio-chimiothérapie. Les complica-
tions étaient médicales chez 8 patientes et chirurgicales chez 21
patientes, surtout des complications urinaires ou digestives.
Lorsqu’on analyse maintenant la survie, elle était significativement
meilleure chez les patientes n’ayant pas d’atteinte ganglionnaire
(71,5 versus 35,7%).
Cette étude est importante car il n’y a aucune donnée dans la littéra-
ture équivalente concernant le taux d’atteinte ganglionnaire résiduel
après radio-chimiothérapie pelvienne. Elle démontre que cette
atteinte ganglionnaire est particulièrement fréquente chez les
patientes ayant un reliquat tumoral en fin d’irradiation. Il n’est
d’ailleurs pas étonnant de retrouver une atteinte ganglionnaire rési-
duelle chez des patientes n’ayant pas pu avoir une stérilisation com-
plète de leur tumeur cervicale. Néanmoins, on retrouve 6 % de gan-
glions pelviens résiduels chez des patientes n’ayant plus de reliquats
cervicaux. Il serait intéressant de voir si elles avaient bénéficié d’un
surdosage ou pas latéro-pelvien. Par ailleurs, il serait aussi intéres-
sant de connaître la survie spécifique de ces patientes ayant une
atteinte ganglionnaire résiduelle sans reliquat tumoral au niveau du
col. Cette étude suggère qu’il existe une place pour la chirurgie gan-
glionnaire de clôture après radio-chimiothérapie.
Influence pronostique de la quantité
des embols vasculaires
chez des patientes ayant un cancer
du col utérin de stade précoce
Chernofsky MR et al. Influence of quantity of lymph vascu-
lar space invasion on time to recurrence in women with
early-stage squamous cancer of the cervix. Gynecol Oncol
2006;100(2):288-93.
L’objectif de cette étude est de déterminer l’impact de la quantité des
embols vasculaires sur le temps de récidive chez des patientes ayant un
cancer du col de stade précoce.
Cent un cas consécutifs de colpo-hystérectomies élargies avec lympha-
dénectomie pour un cancer du col de stade IA2 au stade IIA ont été
analysés. Quatre-vingt-treize pour cent des patientes avaient une
tumeur de stade I et 7 % une tumeur de stade II. Dans la majorité des
cas, il s’agissait d’une tumeur de moins de 4 cm. 22 % des patientes
avaient une atteinte ganglionnaire. Cinq pour cent d’entre elles avaient
des marges positives et 33% ont bénéficié d’une irradiation postopéra-
toire complémentaire. La présence d’embols vasculaires, la profondeur
d’envahissement du stroma cervical, l’atteinte paramétriale et la pré-
sence de marges positives sont des facteurs pronostiques lors de l’ana-
lyse univariée. Il est à noter que la présence d’embols est fréquemment
observée puisque 71% des patientes dans cette étude ont des embols
tumoraux. Lorsqu’on analyse la survie des patientes ayant des marges
chirurgicales passant en zone saine et ayant aussi des embols (cela
concerne 66 patientes), la quantité d’embols vasculaires influence la
survie (nombre de sites avec des embols supérieurs à 5 ou pourcentage
de section avec des embols supérieurs à 29%).
Cette série confirme que la présence d’embols vasculaires est un
facteur pronostique chez les patientes ayant une tumeur de stade
précoce. Elle démontre aussi que la quantité des embols est à
prendre en compte afin de mieux discuter les modalités de la prise
en charge postopératoire.
Métastases ovariennes
dans les cancers du col utérin
Shimada M et al. Ovarian metastasis in carcinoma of the
uterine cervix. Gynecol Oncol 2006;101(2):234-7.
Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 3471 patientes (la série la
plus large dans la littérature ayant analysé le taux de localisations ova-
riennes) traitées par une chirurgie première pour un cancer du col utérin
de stade IB au stade IIB de 1981 à 2000. Son objectif est double : d’une
part, évaluer la fréquence de l’atteinte ovarienne dans les cancers du col
utérin de stade précoce et d’autre part, évaluer les facteurs influençant
14
La Lettre du Gynécologue - n° 313 - juin 2006
REVUE DE PRESSE
P. Morice (Institut Gustave-Roussy, 39, rue Camille-Desmoulins, 94800 Villejuif)

cette métastase et la survie des patientes ayant une localisation ova-
rienne. Cinquante-deux patientes avaient une métastase ovarienne dont
le taux était, en cas de tumeur squameuse, de 0,22% pour les stades IB,
0,75% pour les stades IIA et 2,17 % pour les stades IIB. Lorsqu’il
s’agissait d’adénocarcinomes, ce taux était significativement plus élevé
(3,72 % pour les IB, 5,26 % pour les IIA et 9,85 % pour les stades IIB).
Le taux global d’atteinte ovarienne était donc significativement plus
important chez les patientes ayant des adénocarcinomes que chez celles
ayant des tumeurs squameuses (5,31 versus 0,79 %). En revanche,
lorsqu’on analyse les autres facteurs influençant l’atteinte ovarienne, la
présence d’embols vasculaires, la profondeur d’invasion du stroma,
l’atteinte endométriale et la taille tumorale n’influencent pas la surve-
nue ou pas d’une métastase ovarienne. Par contre, l’envahissement
paramétrial est significativement corrélé à cette localisation.
Lorsqu’on analyse maintenant la survie des 52 patientes ayant une
métastase ovarienne, celles ayant un type histologique squameux ont
une meilleure survie que celles qui ont un type adénocarcinome
même si cette différence n’atteint pas le seuil de la signification sta-
tistique. Il en est de même pour la taille tumorale, la survie à 5 ans
des stades IB avec une métastase ovarienne est de 46%, elle est de
37 % dans les stades IIA avec une localisation ovarienne et 18%
dans les stades IIB, mais cette différence n’atteint pas le seuil de la
signification statistique probablement à cause du faible effectif.
Cette étude démontre de manière formelle que, quel que soit le
stade de la pathologie, la présence d’adénocarcinome est à risque
de métastase ovarienne accru. Les auteurs suggèrent de manière
tout à fait licite qu’en présence de ce type histologique, la conser-
vation ovarienne ne devrait pas être proposée. Cette étude est à
mettre en relation avec l’observation récente rapportée dans la lit-
térature de la première récidive après trachélectomie élargie surve-
nant sous forme d’une métastase ovarienne chez une patiente ayant
un adénocarcinome de forme débutante (stade IB1) (
Picketty M et al.
Am J Obstet Gynecol 2005;193:1382-3).
Chimiothérapie intrapéritonéale
dans les cancers
de l’ovaire de stade avancé
– Armstrong DK et al Intraperitoneal cisplatin and paclitaxel
in ovarian cancer. N Engl J Med 2006;5;354(1):34-43.
– Walker JL et al. Intraperitoneal catheter outcomes in a
phase III trial of intravenous versus intraperitoneal chemo-
therapy in optimal stage III ovarian and primary peritoneal
cancer: a gynecologic oncology group study. Gynecol Oncol
2006;100(1):27-32.
La donnée bibliographique la plus importante publiée ces dernières
semaines dans deux revues concerne l’étude du GOG 172. La survie a
été analysée dans le New England Journal of Medicine ; les complica-
tions et la toxicité ont été analysées dans Gynecologic Oncology. C’est
une étude de phase III concernant des patientes traitées pour un cancer
de l’ovaire de stade III ayant bénéficié d’une chirurgie complète sur le
plan macroscopique ou optimal laissant un reliquat de moins de 1 cm.
Les patientes ont été randomisées entre deux bras :
– un bras intraveineux (IV) conventionnel (les patientes ont reçu 135
mg/m2de paclitaxel sur 24 heures suivis de 75 mg/m2de cisplatine
par voie intraveineuse le deuxième jour) ;
– un bras constitué de patientes ayant bénéficié d’une chimiothéra-
pie mixte intraveineuse et intrapéritonéale (IP). Les patientes ont là
aussi reçu 135 mg/m2de paclitaxel par voie intraveineuse le premier
jour suivis par 100 mg/m2en IP de cisplatine le deuxième et 60
mg/m2de paclitaxel en IP le huitième jour.
Quatre cent-vingt-neuf patientes ont fait partie de cette étude dont 14
patientes inéligibles. Au total, 210 patientes faisaient partie du
groupe intraveineux et 205 patientes du groupe IP. Dans le bras IV,
189 patientes ont reçu 6 cycles de chimiothérapie et 21 patientes ont
reçu moins de 6 cycles. Chez les 205 patientes enrôlées dans le bras
IP, seules 42 % d’entre elles ont pu bénéficier des 6 cycles de chi-
miothérapie IP. Il est à noter qu’il existe une différence significative
de toxicité (douleurs de grades 3 et 4, fatigue, toxicité hématolo-
gique, gastro-intestinale et neurologique) chez les patientes traitées
par voie IP. Néanmoins, on note une différence de survie significa-
tive au bénéfice des patientes ayant été traitées par voie IP. Ainsi, la
médiane de survie sans récidive dans le groupe IV et IP était respec-
tivement de 18,3 et 23,8 mois et la médiane de survie globale dans le
groupe IV et IP était respectivement de 49 et 65,6 mois.
Il est aussi à noter que parmi les 415 patientes éligibles, 202 ont eu
une chirurgie de “second look”. Le taux de “second look” négatif
était significativement plus important chez les patientes traitées par
voie IP que chez les autres (57 versus 41 %). Enfin, donnée très
importante, il y a eu une étude de qualité de vie réalisée avant le qua-
trième cycle, 3 et 6 semaines après la sixième cure de chimiothérapie
et 12 mois après la dernière cure. Il existe une qualité de vie moins
bonne chez les patientes ayant été traitées par voie IP lors du traite-
ment, mais lorsqu’on analyse la qualité de vie à 1 an, il n’existe
aucune différence entre les deux bras.
Les complications étaient-elles étudiées plus spécifiquement dans
l’article publié dans Gynecologic Oncology. Les auteurs expliquent
et détaillent les raisons de l’abandon de la chimiothérapie IP réalisée
chez ces 119 patientes n’ayant pu avoir leurs six cycles de chimio-
thérapie prévus. Dans 34 % des cas, ce traitement a été interrompu
en raison de complications relatives au cathéter (infections, impossi-
bilités d’injecter, fistule autour du cathéter). Pour 34 patientes,
d’autres complications non directement liées au cathéter ont été
observées (troubles digestifs, déshydratation, problèmes métabo-
liques). Mais il est à noter que, même lorsque les six cycles de chi-
miothérapie IP n’ont pu être réalisés, il y a un gain significatif sur la
survie au bénéfice des patientes traitées par voie IP. Enfin, notons
qu’il y a eu un échec plus fréquemment observé de la faisabilité de la
chimiothérapie IP chez les patientes ayant une résection colique
gauche lors de leur chirurgie d’exérèse.
Au total, les données de cet essai sont fondamentales, car il n’y a
pas eu de gain aussi net sur la survie globale dans les cancers de
l’ovaire depuis l’apport du platine. Il semble difficile d’envisager
maintenant de traiter en 2006 un cancer de l’ovaire ayant pu bénéfi-
cier d’une chirurgie optimale ou complète sans se poser la question
de combiner le traitement IV au traitement IP. Néanmoins, de nom-
breuses questions ou réticences demeurent concernant en particu-
lier la toxicité du traitement. D’autres études sont déjà en cours ou
envisagées pour moduler les doses de chimiothérapie et peut-être
modifier les drogues qui vont être utilisées. Des études sont égale-
ment envisagées en France, en particulier pour voir si ces résultats
sont aussi observables chez les patientes bénéficiant d’une
chirurgie d’intervalle.
■
15
La Lettre du Gynécologue - n° 313 - juin 2006
REVUE DE PRESSE
1
/
2
100%