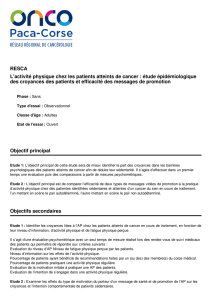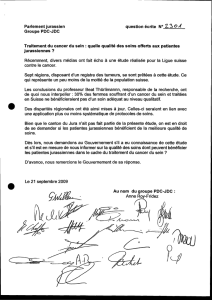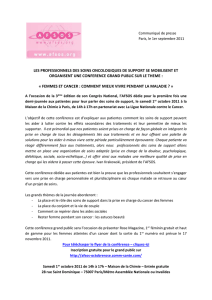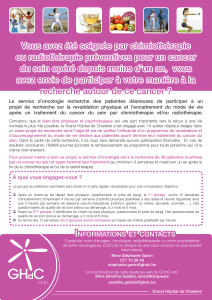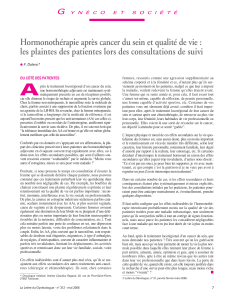G y n é c o e t ...

La Lettre du Gynécologue - n° 315 - octobre 2006
Gynéco et société
Gynéco et société
10
1. Laboratoire d’éthique médicale et de médecine légale, faculté de médecine Paris-5 et
SFFEM (Société française et francophone d’éthique médicale) www.ethique.inserm.fr – http://
www.ethique.inserm.fr, 45, rue des Saints-Pères, 75006 Paris.
2. Département d’échographie et de médecine fœtale, CMCO-SIHCUS, 19, rue Louis-Pasteur,
67300 Schiltigheim.
Les auteurs tiennent à dédier cet article au Pr Jean Bernard,
décédé au mois d’avril 2006. Médecin et chercheur, Jean Bernard,
avant d’être le premier président du Comité consultatif national
d’éthique et l’un des pères de l’éthique médicale en faculté de
médecine, fut un des grands artisans de la qualité de la recherche
médicale dans notre pays et un des fondateurs de la recherche
en éthique médicale, fondant sa réflexion sur le sens et la réa-
lité des pratiques auprès des patients. Il guida nos pas dans ce
domaine à la faculté de médecine Necker, devenue depuis faculté
de médecine Paris-5, et nous lui devons beaucoup.
CADRE RÉGLEMENTAIRE THÉORIQUE
ET LIMITES ÉTHIQUES
Le Comité consultatif national d’éthique français (CCNE)
a émis un certain nombre de recommandations dans
l’avis du 22 juin 1993 portant spécifiquement sur le dé-
pistage de la trisomie 21 et l’utilisation des tests génétiques (1).
Des conditions doivent être respectées, en particulier :
Une information médicale préalable sur le test proposé, intel-
ligible et adaptée, doit être donnée à la femme à laquelle un
accompagnement psychologique doit pouvoir être offert.
Le dosage des marqueurs sériques doit être effectué dans un
laboratoire agréé.
Cet avis décrit la situation de l’annonce d’un diagnostic anté-
natal de trisomie comme : “Le plus souvent ressenti comme un
malheur pour l’individu, une épreuve affective et un fardeau
économique pour la famille et la société.” Cette assertion sou-
ligne la stigmatisation d’emblée négative, d’où semble découler
le choix de privilégier le diagnostic prénatal (DPN) plutôt que
les conditions de prise en charge périnatale. C’est sans doute
pourquoi le CCNE précise bien qu’il ne doit pas s’agir “d’un
programme de masse visant à l’éradication de la trisomie, un
tel programme poserait de redoutables problèmes.”
Suite à cet avis, trois textes ont été publiés fixant les modalités
de prise en charge des patientes enceintes lors d’un diagnostic
prénatal. Le décret de mai 1995 définit pour la première fois les
conditions du DPN (2). Les analyses biologiques doivent être
précédées d’une consultation médicale permettant d’apporter
aux patientes une information sur la maladie dépistée, sur les
moyens de la dépister et sur les résultats attendus. Il est égale-
ment prévu d’informer la patiente sur les risques inhérents au
prélèvement et sur ses conséquences. De plus, le médecin doit
signer une attestation certifiant que les informations sus-men-
tionnées ont bien été communiquées à la femme enceinte.
Un arrêté du 30 septembre 1997 (3) impose un consentement
écrit de la patiente déclarant qu’elle a bien reçu ces informa-
tions. Ce document aborde également la possibilité de révéler
d’autres affections. Finalement (4), l’arrêté du 11 février 1999
va compléter ces deux précédents textes en inscrivant trois
nouvelles obligations concernant :
Le laboratoire qui effectue le caryotype doit être en possession
de l’attestation de consultation médicale et du consentement
écrit de la patiente en application du code de santé publique.
Le compte-rendu ne peut être remis à la patiente que par l’in-
termédiaire du médecin prescripteur.
Le dosage des marqueurs sériques : l’examen ne peut être pra-
tiqué qu’au cours des 15e, 16e, 17e et 18e semaines d’aménorrhée.
Le compte-rendu du résultat : il ne peut être remis à la
patiente que par l’intermédiaire du médecin prescripteur.
Le législateur a ainsi positivement intégré les recommandations
faites par le CCNE et a souhaité un encadrement rigoureux de
cette pratique. Mais il reste à savoir comment ces recommanda-
tions sont appliquées et si l’information et le consentement sont
au niveau d’exigence éthique telle que souhaitée par le CCNE.
Toutefois, au-delà de ces avis et encadrements, il convient de
souligner que l’enjeu éthique de l’obtention du consentement
dans ce domaine n’est pas d’avoir un écrit signé de la part de la
patiente (qui viserait à protéger les médecins et à prouver qu’une
information a été donnée). Il s’agit au contraire d’un élément
bien plus fondamental d’un point de vue de la prise en compte
du respect des personnes et de leur véritable autonomie de choix
: quel est le niveau réel de la qualité de l’information donnée et
quel en est le niveau de compréhension par les patientes ?
Dans la littérature, les études sur le dépistage prénatal de la
trisomie 21 par les marqueurs sériques maternels portent essen-
tiellement sur les résultats de laboratoire ou sur la qualité des
pratiques échographiques, mais peu de travaux font place à la
compréhension de l’information (5).
QUELLE EST LA NATURE DU CONSENTEMENT
DANS LA RÉALITÉ DES PRATIQUES ?
Le consentement est reconnu comme un élément fondamental
de la relation médecin-patient, mais une des conditions de sa
validité est qu’il soit sous-tendu par une information appropriée
et compréhensible.
L’information des patientes lors du dépistage
de la trisomie 21 : quels enjeux éthiques et médico-
légaux pour un consentement réellement éclairé ?
G. Moutel (1), R. Favre (1, 2)
»

La Lettre du Gynécologue - n° 315 - octobre 2006
Gynéco et société
Gynéco et société
11
Le contenu de la consultation médicale préalable à la pratique d’un
dépistage prénatal a été analysé et un certain nombre de proposi-
tions ont été émises sur le contenu de l’information (6), soit :
– information sur la maladie dépistée ;
– signification d’un résultat à bas risque, signification d’un
résultat à haut risque, pourcentage de patientes à bas risque,
pourcentage de patientes à haut risque ;
– risque de fausse couche après le prélèvement proposé aux
patientes à haut risque ;
– pourcentage de patientes à haut risque qui auront un fœtus
trisomique ;
– information sur la possibilité d’une interruption de gros-
sesse pour les patientes dont le résultat prouve que le fœtus
est trisomique.
Ces recommandations ont été reprises et adaptées par le General
Medical Council (7). En France, des textes réglementaires encadrent
cette pratique (1-4), sans que les sociétés savantes aient finalisé pour
autant des recommandations précises comme celles des Anglais.
Une étude française que nous avons coordonnée (en cours de
publication) montre la persistance de lacunes dans ce processus
d’information et de consentement, en particulier concernant les
notions de faux positifs et de faux négatifs, le dépistage associé
de pathologies autres que la trisomie 21 et les conséquences de
la démarche diagnostique (en particulier concernant l’amnio-
centèse et ses risques ou l’interruption de grossesse).
La carence en informations prénatales avait déjà été soulignée par
les travaux de Harris (8) portant sur les dossiers médicaux de faux
négatifs de trisomie 21.Par ailleurs, Lane (9) montrait, en 2001, que
24% des obstétriciens et 21% des sages-femmes déclaraient n’avoir
reçu aucune recommandation spécifique concernant la qualité
de l’information à délivrer et le déroulement d’une consultation
à ce sujet. Une étude réalisée dans le Nord de la France montrait
que 57% des patientes n’avaient pas eu le choix d’accepter ou de
refuser le test (10). Enfin, en Angleterre, 25% des obstétriciens
prescrivaient les tests sans aucune explication préalable (11). Ceci
était en rapport avec une mauvaise connaissance de ces tests et de
leurs conséquences par les prescripteurs, et un déficit de prise de
conscience de la nécessité d’une information de qualité à délivrer
aux patientes (12, 13). Cette méconnaissance peut entraîner une
insuffisance des conseils apportés par les médecins (14).
L’ensemble de ces résultats souligne donc l’importance d’un
investissement des professionnels dans ce domaine, d’autant plus
qu’aujourd’hui ces derniers ont une obligation d’informer, d’apporter
la preuve que cette information a été de qualité et qu’elle a permis
aux patientes de faire un choix réellement éclairé (15, 16).
LA RELATION CLINIQUE INTÈGRE-T-ELLE
LES VALEURS DES PATIENTES ET S’ASSURE-T-ELLE
DE LA COMPRÉHENSION DE L’INFORMATION
PAR LES PATIENTES ?
Avec son corollaire, l’information du patient, le consentement
constitue donc un des points les plus sensibles de la relation
médecin-patient. Comme le soulignait le Pr Jean Hamburger
dans l’ouvrage L’Aventure humaine, publié en 1992, le consente-
ment s’inscrit dans la complexité d’une médecine de plus en plus
moderne et performante, confrontée à l’incertitude du progrès
et de la maladie. Il souligne que la codécision entre le médecin
et le patient est de plus en plus essentielle, le médecin devant
accepter de se mettre à la place du patient et réciproquement
pour bien appréhender toutes les facettes des choix : “Art de
réflexion et de conjecture en 1900, la médecine est devenue
une discipline d’action qui détient aujourd’hui mille pouvoirs
de vie et de mort sur les malades qui lui sont confiés. Puissance
merveilleuse et salvatrice, mais aussi puissance qui va doubler
chaque problème technique d’un problème moral et contraindre
le médecin à repenser toute l’éthique de son métier à chacun
des nouveaux gestes d’audace.” “Toute décision grave doit être
celle de deux hommes, chacun se mettant à la place de l’autre. Le
médecin n’a pas à imposer autoritairement ses propres vues, les
désirs profonds du malade comptent autant que les impératifs
techniques pour la stratégie du traitement.”
En 1997, on assiste à la renaissance du débat sur l’information des
patients suite à la décision de la Cour de cassation qui bouleverse
la doctrine antérieure en faisant désormais peser sur le médecin
la charge de la preuve que l’information a été délivrée, se référant
au code civil et à la nature d’un contrat (second article alinéa
de l’article 1315 du code civil motivant cette innovation juris-
prudentielle) : “...celui qui est légalement ou contractuellement
tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter
la preuve de l’exécution de cette obligation…”
Face à cette décision, les médecins et leurs sociétés savantes vont
s’interroger sur cette contrainte imposée, et vont comprendre
cette décision comme une obligation d’apporter la preuve que
l’information a été donnée, à travers un support écrit signé par
le patient. Nous verrons que cette vision n’est que partiellement
juste et que l’écrit signé d’un patient n’est ni la seule ni toujours
la juste garantie d’une information de qualité.
Quoi qu’il en soit, en 1998, la Cour de cassation complexifie la
question de l’information et du consentement et précise que l’in-
formation doit être complète sur toutes les conséquences d’une
décision médicale. La jurisprudence administrative en 2002 a eu
pour objet l’alignement de la jurisprudence du Conseil d’État sur
celle de la Cour de cassation. Le juge administratif a rejoint le juge
judiciaire en affichant clairement la nécessité d’unifier les règles qui
s’appliquent aux médecins du secteur public hospitalier avec celles
qui sont appliquées pour les médecins du secteur privé.
Cette jurisprudence est reprise dans la loi du 4 mars 2002, dite
loi des droits des patients.
Du coup, à côté des décisions de justice, un débat de nature
éthique voit le jour : comment certes mieux informer, mais
surtout mieux faire participer les patients et les patientes, quand
cela est possible et nécessaire à la prise de décision, afin qu’une
réelle codécision se construise. Ce débat n’est toujours pas clos,
car il nécessite que chaque spécialité médicale réfléchisse à cette
question pour définir jusqu’où on doit aller dans l’exhaustivité,
puis comment accompagner les personnes au décours de l’in-
formation. Enfin, et surtout, comment s’assurer de la réelle
implication des personnes et, en particulier, des patientes dans

La Lettre du Gynécologue - n° 315 - octobre 2006
Gynéco et société
Gynéco et société
12
le cadre de la périnatalité ? Les questions de fond sous-jacentes
sont majeures :
À quoi sert de délivrer une information si elle ne débouche
pas sur une réelle discussion des choix et des conséquences à
venir entre médecins et patientes ?
À quoi sert cette information si, au décours, les femmes ne
sont pas plus éclairées et autonomes face à des prises de déci-
sions complexes ?
C’est ce chemin qu’il convient de construire.
CE QU’IL RESTE À CONSTRUIRE
POUR UN CHOIX RÉELLEMENT ÉCLAIRÉ
Deux prérequis apparaissent indispensables à la validité d’un
consentement réellement éclairé pour une patiente :
Avoir de bonnes connaissances (donc une bonne information,
accessible et comprise) sur sa situation singulière.
Avoir la possibilité d’agir en plein accord avec ses propres
valeurs.
Les médecins doivent donc être les garants du respect de ces
deux prérequis, et les études montrent qu’aujourd’hui l’amélio-
ration du consentement doit passer par une aide aux patientes
à agir en plein accord avec leurs propres valeurs. Ceci suppose
une prise en compte de cette dimension par les professionnels
et une mise en confiance, quel que soit le choix des femmes.
Par ailleurs, travailler sur la qualité de l’information (contenu et
démarche) apparaît essentiel, d’autant plus que c’est une obligation
légale depuis 2002 en France. La qualité de l’entretien médical a
été évaluée dans notre étude (en cours de publication), elle serait
un élément fondamental de la validité du consentement, mais elle
doit être fortement améliorée car des notions essentielles sont très
mal connues par les patientes. Par exemple, 70% évaluent mal la
notion de faux positifs et 50,8% la représentation du risque. V.
Goel (14) relève l’anxiété majeure induite par les faux positifs et la
fausse réassurance chez les patientes ayant eu un faux négatif. On
retrouve la même tendance dans l’étude de J. Gekas (10) seules 32%
des femmes semblent avoir intégré la notion de faux négatifs. La
perception du risque est également mal assimilée, 6% des femmes
ayant eu un test à risque pensent réellement avoir un enfant tri-
somique et 21,5% majorent ce risque en pensant qu’il est de 50%,
alors que la réalité est de moins de 1% (10). Il y a également une
forte méconnaissance des patientes sur la notion du groupe à haut
risque, dans les études, seules 13 % de patientes ont compris cette
notion, les résultats de notre étude en cours (18) montreraient que
le chiffre serait de 30%.
L’information portant sur le dépistage concomitant des défauts de
fermeture du tube neural et d’autres anomalies telles que le Klinefelter
sont également défaillantes. Les résultats de notre étude en cours (18)
montreraient qu’une forte majorité des femmes n’ont jamais entendu
parler du spina bifida et du syndrome de Klinefelter. On doit donc
s’interroger sur les modalités d’information sur ces points. Signalons
enfin que tant pour le dépistage de la trisomie 21 que pour ces patho-
logies, il n’existe que des formulaires administratifs et médico-légaux
de consentement, qui souvent ne s’intègrent pas (dans la forme et dans
le fond) à une réelle démarche pédagogique médicale.
Ce pourrait être l’enjeu d’un travail des sociétés savantes en
lien avec des représentants d’associations parentales. Il s’agit
d’informer sans inquiéter.
CONCLUSION
Choix des parents, acceptation de la situation de handicap ou
interruption de grossesse : un enjeu de santé publique et un
enjeu éthique.
Une enquête pratiquée en 1998 portant sur l’évaluation de l’infor-
mation préalable, sur la remise des résultats et sur les décisions
prises par les femmes conclut à la nécessité d’une amélioration
(15). En 2006, la question perdure et devient un véritable enjeu
de santé publique.
En effet, l’âge maternel des patientes enceintes augmentant, le nom-
bre de grossesses avec trisomie 21 augmente de manière parallèle
et nos pouvoirs publics ont clairement fait le choix d’augmenter
l’accès au diagnostic prénatal. Les chiffres français montre que la
prévalence totale de la trisomie 21 est passé de 17 pour 10000 en
1990 à 26 pour 10000 en 2001 (16). Le nombre d’amniocentèses
à Paris est passé de 12 à 16 % entre 1995 et 1999 (16). Le nombre
d’interruptions médicales pour trisomie 21 a augmenté de manière
parallèle, passant de 38,6% en 1990 à 75,5% en 2001 (16).
Cette évolution majeure de notre société impose aujourd’hui
de s’interroger, sans pour autant remettre en cause le choix des
couples ni la légitimité d’interrompre des grossesses. Il faut en
effet se demander si notre société, au-delà de ses discours conve-
nus, propose de réelles alternatives et les moyens en rapport
pour accueillir un enfant en situation de handicap. Malgré les
annonces au plus haut sommet de l’État, les réalités pratiques
objectivent toujours les carences. Une réflexion sur le handicap et
les conditions de prise en charge des enfants est essentielle si l’on
veut que le choix des parents soit réellement possible et honnête
et éviter les dérives d’un recours automatique au dépistage et à
ses conséquences. Aborder ce sujet et y consacrer réellement
les moyens, au-delà des mots, est d’autant plus important que
l’espérance de vie d’un individu trisomique est passé de 20 à
plus de 50 ans en moins de 30 ans. Sans une telle approche, les
médecins risquent de se tourner davantage (consciemment ou
non) vers la pente glissante d’une systématisation de l’inter-
ruption de grossesse, d’autant plus que le souvenir de l’affaire
Perruche est toujours présent. Cette affaire a laissé des traces
et, à tort ou à raison, perdure l’idée que la médecine aurait pour
finalité la naissance d’enfants “parfaits” (17). Depuis cette affaire,
de nombreux travaux (17) montrent que la condamnation de
médecins peut inciter en effet à une médecine sécuritaire où les
professionnels glisseraient progressivement vers le principe de
précaution, c’est-à-dire limitant la naissance d’enfants porteurs
de handicap pourtant viables. Il faut donc que la notion de
préjudice lié au fait d’être né en situation de handicap (impli-
citement imprimé dans les pratiques médicales suite à l’affaire
Perruche) soit remplacée par celle de solidarité nationale forte,
acceptant en son sein la présence de ces enfants dès lors que
les couples le choisiraient.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces données et réflexions, la question

La Lettre du Gynécologue - n° 315 - octobre 2006
Gynéco et société
Gynéco et société
13
380mm2GH´FXLYUHDUJHQWµ
SRXU XQLQGLFHGH3HDUORSWLPLVp
NOUVEAU
$YDQWXQH
Laboratoire C.C.D. laboratoire de la femme®48, rue des Petites-Écuries 75010 Paris
DGDSWpjYRWUHWHFKQLTXHGHSRVH
FORMES et PRESENTATIONS Dispositifs intra-utérins composés de polyéthylène ORX autour desquels s'enroule
un fil de cuivre (avec noyau d'argent NT), et d'un fil de Nylon mono filamenteux attaché à la base du dispositif.
INDICATIONS Contraception intra-utérine. CONTRE-INDICATIONS Absolues : Anomalies de la cavité, malfor-
mations utérines, affections utérines et salpingiennes, endométrite, suspicion de néoplasie, tumeurs, fibromes, poly-
pes, antécédents d'inflammation pelvienne récente, hémorragies génitales non diagnostiquées, allaitement, maladie de
Wilson ou hypersensibilité au cuivre. MISES EN GARDE et PRECAUTIONS D'EMPLOI Prendre connaissance
des mentions portées sur la notice technique. EFFETS INDESIRABLES • risques infectieux (endométrite, salpin-
gite) nécessitant l'ablation du D.I.U. et une antibiothérapie adaptée. (Ces infections peuvent être cause de stérilité);
• contractions utérines, saignements génitaux, réactions inflammatoires, expulsions.GYNELLE® 375 (735 605.9),
UT 380® Standard (740 273.0), UT 380® Short (740 274.7), TT 380® (768 588.6), NT 380® Standard (439
647.2), NT 380® Short (439 646.6) Remb.Séc. Soc. au tarif de responsabilité pharmaceutique LPP Prix Public :
27,44. Fabrication : (CE. 0459) UT 380®Standard & Short, NT 380®Standard & Short et TT 380®:7
MED.-F- 03270 - (CE. 0120) GYNELLE®375 : PRODIMED -F- 60530- Pour info. complète cf. Vidal
UT 380®
Standard
& Short
NT 380®
Standard
& Short
TT 380®GYNELLE 375®
®
$YDQWXQHERQQHGpFLVLRQ
LO\DWRXMRXUVXQFKRL[
posée : “le niveau de l’information médicale sur la proposition d’un
dépistage par les marqueurs sériques est-il pertinent ?” la réponse
est clairement négative et un travail majeur est à entreprendre
pour faire que les décisions des patientes reposent sur une réelle
possibilité de choix, donc de compréhension d’une prescription
médicale aux implications lourdes de conséquences.
N
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
1. Avis sur le dépistage du risque de la trisomie 21 fœtale à l’aide de tests san-
guins chez les femmes enceintes. Rapport du CCNE, 1993. www.ccne-ethique.fr
2. Décret n° 95 – 559 du 6 mai 1995 relatif aux analyses de cytogénétique et de
biologie pratiquées en vue d’établir un diagnostic prénatal in utero et modifiant
le code de la santé publique.
3. Arrêté du 30 septembre 1997 relatif au consentement de la femme enceinte
à la réalisation des analyses mentionnées à l’article R. 162-16-1 du code de la
santé publique.
4. Arrêté du 11 février 1999 modifiant l’arrêté du 3 avril 1985 fixant la nomen-
clature des actes de biologie médicale.
5. Green J.M. Serum screening for Down’s syndrome: experiences of obstetricians
in England and Wales. Br Med J 1994;309:769-72.
6. Michie S, Dormandy E, Marteau TM. Informed choice: understanding
knowledge in the context of screening uptake. Patient Education and Counseling.
2003;50:247-53.
7. General Medical Council. Seeking patient’s consent. e ethical considera-
tions. Londres: GMC 1999. www.gmc-uk.org
8. Harris R, Lane B, Harris H et al. National confidential enquiry into counsel-
ling for genetic disoders by non-geneticists: general recommendations and speci-
fic standards for improving care. Br J Obstet Gynecol 1999;106:658-63.
9. Lane B, Challen K, Harris HJ, Harris R. Existence and quality of written
antenatal screening policies in the United Kingdom: postal survey. Br Med J
2001;322(7277):22-3.
10. Gekas J, Gondry J, Mazur S, Cesbron P, epot F. Informed consent to serum
screening for down syndrome: are women given adequate information? Prenat
Diagn 1999;19:1-7.
11. Michie S, Smith D, Marteau TM. Prenatal tests: how are women deciding?
Prenat Diagn 1999;19:743-8.
12. Sadler M. Serum screening for Down’s syndrome: how much do health
professionals know? Br J Obstet Gynecol 1997;104:176-9.
13. Dormandy E, Marteau TM. Uptake of prenatal screening test: the role of health
care professionals’ attitudes towards the test. Prenat Diagn 2004;24:864-8.
14. Goel V, Glazier R, Holzapfel S et al. Evaluating patient’s knowledge of ma-
ternal serum screening. Prenat Diagn 1996;16:425-30.
15. Seror V, Costet N, Aymé S. Dépistage prénatal de la trisomie 21 par mar-
queurs sériques maternels: de l’information à la prise de décision des femmes
enceintes. J Gynecol Obstet Biol Reprod 2000;29:492-500.
16. Goujard J. La mesure de la clarté nucale et le dosage des marqueurs séri-
ques commencent-ils à modifier l’incidence de la trisomie 21 en France? Gynecol
Obstet Fertil 2004;32:496-501.
17. Moutel G et al. L’arrêt Perruche, une occasion de nous interroger sur l’accep-
tation du handicap et sur les rapports entre médecine, justice et société. Presse
Med 2002;31:632-5.
18. Favre R. Dépistage de la trisomie 21. Un consentement éclairé a-t-il été réa-
lisé ? Mémoire de DEA de sciences biologiques et médicales, éthique, déontologie
et responsabilités médicales, 2004. www.ethique.inserm.fr
1
/
4
100%